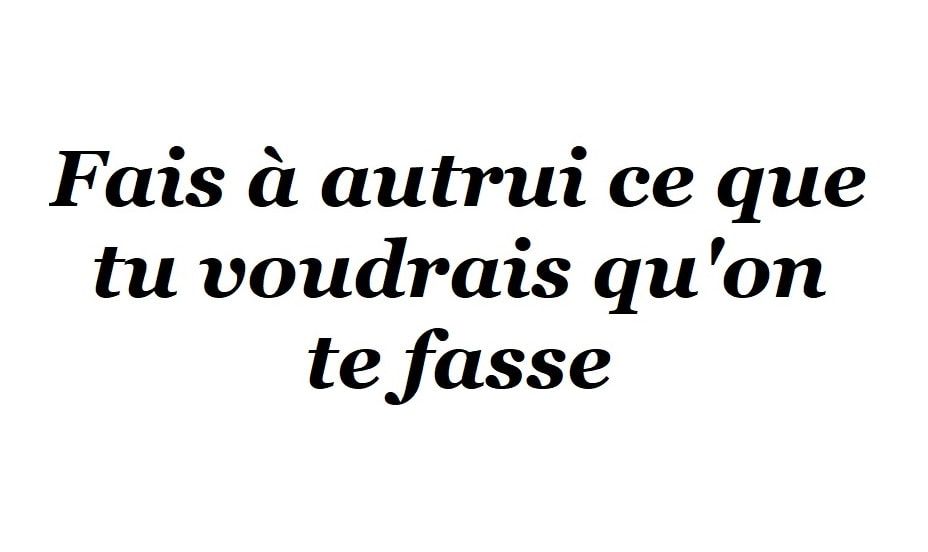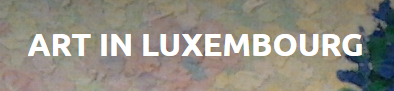|
La majorité des effigies confirmées des derniers Jagellons polono-lituaniens sont des portraits officiels et populaires appartenant à l'école de peinture du Nord. Tout comme aujourd'hui dans certains pays, au XVIe siècle, les gens voulaient avoir chez eux un portrait de leur monarque. Ces effigies étaient souvent idéalisées, simplifiées et inscrites en latin, qui était une langue officielle, à part le ruthène et le polonais, du pays multiculturel. Ils ont fourni la titulature officielle (Rex, Regina), les armoiries et même l'âge (ætatis suæ). Les peintures privées et dédiées à la classe supérieure étaient moins directes. Les peintres opéraient avec un ensemble complexe de symboles, qui étaient clairs à l'époque, mais qui ne sont pas si évidents aujourd'hui.
Depuis le tout début de la monarchie jagellonne en Pologne-Lituanie, l'art s'est caractérisé par le syncrétisme et une grande diversité, ce qu'illustrent le mieux les églises et chapelles fondées par les Jagellon. Ils ont été construits dans un style gothique avec des arcs en ogive et des voûtes d'ogives typiques et décorés de fresques russo-byzantines, rejoignant ainsi les traditions occidentales et orientales. Peut-être que les plus anciens portraits du premier monarque jagellonien - Jogaila de Lituanie (Ladislas II Jagellon) sont ses effigies dans la chapelle gothique de la Sainte Trinité au château de Lublin. Ils ont été commandés par Jogaila et créés par le maître ruthène Andreï en 1418. Sur l'un, le roi était représenté comme un chevalier à cheval et sur l'autre comme un donateur agenouillé devant la Vierge Marie. La voûte était ornée de l'image du Christ pantocrator au-dessus des armoiries des Jagiellon (croix Jagellonne). Des peintures murales similaires ont été créées pour Jogaila par le prêtre orthodoxe Hayl vers 1420 dans le chœur gothique de la cathédrale de Sandomierz et pour son fils Casimir IV Jagellon dans la chapelle Sainte-Croix de la cathédrale de Wawel par des peintres de Pskov en 1470. Le portrait de Jogaila comme l'un des mages dans la chapelle Sainte-Croix mentionnée (Adoration des Mages, section du triptyque de Notre-Dame des Douleurs) est attribué à Stanisław Durink, dont le père est venu de Silésie, et son monument funéraire en marbre dans la cathédrale de Wawel aux artistes du nord de l'Italie. Maîtrisant parfaitement le latin et les autres langues de l'Europe médiévale et de la Renaissance, les Polonais, les Lituaniens, les Ruthènes, les Allemands et d'autres groupes ethniques du pays multiethnique, ont voyagé dans différents pays d'Europe occidentale, donc diverses modes, même les plus étranges, comme les effigies du Christ aux trois visages ou effigies de sainte Wilgeforte barbue et crucifiée, ont facilement pénétré la Pologne-Lituanie. Les portraits déguisés, en particulier les images sous les traits de la Vierge Marie, étaient populaires dans différentes parties de l'Europe depuis au moins le milieu du XVe siècle (par exemple, les portraits d'Agnès Sorel, Bianca Maria Visconti et Lucrezia Buti). Souvent, les dirigeants impopulaires et leurs épouses ou maîtresses étaient représentés comme des membres de la Sainte Famille ou des saints. Cela a naturellement conduit à la frustration et parfois la seule réponse possible était la satire. Le diptyque du peintre flamand anonyme, très probablement Marinus van Reymerswaele, des années 1520 (Musée Wittert à Liège, numéro d'inventaire 12013), faisant référence aux diptyques de Hans Memling, Michel Sittow, Jehan Bellegambe, Jan Provoost, Jan Gossaert et d'autres peintres est évidemment une critique satirique de ces représentations. Au lieu des joues roses d'une « vierge » tenant une fleur d'oeillet rouge, symbole d'amour et de passion, le spectateur curieux verra des joues brunes et un chardon, symbole de la douleur terrestre et du péché. Dans un diptyque de 1487 de Hieronymus Tscheckenburlin du peintre allemand, la vierge rose est remplacée par un squelette en décomposition - memento mori (Kunstmuseum Basel). Parfois aussi, des scènes historiques étaient représentées sous un déguisement mythologique ou biblique ou dans un entourage fantastique. C'est le cas d'un tableau représentant le siège du château de Malbork en 1454 vu de l'ouest - l'un des quatre tableaux de Martin Schoninck, commandés vers 1536 par la Confrérie de Malbork pour être accrochés au-dessus du banc de la Confrérie dans la cour d'Artus à Gdańsk. Pour souligner la victoire de Gdańsk et de la monarchie Jagellonne sur l'Ordre Teutonique, le tableau est accompagné de l'histoire de Judith, une simple femme qui a vaincu un ennemi supérieur, et des effigies du Christ Salvator Mundi et de la Vierge à l'Enfant (perdues pendant la Seconde Guerre mondiale). La popularité des « Métamorphoses » et d’autres œuvres du poète romain Ovide (43 avant J.C. – 17/18 après J.C.) a également contribué à la popularité des portraits déguisés. Le poète vivait parmi les Sarmates, ancêtres légendaires des nobles de Pologne-Lituanie, et était donc considéré comme le premier poète national (comparer « Ovidius inter Sarmatas » de Barbara Hryszko, p. 453, 455). Dans les « Métamorphoses », il traite de la transformation en différents êtres, du déguisement, de l'illusion et de la tromperie, ainsi que de la déification de Jules César et d'Auguste puisque les deux dirigeants font remonter leur lignée à travers Énée jusqu'à Vénus, qui « se frappa son sein des deux mains, et a essayé de cacher César dans un nuage » pour tenter de le sauver des épées des conspirateurs. La Pologne-Lituanie était le pays le plus tolérant de l'Europe de la Renaissance, où dans les premières années de la Réforme, de nombreuses églises servaient simultanément de temples protestants et catholiques. Il n'y a pas de sources connues concernant l'iconoclasme organisé, connu d'Europe occidentale, dans la plupart des cas, des œuvres d'art ont été vendues, lorsque les églises ont été complètement reprises par les dénominations réformées. Les différends sur la nature des images sont restés principalement sur le papier - le prédicateur calviniste Stanisław Lutomirski a qualifié l'icône de Jasna Góra de la Vierge noire de « table d'idolâtrie », « une planche de Częstochowa » qui constituait les portes de l'enfer, et il a décrit l'adoration comme adultère et Jakub Wujek a réfuté les accusations d'iconoclastes, affirmant qu' « ayant jeté les images du Seigneur Christ, ils les remplacent par des images de Luther, Calvin et leurs catins » (d'après « Ikonoklazm staropolski » de Konrad Morawski). Contrairement à d'autres pays où des effigies de « La Madone déchue aux gros seins », des images nues ou à moitié nues de saints ou des portraits déguisés dans des églises et des lieux publics ont été détruits par des foules protestantes, en Pologne-Lituanie, de tels incidents étaient rares. Avant le Grand Iconoclasme, de nombreux temples étaient remplis de nudité et de soi-disant falsum dogma apparus lors du Concile de Trente (vingt-cinquième session du Tridentium, les 3 et 4 décembre 1563), ce qui « ne signifie pas tant une vue hérétique, mais un manque d'orthodoxie du point de vue catholique. L'iconographie devait être nettoyée des erreurs telles que la lasciveté (lascivia), la superstition (superstitio), le charme éhonté (procax venustas), et enfin le désordre et l'insouciance » (d'après « O świętych obrazach » de Michał Rożek). La « nudité divine » de la Rome antique et de la Grèce, redécouverte par la Renaissance, a été bannie des églises, cependant de nombreuses belles œuvres d'art ont été conservées - comme les crucifix nus de Filippo Brunelleschi (1410-1415, Santa Maria Novella à Florence), de Michel-Ange (1492, Église de Santo Spirito à Florence et une autre d'environ 1495, Musée du Bargello à Florence) et par Benvenuto Cellini (1559-1562, Basilique de l'Escorial près de Madrid). La nudité dans le Jugement dernier de Michel-Ange (1536-1541, Chapelle Sixtine) a été censurée l'année suivant la mort de l'artiste, en 1565 (d'après « Michelangelo's Last Judgment - uncensored » de Giovanni Garcia-Fenech). Dans cette fresque presque tout le monde est nu ou à moitié nu. Daniele da Volterra a couvert la nudité la plus controversée des corps nus musclés principalement masculins (les femmes de Michel-Ange ressemblent plus à des hommes avec des seins, car l'artiste avait passé trop de temps avec des hommes pour comprendre la forme féminine), ce qui a valu à Daniele le surnom Il Braghettone, le « faiseur de culottes ». Il a épargné quelques effigies féminines et des scènes manifestement homosexuelles parmi les Justes (deux jeunes hommes s'embrassant et un jeune homme baisant la barbe d'un vieil homme et deux jeunes hommes nus dans un baiser passionné). Les dispositions de Trente atteignirent la Pologne par ordonnances administratives et furent acceptées au synode provincial de Piotrków en 1577. Le synode diocésain de Cracovie, convoqué par l'évêque Marcin Szyszkowski en 1621, traita des questions d'art sacré. Les résolutions du synode ont été un événement sans précédent dans la culture artistique de la République polono-lituanienne. Publiés au chapitre LI (51) intitulé « Sur les images sacrées » (De sacris imaginibus) des Reformationes generales ad clerum et populum ..., ils ont créé des lignes directrices pour le canon iconographique de l'art sacré. Les images saintes ne pouvaient pas avoir de traits de portrait, des images du Adam et Eve nus, sainte Marie-Madeleine à moitié nue ou embrassant une croix dans une tenue obscène et multicolore, sainte Anne aux trois maris, la Vierge Marie peinte ou sculptée dans des vêtements trop profanes, étrangers et indécents doivent être retirés des temples, car ils contiennent de faux dogmes, donnent aux gens simples l'occasion de tomber dans des erreurs dangereuses ou sont contraires à l'Écriture. Cependant, les interdictions n'ont pas été trop respectées, car des représentations de la Sainte Famille, comptant plus de vingt personnes, dont les frères et sœurs du Christ, ont été conservées dans le vaste diocèse de Cracovie (d'après « O świętych obrazach » de Michał Rożek). La Contre-Réforme victorieuse et la Réforme victorieuse ont opposé la luxure éhontée et le charme éhonté et une sorte de paganisme (d'après « Barok : epoka przeciwieństw » de Janusz Pelc, p. 186), mais les responsables de l'église ne pouvaient pas interdire la « nudité divine » des maisons laïques, et les effigies nues de saints étaient encore populaires après le Concile de Trente. Beaucoup de ces peintures ont été acquises par des clients de la République à l'étranger, aux Pays-Bas, à Venise et à Rome, comme, très probablement, la Madone aux gros seins de Carlo Saraceni de la collection Krosnowski (Musée national de Varsovie, M.Ob.1605 MNW). C'était l'époque de la mortalité infantile et maternelle élevée, de la médecine moins développée, du manque de soins de santé publics, où les guerres et les épidémies ravageaient de grandes parties de l'Europe. Par conséquent, la virilité et la fertilité étaient considérées par beaucoup comme un signe de la bénédiction de Dieu (d'après « Male Reproductive Dysfunction », éd. Fouad R. Kandeel, p. 6). En 1565, Flavio Ruggieri de Bologne, qui accompagnait Giovanni Francesco Commendone, légat du pape Pie IV en Pologne, décrivit le pays dans le manuscrit conservé à la Bibliothèque vaticane (Ex codice Vatic. inter Ottobon. 3175, n° 36) : « La Pologne est assez bien habitée, surtout la Mazovie, dans d'autres parties il y a aussi des villes et des villages denses, mais tous en bois, comptant jusqu'à 90 000 d'entre eux au total, dont la moitié appartient au roi, l'autre moitié à la noblesse et clergé, les habitants hors noblesse sont un demi-million et quart, c'est-à-dire deux millions et demi de paysans et un million de citadins. [...] Même les artisans parlent le latin, et il n'est pas difficile d'apprendre cette langue, car dans chaque ville, dans presque chaque village, il y a une école publique. Ils s'approprient les coutumes et la langue des nations étrangères avec une facilité indescriptible, et de tous les pays transalpins, ils apprennent le plus les coutumes et la langue italienne, qui est très utilisée et appréciée par eux ainsi que le costume italien, notamment à la cour. Le costume national est presque le même que celui des Hongrois, mais ils aiment s'habiller différemment, ils changent souvent de robe, ils changent même plusieurs fois par jour. Depuis que la reine Bona de la maison des Sforza, la mère du roi actuel, a introduit la langue, les vêtements et de nombreuses autres coutumes italiennes, certains seigneurs ont commencé à construire dans les villes de Petite-Pologne et de Mazovie. La noblesse est très riche. [...] Seuls les citadins, les juifs, les arméniens et les étrangers, allemands et italiens font du commerce. La noblesse ne vend que son propre grain, qui est la plus grande richesse du pays. Flotté dans la Vistule par les rivières qui s'y jettent, il longe la Vistule jusqu'à Gdańsk, où il est déposé dans des greniers intentionnellement construits dans une partie séparée de la ville, où le garde ne permet à personne d'entrer la nuit. Le grain polonais alimente presque tous les Pays-Bas du roi Philippe, même les navires portugais et d'autres pays viennent à Gdańsk pour le grain polonais, où vous en verrez parfois 400 et 500, non sans surprise. Le grain lituanien longe le Niémen jusqu'à la mer Baltique. Le grain podolien, qui, comme on l'a dit, périt misérablement, pourrait être flotté sur le Dniestr jusqu'à la mer Noire, et de là à Constantinople et Venise, ce qui est actuellement envisagé selon le plan donné par le cardinal Kommendoni [vénitien Giovanni Francesco Commedone]. Outre les céréales, la Pologne fournit aux autres pays du lin, du chanvre, des peaux de boeuf, du miel, de la cire, du goudron, de la potasse, de l'ambre, du bois pour la construction navale, de la laine, du bétail, des chevaux, des moutons, de la bière et de l'herbe de teinture. Ils importent d'autres pays des soieries bleues coûteuses, des étoffes, du lin, des tapisseries, des tapis, de l'Orient des pierres précieuses et des bijoux, de Moscou, des zibelines, des lynx, des ours, des hermines et d'autres fourrures qui manquent en Pologne, ou pas autant que leurs habitants en ont besoin pour se protéger du froid ou pour le glamour. [...] Le roi délibère sur toutes les affaires importantes avec le sénat, bien qu'il ait une voix ferme, la noblesse, comme on l'a dit, a tellement resserré son pouvoir qu'il lui en reste peu » (d'après « Relacye nuncyuszow apostolskich ... » d'Erazm Rykaczewski, p. 125, 128, 131, 132, 136). Marcin Kromer (1512-1589), prince-évêque de Warmie, dans son « Pologne ou sur la géographie, la population, les coutumes, les offices et les affaires publiques du royaume de Pologne en deux volumes » (Polonia sive de situ, populis, moribus, magistratibus et Republica regni Polonici libri duo), publié pour la première fois à Cologne en 1577, soulignait que « presque à notre époque, les marchands et artisans italiens atteignaient aussi les villes les plus importantes ; de plus, la langue italienne se fait entendre de temps en temps de la bouche des Polonais plus éduqués, parce qu'ils aiment voyager en Italie ». Il a également déclaré que « même au centre même de l'Italie, il serait difficile de trouver une telle multitude de personnes de toutes sortes avec lesquelles on pourrait communiquer en latin » et quant au système politique, il a ajouté que « la République de Pologne n'est pas très différente […] de la République de Venise contemporaine » (d'après « W podróży po Europie » de Wojciech Tygielski, Anna Kalinowska, p. 470). Mikołaj Chwałowic (décédé en 1400), appelé le diable de Venise, un noble des armoiries de Nałęcz, mentionné comme Nicolaus heres de Wenacia en 1390, aurait nommé son domaine près de Żnin et Biskupin où il a construit un magnifique château - Wenecja (Wenacia, Veneciae, Wanaczia, Weneczya, Venecia), après son retour de ses études dans la « Reine de l'Adriatique ». Le pays était formé de deux grands États - le Royaume de Pologne et le Grand-Duché de Lituanie, mais c'était un pays multiethnique et multiculturel avec une importante communauté italienne dans de nombreuses villes. Les habitants l'appelaient le plus souvent en latin simplement Res Publicae (République) ou Sarmatie (comme les Grecs, les Romains et les Byzantins de l'antiquité tardive appelaient les grands territoires d'Europe centrale), plus littéraire et par noblesse. La nationalité n'était pas considérée dans les termes d'aujourd'hui et était plutôt fluide, comme dans le cas de Stanisław Orzechowski, qui se dit soit ruthène (Ruthenus / Rutheni), roxolanien (Roxolanus / Roxolani) ou d'origine ruthène, nation polonaise (gente Ruthenus, natione Polonus / gente Roxolani, natione vero Poloni), publié dans ses In Warszaviensi Synodo provinciae Poloniae Pro dignitate sacerdotali oratio (Cracovie, 1561) et Fidei catholicae confessio (Cologne, 1563), très probablement pour souligner son origine et son attachement à la République. Le rôle des femmes dans la société polono-lituanienne à la Renaissance se reflète dans une littérature féminine distincte, qui a ses débuts dans l'anonyme « Senatulus, ou le conseil des femmes » (Senatulus to jest sjem niewieści) de 1543 et surtout le « Parlement des femmes » (Syem Niewiesci) de Marcin Bielski, écrit en 1566-1567. L'idée dérive du satirique Senatus sive Gynajkosynedrion d'Erasme de Rotterdam, publié en 1528, qui provoqua une vague d'imitations en Europe. L'ouvrage de Bielski apporte cependant tout un tas d'articles proposés par des femmes mariées, des veuves et des femmes célibataires à faire passer au Sejm, qui n'ont pas d'équivalent dans l'oeuvre d'Erasme. Il n'y a presque pas de contenu satirique, ce qui est le cœur de l'oeuvre d'Erasme voulant pointer les défauts des femmes. L'élément principal du travail de Bielski est la critique des hommes (d'après « Aemulatores Erasmi?... » de Justyna A. Kowalik, p. 259). Les femmes pointent l'inefficacité du pouvoir des hommes sur le pays et leur manque de souci du bien commun de la République. Leurs arguments sur le rôle des femmes dans le monde sont basés sur la tradition ancienne, quand les femmes non seulement conseillaient les hommes, mais aussi gouvernaient et combattaient pour leur propre compte. Ce travail a provoqué toute une série de brochures consacrées aux questions féminines, dans lesquelles, cependant, l'accent a été davantage mis sur la discussion des vêtements féminins - « Réprimande de la tenue extravagante des femmes » (Przygana wymyślnym strojom białogłowskim) de 1600 ou « Parlement des filles » (Sejm panieński) de Jan Oleski (pseudonyme), publié avant 1617. Des auteurs comme Klemens Janicki (1516-1543), Mikołaj Rej (1505-1569), Krzysztof Opaliński (1609-1655) et Wacław Potocki (1621-1696), ont condamné la variabilité des costumes comme un vice national (d'après « Aemulatores Erasmi? ... », p. 253) et index des livres interdits de l'évêque Marcin Szyszkowski de 1617 interdit un grand nombre de textes humoristiques, divertissants, souvent obscènes, empreints d'érotisme ambigu, et pour ces raisons condamnés par la contre-réforme et le nouveau modèle de culture. Plus tard, en 1625, dans son « Votum sur l'amélioration de la République » (Votvm o naprawie Rzeczypospolitey), Szymon Starowolski s'insurgea contre les femmes italiennes ou italianisées gâchant la jeunesse, la mollesse des hommes et leur réticence à défendre les terres orientales contre les invasions : « Lui, que les courtisanes italiennes caressées ont élevé dans des oreillers, s'emmêlant de leurs douces paroles et de leurs délicatesses, il ne supporte pas les épreuves avec nous ». La grande diversité des costumes remonte au moins de l'époque de Sigismond I. Janicki dans son poème « Sur la variété et l'inconstance de la robe polonaise » (In poloni vestibus varietatem et inconstanciam) décrit le roi Ladislas Jagellon sortant de la tombe et incapable de reconnaître les Polonais et Mikołaj Rej dans sa « Vie de l'homme honnête » (Żywot człowieka poczciwego), publié en 1568, écrit sur « les inventions italiennes et espagnoles élaborées, ces étranges manteaux [...] il ordonnera au tailleur de lui faire ce qu'ils portent aujourd'hui. Et j'entends aussi dans d'autres pays, quand il vous arrive de peindre [décrire] chaque nation, alors ils peignent un Polonais nu et mettent le tissu devant lui avec des ciseaux, coupez-vous comme vous daignez ». L'écrivain polonais d'origine vénitienne Alessandro Guagnini dei Rizzoni (Aleksander Gwagnin) attribue cela à l'habitude des Polonais de visiter les pays les plus éloignés et les plus divers, d'où des costumes et des coutumes étrangers ont été apportés dans leur patrie - « On peut voir en Pologne, des costumes de diverses nations, en particulier italienne, espagnole et hongroise, ce qui est plus courant que d'autres » (d'après « Obraz wieku panowania Zygmunta III ... » de Franciszek Siarczyński, p. 71). Des œuvres d'art ont été commandées aux meilleurs maîtres d'Europe - argenterie et bijoux à Nuremberg et Augsbourg, peintures et tissus à Venise et en Flandre, armures à Nuremberg et Milan et autres centres. Pour les tapisseries représentant le Déluge (environ 5 pièces) commandées en Flandre par Sigismond II Auguste au début des années 1550, considérées comme l'une des plus belles d'Europe, le roi paya la somme faramineuse de 60 000 (ou 72 000) ducats. Plus d'un siècle plus tard, en 1665, leur valeur était estimée à 1 million de florins, tandis que la terre de Żywiec à 600 000 thalers et le palais de Casimir à Varsovie, richement équipé, à 400 000 florins (d'après « Kolekcja tapiserii... » de Ryszard Szmydki, p 105). Ce n'était qu'une petite partie de la riche collection d'étoffes des Jagellon, dont certaines furent également acquises en Perse (comme les tapis achetés en 1533 et 1553). Faits de soie précieuse et tissés d'or, ils étaient beaucoup plus appréciés que les peintures. « Le prix moyen d'un petit tapis sur le marché vénitien du XVIe siècle était d'environ 60 à 80 ducats, ce qui équivalait au prix d'un retable commandé à un peintre célèbre ou même d'un polyptyque entier d'un maître moins connu » (après « Jews and Muslims Made Visible ... », p. 213). En 1586, le tapis d'occasion à Venise coûtait 85 ducats et 5 soldi et les tentures murales achetées à des marchands flamands 116 ducats, 5 lires et 8 soldi (d'après « Marriage in Italy, 1300-1650 », p. 37). À cette époque, en 1584, le Tintoret ne fut payé que 20 ducats pour un grand tableau d'Adoration de la Croix (275 x 175 cm) avec 6 personnages pour l'église de San Marcuola et 49 ducats en 1588 pour un retable montrant saint Léonard avec plus de 5 personnages pour la Basilique Saint-Marc de Venise. En 1564, Titien informa le roi Philippe II d'Espagne qu'il devrait payer 200 ducats pour une réplique autographe du Martyre de saint Laurent, mais qu'il pouvait en avoir une à l'atelier pour seulement 50 ducats (d'après « Tintoretto ... » par Tom Nichols, p. 89, 243). La moindre valeur des peintures signifiait qu'elles n'étaient pas mises en évidence dans les inventaires et la correspondance. Les collections royales en Espagne n'ont été en grande partie pas affectées par les conflits militaires majeurs, de sorte que de nombreuses peintures ainsi que des lettres connexes ont été conservées. Peut-être ne savons-nous jamais combien de lettres Titien a envoyées aux monarques de Pologne-Lituanie, le cas échéant. Lorsque la Pologne a retrouvé son indépendance en 1918 et a rapidement commencé à reconstruire les intérieurs dévastés du château royal de Wawel, il n'y avait aucune effigie de monarque à l'intérieur (peut-être à l'exception d'un portrait d'un empereur d'Autriche au pouvoir, car le bâtiment servait à l'armée). En 1919, la collecte systématique des collections de musée pour Wawel a commencé (d'après « Rekonstrukcja i kreacja w odnowie Zamku na Wawelu » de Piotr M. Stępień, p. 39). La pratique consistant à créer des portraits pour des clients des territoires de la Pologne actuelle à partir de dessins d'étude peut être attestée depuis au moins le début du XVIe siècle. Le plus ancien connu est le soi-disant « Livre des effigies » (Visierungsbuch), perdu pendant la Seconde Guerre mondiale. Il s'agissait d'une collection de dessins préparatoires représentant les ducs de Poméranie, qui étaient liés aux Jagellon, principalement par l'atelier de Cranach. Parmi les plus anciens figuraient des portraits de Bogislav X (1454-1523), duc de Poméranie et de sa belle-fille Amélie du Palatinat (1490-1524) par le cercle d'Albrecht Dürer, créés après 1513. Tous ont probablement été réalisés par des membres de l'atelier envoyés en Poméranie ou moins probablement par des artistes locaux et rendus aux mécènes avec des effigies prêtes. A l'occasion du partage de la Poméranie en 1541 avec son oncle le duc Barnim XI (IX), le duc Philippe Ier commande un portrait à Lucas Cranach le Jeune. Ce portrait, daté en haut à gauche, est aujourd'hui au Musée national de Szczecin, tandis que le dessin préparatoire, précédemment attribué à Hans Holbein le Jeune ou à Albrecht Dürer, est au Musée des Beaux-Arts de Reims. Un monogramiste I.S. de l'atelier de Cranach a utilisé le même ensemble de dessins d'étude pour créer un autre portrait similaire du duc, maintenant dans le Kunstsammlungen der Veste Coburg. Des études pour les portraits de la princesse Marguerite de Poméranie (1518-1569) et d'Anne de Brunswick-Lunebourg (1502-1568), épouse de Barnim XI (IX), toutes deux datant d'environ 1545, ont été minutieusement décrites par un membre de l'atelier envoyé en Poméranie pour les créer en indiquant les couleurs, les tissus, les formes pour faciliter le travail dans l'atelier de l'artiste. Sans aucun doute, sur la base de dessins similaires, l'atelier de Cranach a créé des miniatures des Jagiellon au musée Czartoryski. Dans les années 1620, un peintre de la cour de Sigismond III Vasa a créé des dessins ou des miniatures après quoi Pierre Paul Rubens a créé le portrait du roi (collection Heinz Kisters à Kreuzlingen), très probablement dans le cadre d'une série. Le même peintre de la cour a peint le portrait en pied de Sigismond au palais de Wilanów. Entre 1644 et 1650 Jonas Suyderhoef, un graveur hollandais, actif à Haarlem, réalise une estampe à l'effigie de Ladislaus IV Vasa d'après un tableau de Pieter Claesz. Soutman (P. Soutman Pinxit Effigiavit et excud / I. Suÿderhoef Sculpsit) et à cette époque Soutman, également actif à Haarlem, a créé un dessin similaire à l'effigie du roi (Albertina à Vienne). Après le déluge destructeur (1655-1660), le pays se redresse lentement et les commandes étrangères les plus importantes sont principalement l'argenterie, dont un grand aigle polonais en argent, base héraldique de la couronne royale, créée par Abraham I Drentwett et Heinrich Mannlich à Augsbourg, très probablement pour le couronnement de Michel Korybut Wiśniowiecki en 1669, aujourd'hui au Kremlin de Moscou. Les commandes étrangères de portraits ont repris de manière plus significative sous le règne de Jean III Sobieski. Des peintres français tels que Pierre Mignard, Henri Gascar et Alexandre-François Desportes (un bref séjour en Pologne, entre 1695 et 1696), actifs principalement à Paris, sont fréquemment crédités comme auteurs de portraits des membres de la famille Sobieski. Le peintre néerlandais Adriaen van der Werff, doit avoir peint le portrait de 1696 d'Edwige-Élisabeth de Neubourg, épouse de Jacques-Louis Sobieski, à Rotterdam ou Düsseldorf, où il était actif. Le même Jan Frans van Douven, actif à Düsseldorf à partir de 1682, qui réalisa plusieurs effigies de Jacques-Louis et de sa femme. Dans la Bibliothèque de l'Université de Varsovie conservé un dessin préparatoire de Prosper Henricus Lankrink ou d'un membre de son atelier d'environ 1676 pour une série de portraits de Jean III (Coninck in Polen conterfeyt wie hy in woonon ...), décrit en néerlandais avec les couleurs et les noms des tissus (violet, wit satin). Lankrink et son studio les ont probablement tous créés à Anvers car son séjour en Pologne n'est pas confirmé. Quelques années plus tard, vers 1693, Henri Gascar, qui après 1680 s'installe de Paris à Rome, peint une apothéose réaliste de Jean III Sobieski entouré de sa famille, représentant le roi, sa femme, leur fille et leurs trois fils. Un graveur français Benoît Farjat, actif à Rome, a réalisé une estampe d'après cette peinture originale qui n'a probablement pas survécu, datée « 1693 » (Romae Superiorum licentia anno 1693) en bas à gauche et signée en latin en haut à droite : « H. Gascar peint, Benoît Farjat gravé » (H. GASCAR PINX. / BENEDICTVS FARIAT SCVLP.). Deux exemplaires d'atelier de ce tableau sont connus - l'un au château de Wawel à Cracovie, et l'autre, probablement d'une dot de Teresa Kunegunda Sobieska, se trouve à la résidence de Munich. Une telle représentation réaliste de la famille doit avoir été basée sur des dessins d'étude créés en Pologne, car le séjour de Gascar en Pologne n'est pas confirmé dans les sources. Le peintre français Nicolas de Largillière, a probablement travaillé à Paris sur le portrait de Franciszek Zygmunt Gałecki (1645-1711), aujourd'hui au Musée national de Schwerin. Aussi l'un des portraits les plus célèbres des collections polonaises - portrait équestre du comte Stanisław Kostka Potocki par Jacques Louis David de 1781 a été créé « à distance ». Un catalogue de collection du palais de Wilanów, publié en 1834, mentionne que le portrait a été achevé à Paris « d'après une esquisse réalisée sur le vif à l'école d'équitation de Naples ». L'un de ces dessins modello ou ricordo se trouve à la Bibliothèque nationale de Pologne (R.532/III). Il en était de même pour les statues et les reliefs avec portraits. Certains des plus beaux exemplaires conservés en Pologne ont été commandés auprès des meilleurs ateliers étrangers. Parmi les plus anciennes et les meilleures figurent les épitaphes en bronze réalisées à Nuremberg par l'atelier de Hermann Vischer le Jeune, Peter Vischer l'Ancien et Hans Vischer à la fin du XVe et au début du XVIe siècle, comme l'épitaphe de Filippo Buonaccorsi, appelé Callimaque à Cracovie, épitaphe d'Andrzej Szamotulski (mort en 1511), voïvode de Poznań, à Szamotuły, tombeau de Piotr Kmita de Wiśnicz et du cardinal Frédéric Jagiellon (mort en 1503), tous deux à la cathédrale du Wawel et tombeau du banquier du roi Sigismond Ier, Seweryn Boner et son épouse Zofia Bonerowa née Bethman à la basilique Sainte-Marie de Cracovie. Vers 1687, le « roi victorieux » Jean III Sobieski commanda de grandes quantités de sculptures à Anvers à l'atelier d'Artus Quellinus II, de son fils Thomas II et de Lodewijk Willemsens et à Amsterdam à l'atelier de Bartholomeus Eggers pour la décoration du palais de Wilanów à Varsovie, dont les bustes du couple royal, aujourd'hui à Saint-Pétersbourg. Toutes ces statues et reliefs étaient basés sur des dessins ou des portraits, peut-être similaires au triple portrait du cardinal de Richelieu, réalisé comme étude pour un buste qui serait réalisé par le sculpteur italien Gian Lorenzo Bernini à Rome. Pour la statue équestre du prince Józef Poniatowski (1763-1813), réalisée entre 1826 et 1832 et inspirée de la statue de Marc Aurèle à Rome, le sculpteur dano-islandais Bertel Thorvaldsen (1770-1844), bien qu'arrivé de Rome à Varsovie, en 1820, dut utiliser d'autres effigies du prince. L'initiatrice de la construction du monument fut Anna Potocka née Tyszkiewicz (1779-1867). Le monument fut confisqué par les autorités russes après l'Insurrection de Novembre (1830-1831) et fut restitué à Varsovie en mars 1922. Après la répression de l'Insurrection de Varsovie, les envahisseurs allemands nazis ordonnèrent de faire sauter la statue le 16 décembre 1944. Un nouveau moulage de la sculpture, réalisé dans les années 1948-1951, fut offert à Varsovie par le Royaume du Danemark. Certaines sources confirment également cette pratique. Lors de son second séjour à Rome, Stanisław Reszka (1544-1600), qui admirait les peintures de Federico Barocci à Senigallia ou l'œuvre de Giulio Romano à Mantoue, achète à nouveau des peintures, des assiettes d'argent et d'or. Il envoie de nombreuses œuvres de ce genre en cadeau en Pologne. A Bernard Gołyński (1546-1599) il envoie des peintures, dont un portrait du roi et sa propre effigie et pour le roi Étienne Bathory un portrait de son neveu. Ces portraits du monarque et de son neveu ont donc été réalisés à Rome ou à Venise à partir de dessins d'étude ou de miniatures que Reszka apportait. A une autre occasion, il envoie au roi huit vases en porcelaine dans un écrin décoratif, acheté à Rome et à Wojciech Baranowski (1548-1615), évêque de Przemyśl, un relief de saint Albert, sculpté en ébène. Par l'intermédiaire du cardinal Ippolito Aldobrandini (futur pape Clément VIII), nonce papal en Pologne entre 1588 et 1589, il envoie des tableaux achetés pour le roi, l'un du Sauveur, brodé « de l'œuvre la plus excellente » et saint Augustin, fait de plumes d'oiseaux, l'image « la plus belle » (pulcherrimum), comme il dit. Au secrétaire royal Rogulski, venu à Rome, il donne un encrier en argent, et le chambellan du chancelier Jan Zamoyski lui confie une pierre précieuse à réparer en Italie, mais auparavant, Reszka a consulté les orfèvres de Cracovie. Tous ces objets, y compris les peintures, devaient être l'œuvre des meilleurs artistes italiens, mais les noms apparaissent rarement dans les sources. En 1584, le neveu du roi Étienne, André Bathory, avec ses compagnons, acheta et commanda de nombreux objets exquis à Venise, notamment des draps d'or avec des armoiries, des cuirs gaufrés et dorés dits de Cordoue, fabriqués par l'orfèvre Bartolomeo del Calice. Une autre fois, il acheta « 12 bols, 16 orbes d'argent » (12 scudellas, orbes 16 argenteos) à Mazziola et supervisa l'artiste travaillant à l'exécution de « vases en verre » (vasorum vitreorum). A Rome, ils rendent visite à un certain Giacomo l'Espagnol pour voir les « merveilles de l'art » (mirabilia artis), où Bathory a probablement acheté les bibelots et les beaux tableaux, montrés plus tard aux délégués de l'abbaye de Jędrzejów. Des visiteurs de Pologne-Lituanie ont donné et reçu de nombreux cadeaux de valeur. En 1587, le Sénat vénitien, par l'intermédiaire de deux citoyens importants, offrit au cardinal André Bathory, venu en tant qu'envoyé de la République polono-lituanienne avec l'annonce de l'élection de Sigismond III, deux bassins et cruches en argent, quatre plateaux et six candélabres « du beau travail » (pulchri operis). Le pape donne deux médailles à son image à Rogulski et une chaîne en or au cardinal Aldobrandini. Après son retour en Pologne, le cardinal Bathory donne à la reine Anna Jagellon une croix de corail, reçue du cardinal Borromée, et une boîte de nacre (ex madre perla), recevant en retour une belle bague chère. De nombreux artistes ont également été engagés en Italie pour la République. Le roi Étienne confie à son neveu la mission d'amener à la cour royale des architectes qui maîtrisent l'art de construire des forteresses et des châteaux. Poussé par le roi, Reszka fait des efforts par l'intermédiaire du comte Taso, cependant, quelques mois seulement après son arrivée, il parvient à entrer dans le service royal Leopard Rapini, un architecte romain pour un salaire annuel de 600 florins. De retour en Pologne, Simone Genga, architecte et ingénieur militaire d'Urbino, est admise comme courtisan en présence de l'archevêque de Senigallia. Les Italiens avaient également de nombreuses effigies de monarques polono-lituaniens, dont beaucoup ont été oubliées lorsque la République a cessé d'être une puissance européenne de premier plan après le déluge (1655-1660). Selon les livres de pérégrination de Maciej Rywocki de 1584 à 1587, écrits par le mentor et l'intendant des frères Kryski de Mazovie, au cours de leur voyage de trois ans en Italie pour l'étude et l'éducation, dans la Villa Médicis à Rome, propriété du cardinal Ferdinand, plus tard grand-duc de Toscane, dans la galerie des portraits, il a vu « avec tous les rois polonais et le roi Étienne et la reine [Anna Jagellon] très ressemblant ». Cette effigie de la reine élue de la République, peut-être par un peintre vénitien, ressemblait sans aucun doute aux portraits de sa chère amie Bianca Cappello, une noble dame vénitienne et grande-duchesse de Toscane. Selon Stanisław Reszka, qui fut l'invité de Ferdinand à Florence en 1588, le grand-duc possédait un ritrat (portrait, de l'italien ritratto) du roi Sigismond III Vasa et de son père Jean III de Suède. Reszka lui envoya une carte de la République réalisée sur satin sur laquelle figurait également un portrait de Sigismond III (Posłałem też księciu Jegomości aquilam na hatłasie pięknie drukowaną Regnorum Polonorum, który był barzo wdzięczen. Tam też jest wyrażona twarz Króla Jmci, acz też ma ritrat i Króla Jmci szwedzkiego, a także i Pana naszego) (d'après « Włoskie przygody Polaków ... » d'Alojzy Sajkowski, p. 104). Quelques décennies plus tôt, Jan Ocieski (1501-1563), secrétaire du roi Sigismond Ier, écrivit dans son journal de voyage à Rome (1540-1541) les informations sur un portrait du roi Sigismond, qui était en la possession du cardinal S. Quatuor avec une note extrêmement flatteuse : « c'est un roi comme jamais auparavant » (hic est rex, cui similis non est inventus), et « qui est le roi le plus sage, et le plus expérimenté dans les affaires » (qui est prudentissimus rex et usu tractandarum rerum probatissimus), selon ce cardinal (d'après « Polskie dzienniki podróży ... » de Kazimierz Hartleb, p. 52, 55-57, 67-68). La situation était similaire dans d'autres pays européens. Après la mort de Ladislas IV Vasa en 1648, Francesco Magni (1598-1652), seigneur de Strážnice en Moravie, ordonna que le portrait du monarque polono-lituanien soit déplacé du piano nobile représentatif, une galerie avec des portraits des Habsbourg, ses ancêtres, parents et bienfaiteurs, dans sa chambre privée au deuxième étage du château (d'après « Portrait of Władysław IV from the Oval Gallery ... » de Monika Kuhnke, Jacek Żukowski, p. 75). Les portraits originaux du roi Ladislas IV et de la reine Marie Casimire, d'après lesquels des copies furent réalisées au XVIIIe siècle pour la galerie ancestrale (Ahnengalerie) de la résidence de Munich, étaient considérés comme représentant Charles X Gustave de Suède (CAROLUS X GUSTAVUS) et sa petite-fille Ulrique-Éléonore (1688-1741), reine de Suède (UDALRICA ELEONORA). La destruction massive du patrimoine du République et le chaos de l’après-guerre ont également contribué à de telles erreurs en Pologne. Ainsi, dans la galerie des 22 portraits des rois de Pologne, peints entre 1768 et 1771 par Marcello Bacciarelli pour embellir la salle dite de marbre du château royal de Varsovie, le roi Sigismond II Auguste est Jogaila (VLADISLAUS JAGIELLO, numéro d'inventaire ZKW/2713/ab) et fils d'Anna Jagellon (1503-1547), l'archiduc Charles II d'Autriche (1540-1590) était présenté comme Sigismond II Auguste (SIGISMUNDUS AUGUSTUS, ZKW/2719/ab), selon les descriptions sous les images. Ces portraits sont des copies de peintures de Peter Danckerts de Rij datant d'environ 1643 (Palais de Nieborów, NB 472 MNW, NB 473 MNW, déposées au Château Royal de Varsovie), basées sur des originaux perdus. Pendant le déluge (1655-1660), alors que la situation était désespérée et que beaucoup s'attendaient à ce que les envahisseurs barbares détruisent totalement le Royaume de Vénus - ils ont pillé et incendié la majorité des villes et forteresses de la République et planifié la première partage du pays (traité de Radnot), le roi Jean Casimir Vasa, descendant des Jagellon, s'est tourné vers une femme - la Vierge Marie pour la protéction. A l'initiative de son épouse la reine Marie-Louise de Gonzague dans la ville fortifiée de Lviv en Ruthénie le 1er avril 1656, il proclame la Vierge sa patronne et reine de ses pays (Ciebie za Patronkę moją i za Królowę państw moich dzisiaj obieram). Bientôt, lorsque les envahisseurs furent repoussés, l'icône médiévale byzantine de la Vierge Noire (Hodégétria) de Częstochowa, avec des cicatrices sur le visage, vénérée à la fois par les catholiques et les chrétiens orthodoxes orientaux, et déjà entourée d'un culte, devint la plus sainte de toute la Pologne. Le sanctuaire fortifié de la Vierge Noire à la Montagne Lumineuse (Jasna Góra) fut défendu du pillage et de la destruction par les armées du « brigand de l'Europe » à la fin de 1655, une riza (robe) de style ruthène fut confectionnée pour la Vierge et ornée des plus beaux exemples de bijoux baroques et Renaissance offerts par les pèlerins, parfaite illustration de la culture du pays et de sa diversité. La statue principale de la belle résidence du « roi victorieux » Jean III Sobieski, qui sauva Vienne du pillage et de la destruction en 1683 - le palais de Wilanów, à l'exception du monument équestre prévu du roi, n'était pas la statue de Mars, dieu de la guerre, ni de Apollon, dieu des arts, ni même de Jupiter, roi des dieux, mais de Minerve – Pallas, déesse de la sagesse. Elle a très probablement été réalisée par l'atelier d'Artus Quellinus II à Anvers ou par Bartholomeus Eggers à Amsterdam et placé dans le pavillon supérieur couronnant l'ensemble de la structure. Malheureusement, cette grande statue en marbre, ainsi que bien d'autres, dont des bustes du roi et de la reine, furent pillées par l'armée russe en 1707. Dans « Le Registre des statues en marbre de Carrare et autres objets pris à Willanów en août 1707 » (Connotacya Statui Marmuru Karrarskiego y innych rzeczy w Willanowie pobranych An. August 1707), elle a été décrite comme une « Satue de Pallas [...] dans la fenêtre de la pièce au-dessus de l'entrée du palais, reposant sa main droite sur un bouclier en marbre doré avec l'inscription Vigilando Quiesco [En veillant, je me repose]" (Statua Pallas [...] w oknie salnym nad weysciem do Pałacu podpierayacey ręką prawą o tarczę z Marmuru wyrobioną pozłocistą, na ktorey Napis Vigilando Quiesco). Plus tard, elle décora très probablement le théâtre Kamenny de Saint-Pétersbourg (démoli après 1886), que Johann Gottlieb Georgi décrit dans sa « Description de la capitale impériale russe ... », publiée en 1794 : « Au-dessus de l'entrée principale se trouve l'image d'une Minerve assise en marbre de Carrare, avec ses symboles, et sur le bouclier : Vigilando quiesco". Le fait que rien (ou presque) ne soit conservé ne veut pas dire que rien n'a existé, alors peut-être même le séjour de quelques ou plusieurs grands artistes européens en Pologne-Lituanie est-il encore à découvrir.
Portrait du joaillier royal Giovanni Jacopo Caraglio âgé de 47 ans recevant un médaillon de l'aigle royal polonais avec monogramme du roi Sigismond Auguste (SA) sur sa poitrine par Paris Bordone, 1547-1553, Château Royal de Wawel à Cracovie.
|
Artinpl est un projet éducatif individuel pour partager des connaissances sur les œuvres d'art aujourd'hui et dans le passé en Pologne.
Si vous aimez ce projet, veuillez le soutenir avec n'importe quel montant afin qu'il puisse se développer. © Marcin Latka Catégories
All
Archives
April 2023
|