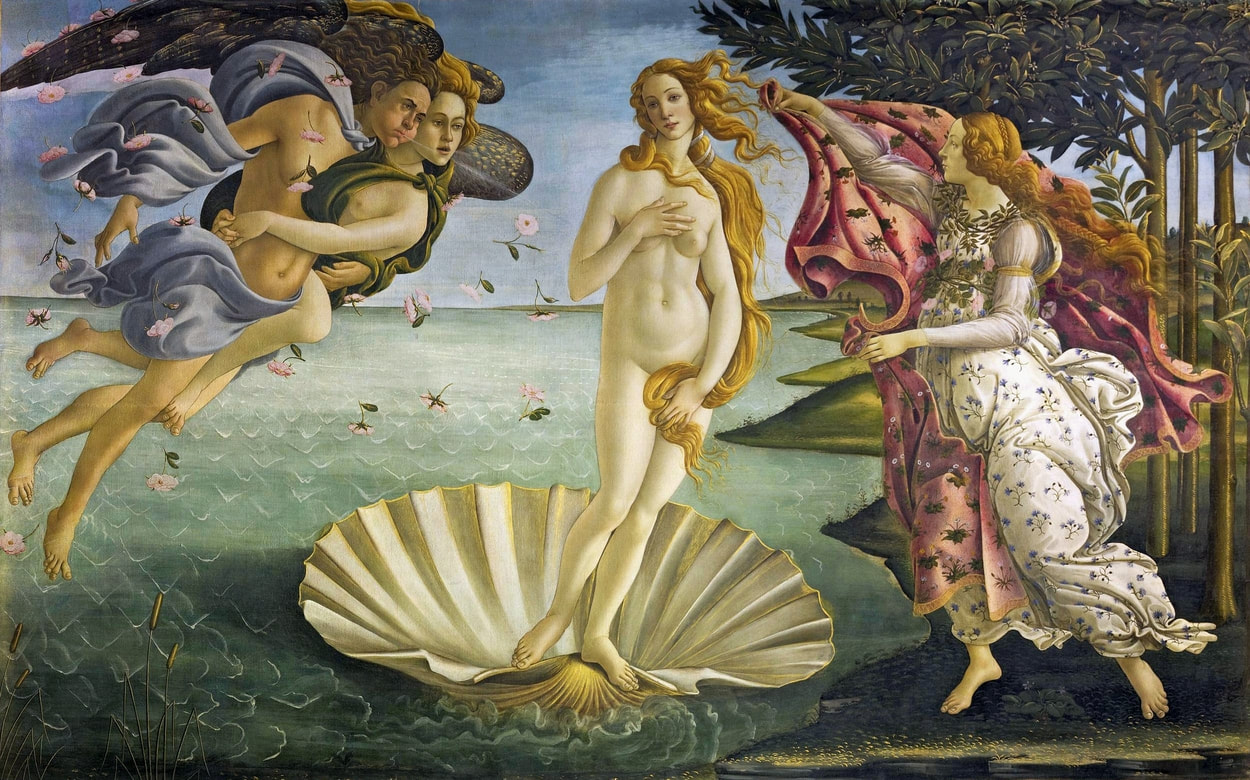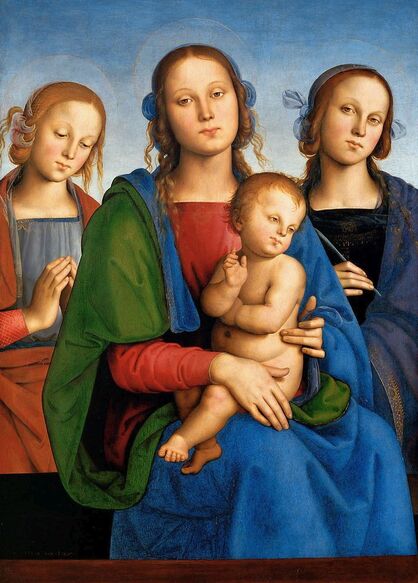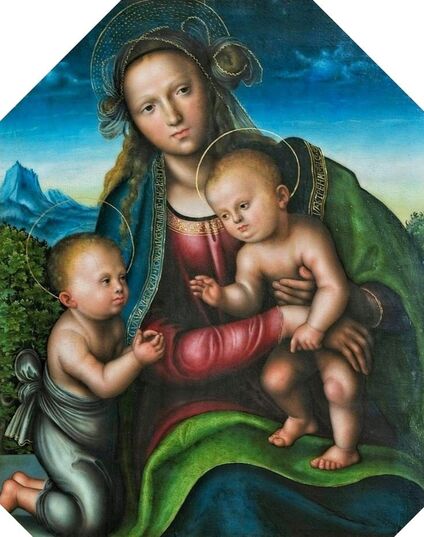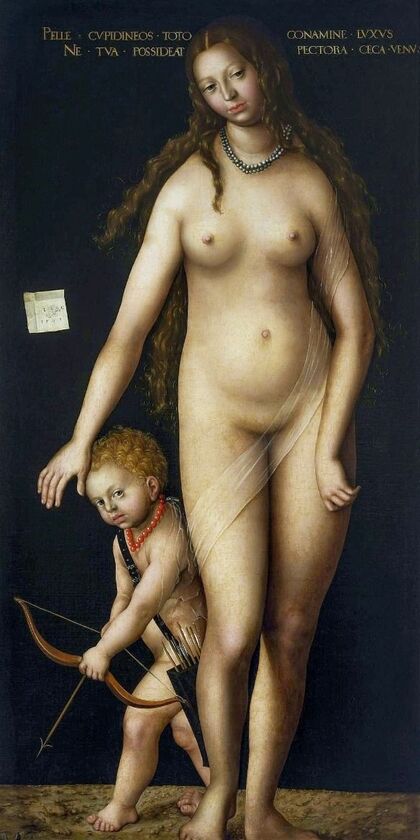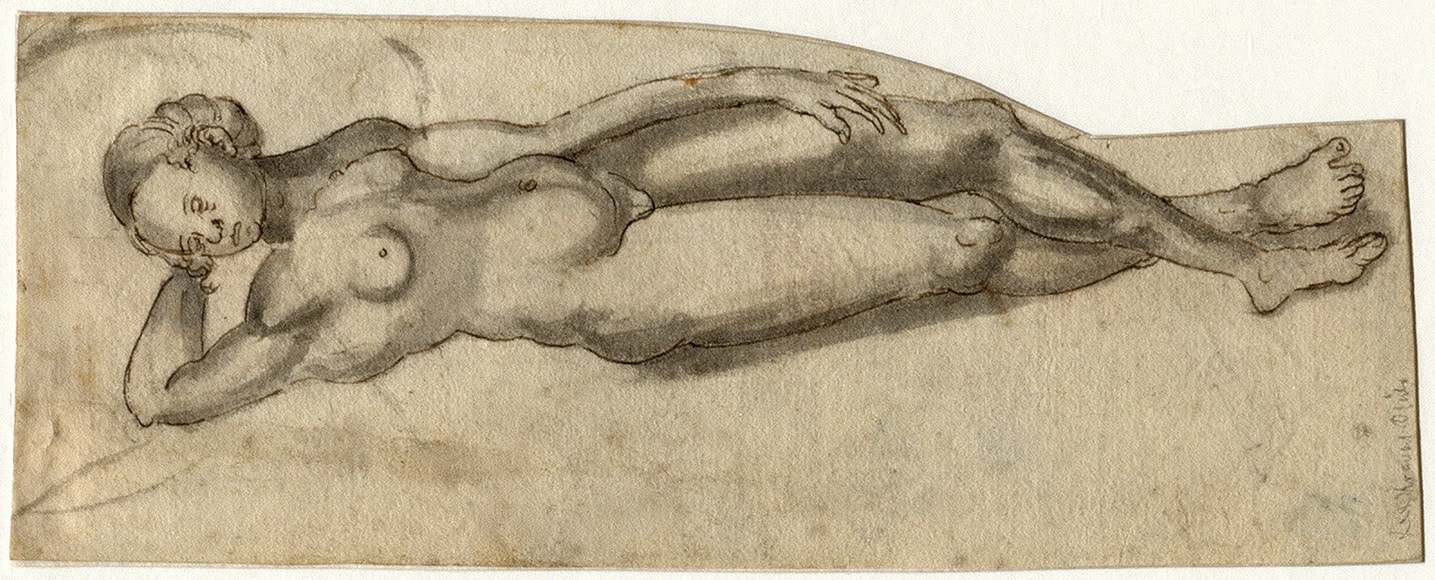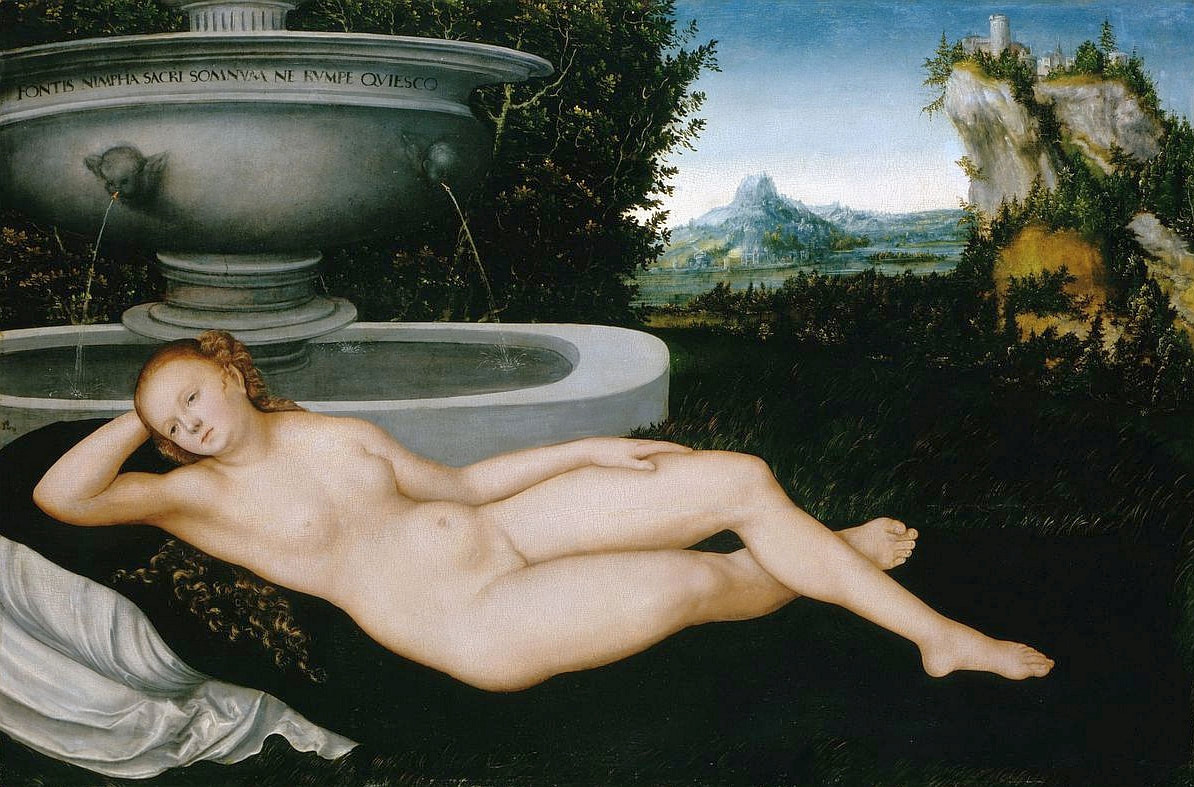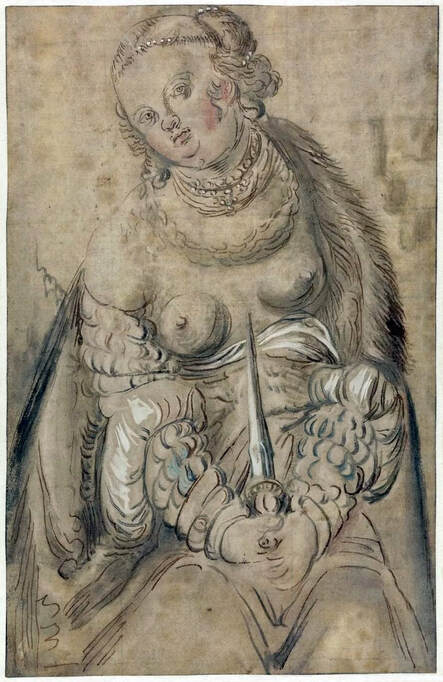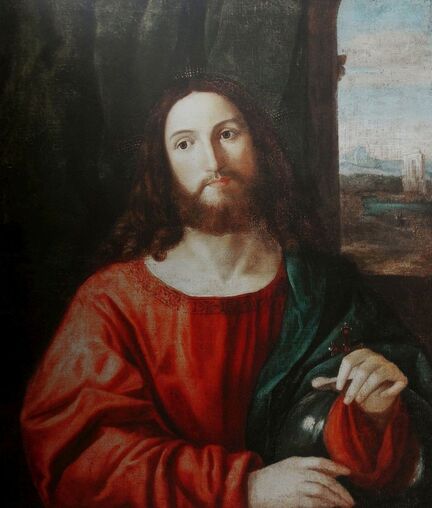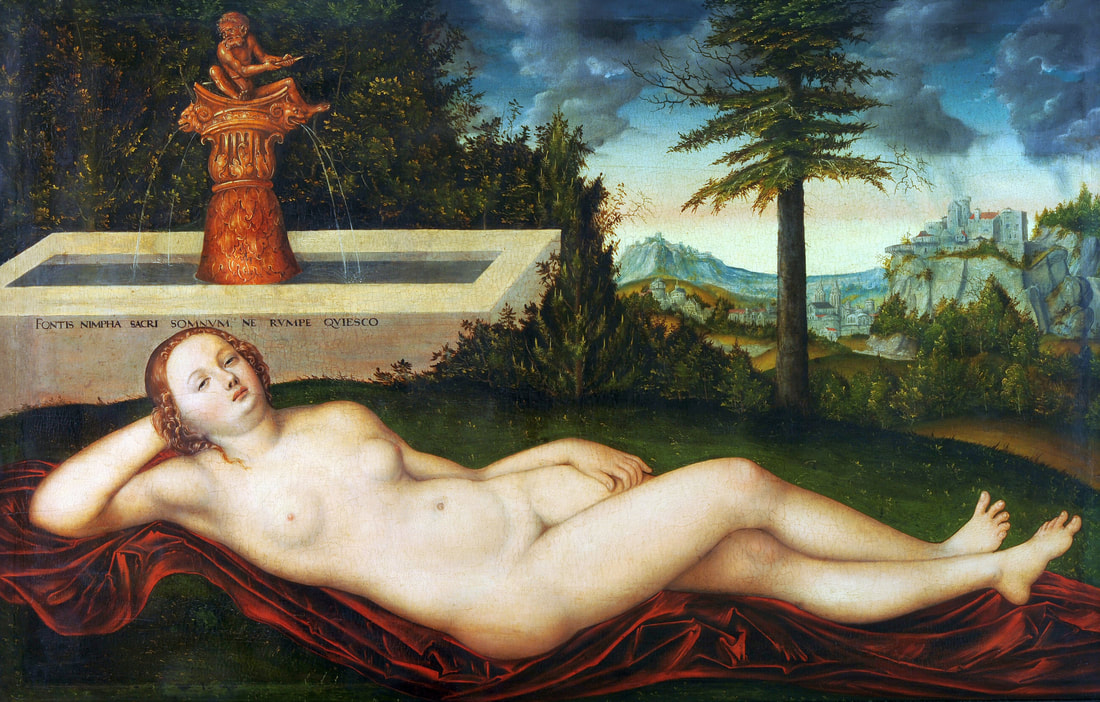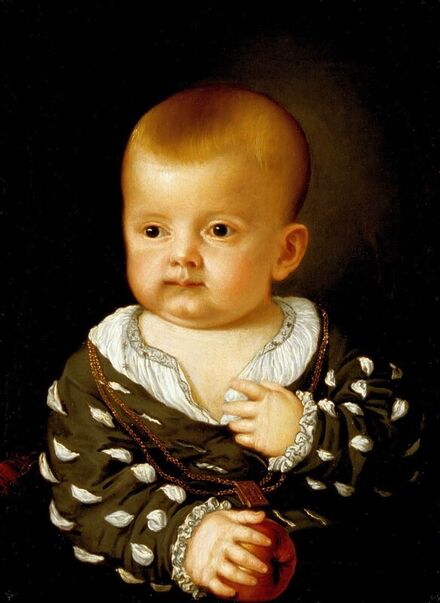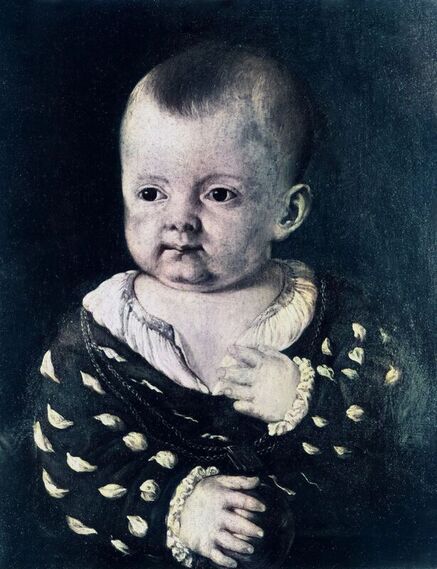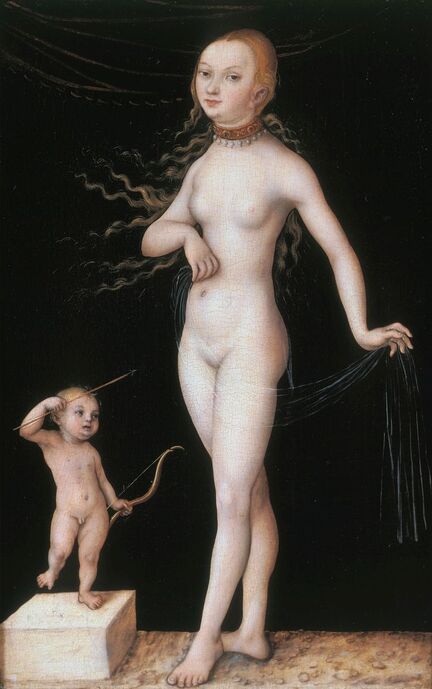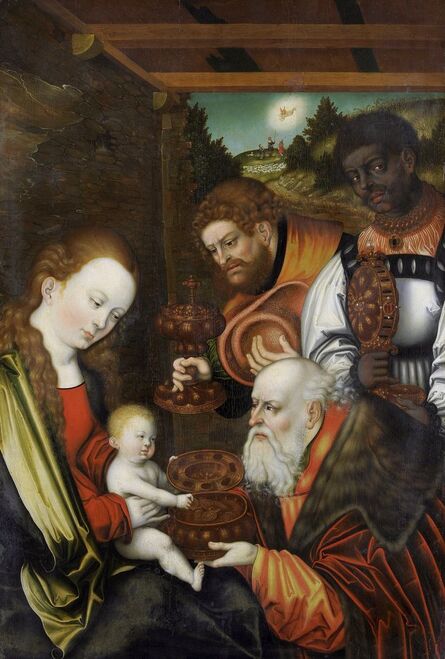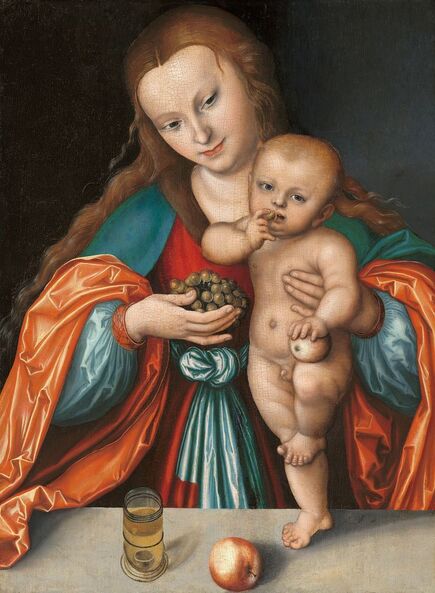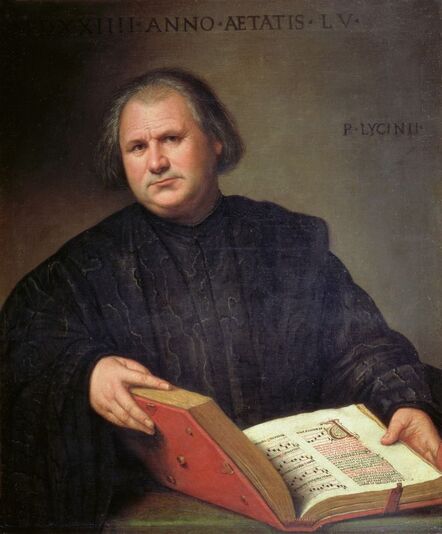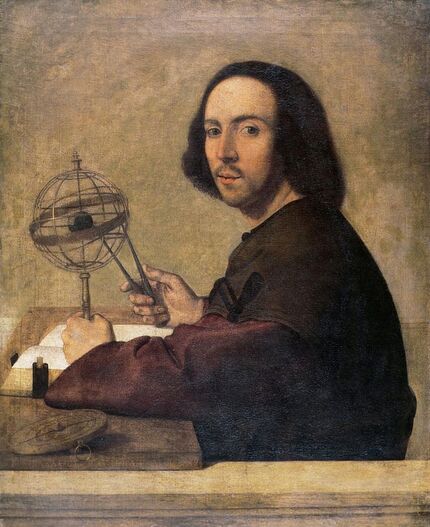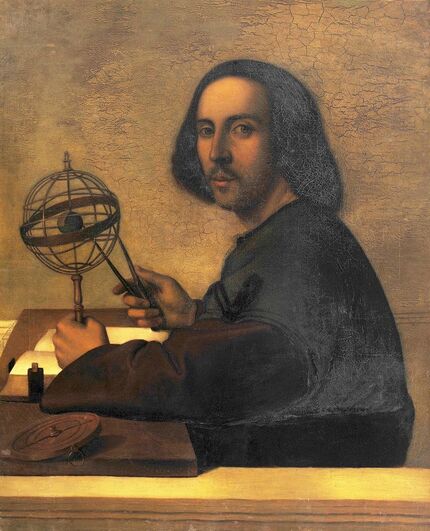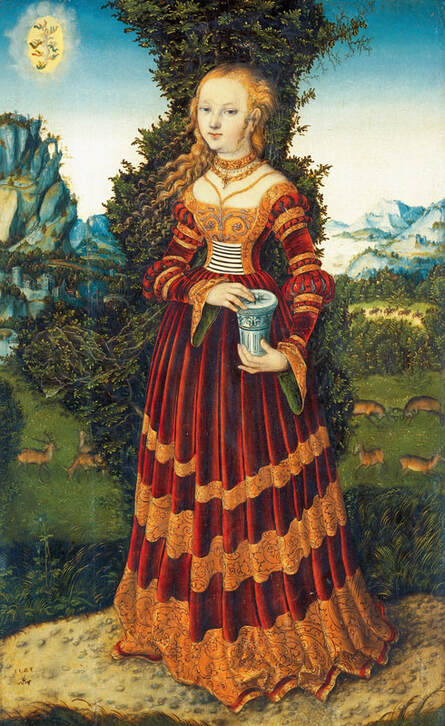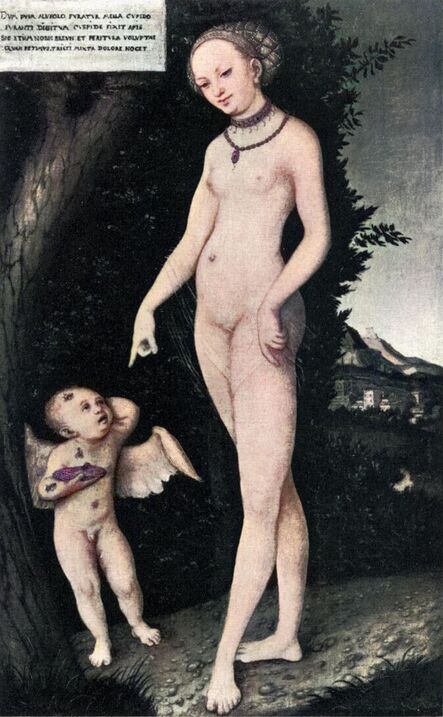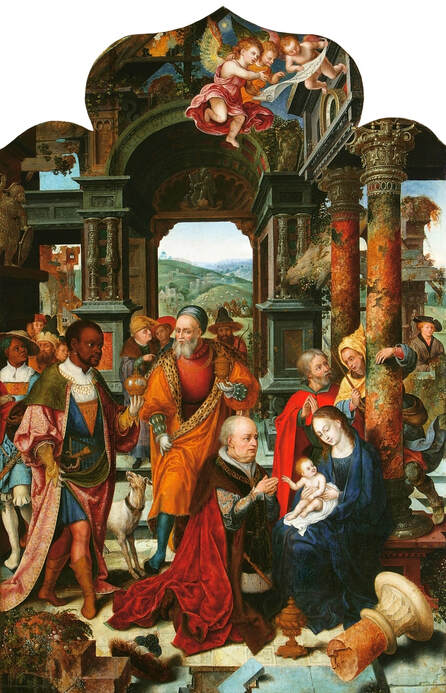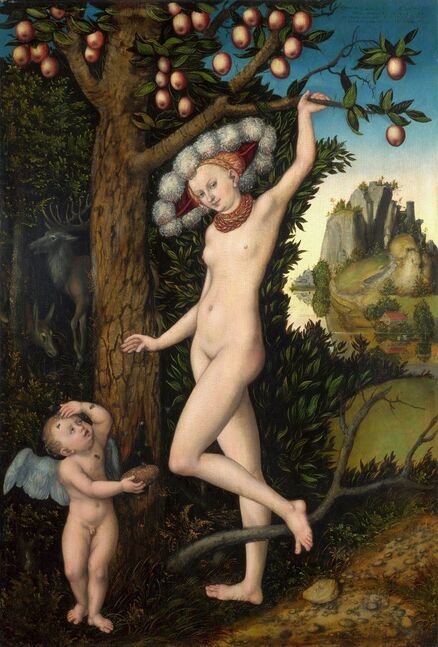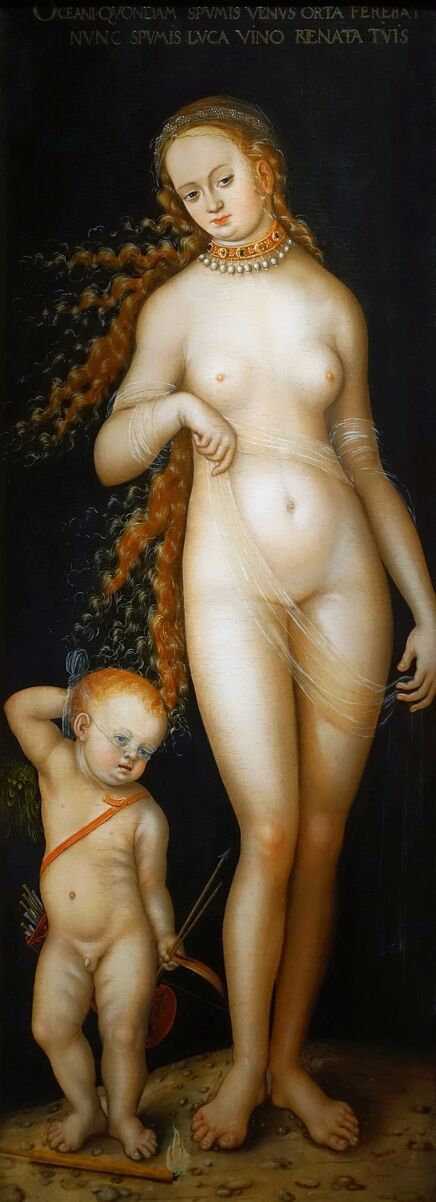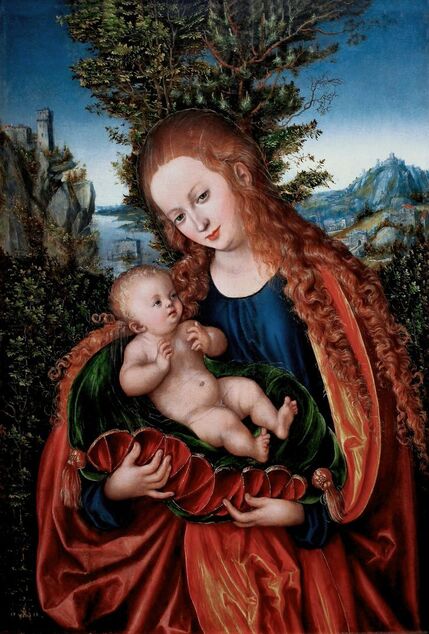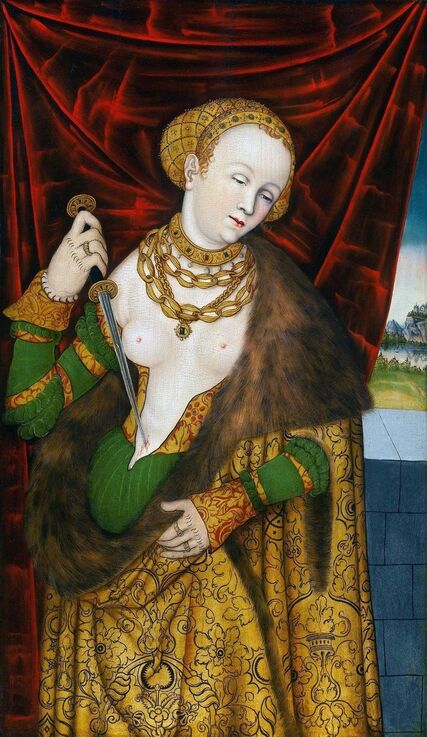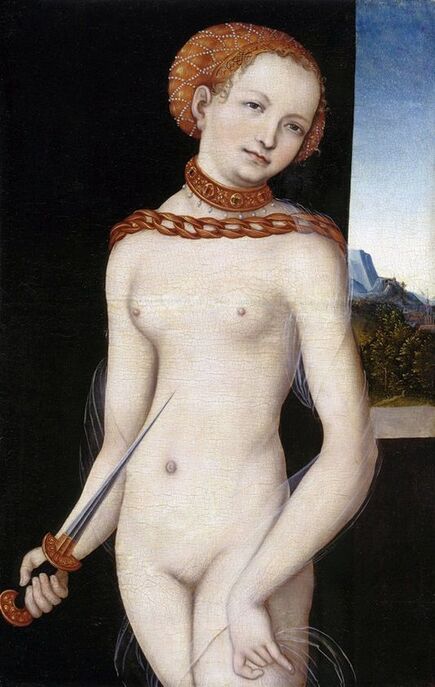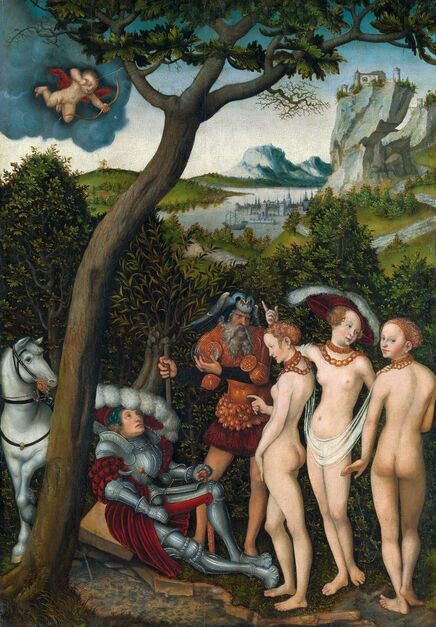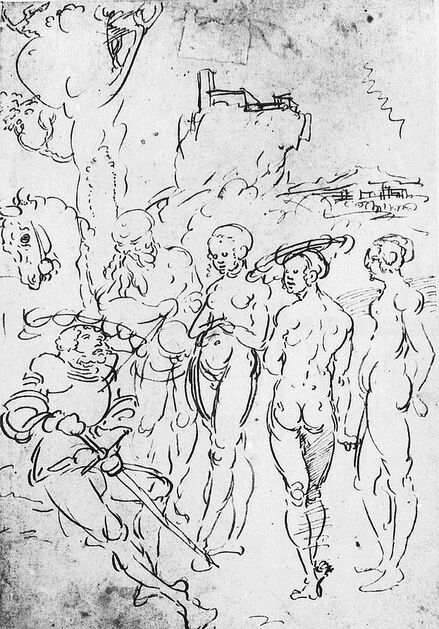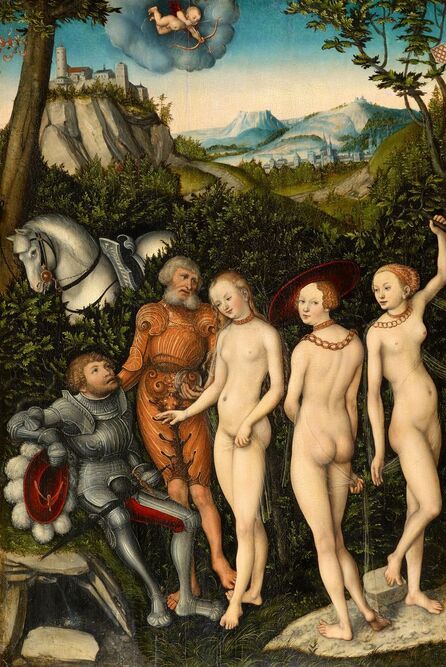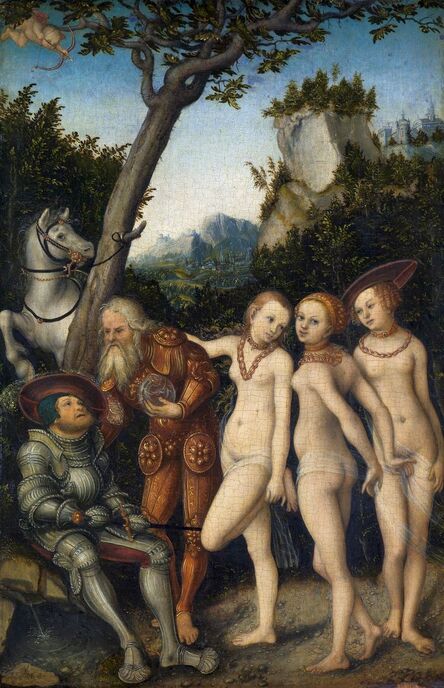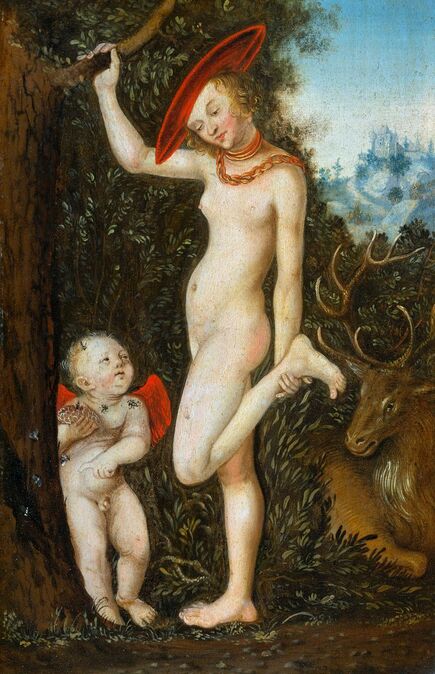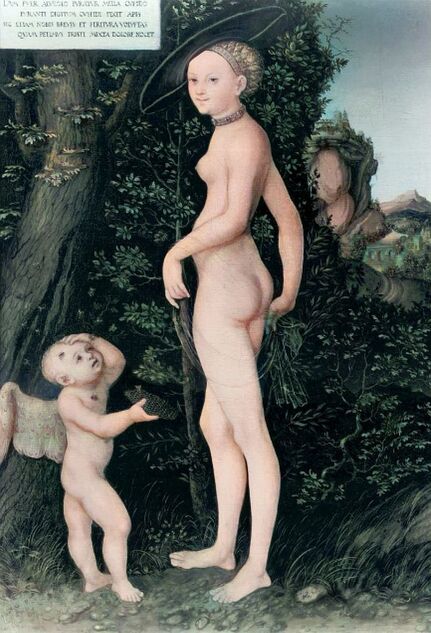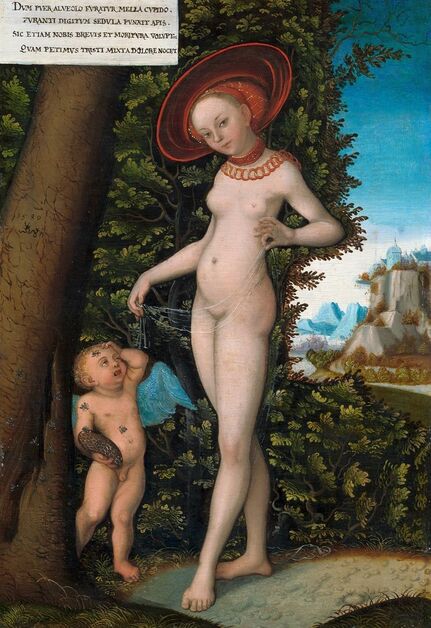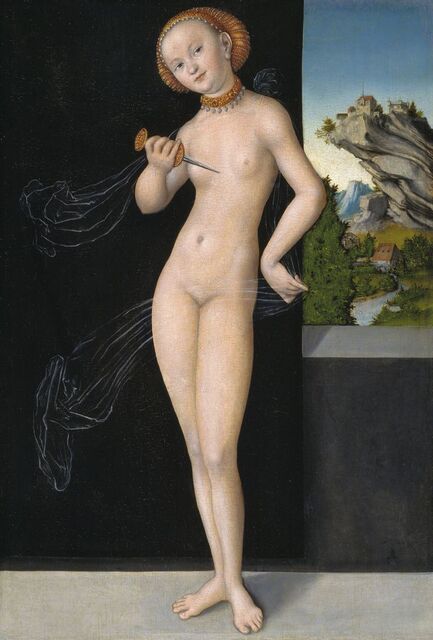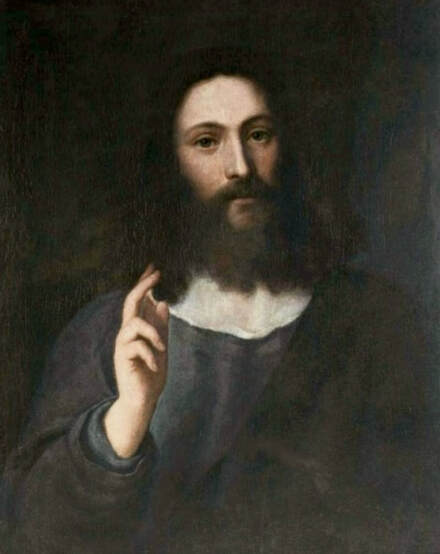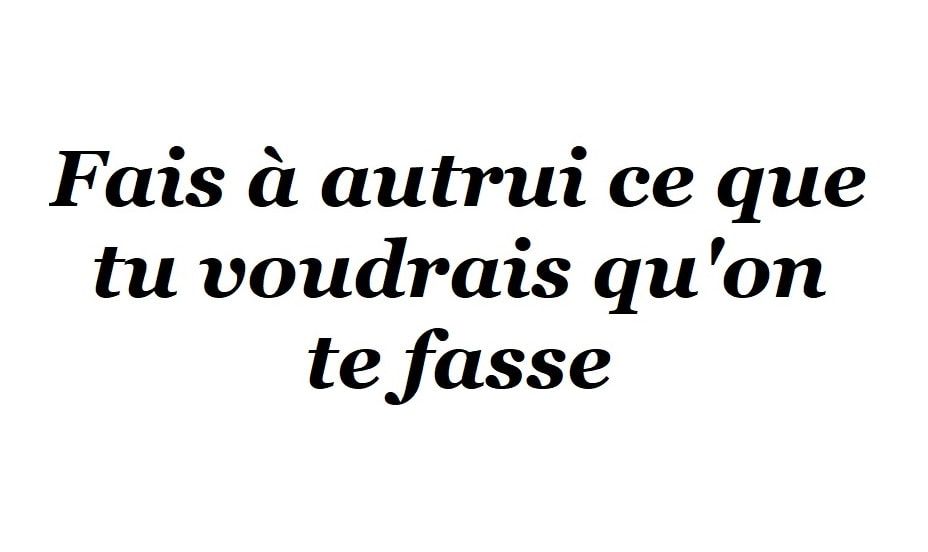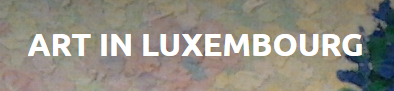|
Portraits de Simonetta Vespucci, Beatrice d'Aragona et Barbara Zapolya en Vénus et en Madone
Vers 850, l'église de Santa Maria Nova (Nouvelle Sainte Marie), a été construite sur les ruines du Temple de Vénus et de Roma entre le bord oriental du Forum Romanum et le Colisée à Rome. Le temple était dédié aux déesses Venus Félix (Vénus porteuse de bonne fortune) et Roma Aeterna (Rome éternelle) et aurait été le plus grand temple de la Rome antique. La Vierge Marie devait désormais être vénérée dans un site antique dédié à l'ancêtre du peuple romain, en tant que mère d'Enée, le fondateur de Rome. Jules César a revendiqué Vénus comme son ancêtre, le dictateur Sylla et Pompée comme leur protectrice. Elle était la déesse de l'amour, de la beauté, du désir, du sexe, de la fertilité, de la prospérité et de la victoire.
En avril 1469, à l'âge de seize ans, une noble génoise Simonetta Cattaneo (1453-1476), mariée à Gênes en présence du Doge et de toute l'aristocratie de la ville Marco Vespucci de la République de Florence, cousin éloigné du navigateur Amerigo Vespucci. Après le mariage, le couple s'installe à Florence. Simonetta devient rapidement populaire à la cour florentine et suscite l'intérêt des frères Médicis, Lorenzo et Giuliano. Lorsqu'en 1475, Giuliano remporta un tournoi de joutes après avoir porté une bannière sur laquelle se trouvait une image de Simonetta en tant que Pallas Athéna, peinte par Sandro Botticelli, sous laquelle se trouvait l'inscription française La Sans Pareille, et il nomma Simonetta en tant que « La Reine de la Beauté » lors de cet événement, sa réputation de beauté exceptionnelle s'est encore accrue. Elle mourut un an plus tard dans la nuit du 26 au 27 avril 1476. Le jour de ses funérailles, elle fut transportée à travers Florence dans un cercueil découvert vêtu de blanc pour que les gens l'admirent une dernière fois et il a peut-être existé un posthume culte à son sujet à Florence. Elle est devenue un modèle pour différents artistes et Botticelli l'a fréquemment représentée sous les traits de Vénus et de la Vierge, les divinités les plus importantes de la Renaissance, qui avaient toutes deux pour symbole des perles et des roses. Parmi les plus belles figurent les peintures du Musée national de Varsovie (tempera sur panneau, 111 x 108 cm, M.Ob.607) et le château de Wawel (tempera sur panneau, 95 cm, ZKWawel 2176) dans lesquelles la Vierge présente ses traits, ainsi que la déesse de la célèbre Naissance de Vénus à la Galerie des Offices à Florence (tempera sur toile, 172,5 x 278,5 cm, 1890 n. 878) et Vénus à la Gemäldegalerie de Berlin (huile sur toile, 158,1 x 68,5 cm, 1124). Elle fut aussi très probablement le modèle de la Vénus de la Galerie Sabauda de Turin (huile sur toile, 176 x 77,2 cm, inv. 172), achetée en 1920 par Riccardo Gualino, ainsi connue sous le nom de Vénus Gualino. Giorgio Vasari, rappelle que des représentations similaires, réalisées dans l'atelier de Botticelli, ont été retrouvées dans diverses maisons florentines. Si la plus grande célébrité de cette époque prêtait son apparence à la déesse de l'amour et à la Vierge, il est plus qu'évident que d'autres dames fortunées souhaitaient être représentées de la même manière. Le 22 décembre 1476, Matthias Corvin, roi de Hongrie, de Bohême et de Croatie, épousa une autre beauté de la Renaissance, Béatrice d'Aragona de Naples, une parente de Bona Sforza, reine de Pologne (le grand-père de Bona, Alphonse II de Naples, était le frère de Béatrice). Matthias était fasciné par sa femme jeune, intelligente et instruite. Son buste en marbre créé par Francesco Laurana dans les années 1470 (The Frick Collection à New York, 1961.2.86) porte l'inscription DIVA BEATRIX ARAGONIA (Divine Béatrice d'Aragon) pour rehausser encore sa beauté lointaine et éthérée. De nombreux Italiens ont suivi Béatrice en Hongrie, parmi lesquels Bernardo Vespucci, frère d'Amerigo, qui a donné son nom à l'Amérique (d'après « The Beauty and the Terror: The Italian Renaissance and the Rise of the West » de Catherine Fletcher, 2020, p. 36). Corvin a commandé des œuvres d'art à Florence et les peintres Filippino Lippi, Attavante degli Attavanti et Andrea Mantegna ont travaillé pour lui. Il a également reçu des œuvres d'art de son ami Lorenzo de 'Medici, comme des reliefs en métal des têtes d'Alexandre le Grand et de Darius par Andrea da Verrocchio, comme le cite Vasari. Il est fort possible que Vénus de Sandro Botticelli ou de l'atelier à Berlin ait également été envoyée de Florence à Matthias Corvin ou amenée par Béatrice en Hongrie. Après la mort de Corvin, Béatrice épousa en 1491 son second mari, Vladislas II, fils de Casimir IV, roi de Pologne et frère aîné de Sigismond I. Deux tableaux de la Vierge à l'Enfant des années 1490 du Pérugin, peintre qui entre 1486 et 1499 travailla principalement à Florence, au Kunsthistorisches Museum de Vienne (tempera et huile sur panneau, 86,5 x 63 cm, GG 132, ancienne collection impériale) et au Städel Museum (tempera et huile sur panneau, 67,7 x 51,5 cm, inv. 843, acquis en 1832) représentent la même femme comme la Vierge. Les deux effigies sont très similaires au buste de Béatrice par Francesco Laurana. Le tableau du musée Städel a très probablement été copié ou recréé sur la base du même ensemble de dessins d'étude par d'autres artistes, dont le jeune Lucas Cranach l'Ancien. Une version, attribuée à Timoteo Viti, fut offerte à la Collégiale d'Opatów en 1515 par Krzysztof Szydłowiecki, qui fut initialement Trésorier et Maréchal de la Cour du Prince Sigismond depuis 1505, et à partir de 1515 le Grand Chancelier de la Couronne. Il était un ami du roi Sigismond et voyageait fréquemment en Hongrie et en Autriche. Deux autres versions de Lucas Cranach l'Ancien se trouvent dans des collections privées, dont une vendue à Vienne en 2022 (huile sur panneau, 76,6 × 59 cm, Im Kinsky, 28 juin 2022, lot 95). La même femme a également été représentée en Vénus Pudica dans un tableau attribué à Lorenzo Costa au Musée des Beaux-Arts de Budapest (huile sur panneau, 174 x 76 cm, inv. 1257). Il a été acheté par le Musée de Budapest à Brescia en 1895 à Achille Glisenti, un peintre italien qui a également travaillé en Allemagne. Entre 1498-1501 et 1502-1506, le cinquième des six fils du roi polonais Casimir IV Jagellon, le prince Sigismond se rendait fréquemment à Buda, pour vivre à l'illustre cour de son frère aîné, le roi Vladislas II. Sur son chemin, il s'arrêta au château de Trenčín, propriété d'Étienne Zapolya, palatin du royaume de Hongrie. Étienne était marié à la princesse polonaise Hedwige de Cieszyn de la dynastie Piast et possédait également 72 autres châteaux et villes, et tirait des revenus des mines de Transylvanie. Lui et sa famille étaient également des invités fréquents à la cour royale de Buda. Au Piotrków Sejm de 1509, les seigneurs du royaume insistèrent pour que Sigismond, qui fut élu roi en 1506, se marie et donne à la Couronne et à la Lituanie un héritier mâle légitime. En 1509, la plus jeune fille de Zapolya, Barbara, atteint l'âge de 14 ans et Lucas Cranach, alors peintre de la cour du duc de Saxe, est envoyé par le duc à Nuremberg dans le but de prendre en charge le tableau peint par Albrecht Dürer, fils d'un orfèvre hongrois, pour le duc. Cette même année, Cranach réalise deux tableaux représentant la même femme en Vénus et en Vierge. Le tableau de Vénus et Cupidon, signé des initiales LC et daté de 1509 sur le cartellino positionné sur un fond sombre a été acquis par l'impératrice Catherine II de Russie en 1769 avec la collection du comte Heinrich von Brühl à Dresde, maintenant au Musée de l'Ermitage (huile sur toile transférée du bois, 213 x 102 cm, ГЭ-680). Son histoire antérieure est inconnue, il ne peut donc être exclu que le comte Brühl, un homme d'État polono-saxon à la cour de Saxe et de la République polono-lituanienne, l'ait acheté en Pologne. Le tableau est inspiré des Vénus de Botticelli et Lorenzo Costa. Cependant, l'inspiration directe n'a peut-être pas été un tableau mais une statue, comme celle de Vénus et Cupidon découverte près de l'église Santa Croce de Gerusalemme à Rome avant 1509. Cette grande sculpture en marbre, aujourd'hui conservée au musée Pio Clementino (214 cm, inv. 936), qui fait partie des Musées du Vatican, s'inspire à son tour de l'Aphrodite de Cnide (Vénus Pudica) de Praxitèle d'Athènes. D'après l'inscription sur la base : VENERI FELICI / SALLVSTIA / SACRVM / HELPIDVS D[onum] D[edit] (dédié par Sallustia et Helpidus à l'heureuse Vénus), on a longtemps cru qu'il représentait Sallustia Barbia Orbiana (Orbiane), une impératrice romaine du troisième siècle, avec le titre d'Augusta comme épouse de Sévère Alexandre de 225 à 227 après JC, représenté comme Vénus Felix et dédié par ses liberti (esclaves affranchis), Sallustia et Helpidius. Les têtes de portrait sont également interprétées comme représentant Sallustie inconnue comme Vénus et son fils Helpidus comme Cupidon et les origines décrites comme provenant peut-être du temple près des Horti Sallustiani (Jardins de Salluste). De nos jours, la statue est considérée comme un « portrait déguisé » de l'impératrice Faustine ou Faustina Minor (décédée vers 175 après JC), épouse de l'empereur Marc Aurèle (comparer « The Art of Praxiteles ... » d'Antonio Corso, p. 157). Elle ressemble à une autre statue déguisée de Faustine, représentée en Fortuna Obsequens, déesse romaine du destin (Casa de Pilatos à Séville) et son buste à Berlin (Altes Museum). Le deuxième tableau, très similaire aux effigies de Béatrice de Naples en Madone, montre cette femme contre le paysage qui est très similaire à la topographie du château de Trenčín, où Barbara Zapolya a passé son enfance et où elle a rencontré Sigismond. Ce tableau, aujourd'hui conservé au musée Thyssen-Bornemisza à Madrid (huile sur panneau, 71,5 x 44,2 cm, 114 (1936.1)), provient de la collection du critique d'art britannique Robert Langton Douglas (1864-1951), qui vécut à Italie de 1895 à 1900, et acquise à New York en 1936. Elle offre à l'Enfant une grappe de raisin, symbole chrétien du sacrifice rédempteur, mais aussi symbole populaire de la Renaissance pour la fertilité, emprunté au dieu romain de la vendange et de la fertilité, Bacchus. Les deux femmes ressemblent beaucoup à Barbara Zapolya d'après son portrait avec le monogramme B&S. Dans l'autel principal de l'église du XIIIe siècle à Strońsko près de Sieradz dans le centre de la Pologne, il existe une version très similaire de cette peinture de l'atelier de Lucas Cranach l'Ancien. L'inscription latine sur Vénus à Saint-Pétersbourg met en garde celui à qui elle était destinée : « Chassez de toutes vos forces les excès de Cupidon, afin que Vénus ne s'empare pas de votre cœur aveuglé » (PELLE · CVPIDINEOS · TOTO / CONAMINE · LVXVS / NE · TVA · POSSIDEAT / PECTORA · CECA · VENVS).
Statue de l'impératrice Faustine la Jeune en Vénus Felix, Rome antique, vers 170-175 après JC, Musée Pio Clementino.
Portrait de Simonetta Vespucci en Vierge à l'Enfant avec saint Jean-Baptiste et un ange par Sandro Botticelli, années 1470, Musée national de Varsovie.
Portrait de Simonetta Vespucci en Vierge à l'Enfant avec des anges par Sandro Botticelli ou l'atelier, années 1470, Château Royal de Wawel à Cracovie.
La Naissance de Vénus par Sandro Botticelli, 1484-1485, Galerie des Offices à Florence.
Portrait de Simonetta Vespucci en Vénus par Sandro Botticelli ou atelier, quatrième quart du XVe siècle, Gemäldegalerie à Berlin.
Vénus par Sandro Botticelli ou l'atelier, quatrième quart du XVe siècle, Galerie Sabauda à Turin.
Portrait de Béatrice de Naples en Vénus par Lorenzo Costa, quatrième quart du XVe siècle, Musée des Beaux-Arts de Budapest.
Portrait de Béatrice de Naples en Vierge à l'Enfant avec des saints par le Pérugin, années 1490, Kunsthistorisches Museum de Vienne.
Portrait de Béatrice de Naples en Vierge à l'Enfant avec l'Enfant Saint Jean-Baptiste par le Pérugin, années 1490, Musée Städel de Francfort-sur-le-Main.
Portrait de Béatrice de Naples en Vierge à l'Enfant avec l'Enfant Saint Jean-Baptiste par Timoteo Viti ou Lucas Cranach l'Ancien, années 1490, Collégiale Saint-Martin d'Opatów.
Portrait de Béatrice de Naples en Vierge à l'Enfant avec l'Enfant Saint Jean Baptiste par Lucas Cranach l'Ancien, années 1490, Collection privée.
Portrait de Barbara Zapolya en Vénus et Cupidon par Lucas Cranach l'Ancien, 1509, Musée de l'Ermitage.
Portrait de Barbara Zapolya en Vierge à l'Enfant avec une grappe de raisin par Lucas Cranach l'Ancien, 1509-1512, Musée Thyssen-Bornemisza à Madrid.
Portrait de Barbara Zapolya en Vierge à l'Enfant dans un paysage par l'atelier de Lucas Cranach l'Ancien, 1509-1512, église paroissiale de Strońsko.
Portrait de Magdalena Thurzo par Lucas Cranach l'Ancien
L'une des plus anciennes et des meilleures madones de Cranach se trouve au musée archidiocésain de Wrocław (huile sur panneau, 70,3 x 56,5 cm). L'œuvre se trouvait initialement dans la cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Wrocław et y aurait été offerte en 1517 par Jean V Thurzo, prince-évêque de Wrocław, qui a également fondé un nouveau portail de sacristie, considéré comme la première œuvre de la Renaissance en Silésie. Thurzo, issu de la famille patricienne hongroise-slovaque-polonaise-allemande, est né le 16 avril 1464 ou 1466 à Cracovie, où son père a construit une fonderie à Mogiła. Il a étudié à Cracovie et en Italie et il a commencé sa carrière ecclésiastique en Pologne (scolastique à Gniezno et à Poznań, chanoine à Cracovie). Le roi polonais Jean Ier Albert l'envoya dans plusieurs missions diplomatiques. Peu de temps après, il s'installe à Wrocław en Silésie et devient chanoine et doyen du chapitre de la cathédrale en 1502 et évêque de Wrocław à partir de 1506.
Thurzo possédait une importante bibliothèque et de nombreuses œuvres d'art. En 1508, il paya 72 florins à Albrecht Dürer, le fils d'un orfèvre hongrois, pour une peinture de la Vierge Marie (Item jhr dörfft nach keinen kaufman trachten zu meinem Maria bildt. Den der bischoff zu Preßlau hat mir 72 fl. dafür geben. Habs wohl verkhaufft.), selon la lettre de l'artiste du 4 novembre 1508. Selon Jan Dubravius, il possédait également Adam et Eve de Dürer, pour lequel il a payé 120 florins. En 1515, le frère cadet de Jean, Stanislas Thurzo, évêque d'Olomouc, chargea Lucas Cranach l'Ancien de créer un retable sur les thèmes de la décapitation de saint Jean-Baptiste et de la décapitation de sainte Catherine (château de Kroměříž), tandis que son autre frère Georges, qui a épousé Anna Fugger, a été représenté par Hans Holbein l'Ancien (Kupferstichkabinett à Berlin). En 1509 ou peu de temps après, il acheva la reconstruction de la résidence d'été épiscopale de Javorník. Le château médiéval construit par le duc Piast Bolko II de Świdnica a été transformé en palais Renaissance de 1505, selon deux plaques de pierre sur le mur du château créées par l'atelier de Francesco Fiorentino (qui a ensuite travaillé en Pologne) à Kroměříž, l'une commençant par les mots « Jean Thurzo, évêque de Wroclaw, Polonais, a réparé cette citadelle » (Johannes Thurzo, episcopus Vratislaviensis, Polonus, arcem hanc bellorum ac temporum injuriis solo aequatam suo aere restauravit, mutato nomine montem divi Joannis felicius appellari voluit M. D. V.). Il a également rebaptisé le château comme Colline de Jean (Mons S. Joannis, Jánský Vrch, Johannisberg ou Johannesberg), pour honorer le patron des évêques de Wrocław, saint Jean-Baptiste. À l'époque de Thurzo, le château est devenu un lieu de rencontre d'artistes et d'érudits, dont le chanoine de Toruń, Nicolas Copernic. Avec son frère Stanislas, évêque d'Olomouc, il a couronné Louis Jagellon, âgé de trois ans, roi de Bohême le 11 mars 1509 à Prague. L'évêque Thurzo avait deux sœurs. La jeune Marguerite a épousé Konrad Krupka, un marchand de Cracovie et l'aînée Madeleine a d'abord été mariée à Max Mölich de Wrocław et en 1510, elle a épousé Georg Zebart de Cracovie, qui étaient tous deux impliqués dans les entreprises financières de son père Jean III Turzo en Pologne, Slovaquie et la Hongrie. La peinture de la Madone de Wrocław est généralement datée d'environ 1510 ou peu après 1508, lorsque Cranach a été anobli par Frédéric le Sage, électeur de Saxe, car une chevalière décorée des initiales inversées « L.C » et l'insigne du serpent de Cranach est l'un des éléments les plus importants du tableau. Le château sur un rocher fantastique en arrière-plan avec deux tours rondes, une petite cour intérieure et une tour-porte à droite correspond parfaitement à la disposition et à la vue du château de Jánský Vrch au début du XVIe siècle (dessins de reconstruction hypothétiques de Rostislav Vojkovský). Des échafaudages et une échelle sont également visibles, le bâtiment est clairement en cours de reconstruction et d'extension. L'enfant tient des raisins, symbole chrétien de la rédemption, mais aussi ancien symbole de fertilité. La femme représentée comme la Vierge ressemble aux effigies de Georges Thurzo (Musée Thyssen-Bornemisza à Madrid et Kupferstichkabinett à Berlin), elle pourrait donc être identifiée comme Madeleine Thurzo, qui à cette époque était sur le point de se marier.
Portrait de Madeleine Thurzo en Vierge à l'Enfant avec une grappe de raisin contre la vue idéalisée du château de Jánský Vrch par Lucas Cranach l'Ancien, vers 1509-1510, Musée archidiocésain de Wrocław.
Portrait de Barbara Zapolya en Salomé avec la tête de saint Jean-Baptiste par Lucas Cranach l'Ancien
« Dans le monde chrétien jusqu'à la Renaissance, les hommes étaient associés à la tête (et donc à la pensée, à la raison et à la maîtrise de soi) et les femmes au corps (et donc aux sens, à la physicalité et aux passions) » (Gail P . Streete's « The Salome Project: Salome and Her Afterlives », 2018, p. 41).
Au cours de la Renaissance, Salomé est devenue un symbole érotique de la luxure féminine audacieuse et incontrôlable, de la séduction féminine dangereuse, de la nature perverse de la femme, du pouvoir de la perversité féminine, mais aussi un symbole de beauté et de complexité. L'une des plus anciennes représentations de la danse de Salomé est une fresque de la cathédrale de Prato, réalisée entre 1452 et 1465 par Filippo Lippi, qui a également réalisé des peintures pour Matthias Corvin, roi de Hongrie. En avril 1511, Sigismond informa son frère, le roi Vladislas, qu'il souhaitait épouser une noble hongroise. Il a choisi Barbara Zapolya. Le traité de mariage fut signé le 2 décembre 1511 et la dot de Barbara fut fixée à 100 000 zlotys rouges. Barbara a été louée pour ses vertus, Marcin Bielski a écrit sur sa dévotion à dieu et son obéissance à son mari, sa bonté et sa générosité. Le tableau de Lucas Cranach l'Ancien à Lisbonne la représente comme Salomé portant un manteau bordé de fourrure et un chapeau de fourrure. Il a été offert au Musée d'art ancien de Lisbonne par Luis Augusto Ferreira de Almeida, 1er Comte de Carvalhido. Il est possible que le tableau ait été envoyé au Portugal au XVIe siècle par la cour polono-lituanienne. En 1516, Jan Amor Tarnowski, qui a fait ses études à la cour des monarques jagellons, et deux autres seigneurs polonais ont été anoblis dans l'église Saint-Jean de Lisbonne par le roi Manuel I. Plus d'une décennie plus tard, en 1529 et à nouveau en 1531 arrivé en Pologne-Lituanie Damião de Góis, à qui le roi Jean III du Portugal a confié la mission de négocier le mariage de la princesse Hedwige Jagellon, fille de Barbara Zapolya, avec le frère du roi. En 1520, Hans Kemmer, élève de Lucas Cranach l'Ancien à Wittenberg, probablement peu après son retour dans sa ville natale de Lübeck (mentionné pour la première fois dans le livre de la ville le 25 mai 1520), crée une copie ou plutôt une version modifiée de cette peinture. Il a signé cette oeuvre d'un monogramme HK (lié) et datée « 1520 » au bord du plat. Le tableau provient d'une collection privée en Autriche et a été vendu en 1994 (huile sur panneau, 58 x 51 cm, Dorotheum à Vienne, 18 octobre 1994, lot 151). Son costume est plus orné dans cette version, mais le visage n'est pas peint de manière très élaborée. Le chapeau en velours doublé de fourrure du modèle est évidemment d'Europe orientale et similaire a été représenté dans un portrait d'un homme avec un chapeau de fourrure de Michele Giambono (Palazzo Rosso à Gênes), créé à Venise entre 1432-1434, qui est identifié pour représenter un prince bohémien ou hongrois venu en Italie pour le couronnement de l'empereur Sigismond. Sa main gauche n'est pas naturelle et presque grotesque ou « naïvement » peinte (repeinte dans la version de Lisbonne très probablement au XIXe siècle), ce qui indique que le peintre s'est basé sur un dessin d'étude qu'il a reçu pour créer le tableau et n'a pas vu le modèle vivant. Quelques années plus tard, Laura Dianti (décédée en 1573), maîtresse d'Alphonse Ier d'Este, duc de Ferrare, a été représentée dans plusieurs portraits déguisés par Titien et son atelier. Son portrait avec un page africain (collection de Heinz Kisters à Kreuzlingen) est connu de plusieurs copies et d'autres versions, dont certaines la dépeignent en Salomé. L'original de Titien déguisé en femme fatale biblique a probablement été perdu. Des peintures de la Vierge et l'Enfant avec le jeune saint Jean-Baptiste du Titien et de son atelier (Galerie des Offices à Florence et Musée Fesch à Ajaccio) sont également identifiées pour représenter Laura ainsi que sainte Marie Madeleine par l'entourage du Titien (collection particulière). Ils ont tous suivi le même modèle romain de portraits sous les traits de divinités et de héros mythologiques. L'image d'Hérodiade/Salomé conservée au couvent des Augustins de Cracovie et l'inventaire posthume de Melchior Czyżewski, mort à Cracovie en 1542, répertorie deux de ces peintures. La popularité de telles images en Pologne-Lituanie se reflète dans la poésie. Dans les œuvres fragmentaires conservées de Mikołaj Sęp Szarzyński (vers 1550 - vers 1581), il y a quatre épigrammes sur des peintures, dont « Sur l'image de sainte Marie-Madeleine » et « Sur l'image d'Hérodiade avec la tête de Saint Jean » (d'après « Od icones do ekfrazy ... » de Radosław Grześkowiak).
Portrait de Barbara Zapolya en Salomé avec la tête de saint Jean-Baptiste par Lucas Cranach l'Ancien, 1510-1515, Musée national d'art ancien de Lisbonne.
Portrait de Barbara Zapolya en Salomé avec la tête de saint Jean-Baptiste par Hans Kemmer, 1520, Collection privée.
Portraits de Barbara Zapolya et Barbara Jagiellon par Lucas Cranach l'Ancien
Le 21 novembre 1496 à Leipzig, Barbara Jagellon, la quatrième fille de Casimir IV Jagellon, roi de Pologne et grand-duc de Lituanie et d'Élisabeth d'Autriche, princesse de Bohême et de Hongrie, gui parvenue à l'âge adulte, épousa Georges de Saxe, fils et successeur d'Albert III l'Intrépide, duc de Saxe et Sidonie de Podebrady, fille de Georges, roi de Bohême, lors d'une cérémonie glamour et élaborée. 6 286 nobles allemands et polonais auraient assisté au mariage. Le mariage était important pour les Jagellons en raison de la rivalité avec les Habsbourg en Europe centrale.
Dès 1488, alors que son père était parti en campagne en Flandre et en Frise, Georges, le mari de Barbara exerça diverses fonctions officielles en son nom, et lui succéda après sa mort en 1500. Le cousin de Georges, le prince-électeur Frédéric le Sage, était un homme très pieux et il a recueilli de nombreuses reliques, dont un échantillon de lait maternel de la Bienheureuse Vierge Marie. En 1509, l'électeur avait imprimé un catalogue de cette collection, réalisé par son artiste de cour Lucas Cranach et son inventaire de 1518 recensait 17 443 pièces. En 1522, l'empereur Charles V proposa les fiançailles d'Hedwige Jagellon, la fille aînée de Sigismond Ier, frère de Barbara, avec Jean-Frédéric, héritier du trône de Saxe et neveu de Frédéric le Sage, car l'électeur très probablement homosexuel en relation avec Degenhart Pfäffinger, resta célibataire. Le portrait de Frédéric par l'entourage de Lucas Cranach l'Ancien des années 1510 se trouve au château de Kórnik près de Poznań. Le 20 novembre 1509 à Wolfenbüttel, Catherine (1488-1563), fille du duc Henri IV de Brunswick-Lunebourg, épouse le duc Magnus Ier de Saxe-Lauenbourg (1470-1543). Peu de temps après le mariage, elle lui donna un fils, futur François Ier (1510-1581). Magnus fut le premier des ducs de Saxe-Lauenburg à renoncer aux prétentions électorales, longtemps disputées entre les deux lignées de la maison ducale saxonne. Il ne portait ni le titre électoral ni les épées électorales (Kurschwerter) dans ses armoiries. Les épées électorales indiquaient la fonction d'archi-maréchal impérial (Erzmarschall, Archimarescallus), se rapportant au privilège de prince-électeur. Le 12 août 1537, la fille aînée de Catherine et de Magnus, Dorothée de Saxe-Lauenbourg (1511-1571), est couronnée reine du Danemark et de Norvège dans la cathédrale de Copenhague. « Afin qu'ils voient un grand royaume et un peuple puissant, qu'ils portent la reine de leur seigneur sous les étoiles, ô vierge heureuse, heureuses étoiles qui t'ont enfantée, pour la gloire de ton pays » (Ut videant regnum immensum populumque potentem: Reginam domini ferre sub astra sui, O felix virgo, felicia sidera, que te, Ad tantum patrie progenuere decus), écrit dans son « Hymne pour le couronnement de la reine Barbara » (In Augustissimu[m] Sigisimu[n]di regis Poloniae et reginae Barbarae connubiu[m]), publié à Cracovie en 1512, le secrétaire de la reine Andrzej Krzycki. La reine Barbara Zapolya a été couronnée le 8 février 1512 dans la cathédrale de Wawel. Elle a apporté à Sigismond une énorme dot de 100 000 zloty rouges, égale aux filles impériales. Leur mariage était très cher et a coûté 34 365 zlotys, financés par un riche banquier de Cracovie Jan Boner. Un tableau de Lucas Cranach l'Ancien de la Galerie nationale du Danemark à Copenhague daté d'environ 1510-1512, montre une scène du mariage mystique de sainte Catherine. La sainte « en tant qu'épouse doit partager la vie de son mari, et comme le Christ a souffert pour la rédemption de l'humanité, l'épouse mystique entre dans une participation plus intime à ses souffrances » (d'après l'Encyclopédie catholique). La Vierge Marie porte des traits de la reine Barbara Zapolya, semblables aux peintures de l'église paroissiale de Strońsko ou du musée Thyssen-Bornemisza de Madrid. La femme de droite, représentée dans une pose similaire à certains portraits de donateurs, est identifié comme l'effigie de sainte Barbe. C'est donc elle qui a commandé le tableau. Ses traits du visage ressemblent beaucoup au portrait de Barbara Jagellon par Cranach du Musée des Beaux-Arts de Silésie à Wrocław, aujourd'hui à la Gemäldegalerie de Berlin. L'effigie de sainte Catherine ressemble fortement au portrait de Dorothée de Saxe-Lauenbourg, reine du Danemark et fille de Catherine de Brunswick-Wolfenbüttel, duchesse de Saxe-Lauenbourg, au château de Frederiksborg, près de Copenhague. La peinture décrite provient de la collection royale danoise et avant 1784, elle se trouvait dans la chambre des meubles du palais royal de Christiansborg à Copenhague. Le tableau porte les armoiries de l'électorat de Saxe en partie supérieure. Le message est donc que Saxe-Lauenburg doit rejoindre la « famille jagellonne » et grâce à cette union ils peuvent reconquérir le titre électoral. Une bonne copie d'atelier, acquise en 1858 de la collection d'un théologien catholique Johann Baptist von Hirscher (1788-1865) à Fribourg-en-Brisgau, se trouve à la Staatliche Kunsthalle Karlsruhe. La peinture est très similaire à d'autres mariage mystique de sainte Catherine de Lucas Cranach l'Ancien, qui se trouvaient au musée Bode à Berlin avant la Seconde Guerre mondiale, perdus. Dans cette scène, la reine Barbara est très probablement entourée de ses dames de cour hongroises et moraves déguisées en saintes Marguerite, Catherine, Barbe et Dorothée. Il a été acheté à une collection privée à Paris, d'où la provenance de la collection royale polonaise ne peut être exclue - Jean Casimir Vasa, arrière-petit-fils de Sigismond Ier en 1668 et de nombreux autres aristocrates polonais ont transféré à Paris leurs collections au XVIIème siècle et plus tard. La copie de ce tableau d'environ 1520 se trouve dans l'église de Jachymov (Sankt Joachimsthal), où à partir de 1519 Louis II, roi de Hongrie, de Croatie et de Bohême frappa sa célèbre pièce d'or, dite jocondale. La femme à l'effigie de Lucrèce, modèle de femme vertueuse, de Lucas Cranach l'Ancien, qui se trouvait à la fin du XIXe siècle dans la collection de Wilhelm Lowenfeld à Munich ressemble beaucoup à l'effigie de Barbara Jagiellon à Copenhague. C'est l'une des premières versions survivantes du sujet par Cranach et est considérée comme un pendant de la Salomé de Lisbonne (Friedländer). Les deux peintures ont des dimensions, une composition, un style similaires, ainsi que le sujet d'une ancienne femme fatale et ont été créées à la même période. L'œuvre de Lisbonne représente la belle-sœur de Barbara Jagellon, la reine Barbara Zapolya. Une effigie similaire de Lucrèce, également de Cranach l'Ancien, a été vendue aux enchères à la Art Collectors Association Gallery de Londres en 1920. L'effigie de Mater dolorosa de la Galerie nationale de Prague, offerte en 1885 par le baron Vojtech (Adalbert) Lanna (1836-1909), est presque identique au visage de sainte Barbe du tableau de Copenhague. En 1634, l'œuvre appartenait à un abbé non identifié qui a ajouté ses armoiries avec ses initiales « A. A. / Z. G. » dans le coin supérieur droit du tableau. En revanche, le visage de Madone d'un tableau du Musée national de Varsovie (numéro d'inventaire M.Ob.2542 MNW) est très similaire à celui de Salomé à Munich. Ce tableau est attribué au suiveur de Lucas Cranach l'Ancien et daté du premier quart du XVIe siècle. L'effigie de Salomé de la même époque par Lucas Cranach l'Ancien, acquise en 1906 par le Musée national de Bavière à Munich auprès du presbytère catholique de Bayreuth, représente également Barbara Jagiellon. Une copie modifiée de ce tableau par l'atelier de Cranach ou un copiste du XVIIe siècle, peut-être Johann Glöckler, avec le modèle représenté portant une robe en tissu de brocart exquis se trouvait dans la collection Heinz Kisters à Kreuzlingen dans les années 1960 (huile sur panneau, 34,8 × 24,5 cm). C'est l'une des nombreuses variantes connues de la composition. Peut-être à cette époque ou plus tard, lorsque sa belle-sœur Bona Sforza commanda des portraits vers 1530, la duchesse commanda également une série de ses portraits en tant qu'une autre femme fatale biblique, Judith. Le portrait d'atelier ou suiveur de Cranach de collection privée, vendu en 2014, est très proche du tableau de Munich, tandis que la pose correspond pour l'essentiel au portrait de sa nièce Hedwige Jagellon de la collection Suermondt, daté de 1531. George de Saxe et Barbara Jagellon ont été mariés pendant 38 ans. Après sa mort le 15 février 1534, il se laisse pousser la barbe en signe de chagrin, ce qui lui vaut le surnom de Barbu. Il mourut à Dresde en 1539 et fut enterré à côté de sa femme dans une chapelle funéraire de la cathédrale de Meissen.
Portrait de la reine Barbara Zapolya (1495-1515), Barbara Jagellon (1478-1534), duchesse de Saxe et Catherine de Brunswick-Wolfenbüttel (1488-1563), duchesse de Saxe-Lauenburg en Vierge à l'Enfant avec les saints Barbara et Catherine par Lucas Cranach l'Ancien, vers 1512-1514, Galerie nationale du Danemark.
Portrait de la reine Barbara Zapolya (1495-1515), Barbara Jagellon (1478-1534), duchesse de Saxe et Catherine de Brunswick-Wolfenbüttel (1488-1563), duchesse de Saxe-Lauenburg en Vierge à l'Enfant avec les saints Barbara et Catherine par l'atelier de Lucas Cranach l'Ancien, vers 1512-1514, Staatliche Kunsthalle Karlsruhe.
Portrait de la reine Barbara Zapolya (1495-1515) et de ses dames de cour en Vierge et les saintes par Lucas Cranach l'Ancien, vers 1512-1514, Musée Bode à Berlin, perdu.
Portrait de Barbara Jagellon (1478-1534), duchesse de Saxe en Salomé par Lucas Cranach l'Ancien, vers 1512, Musée national de Bavière à Munich.
Portrait de Barbara Jagellon (1478-1534), duchesse de Saxe en Salomé par l'atelier ou suiveur de Lucas Cranach l'Ancien, après 1512 (XVIIe siècle ?), collection privée.
Portrait de Barbara Jagellon (1478-1534), duchesse de Saxe en Judith avec la tête d'Holopherne par atelier ou suiveur de Lucas Cranach l'Ancien, vers 1512-1531, Collection particulière.
Portrait de Barbara Jagellon (1478-1534), duchesse de Saxe en Lucrèce par Lucas Cranach l'Ancien, vers 1512-1514, Collection particulière.
Portrait de Barbara Jagellon (1478-1534), duchesse de Saxe en Lucrèce par Lucas Cranach l'Ancien, vers 1512-1514, Collection particulière.
Portrait de Barbara Jagellon (1478-1534), duchesse de Saxe en Mater dolorosa par Lucas Cranach l'Ancien, vers 1512-1514, Galerie nationale de Prague.
Portrait de Barbara Jagellon (1478-1534), duchesse de Saxe en Vierge à l'Enfant par un suiveur de Lucas Cranach l'Ancien, premier quart du XVIe siècle, Musée national de Varsovie.
Portraits d'Elisabeth Jagellon par Lucas Cranach l'Ancien et atelier
« Les villes et les villages sont rares en Lituanie; la principale richesse d'entre eux sont surtout les peaux d'animaux, auxquelles notre époque a donné les noms de Zibellini et armelli (hermine). Usage inconnu de l'argent, les peaux prennent sa place. Les classes inférieures utilisent le cuivre et argent; plus précieux que l'or. Les dames nobles ont des amants en public, avec la permission de leurs maris, qu'elles appellent assistants de mariage. C'est une honte pour les hommes d'adjoindre une maîtresse à leur femme légitime. Les mariages se dissolvent facilement par consentement mutuel, et ils se remarient. Il y a beaucoup de cire et de miel ici que les abeilles sauvages fabriquent dans les bois. L'usage du vin est très rare, et le pain est très noir. Le bétail fournit de la nourriture à ceux qui utilisent beaucoup de lait » (Rara inter Lithuanos oppida, neque frequentes villae: opes apud eos, praecipuae animalis pelles, quibus nostra aetas Zibellinis, armellinosque nomina indidit. Usus pecuniae ignotus, locum eius pelles obtinent. Viliores cupri atque argenti vices implent; pro auro signato, pretiosiores. Matronae nobiles, publice concubinos habent, permittentibus viris, quos matrimonii adiutores vocant. Viris turpe est, ad legitimam coniugem pellicem adiicere. Solvuntur tamen facile matrimonia mutuo consensu, et iterum nubunt. Multum hic cerae et mellis est quod sylvestres in sylvis apes conficiunt. Vini rarissimus usus est, panis nigerrimus. Armenta victum praebent multo lacte utentibus.), a écrit au milieu du XVe siècle le pape Pie II (Enea Silvio Piccolomini, 1405-1464) dans ses textes publiés à Bâle en 1551 par Henricus Petrus, qui a également publié la deuxième édition du De revolutionibus orbium coelestium de Nicolas Copernic (Aeneae Sylvii Piccolominei Senensis, qui post adeptum ..., p. 417). Certains écrivains conservateurs du XIXe siècle, clairement choqués et terrifiés par cette description, ont suggéré que le pape mentait ou répandait de fausses rumeurs.
Elisabeth Jagellon, treizième et dernière enfant de Casimir IV, roi de Pologne et grand-duc de Lituanie et de son épouse Elisabeth d'Autriche (1436-1505), est très probablement née le 13 novembre 1482 à Vilnius, alors que sa mère avait 47 ans. En 1479, Elisabeth d'Autriche avec son mari et ses jeunes enfants, quitta Cracovie pour Vilnius pendant cinq ans. La princesse a été baptisée du nom de sa mère. Quelques mois plus tard, le 4 mars 1484 à Grodno mourut le prince Casimir, l'héritier présomptif et futur saint, et fut enterré dans la cathédrale de Vilnius. Casimir IV mourut en 1492 dans le vieux château de Grodno au Grand-Duché de Lituanie. Après la mort de son père, Elisabeth renforce sa relation avec sa mère. En 1495, avec sa mère et sa sœur Barbara, elle retourna en Lituanie pour rendre visite à son frère Alexandre Jagellon, grand-duc de Lituanie. Quand elle avait 13 ans, en 1496, Jean Cicéron, électeur de Brandebourg avait l'intention de l'épouser avec son fils Joachim, mais le mariage ne s'est pas concrétisé et le 10 avril 1502, Joachim épousa Elisabeth de Danemark, fille du roi Jean de Danemark. En 1504, Alexandre, devenu roi de Pologne en 1501, lui accorda un douaire, sécurisée sur Łęczyca, Radom, Przedecz et le village de Zielonki. Entre 1505 et 1509, le voïvode de Moldavie, Bogdan III le Borgne, chercha à gagner la main d'Elisabeth, mais la jeune fille s'y opposait catégoriquement. Dans les années suivantes, les propositions de mariage des princes italiens, allemands et danois ont été envisagées, et il était même prévu d'épouser Elisabeth avec l'empereur veuf Maximilien Ier, qui avait plus de 50 ans lorsqu'en 1510 mourut sa troisième épouse Blanche-Marie Sforza. En 1509, la princesse Elisabeth a acheté une maison sur la colline de Wawel aux vicaires de la cathédrale, située entre les maisons de Szydłowiecki, Gabryielowa, Ligęza et Filipowski et son frère, le roi Sigismond Ier, a commandé à Nuremberg un autel en argent pour la cathédrale de Wawel après victoire sur Bogdan III le Borgne, créé en 1512 par Albrecht Glim. Elisabeth a également élevé les enfants du roi. Sans attendre une réponse claire de l'empereur Maximilien, Sigismond et son frère Vladislas II décident d'épouser leur sœur avec le duc Frédéric II de Legnica. D'abord, cependant, Sigismond voulait communiquer avec sa sœur pour son opinion. « Nous n'avons aucun doute qu'elle accepterait facilement tout ce que Votre Altesse et Nous considérerons comme juste et reconnaissant », a-t-il écrit à Vladislas. L'union était censée renforcer les liens du roi Sigismond avec le duché de Legnica. Le contrat de mariage a été signé à Cracovie le 12 septembre 1515 par Jean V Thurzo, évêque de Wrocław, qui remplaçait le marié. Elisabeth a reçu une dot de 20 000 zlotys, dont 6 000 devaient être payés lors du mariage, 7 000 le jour de la sainte Elisabeth en un an et les 7 000 derniers le jour de la sainte Elisabeth en 1517. De plus, la princesse a reçu un trousseau en l'or, l'argent, les perles et les pierres précieuses, estimés à 20 000 zlotys, à l'exception des robes d'or et de soie et des fourrures d'hermine et de zibeline. Le mari devait transférer un douaire de 40 000 zlotys, garantis sur tous les revenus de Legnica et lui payer annuellement 2 400 zlotys. Le 8 novembre 1515, Elisabeth partit pour Legnica de Sandomierz, accompagnée de Stanisław Chodecki, Grand Maréchal de la Couronne, des prêtres Latalski et Lubrański, voïvode de Poznań et de l'évêque Thurzo. Le mariage d'Elisabeth, 32 ans, avec Frederick, 35 ans, a eu lieu le 21 ou le 26 novembre à Legnica et le couple y a vécu dans le château des Piast. Le 2 février 1517, elle donna naissance à une fille, Hedwige, qui mourut deux semaines plus tard, suivit de sa mère le 17 février. La duchesse fut enterrée dans la chartreuse de Legnica et en 1548, son corps fut transféré dans un autre temple à Legnica - l'église Saint-Jean. Un tableau de Lucrèce, l'incarnation de la vertu et de la beauté féminines, de Lucas Cranach l'Ancien ou de son atelier a été acquis par Gemäldegalerie Alte Meister à Kassel auprès du marchand d'art Gutekunst à Stuttgart en 1885. Selon l'inscription au verso du panneau, il était antérieur dans une collection privée à Augsbourg, ville fréquemment visitée par l'empereur Maximilien Ier. La tour au sommet d'une colline visible à gauche en arrière-plan ressemble étonnamment à la dominante de Vilnius du XVIe siècle, la tour médiévale de Gediminas du château supérieur. La pose, le costume et même les traits du visage de Lucrèce sont très similaires au portrait de la sœur aînée d'Elisabeth Barbara Jagiellon (1478-1534), duchesse de Saxe en Lucrèce de la collection de Wilhelm Löwenfeld à Munich. Un dessin d'étude pour ce tableau par un artiste de l'atelier de Cranach, peut-être un étudiant envoyé en Pologne-Lituanie pour préparer les premiers dessins, se trouve à la Klassik Stiftung Weimar (CC 100). La même femme a également été représentée comme la nymphe des eaux Égérie couchée, aujourd'hui dans le pavillon de chasse Grunewald à Berlin. Le peintre a très probablement utilisé le même dessin modèle pour créer les deux effigies (à Kassel et à Berlin). Égérie, la nymphe de la source sacrée, probablement une déesse de l'eau italique indigène, avait le pouvoir d'aider à la conception. « On disait que sa fontaine jaillissait du tronc d'un chêne et quiconque en buvait de l'eau était béni par la fertilité, les visions prophétiques et la sagesse » (d'après « Encyclopedia of Fairies in World Folklore and Mythology » de Theresa Bane, p. 119) . La tour médiévale sur une pente raide en arrière-plan est également similaire sur les deux tableaux. Ce tableau se trouvait vraisemblablement au palais de la ville de Berlin depuis le XVIe siècle et en 1699, il a été enregistré au palais de la ville de Potsdam. Il ne peut être exclu qu'il ait été envoyé à Joachim Ier Nestor, électeur de Brandebourg ou à son frère Albert de Brandebourg, futur cardinal, ou qu'il ait été enlevé de Pologne pendant le déluge (1655-1660). Le dessin initial de ce tableau se trouve dans la collection graphique de la bibliothèque universitaire d'Erlangen (H62/B1338). Une autre Lucrèce similaire a été vendue à Bruxelles en 1922. Bruxelles était une capitale des Pays-Bas des Habsbourg, un dominium de l'empereur Maximilien. Il est fort possible que sa fille l'archiduchesse Marguerite d'Autriche, gouvernante des Pays-Bas des Habsbourg de 1507 à 1515, qui résidait à Malines, ait reçu un portrait d'une éventuelle belle-mère. Ce portrait est également très similaire à un autre portrait de la sœur d'Elisabeth, Barbara, en Lucrèce, qui a été vendu aux enchères à Londres en 1920. La Lucrèce de Bruxelles a été copiée dans un autre tableau, aujourd'hui à Veste Coburg, qui, selon une inscription ultérieure, est connue sous le nom de Didon la reine de Carthage. Il se trouvait initialement dans le cabinet d'art (Kunstkammer) du palais Friedenstein à Gotha, comme le portrait de la nièce d'Elisabeth Hedwige Jagellon par Cranach de 1534. Le costume de Didon est très similaire à la robe de Salomé visible dans un tableau de la Décollation de Saint Jean-Baptiste (château de Kroměříž), daté « 1515 » et créé par Cranach pour Stanislas Thurzo, évêque d'Olomouc, frère de l'évêque Jean V Thurzo. Ce tableau porte l'inscription en latin DIDO REGINA et la date M.D.XLVII (1547). Le palais Friedenstein a été construit pour Ernest I, duc de Saxe-Gotha, et l'un des événements les plus importants de l'histoire de sa famille a été la bataille de Mühlberg en 1547, perdue par son arrière-grand-père Jean-Frédéric Ier, qui a été dépouillé de son titre d'électeur de Saxe et les forces impériales firent sauter les fortifications du château de Grimmenstein, prédécesseur du palais de Friedenstein. Il est possible qu'un portrait d'Elisabeth en Lucrèce, dont l'identité était déjà perdue en 1547, devienne pour la famille de Jean-Frédéric un symbole de leur passé glorieux et de leur chute tragique, exactement comme dans l'Histoire de Didon et Enée. Les mêmes traits du visage ont également été utilisés dans une série de peintures de Madonna lactans, symbole de la maternité et de la capacité de protection de la Vierge Marie. Cette image populaire de Marie avec l'enfant Jésus est similaire aux anciennes statues d'Isis lactans, c'est-à-dire la déesse égyptienne Isis, vénérée comme la mère idéale et fertile, représentée en train d'allaiter son fils Horus. La meilleure version est maintenant au Musée des Beaux-Arts de Budapest. Ce tableau a été donné au musée en 1912 par le comte János Pálffy de sa collection du château de Pezinok en Slovaquie. Le tableau était auparavant, très probablement, dans la collection de Principe Fondi qui a été vendue aux enchères à Rome en 1895. L'œuvre est magnifiquement peinte et le paysage en arrière-plan ressemble à la vue de Vilnius et de la rivière Néris vers 1576, mais le visage n'était pas très habilement ajouté à la peinture, très probablement comme dernière partie, et l'effigie entière ne semble pas naturelle. La même erreur a été reproduite dans les copies et le visage de la Vierge dans la copie du Hessisches Landesmuseum Darmstadt a une apparence presque grotesque. Ce dernier tableau a été acquis avant 1820, probablement de la collection des landgraves de Hesse-Darmstadt et la tour perchée derrière la Vierge est presque identique à celle du tableau de Lucrèce à Kassel. D'autres versions se trouvent au couvent des Capucins à Vienne, très probablement de la collection des Habsbourg, une a été vendue à Lucerne en 2006 (Galerie Fischer) et une autre en 2011 à Prague (Arcimboldo). Le visage du modèle dans toutes les effigies mentionnées avec une lèvre distincte des Habsbourg / ducs de Mazovie, ressemble beaucoup à la sœur d'Elisabeth Barbara Jagiellon, à sa mère Elisabeth d'Autriche et à son frère Sigismund I. Il y a aussi un tableau à la Klassik Stiftung Weimar, créé par l'atelier ou un disciple de Lucas Cranach l'Ancien, représentant la Vierge Marie flanquée de deux saintes, très similaire aux compositions de la Galerie nationale du Danemark à Copenhague et du Bode Museum à Berlin, perdu pendant la Seconde Guerre mondiale. Le tableau a été acquis avant 1932 sur le marché de l'art de Berlin. L'effigie de Marie est une copie d'un tableau de Strońsko près de Sieradz dans le centre de la Pologne, le portrait de Barbara Zapolya. La femme de gauche, recevant une pomme de l'Enfant, est identique aux effigies de Barbara Jagellon, duchesse de Saxe et celle de droite ressemble à Elisabeth Jagellon. Le château en arrière-plan correspond parfaitement à la disposition du château royal de Sandomierz vers 1515, vu de l'ouest. Le château gothique de Sandomierz a été construit par le roi Casimir le Grand après 1349 et il a été reconstruit et agrandi vers 1480. Le 15 juillet 1478, la reine Elizabeth d'Autriche y a donné naissance à Barbara Jagellon et la famille royale a vécu dans le château à partir de 1513 environ. En 1513, Sigismond Ier ordonna de démolir certaines structures médiévales en ruine et d'agrandir et de reconstruire le bâtiment dans le style renaissance. Des cloîtres à arcades à deux étages autour d'une cour fermée (ailes ouest, sud et est) ont été construits entre 1520-1527. Le château a été détruit pendant le déluge en 1656 et l'aile ouest a été reconstruite entre 1680 et 1688 pour le roi Jean III Sobieski.
Dessin d'étude pour le portrait de la princesse Elisabeth Jagellon (1482-1517) en nymphe des eaux Égérie couchée par l'atelier de Lucas Cranach l'Ancien, vers 1510-1515, Collection graphique de la bibliothèque universitaire d'Erlangen.
Portrait de la princesse Elisabeth Jagellon (1482-1517) en nymphe des eaux Égérie couchée par Lucas Cranach l'Ancien, vers 1510-1515, pavillon de chasse de Grunewald.
Dessin d'étude pour le portrait de la princesse Elisabeth Jagellon (1482-1517) en Lucrèce par l'atelier de Lucas Cranach l'Ancien, vers 1510-1515, Klassik Stiftung Weimar.
Portrait de la princesse Elisabeth Jagellon (1482-1517) en Lucrèce par Lucas Cranach l'Ancien ou l'atelier, vers 1510-1515, Gemäldegalerie Alte Meister à Cassel.
Portrait de la princesse Elisabeth Jagellon (1482-1517) en Lucrèce par Lucas Cranach l'Ancien ou l'atelier, vers 1510-1515, Collection particulière.
Portrait d'Elisabeth Jagellon (1482-1517), duchesse de Legnica en Lucrèce (Dido Regina) par atelier ou disciple de Lucas Cranach l'Ancien, vers 1515, Veste Cobourg.
Portrait d'Elisabeth Jagellon (1482-1517), duchesse de Legnica en Madonna lactans par Lucas Cranach l'Ancien, vers 1515, Musée des Beaux-Arts de Budapest.
Portrait d'Elisabeth Jagellon (1482-1517), duchesse de Legnica en Madonna lactans par atelier ou disciple de Lucas Cranach l'Ancien, vers 1515, Hessisches Landesmuseum Darmstadt.
Portrait de la reine Barbara Zapolya (1495-1515), Barbara Jagellon (1478-1534), duchesse de Saxe et Elisabeth Jagellon (1482-1517), duchesse de Legnica en Vierge flanquée de deux saintes par atelier ou disciple de Lucas Cranach l'Ancien, vers 1515, Klassik Stiftung Weimar.
Portraits de Georges Ier de Brzeg et d'Anna de Poméranie par Hans Suess von Kulmbach
Le 9 juin 1516 à Szczecin, le duc Georges Ier de Brzeg (1481-1521) épousa Anna de Poméranie (1492-1550), la fille aînée du duc Bogislav X de Poméranie (1454-1523) et sa seconde épouse Anna Jagellon (1476 -1503), fille du roi Casimir IV de Pologne.
Selon le livre de la ville de Brzeg (fol. 24 v.), leurs fiançailles ont eu lieu dès 1515. En juin 1515, Georges a imposé une taxe de deux ans aux habitants de son duché afin de percevoir des sommes de dot de 10 000 florins (d'après « Piastowie: leksykon biograficzny », p. 507), la somme que la princesse a également reçue de son père. Dans les années 1512-1514, il y eut des négociations concernant le mariage d'Anna avec le roi danois Christian II. Ce mariage a été empêché par les Hohenzollern, menant à son mariage avec Isabelle d'Autriche, sœur de l'empereur Charles Quint. Georges, le plus jeune fils du duc Frédéric Ier, duc de Chojnów-Oława-Legnica-Brzeg-Lubin, par sa femme Ludimille, fille de Georges de Poděbrady, roi de Bohême, était le vrai prince de la Renaissance, un grand mécène de la culture et art. Séjournant souvent à la cour de Vienne et de Prague, il s'habitua à la splendeur, si bien qu'en 1511, lors du séjour de la famille royale bohémienne-hongroise à Wrocław, tous les courtisans furent éclipsés par la splendeur de sa suite. En février 1512, il était à Cracovie au mariage du roi Sigismond Ier avec Barbara Zapolya, arrivant avec 70 chevaux, puis en 1515 au mariage de son frère avec la princesse polono-lituanienne Elisabeth Jagellon (1482-1517) à Legnica, et en 1518 de nouveau à Cracovie lors du mariage de Sigismond avec Bona Sforza. Il imita les coutumes des cours jagellonnes de Cracovie et de Buda, eut de nombreux courtisans, organisa des fêtes et des jeux dans son château de Brzeg (d'après « Brzeg » de Mieczysław Zlat, p. 21). Il mourut en 1521 à l'âge de 39 ans. Georges et Anna n'avaient pas d'enfants et selon les dernières volontés de son mari, elle a reçu le duché de Lubin en dot avec le droit à vie à un gouvernement indépendant. Le règne d'Anna à Lubin a duré vingt-neuf ans et, après sa mort, il est tombé au duché de Legnica. Le peintre majeur de l'époque à la cour royale de Cracovie était Hans Suess von Kulmbach. Son travail est documenté entre 1509-1511 et 1514-1515, travaillant pour le roi Sigismond Ier (son portrait à Gołuchów, triptyque de Pławno, une aile d'un retable à l'effigie d'un roi, identifié comme portrait de Jogaila/Ladislas Jagellon, à Sandomierz, entre autres), son banquier Jan Boner (autel de sainte Catherine) et son neveu Casimir, margrave de Brandebourg-Kulmbach à partir de 1515 (son portrait daté « 1511 » à l'Alte Pinakothek de Munich). Hans, né à Kulmbach, a été l'élève du peintre vénitien Jacopo de' Barbari (van Venedig geporn, selon Dürer) puis s'est rendu à Nuremberg, où il s'est lié d'amitié avec Albrecht Dürer en tant qu'assistant. Le portrait d'homme de Kulmbach en collection privée (vendu aux enchères chez Sotheby's, Londres en 1959) porte l'inscription · I · A · 33 (abréviation de Ihres Alters 33 en allemand, son âge 33 ans, en haut à gauche), monogramme du peintre HK (joint) et au-dessus l'année 1514 (en haut à droite). L'homme avait le même âge que le duc Georges Ier de Brzeg, né selon les sources entre 1481 et 1483 (d'après « Piastowie: leksykon biograficzny », p. 506), lorsque Kulmbach s'installa à Cracovie. Ce portrait a son pendant dans un autre tableau de même format et dimensions (41 x 31 cm / 40 x 30 cm), portrait d'une jeune femme à Dublin (National Gallery of Ireland, numéro d'inventaire NGI.371, acheté chez Christie's, Londres, 2 juillet 1892, lot 15). Les deux portraits ont été peints sur des panneaux de bois de tilleul, ils ont une composition et une inscription similaires. D'après l'inscription sur le portrait de femme, elle avait 24 ans en 1515 (· I · A · 24 / 1515 / HK), exactement comme Anna de Poméranie, née fin 1491 ou dans la première moitié de 1492 (après « Rodowód książąt pomorskich » d'Edward Rymar, p. 428), lorsqu'elle était fiancée à Georges Ier de Brzeg. La femme ressemble fortement aux effigies d'Anna de Poméranie par Lucas Cranach l'Ancien et l'atelier, identifiées par moi. Son costume est très similaire à celui visible dans le tableau représentant l'Auto-enterrement de saint Jean l'évangéliste (basilique Sainte-Marie de Cracovie), créé par Kulmbach en 1516, montrant peut-être l'intérieur de la cathédrale de Wawel avec un sarcophage gothique original en argent de saint Stanislas. Les figures féminines de ce dernier tableau pourraient être la reine Barbara Zapolya (décédée en 1515) et ses dames ou l'épouse de Jan Boner, Szczęsna Morsztynówna et ses dames.
Portrait de Georges Ier de Brzeg (1481-1521), âgé de 33 ans par Hans Suess von Kulmbach, 1514, Collection privée.
Portrait d'Anna de Poméranie (1492-1550), âgée de 24 ans par Hans Suess von Kulmbach, 1515, National Gallery of Ireland.
Auto-enterrement de saint Jean l'évangéliste par Hans Suess von Kulmbach, 1516, basilique Sainte-Marie de Cracovie.
Portraits de Laurent de Médicis, duc d'Urbin par des peintres vénitiens
« Quant à Florence, 1513 a également vu un autre Médicis, Laurent de Médicis (le petit-fils de Laurent le Magnifique), revenir au pouvoir en tant que "citoyen de premier plan", une évolution heureuse pour certains, odieuse pour d'autres. Lui aussi a poursuivi la campagne des Médicis vers l'expansion, désirant, et avec l'aide de son oncle le pape, obtenir le titre de duc d'Urbin en 1516. C'est à lui, en effet, que Machiavel finit par dédier Le Prince, dans l'espoir, vain rétrospectivement, que Laurent pourrait devenir le rédempteur recherché de l'Italie pour qui les dernières lignes du Prince crient avec tant d'urgence. En tant que duc d'Urbin, il épousa une fille du comte d'Auvergne, avec qui il eut une fille, Catherine de Médicis, qui deviendra plus tard reine de France » (d'après « Machiavelli: A Portrait » de Christopher Celenza, p. 161).
Laurent, né à Florence le 12 septembre 1492, reçut le nom de son éminent grand-père paternel Laurent le Magnifique. Tout comme pour son grand-père, l'emblème de Laurent était le laurier, à cause du jeu sur les mots laurus (laurier) et Laurentius (Lorenzo, Laurent). Une médaille en bronze coulée par Antonio Francesco Selvi (1679-1753) dans les années 1740, inspirée de la médaille créée par Francesco da Sangallo (1494-1576), représente le duc de profil avec une inscription en latin LAVRENTIVS. MEDICES. VRBINI.DVX.CP. à l'avers et un laurier avec un lion, généralement considéré comme symbole de force, de chaque côté avec la devise qui dit : .ITA. ET VIRTVS. (Ainsi aussi est la vertu), pour signifier que la vertu comme le laurier est toujours verte. Une autre médaille de Sangallo au British Museum (numéro d'inventaire G3,TuscM.9) montre également une couronne de laurier autour du champ au verso. Le soi-disant « Portrait d'un poète » de Palma Vecchio à la National Gallery de Londres, acheté en 1860 à Edmond Beaucousin à Paris, est généralement daté d'environ 1516 en se basant sur le costume (huile sur toile, transférée sur bois, 83,8 x 63,5 cm, NG636). Le laurier derrière l'homme a la même signification symbolique que le laurier sur les médailles du duc d'Urbin et son visage ressemble beaucoup aux effigies de Laurent de Médicis par Raphaël et son atelier. Le même homme a également été représenté dans une série de peintures de peintres vénitiens montrant le Christ comme le Rédempteur du monde (Salvator Mundi). L'une attribuée à Palma Vecchio est exposée au Musée des Beaux-Arts de Strasbourg (huile sur panneau, 74 x 63 cm, MBA 585), l'autre au Musée national de Wrocław (huile sur toile, 78,5 x 67,7, VIII-1648, achetée en 1966 à Zofia Filipiak), peut-être issue de la collection royale polonaise, a été peinte plutôt dans le style de Giovanni Cariani ou de Bernardino Licinio, et une autre dans le Agnes Etherington Art Center de Kingston (huile sur toile, 76,8 x 65 cm, 10-011) est attribué à Girolamo da Santacroce de Bergame, élève de Gentile Bellini, actif principalement à Venise. Cette pratique de portraits déguisés, habillés en saints chrétiens ou en membres de la Sainte Famille, était populaire au sein de la famille Médicis depuis au moins le milieu du XVe siècle. Le meilleur exemple est un tableau commandé en Flandre - la Madone des Médicis avec des portraits de Piero di Cosimo de' Medici (1416-1469) et de son frère Giovanni (1421-1463) en saints Côme et Damien, peint par Rogier van der Weyden entre 1460 et 1464 lorsque l'artiste travaillait à Bruxelles (Städel Museum, 850). Comme dans « Le Prince » de Machiavel, le message est clair, « plus qu'un simple prince, Laurent peut devenir un "rédempteur" qui chasse d'Italie la "domination barbare [qui] pue tout le monde" » (d'après « Apocalypse without God: Apocalyptic Thought, Ideal Politics, and the Limits of Utopian Hope» de Ben Jones, p.64).
Portrait de Laurent de Médicis (1492-1519), duc d'Urbin par Palma Vecchio, vers 1516, National Gallery de Londres.
Portrait de Laurent de Médicis (1492-1519), duc d'Urbin en Rédempteur du monde (Salvator Mundi) par Palma Vecchio, vers 1516, Musée des Beaux-Arts de Strasbourg.
Portrait de Laurent de Médicis (1492-1519), duc d'Urbin en Rédempteur du monde (Salvator Mundi) par Giovanni Cariani ou Bernardino Licinio, vers 1516, Musée national de Wrocław.
Portrait de Laurent de Médicis (1492-1519), duc d'Urbin en Rédempteur du monde (Salvator Mundi) par Girolamo da Santacroce, vers 1516, Centre d'art Agnès Etherington.
Portrait de Barbara Zapolya par Lucas Cranach l'Ancien
En 1535, une somptueuse cérémonie de mariage eut lieu au château de Wawel à Cracovie. Hedwige, la fille unique de Sigismond Ier l'Ancien et sa première épouse Barbara Zapolya était mariée à Joachim II Hector, électeur de Brandebourg.
La mariée a reçu une grosse dot, y compris un coffret, maintenant au Musée de l'Ermitage, commandé par Sigismond Ier en 1533 et orné de bijoux de la collection de Jagellon, composés de 6,6 kg d'argent et de 700 grammes d'or, ornés de 800 perles, 370 rubis, 300 diamants et autres pierres précieuses, dont un bijou en forme de lettre S. Le même monogramme est visible sur les manches de la robe d'Hedwige dans son portrait par Hans Krell d'environ 1537. Une bague avec la lettre S est sur le monument funéraire de Sigismond dans la cathédrale de Wawel et il a également frappé des pièces de monnaie avec une S. Hedwige a sans doute emporté aussi avec elle à Berlin un portrait de sa mère. Le portrait d'une femme avec collier et ceinture avec monogramme B&S, daté par les experts d'environ 1512, qui se trouvait dans la collection impériale de Berlin avant la Seconde Guerre mondiale, maintenant dans une collection privée (huile sur panneau, 42 x 30 cm), est parfois identifié comme représentant Barbara Jagellon, duchesse de Saxe et la belle-sœur de Barbara Zapolya. Un pendentif avec le monogramme des époux SH (Sophia et Henricus) est visible sur la pierre tombale de Sophie Jagellon (1522-1575), duchesse de Brunswick-Lunebourg, fille de Sigismond et de sa seconde épouse Bona Sforza, à l'église Sainte-Marie de Wolfenbüttel. De tels bijoux avec des monogrammes, appelés « lettres » (litera/y), étaient populaires et sont mentionnés dans de nombreux inventaires. Parmi plus de 250 bagues de la reine Bona, il y avait une bague en émail noir, un diamant, des rubis et une émeraude, sur laquelle figuraient les lettres BR (BONA REGINA) et trois autres avec la lettre B. Les filles de Sigismond, Sophie, Anna et Catherine, possédaient les bijoux avec les lettres S, A et C de la première lettre de leurs noms en latin dont seul le bijou de Catherine a survécu (Musée de la cathédrale d'Uppsala). Ils ont été réalisés en 1546 par Nicolas Nonarth à Nuremberg et représentés dans leurs portraits par l'atelier de Lucas Cranach le Jeune. Florian, orfèvre de la cour entre 1502-1540, aîné de la guilde en 1511, fut payé dans les années 1510-1511 pour divers travaux pour le roi et son fils illégitime Jean (1499-1538), plus tard évêque de Vilnius et Poznań. Il fabriqua des ceintures en argent pour le roi, un socle pour une horloge, des harnais pour chevaux, des gobelets pour la maîtresse du roi Katarzyna Telniczanka et des ustensiles en argent pour la salle de bain royale (d'après « Mecenat Zygmunta Starego ... » d'Adam Bochnak, p. 137). La feuille d'or avec sainte Barbe réalisée comme fond du tableau de Notre-Dame de Częstochowa est considérée comme un cadeau de la reine Barbara offert lors d'un pèlerinage au monastère le 27 octobre 1512. Le collier et la ceinture en forme de chaînes avec des initiales sont clairement une allusion à une grande affection, ainsi les lettres doivent être les initiales de la femme et de son mari. Si le tableau était une effigie de Barbara Jagellon, les initiales seraient B et G ou G et B pour Barbara et son mari George (Georgius, Georg), duc de Saxe. Le monogramme doit être alors de Barbara Zápolya et Sigismond Ier, les parents d'Hedwige, donc le portrait est l'effigie de sa mère.
Portrait de Barbara Zapolya (1495-1515), reine de Pologne avec collier et ceinture avec monogramme B&S (Barbara et Sigismundus) par Lucas Cranach l'Ancien ou atelier, vers 1512-1515, collection particulière.
Portraits du roi Sigismond Ier et de la reine Barbara Zapolya par l'atelier de Michel Sittow
Du 15 au 26 juillet 1515, le premier congrès de Vienne a eu lieu, en présence de l'empereur romain germanique, Maximilien I, et des frères Jagellons, Vladislas II, roi de Hongrie et roi de Bohême, et Sigismond I, roi de Pologne et Grand Duc de Lituanie. La réunion est devenue un tournant dans l'histoire de l'Europe centrale. En plus des arrangements politiques, Maximilien et Vladislas ont convenu d'un contrat d'héritage et ont arrangé un double mariage entre leurs deux maisons. Après la mort de Vladislas, et plus tard de son fils et héritier, le traité de succession mutuelle Habsbourg-Jagellon a finalement accru le pouvoir des Habsbourg et diminué celui des Jagellons.
Dans les années 1510, Michel Sittow, qui a travaillé comme portraitiste de cour pour les Habsbourg et d'autres maisons royales importantes en Espagne et aux Pays-Bas, a peint un portrait d'un homme avec la croix brodée de l'ordre espagnol de Calatrava sur sa poitrine, aujourd'hui dans le National Gallery of Art de Washington. Cet homme est identifié comme Don Diego de Guevara (mort en 1520), trésorier de Marguerite d'Autriche (gouvernante des Pays-Bas de 1507 à 1515, fille de l'empereur Maximilien Ier), chevalier de l'ordre de Calatrava, qui possédait l'un des plus beaux collections d'art néerlandais, dont le célèbre portrait d'Arnolfini de Jan van Eyck. Il a également servi d'autres ducs successifs de Bourgogne et comme ambassadeur. Ce portrait formait à l'origine un diptyque avec la Vierge à l'Enfant et l'oiseau de Sittow, aujourd'hui à la Gemäldegalerie de Berlin. La Vierge Marie a les traits d'une femme identifiée comme Mary Rose Tudor (1496-1533), sœur d'Henri VIII d'Angleterre, qui était fiancée à Charles V, futur empereur romain germanique, en 1507. Ce portrait de Sittow et une copie se trouvent au Kunsthistorisches Museum de Vienne (GG 5612, GG 7046). Le mariage était prévu pour 1514, mais n'a pas eu lieu, en raison de la maladie de Charles. Les Habsbourg commandent alors le portrait de la mariée pour apaiser le furieux Henri VIII, cependant, l'engagement a été annulé. Pour ses efforts pour provoquer le double mariage en 1515, le roi Sigismond reçut une assurance écrite de Maximilien qu'il travaillerait dans l'empire pour faire reconnaître les revendications polonaises contre l'Ordre teutonique et assurer la fin du soutien des Moscovites dirigé contre la Pologne (d'après « Schicksalsorte Österreichs » de Johannes Sachslehner, p. 71-77). Le congrès des monarques a été commémoré dans une série de gravures sur bois par les plus grands artistes travaillant pour les Habsbourg - une gravure sur bois de Hans Burgkmair, Leonard Beck, Hans Schaufelein ou Hans Springinklee de la série « Le roi blanc » (Der Weisskunig) montrant le premier rencontre entre Bratislava et Hainburg an der Donau le 15 juillet 1515 (Bibliothèque nationale d'Autriche à Vienne) et Le Congrès des princes de l'Arc de triomphe de l'empereur Maximilien Ier d'Albrecht Dürer (Metropolitan Museum of Art). Sigismond, en tant que fils d'Élisabeth d'Autriche (1436-1505), était lié à l'empereur, qui à son tour était un petit-fils de Cymburge de Mazovie (décédé en 1429). Sans aucun doute, il a reçu de nombreux portraits de famille des Habsbourg par des artistes tels que Giovanni Ambrogio de Predis, Albrecht Dürer, Bernhard Strigel, Hans Burgkmair, Hans Maler zu Schwaz, Joos van Cleve, Bernard van Orley, Jacopo de' Barbari et Michel Sittow, mais maintenant, il avait l'occasion de rencontrer certains d'entre eux. Le roi de Pologne était sûrement émerveillé par la splendeur de la cour impériale. Contrairement aux puissants dirigeants nationaux ou impériaux : Henri VII en Angleterre, Ferdinand et Isabelle en Espagne, Louis XI en France et Maximilien Ier dans le Saint Empire romain germanique, dont le règne était de plus en plus conçu et exprimé en termes « absolutistes » (d'après « A Cultural History of Theatre in the Early Modern Age » de Robert Henke, p. 16), en tant que monarque électif (élection du 20 octobre et du 8 décembre 1506) dont le budget était strictement contrôlé par les nobles polonais, lituaniens et ruthènes et le parlement, il ne pouvait pas se permettre de dépenser de grosses sommes pour garder de tels artistes à sa cour. Déjà lors du Sejm du couronnement en 1507, Sigismond Ier s'engageait à fournir au Sénat les comptes du Trésorier de la Couronne sur les dépenses publiques (d'après « Sejm Rzeczypospolitej... » de Stefania Ochmann-Staniszewska, Zdzisław Staniszewski, p. 204). Cependant, il pourrait leur avoir commandé quelques peintures. Entre 1514 et 1516, Sittow a effectué différentes missions pour les Habsbourg. En 1514, il visite Copenhague pour peindre le portrait de Christian II de Danemark pour Marguerite d'Autriche. Le portrait faisait partie de la diplomatie pour les fiançailles du roi danois avec la nièce de Marguerite, Isabelle d'Autriche. En 1515, il était de nouveau aux Pays-Bas et il est allé en Espagne. Portrait d'un homme avec un grand col de fourrure par disciple de Michel Sittow (huile sur panneau de chêne, 33,8 x 23,5 cm, vendu chez Sotheby's Londres, 06 décembre 2012, lot 101) est largement basé sur le portrait de Diego de Guevara par Sittow, créé selon à différentes sources entre 1514 et 1518. La pose et le costume sont très similaires, ainsi que la composition et même le tapis du parapet. Cependant, le visage est complètement différent. Il semble que l'élève de Sittow ait utilisé le même ensemble de dessins d'étude pour la composition et un autre pour le visage. Le modèle ressemble beaucoup à l'effigie de Sigismond Ier du Congrès des princes d'Albrecht Dürer et à son portrait par Hans von Kulmbach (château de Gołuchów). Le visage à la lèvre inférieure saillante des Habsbourg et des ducs de Mazovie est similaire aux portraits du roi polonais de Christoph Amberger (Palais de Wilanów, perdu) et de Titien (Kunsthistorisches Museum de Vienne), tous deux identifiés par moi. Comme le portrait de de Guevara, ce tableau fait également partie d'un diptyque. La Madone à l'Enfant et l'oiseau du suiveur de Sittow (huile sur panneau de chêne, 34 x 24 cm, vendu chez Koller Auktionen Zürich, 18 mars 1998, lot 20) correspondent parfaitement en termes de composition, de style et de dimensions. Similaire au portrait vendu à Londres, il s'agit d'une copie du tableau de la Vierge de Berlin (Mary Rose Tudor), cependant, le visage est différent et ressemble aux effigies de la reine Barbara Zapolya, première épouse de Sigismond, décédée le 2 octobre 1515, quelques mois après son retour de Vienne. Cette effigie ressemble également au buste en marbre de la reine du château d'Olesko, très probablement créé par un sculpteur néerlandais. Tenant compte du fait que les effigies royales, telles que les portraits de l'empereur Maximilien par Strigel, ont été créées en de nombreuses copies et versions, les effigies décrites pourraient être des copies d'atelier d'originaux perdus par Sittow.
Portrait du roi Sigismond Ier en donateur par l'atelier de Michel Sittow, vers 1515, Collection particulière.
Portrait de la reine Barbara Zapolya en Vierge à l'enfant et l'oiseau par l'atelier de Michel Sittow, vers 1515, Collection particulière.
Portraits de Jan Dantyszek en saint Jean-Baptiste par Joos van Cleve
A partir de 1454 environ, la ville hanséatique de Gdańsk devint le principal port de Pologne-Lituanie et grâce à des privilèges royaux, comme le Grand Privilège de 1457, l'un des points de transbordement européens les plus importants pour le grain. Les liens économiques et culturels de la ville avec les Pays-Bas étaient naturels et forts. Le grain était exporté de Gdańsk et des œuvres d'art comme des pierres tombales en pierre et en métal et des autels en bois, produites là-bas en grande quantité, étaient importées de Flandre (d'après « Złoty wiek malarstwa gdańskiego ... » de Teresa Grzybkowska, p. 44).
Au XVIe siècle, le marché de l'art néerlandais a développé un système efficace de distribution des œuvres d'art. Les retables gothiques tardifs étaient généralement créés sans commande et vendus sur le marché libre. Les artistes s'occupaient également de la vente d'œuvres en dehors de l'atelier et voyageaient à travers le pays ou à l'étranger à cette fin. Dans le cas d'œuvres commandées à une autre ville ou pays, l'artiste était obligé de les livrer au navire. Les artistes organisent également des loteries d'objets d'art, comme celle organisée en 1559 par un peintre malinois - Claude Dorizi. En 1577, un marchand de Lüneburg, Michael Willing, organise une loterie de gravures et de peintures à Gdańsk. Une autre méthode de vente des produits de l'atelier par l'artiste était la participation à la foire d'Anvers ou Bergen-op-Zoom, qui se tenait deux fois par an et était visitée par des marchands de toute l'Europe (d'après « Mecheleńskie reliefy ... » d'Aleksandra Lipinska, p. 189-190). La première œuvre majeure des Pays-Bas « importée » à Gdańsk fut probablement le Jugement dernier de Memling. Cependant, le triptyque n'y était pas destiné, mais commandé vers 1467 par un banquier italien Angelo di Jacopo Tani (1415-1482) pour la chapelle Saint-Michel de Badia Fiesolana près de Florence. Tani était directeur de la Banque Médicis à Bruges de 1455 à 1465. Le navire qui devait prendre la peinture à Florence en 1473 a été capturé peu après avoir quitté le port de Bruges par des corsaires commandés par Paul Beneke et le triptyque a été donné à l'église Sainte-Marie de Gdańsk. Outre le portrait du fondateur Angelo Tani en donateur au revers de l'aile gauche, il contient le portrait de sa femme Caterina di Francesco Tanagli (1446-1492) dans une pose similaire en contrepartie de l'aile droite. Caterina, qui n'a pas pu accompagner son mari lors de son voyage d'affaires aux Pays-Bas en 1467-1469, a été peint en Italie par un artiste florentin (les chercheurs suggèrent le cercle de Filippo Lippi ou Piero del Pollaiuolo), puis son image a été livrée à l'atelier de Memling. Le tableau contient également de nombreux portraits déguisés tels que le portrait de Charles le Téméraire (1433-1477), duc de Bourgogne en saint André, le saint patron du duché de Bourgogne, Tommaso di Folco Portinari (vers 1424-1501) et son épouse Maria Maddalena Portinari née Baroncelli (née en 1456) comme pécheurs et probablement beaucoup d'autres en attente de découverte. Le triptyque a ouvert les portes à l'importation intensive de l'art néerlandais pendant deux siècles. Les retables néerlandais ont trouvé preneur dans les églises de Poméranie à Pruszcz (1500-1510), Gdańsk-Święty Wojciech (vers 1510) ou Żuków (vers 1520) et en 1520 l'atelier malinois de Jan van Wavere a créé un autel pour la chapelle de saint Antoine, également dans l'église Sainte-Marie de Gdańsk, commandée par la guilde des porteurs (aujourd'hui dans l'église de l'ordre teutonique de Vienne). En 1526, la Confrérie de Malbork apporta d'Amsterdam un tableau de la Madone pour la Cour d'Artus à Gdańsk. Avant 1516, le jeune artiste Joos van Cleve (né en 1485/1490), qui n'avait été membre de la Guilde de saint Luc d'Anvers que pendant quatre ou cinq ans, ornait les ailes de l'autel Saint Renaud créé par l'atelier de Jan de Molder à Anvers, aujourd'hui au Musée national de Varsovie (M.Ob.2190). Le polyptyque a été commandé par la Confrérie de saint Renaud à Gdańsk pour la chapelle de ce saint dans l'église Sainte-Marie et il était probablement prêt avant septembre 1516. L'artiste s'est représenté sous les traits de saint Renaud. Ce fut l'un des premiers de ses « portraits allégoriques » au sein de compositions religieuses (d'après « Nieznane autoportrety Joosa van Cleve ... » de Jan Białostocki, p. 468). Les autoportraits de Joos figurent dans la scène de la Cène (Retable de la Lamentation, vers 1525, Musée du Louvre) et dans l'Adoration des mages de Jan Leszczyński (vers 1527, Musée national de Poznań). Ces portraits déguisés étaient populaires aux Pays-Bas depuis au moins le XVe siècle. Les premiers exemples incluent des effigies de Charles le Téméraire (1433-1477), duc de Bourgogne comme l'un des mages bibliques dans le retable de Sainte-Colombe de Rogier van der Weyden (vers 1455, Alte Pinakothek à Munich), en saint André dans le Jugement dernier mentionné et dans l'effigie de ce saint tenant un chapelet (vers 1490, Musée Groeninge à Bruges) par Hans Memling, ainsi que des portraits de Marie de Bourgogne (1457-1482) en sainte Catherine et Marguerite d'York (1446- 1503), duchesse de Bourgogne en sainte Barbe dans le retable de saint Jean (vers 1479, Memlingmuseum à Bruges) et le Mariage mystique de sainte Catherine (vers 1480, Metropolitan Museum of Art), également de Memling. Outre les portraits déguisés, ils contenaient également d'autres références aux mécènes, comme les armoiries, comme dans la Madone des Médicis avec des portraits de Piero di Cosimo de' Medici (1416-1469) et de son frère Giovanni (1421-1463) en saints Côme et Damien de Rogier van der Weyden (1453-1460, Städel Museum de Francfort) ou le Jugement dernier de Memling à Gdańsk avec les emblèmes héraldiques de Tani et de sa femme. Le seul blason de l'autel de saint Renaud se trouve dans la prédelle, qui est parfois attribuée à un artiste différent, peut-être de Gdańsk. La prédelle représente le Christ comme Homme de douleurs avec la Vierge Marie et les saints : Barbe, Catherine d'Alexandrie, Jacques l'Ancien, Sébastien, Adrien de Nicomédie, Antoine l'Abbé et Roch et le blason entre le Christ et Saint Sébastien est une croix des Chevaliers du Saint-Sépulcre de Jérusalem - une croix de Jérusalem en or sur un bouclier rouge, la couleur du sang, pour signifier les cinq plaies du Christ. Le chevalier le plus important du Saint-Sépulcre de Gdańsk (latin Gedanum ou Dantiscum) à cette époque était Jean de Gdańsk ou Johannes von Höfen-Flachsbinder, mieux connu sous le nom de Johannes Dantiscus ou Jan Dantyszek, secrétaire royal et diplomate au service du roi Sigismond, qui voyagea fréquemment à travers l'Europe, notamment à Venise, en Flandre et en Espagne. La croix des Chevaliers du Saint-Sépulcre et les attributs de sainte Catherine d'Alexandrie, commémorant le pèlerinage de Dantyszek en Terre Sainte et le monastère de sainte Catherine sur le mont Sinaï en 1506, sont visibles dans son ex-libris par Hieronymus Vietor, créé en 1530-32, et au revers du modèle en bois pour sa médaille par Christoph Weiditz, créé en 1529. À partir de 1515, Dantyszek était envoyé à la cour impériale à Vienne. De là, il a voyagé trois fois à Venise. Puis il séjourna à la cour impériale d'abord au Tyrol, à partir du 9 février 1516, puis à Augsbourg, d'octobre à fin 1516. Début 1517, il se rendit avec Wilhelm von Roggendorf aux Pays-Bas et tenta de convaincre la petite-fille de l'empereur, Éléonore d'Autriche (1498-1558), pour épouser le monarque polonais (d'après « Jan Dantyszek ... » de Zbigniew Nowak, p. 109). Il est revenu des Pays-Bas par mer à Gdańsk. Dantyszek, qui commandait fréquemment des œuvres d'art à divers artistes qu'il rencontrait à la cour impériale et lors de ses voyages et servait d'intermédiaire dans de telles commandes pour ses amis et mécènes, était indéniablement un visiteur important pour de nombreux artistes aux Pays-Bas. Il n'y a pas de lien direct reliant le retable de Gdańsk à Dantyszek, donc toute référence au diplomate royal était probablement une courtoisie, comme l'effigie mentionnée du duc de Bourgogne en saint André dans le Jugement dernier, commandée par un client italien. Il est possible que certains membres de la Confrérie de saint Renaud aient été représentés dans certaines des scènes de l'autel, mais il devrait y avoir une référence plus forte à la nouvelle maison du polyptyque, qui a été commandé spécifiquement pour l'église Sainte-Marie de Gdańsk. L'effigie de saint Jean-Baptiste au revers de l'aile gauche et d'un compagnon de saint Renaud à l'aile droite doit être considérée comme telle. Si saint Renaud est un autoportrait de l'auteur, saint Jean-Baptiste est aussi le portrait déguisé d'une personne réelle - Jean de Gdańsk, c'est-à-dire Jan Dantyszek. Son visage ressemble à d'autres effigies du secrétaire royal, notamment son portrait par Dosso Dossi (Nationalmuseum de Stockholm), identifié par moi. Un autre Jean-Baptiste très similaire, attribué à Joos van Cleve se trouve également en Pologne, dans la collection du Château Royal de Varsovie (ZKW/3629/ab). Certains chercheurs voient le tableau comme une œuvre italienne, très probablement vénitienne - la composition, la plastique, les couleurs en parlent, mais la construction technologique prouve sa provenance néerlandaise (d'après « The Royal Castle in Warsaw: A Complete Catalogue of Paintings ... » par Dorota Juszczak et Hanna Małachowicz, p. 542-544). C'est probablement parce que le peintre a copié une peinture vénitienne, peut-être de Titien, et s'est inspiré de son style de coups de pinceau audacieux et flous et de composition. Ces impacts mutuels sont visibles dans les portraits de Jan Dantyszek par l'atelier de Marco Basaiti (Musée de l'Université Jagellonne) et par Jacob van Utrecht (collection privée) et dans les portraits de François Ier, roi de France - la fourrure dans son portrait par l'atelier de Joos van Cleve (château royal de Varsovie, ZKW/2124/ab) est peint dans un style similaire à celui de saint Jean-Baptiste et la pose du roi dans un tableau du peintre vénitien (collection privée), indique qu'il a copié une œuvre d'un maître néerlandais. Stylistiquement la peinture a été datée d'environ 1520, cependant, l'examen dendrochronologique du tableau indique le début des années 1540 comme l'époque probable de la création, ce qui n'exclut pas la paternité de Joos car il est mort en 1540 ou 1541, ou son fils Cornelis, qui a peint dans un style similaire et est mort entre 1567 et 1614. Le tableau était une propriété de Sosnicki en 1952, probablement à Saint-Pétersbourg, et en 1994, il a été offert par Edward Kossoy au château reconstruit à Varsovie.
Portrait de Jan Dantyszek en saint Jean-Baptiste et autoportrait en saint Renaud par Joos van Cleve, avant 1516, Musée national de Varsovie.
Portrait de Jan Dantyszek en saint Jean-Baptiste par Joos van Cleve ou suiveur, 1520-1541, Château Royal de Varsovie.
Portraits de Barbara Jagellon contre les vues idéalisées de Meissen et Königstein par Lucas Cranach l'Ancien
« Et puisque l'état de Lech s'est avéré être fondé dans une zone contenant de vastes forêts et bosquets que les anciens croyaient être habités par Diane et que Diane revendiquait le pouvoir sur eux, Cérès, d'autre part, était considérée comme la mère et la déesse de les récoltes dont le pays avait besoin, [donc] ces deux déesses : Diane dans leur langue appelée Dziewanna et Cérès appelée Marzanna jouissaient d'un culte et d'une dévotion particuliers », écrit Jan Długosz (1415-1480), chroniqueur et diplomate, dans ses « Annales ou chronique du glorieux royaume de Pologne » (Annales seu Cronicae incliti Regni Poloniae), écrit entre 1455 et 1480. En 1467, il se voit confier la tutelle des fils du roi Casimir IV Jagellon.
Devana (Dziewanna en polonais), déesse de la nature sauvage, des forêts, de la chasse et de la lune vénérée par les Slaves occidentaux, est également mentionnée par Maciej Stryjkowski dans sa « Chronique de la Pologne, de la Lituanie, de la Samogitie et de toute la Ruthénie de Kiev, Moscou ... » (Kronika Polska Litewska, Zmodzka, y wszystkiey Rusi Kijowskiey, Moskiewskiey...), publié à Königsberg (aujourd'hui Kaliningrad) en 1582 : « Diane, la déesse de la chasse, était appelée par les Sarmates Ziewonia ou Devana dans leur langue ». Néanmoins, selon certains chercheurs, comme Aleksander Brückner (1856-1939), Długosz, inspiré par la mythologie romaine, a inventé ou modifié des croyances pour correspondre à la divinité romaine. Dans un pays multiculturel où beaucoup de gens parlaient latin, il était facile d'avoir une telle inspiration. Une autre invention ultérieure inspirée par la forte culture latine en Pologne-Lituanie et l'art du XVIe siècle pourrait être Milda, la déesse lituanienne de l'amour, comparée à Vénus romaine. Dans la mythologie romaine, les aides de Diane sont des nymphes, dont les homologues slaves les plus proches sont des déesses (boginki), ou roussalki (rusałki), fréquemment associées à l'eau et représentées comme de belles filles nues, comme dans le tableau du peintre russe Ivan Gorokhov de 1912. Les légendaires nymphes de l'eau, censées vivre dans les eaux du lac Svitiaz en Biélorussie (Świteź en polonais), s'appelaient świtezianki. La légende dit que les świtezianki tentent les garçons qui en tombent amoureux puis les noient dans les vagues du lac (d'après « Duchy Kresów Wschodnich » d'Alicja Łukawska, p. 151). La nymphe romaine de la source sacrée, Egérie, est mentionnée par Długosz dans ses Historiae Polonicae Liber XIII Et Ultimus, comme conseiller de Numa Pompilius, le deuxième roi de Rome (Et exempla non defunt. Nam complures legiferi ita fecerunt: apud Græcos Pisistratus, apud Romanos Numa cum sua Nympha Egeria &c). Selon la légende, en tant qu'épouse divine de Numa, elle l'a conseillé sur les décisions importantes et lui a ainsi montré le chemin d'un gouvernement sage. Le tableau de 1885 du peintre espagnol Ulpiano Checa au musée du Prado à Madrid montre la nymphe Egérie dictant les lois de Rome à Numa Pompilius. Egérie était vénérée par les femmes enceintes parce qu'elle, comme Diane, pouvait leur accorder un accouchement facile. Avant 1500, l'intérieur de la partie résidentielle du château d'Albrechtsburg à Meissen fut reconstruit pour Barbara Jagellon (1478-1534) et son mari Georges le Barbu (1471-1539), duc de Saxe. Ce château médiéval a été érigé sur le site de l'ancienne colonie slave de Misni habitée par des Daleminciens. Une autre reconstruction, à plus grande échelle, a eu lieu entre 1521 et 1524, lorsque Jacob Haylmann a achevé la salle des armoiries au 2e étage et 3e étage du palais et qu'une annexe sépulcrale séparée a été créée à la cathédrale, la soi-disant Capella Ducis Georgii pour Georges et sa femme. Le couple résidait principalement dans le siège ancestral de la lignée Albertine de la maison de Wettin, à Dresde, à l'origine également une colonie slave, appelée Drežďany en sorabe. Barbara a donné naissance à 10 enfants, dont six sont morts en bas âge. Elle est décédée à Leipzig à l'âge de 55 ans et a été enterrée dans la cathédrale de Meissen dans une chapelle funéraire construite par son mari. Barbara et Georges sont le dernier couple de la maison de Wettin à être enterré dans la cathédrale de Meissen. Le retable de la chapelle funéraire a été créé par Lucas Cranach l'Ancien peu après la mort de Barbara et représente le couple en tant que donateurs entourés d'apôtres et de saints. Le tableau d'une nymphe à la fontaine de Lucas Cranach l'Ancien, aujourd'hui au Museum der bildenden Künste de Leipzig (huile sur panneau, 59 x 91,5 cm, numéro d'inventaire 757), provient de la collection de l'historien de l'art Johann Gottlob von Quandt (1787-1859) à Dresde, acquis par le musée en 1901. Ce tableau est signé de l'insigne de l'artiste et daté « 1518 » sur la fontaine dont le pilier est orné d'une statue de faune nu. Les faunes et les nymphes ont été parmi les premiers habitants de la Rome primitive, selon l'Énéide de Virgile (Haec nemora indigenae Fauni nymphaeque tenebant). Le paysage derrière elle est son royaume magique et légendaire, cependant la topographie et la forme générale des édifices correspondent parfaitement à Meissen, comme dans la vue de la ville publiée vers 1820 dans « Les 70 vues pittoresques et vues des environs de Dresden ... » (70 mahlerische An- und Aussichten der Umgegend von Dresden ...) de Carl August Richter et Ludwig Richter. Cela semble aussi être une sorte d'énigme pour le spectateur. Sur la droite, nous pouvons voir Albrechtsburg en guise de sa demeure, en dessous se trouve la ville de Meissen avec l'église et l'Elbe. Le visage d'une femme ressemble beaucoup à Barbara Jagellon, duchesse de Saxe, d'après ses effigies en Lucrèce et la composition est similaire au portrait de la sœur de Barbara, la princesse Élisabeth Jagellon (1482-1517) en tant qu'Egérie (pavillon de chasse de Grunewald à Berlin). A travers cette image en guise de nymphe Egérie, conseillère du roi de Rome, la duchesse de Saxe a voulu exprimer la puissance de la sagesse féminine. Se référant à roussalka, la duchesse joue avec l'aspect périlleux de la nature féminine - « Je suis la Nymphe de la Source Sacrée : Ne dérangez pas mon sommeil. Je me repose » (FONTIS NIMPHA SACRI SOMNVM NE RVMPE QVIESCO), se lit l'inscription latine sur la fontaine sous la statue du faune vaincu tenant une lance brisée. La même femme était représentée dans un autre tableau nu, la montrant comme Lucrèce, une femme noble de la Rome antique, l'incarnation de la vertu et de la beauté féminines. Son visage ressemble beaucoup à celui de Lucrèce, qui se trouvait à la fin du XIXe siècle dans la collection de Wilhelm Lowenfeld à Munich, l'image de Barbara Jagellon. Le paysage derrière elle représente Königstein (lapide regis, « Rocher du roi ») près de Dresde, en Suisse saxonne. Le lieu tire son nom du château des rois de Bohême, qui contrôlaient la vallée de l'Elbe. La forteresse était probablement un bastion slave dès le XIIe siècle, mais elle n'est pas mentionnée dans les chroniques avant l'année 1241 (d'après « The Story of the Encyclopaedia Britannica, 1768-1943 » de Paul Robert Kruse, p. 896). En 1459, elle passa officiellement aux margraves de Meissen. En 1516, le duc Georges le Barbu, farouche opposant à la Réforme, fonda une abbaye célestine sur le Königstein, dédiée à la Vierge Marie, néanmoins, de plus en plus de moines s'enfuirent jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un moine et une femme en couches, d'où la fermeture du monastère en 1524. Le plateau rocheux, visible dans la peinture de Cranach, ressemble beaucoup à la vue de Königstein par Matthäus Merian, publiée dans la Topographia Superioris Saxoniae (1650, partie de Topographia Germaniae), ainsi qu'à la vue de la forteresse de Königstein vers 1900 (photochrome). Ce tableau se trouve aujourd'hui dans la Forteresse de Cobourg (huile sur panneau, 85,5 x 57,5 cm, numéro d'inventaire M.162), où se trouvent également des portraits de la sœur de Barabra Élisabeth Jagellon (1482-1517), duchesse de Legnica en Lucrèce (M.039) et sa nièce la princesse Hedwige Jagellon (1513-1573) contre la vue idéalisée de Cracovie (M.163), toutes deux de Cranach ou de son atelier. Il provient d'anciennes possessions ducales de Cobourg et a été enregistré en 1851 au château de Cobourg. L'oeuvre est attribuée à Lucas Cranach l'Ancien ou à son fils Hans Cranach et datée d'environ 1518-1519 soit environ 1530. Avec la chute du royaume de Vénus en Europe centrale au XVIIe siècle, de nombreuses effigies de cette importante souveraine de la dynastie jagellonne ont également été oubliées et elle est connue aujourd'hui par des portraits moins favorables en costume noir avec ses cheveux recouverts d'un bonnet, soumise à la puissance de Dieu et de son mari, exactement comme les hommes voulaient la voir.
Portrait de Barbara Jagellon (1478-1534), duchesse de Saxe en nymphe des eaux Égérie couchée contre la vue idéalisée de Meissen par Lucas Cranach l'Ancien, 1518, Museum der bildenden Künste à Leipzig.
Portrait de Barbara Jagellon (1478-1534), duchesse de Saxe en Lucrèce contre la vue idéalisée de Königstein par Lucas Cranach l'Ancien ou Hans Cranach, vers 1518-1519 ou vers 1530, Veste Coburg.
Portrait de Bona Sforza par le peintre vénitien
« Quant à la beauté, elle n'est en rien différente du portrait que M. Chryzostom a apporté, ses cheveux sont d'un beau blond clair, quand (curieusement) ses cils et sourcils sont complètement noirs, les yeux plutôt angéliques qu'humains, le front radieux et serein , nez droit sans aucune bosse ni courbure », décrit Bona Sforza d'Aragona le 21 décembre 1517 dans sa lettre au roi Sigismond Ier, Stanisław Ostroróg, châtelain de Kalisz.
Déjà en 1517, le banquier royal et principal fournisseur de Sigismond, Jan Boner, reçut l'ordre d'apporter de Venise du satin en trois couleurs : cramoisi, blanc et noir, velours rouge et brocart et d'acheter une bague avec un gros diamant à Cracovie ou à Venise pour 200 ou 300 zloty rouges pour le mariage du roi. Les effigies de la reine des années 1520 et 1530 confirment son goût particulier pour différents types de filets à cheveux, très probablement pour exposer ses beaux cheveux, tandis que les chasubles qu'elle a fondées, peut-être fabriquées à partir de ses robes (à Cracovie et Łódź), confirment que des tissus et des broderies similaires à celles visibles sur le portrait étaient en sa possession. L'arche, la robe, le filet à cheveux et la coiffure à l'effigie de la reine Bona publiée à Cracovie en 1521, sont étonnamment semblables. Le graveur s'est sans aucun doute basé sur le portrait peint de la reine, éventuellement une autre version du tableau à Londres. La chasse au lapin sur son corsage est une allusion à la fertilité de la reine et à sa capacité à produire des héritiers mâles à Sigismond, âgé de plus de 50 ans. Le tableau décrit de l'école vénitienne, aujourd'hui à la National Gallery de Londres (huile sur panneau, 36,8 x 29,8 cm, numéro d'inventaire NG631), est généralement daté d'environ 1510-1520. Il a été acheté à la collection d'Edmond Beaucousin à Paris, en 1860, comme le portrait de Laurent de Médicis (1492-1519), duc d'Urbin par Palma Vecchio (NG636) de la même époque, identifié par moi. Il est possible que les deux effigies proviennent de la collection royale polonaise, car depuis l'abdication de Jean II Casimir Vasa, qui s'est installé à Paris, de nombreuses collections artistiques de Pologne ont été transférées en France. Ce buste « aux cheveux blonds enfermés dans un filet, et dans une riche robe d'étoffe byzantine brodée » fut initialement attribué à Francesco Bissolo (1470/72-1554), peintre vénitien décrit comme l'élève de Giovanni Bellini, « distingué pour une délicatesse d'exécution et un sens aigu de la couleur » (d'après « Descriptive and Historical Catalogue of the Pictures ... » de Ralph Nicholson Wornum, p. 38). La même femme était représentée sous les traits de la Vierge Marie dans le tableau de Francesco Bissolo, aujourd'hui au Musée national de Varsovie (numéro d'inventaire M.Ob.953, antérieur 128830). La ressemblance de la dame blonde avec d'autres effigies de la reine Bona, notamment le portrait d'atelier de Giovanni Battista Perini (Château royal de Varsovie, ZKW/60) et une miniature de Lambert Sustris ou cercle (Musée Czartoryski, XII-141) est indubitable. Une grande similitude peut également être soulignée avec le portrait de la mère de Bona, Isabelle d'Aragon, duchesse de Milan, peint par Bernardino de' Conti ou cercle d'Ambrogio de Predis (inscrit indistinctement : ISABELLA / SFORZAAL / LAS.DVCHESSA / DICASTRO), de la collection Rothschild - lèvres et cheveux teints. Bien que la coiffure du modèle soit typique de la mode italienne vers 1520, dans ce contexte l'inspiration du portrait romain, en particulier les bustes de l'impératrice romaine Julia Domna (vers 160-217 après JC), est perceptible - buste en marbre de l'atelier romain du fin IIe siècle après J.-C. - début IIIe siècle après J.-C. (Musée des Beaux-Arts de Lyon) et buste Renaissance sculpté en marbre et porphyre du tournant des XVIe et XVIIe siècles (Château royal de Wawel). Julia était la première impératrice de la dynastie des Sévère et dans sa statue en marbre du portique de la fontaine avec lampe à huile à Ostia Antica (Musée Archéologique d'Ostie à Rome), elle était représentée sous les traits de Cérès (Déméter), déesse de l'agriculture, des moissons, fertilité et maternité. Bona s'est inspirée de la Rome antique dans de nombreux aspects de sa vie (son fils était le nouvel Auguste) et les bustes d'empereurs et d'impératrices romains dans des médaillons dans une frise peinte dans la partie supérieure de la cour à arcades du château de Wawel, créé entre 1535 et 1536 par Dionisius Stube, pourraient être son initiative. Selon les récits du XVIIe siècle, les statues des empereurs romains décoraient les intérieurs de Wawel. Il s'agit très probablement de la reine qui était représentée nue avec une coiffure similaire, embrassée par son mari, dans le coin droit du petit tableau peint en 1527 par Hans Dürer représentant la Fontaine de Jouvence (Musée national de Poznań, MNP M 0110, signé et daté centre gauche, sur tronc d'arbre : 1527 / HD). Hans, frère cadet d'Albrecht Dürer, fut nommé peintre de la cour du roi Sigismond Ier en 1527.
Portrait de Bona Sforza d'Aragona (1494-1557), reine de Pologne sur fond d'arc par le peintre vénitien, peut-être Francesco Bissolo, vers 1520, National Gallery de Londres.
Portraits des ducs de Mazovie Stanislas et Janusz III par Giovanni Cariani et Bernardino Licinio
« Ils ont tous deux surpassé de nombreux rois par leur maison, leur élégance mondiale et leur équipement de guerre, et étaient également dignes de leurs célèbres ancêtres », écrit dans son ouvrage Topographia siue Masoviæ descriptio, publié à Varsovie en 1634 Andrzej Święcicki, notaire de la région de Nur, à propos de Stanislas et Janusz III, ducs de Mazovie.
Le 28 octobre 1503 mourut Conrad III le Roux, duc de Mazovie. Ses deux fils mineurs lui succèdent conjointement sous la régence de leur mère Anna (1476-1522), membre ambitieux de la famille lituanienne Radziwill. Outre Stanislas (1500-1524) et Janusz III (1502-1526), elle était la mère de deux filles Sophie (1497/1498-1543) et Anna (vers 1498-1557). La main ferme d'Anna déplut aux nobles. Elle fut régente de Mazovie jusqu'en 1518, date à laquelle, à la suite d'une rébellion de la noblesse, déclenchée par son ancien amant Mrokowski, elle fut forcée de céder le pouvoir à ses fils adultes. Malgré le transfert formel du pouvoir, Anna conserva le pouvoir réel jusqu'à sa mort en 1522. En 1516, la duchesse demanda à l'empereur de soutenir la candidature de sa fille comme épouse du roi polonais Sigismond Ier, il décida cependant d'épouser Bona Sforza. En 1518, elle et ses enfants ont assisté à la cérémonie de mariage de Sigismond Ier avec Bona à Cracovie. La vieille duchesse était connue pour son style de vie somptueux et son penchant pour les hommes. Elle a eu une liaison avec Jan Mrokowski, qu'elle a promu au poste d'archidiacre de Varsovie en 1508 et plus tard avec Andrzej Zaliwski, qui a été nommé châtelain de Wizna (le troisième poste le plus important de la principauté). Elle s'occupe également de l'éducation sexuelle de ses fils en mettant à leur disposition à un moment de leur adolescence 8 de ses dames de cour, parmi lesquelles se trouve la fille du voïvode de Płock, Katarzyna Radziejowska, qui sera plus tard accusée d'avoir empoisonné les ducs. Leur amour de la boisson et des femmes et leur style de vie dissolu ont très probablement contribué à la mort prématurée des deux ducs. Stanislas mourut le 8 août 1524 à Varsovie et Janusz III dans la nuit du 9 au 10 mars 1526. Ils furent inhumés dans la cathédrale Saint-Jean de Varsovie. Leur sœur Anna a fondé un monument funéraire, le premier exemple de sculpture de la Renaissance en Mazovie, créé par un sculpteur italien vers 1526, très probablement Bernardino Zanobi de Gianotis, dit Romanus, de Florence ou de Rome, actif en Pologne depuis 1517. La dalle, en marbre rouge hongrois « royal », a préservé la destruction du temple pendant la Seconde Guerre mondiale et représente les ducs ensemble, enlacés. Les deux ducs ont été montrés ensemble dans toutes les effigies connues, avant cet article - créées au XVIIème siècle d'après l'original d'environ 1510 (au Musée de l'Ermitage et au Château Royal de Varsovie). À la mort de jeunes princes, leur duché fut annexé par Sigismond Ier tandis que Bona Sforza était fréquemment accusée d'avoir empoisonné Stanislas et son frère. Selon des études anatomiques et anthropologiques des squelettes des deux ducs, publiées en 1955, Janusz III (squelette 1) était subnordique et mesurait environ 176,4 cm de haut et Stanislaus (squelette 2) de type nordique avec des « cheveux roux » et environ 183 cm de haut. Les examens spécialisés n'ont révélé aucune trace de poison. Les deux princes ont été enterrés dans des costumes en soie vénitienne - fragment de tissu avec des médaillons du cercueil de Janusz III et fragment de tissu damassé avec un motif de couronne du cercueil de Stanislas. Les cercueils étaient probablement recouverts d'un tissu de soie avec des aigles, un arbre de vie et une couronne stylisée en forme de fleur (maintenant au Musée de Varsovie), créé à Lucques à la fin du XVe siècle. Outre le commerce, des contacts importants entre la Mazovie et Venise remontent au Moyen Âge. En 1226, Konrad Ier, duc de Mazovie et de Cujavie, ayant des difficultés avec des raids constants sur son territoire et désireux de devenir le haut duc de Pologne, invita l'ordre militaire religieux des chevaliers teutoniques à pacifier ses voisins les plus dangereux et à sauvegarder son territoire. Cette décision eut par la suite des conséquences bien pires pour tout l'État polonais. En 1309, les chevaliers ont déplacé leur siège de Venise à Malbork (Marienburg). Le double portrait dit des frères Bellini est signalé dans la collection royale française depuis au moins 1683 (numéro d'inventaire 107, à la manière de Giovanni Bellini, aujourd'hui au Louvre, huile sur toile, 45 x 63 cm, INV 101 ; MR 59). Il est maintenant attribué à Giovanni Cariani et les costumes sont typiques d'environ 1520, donc il ne peut s'agir des Bellini, décédés en 1507 (Gentile) et en 1516 (Giovanni). Edgar Degas, croyant qu'il s'agit de l'effigie des célèbres Vénitiens, a créé une copie de ce portrait (château de Saltwood, huile sur toile, 43 x 63 cm). Ce portrait est connu de plusieurs versions dont certaines sont attribuées à Vittore di Matteo, dit Vittore Belliniano, fils de Matteo, élève de Gentile Bellini. La version du Museum of Fine Arts de Boston (huile sur toile, 43,8 x 59,3 cm, 50.3412) est très similaire à la peinture du Louvre. Dans la version du Museum of Fine Arts de Houston (huile sur toile, 45,7 x 63,2 cm, 44.553), qui était dans la collection Solly à Londres jusqu'en 1821, les hommes ont changé de place. Un autre, de même composition que le tableau du Louvre, a été coupé en deux (un indistinctement monogrammé en bas à droite). Les deux tableaux font désormais partie de collections privées (huile sur toile, 44,3 x 35,3 cm, Christie's à Londres, vente 4936, 4 mai 2012, lot 63 et huile sur toile, 44,8 x 31,8 cm, Christie's à Londres, vente 6360, 6 juillet 2012, lot 57). La moitié d'un autre tableau ou une composition distincte, attribuée à Vittore Belliniano, se trouvait à l'Ermitage avant 1937 et auparavant dans la collection Barbarigo à Venise (huile sur toile, 42,5 x 36,5 cm, Christie's à Londres, vente 17196, 5 juillet 2019, lot 174). Le nombre de copies contemporaines de ce tableau indique également que les deux hommes étaient d'importants dirigeants européens dont les effigies étaient réparties dans toute l'Europe de la Renaissance. Ces portraits correspondent parfaitement à l'iconographie connue des deux ducs de Mazovie, ainsi qu'à l'examen de leurs restes. L'homme aux « cheveux roux » a également été représenté dans un autre tableau, également de la collection Solly, à la National Gallery de Londres (huile sur bois, 64,5 x 49,2 cm, NG1052, légué par Miss Sarah Solly, 1879). Il est peint dans le style d'Andrea Previtali, peintre italien également actif à Venise. L'homme « subnordique » a été représenté dans plusieurs portraits de Bernardino Licinio, comme l'effigie tenant un livre au Palais Royal de Turin (huile sur toile, 52 x 51,5 cm, 687, provenant de l'ancienne collection des ducs de Savoie), un portrait tenant son manteau de fourrure, qui se trouvait à la Galerie Manfrin à Venise avant 1851, aujourd'hui en collection privée (huile sur toile, 77,5 x 59,7 cm, Sotheby's à New York, 20 mai 2021, lot 2), un autre portrait tenant des gants au Kunsthistorisches Museum de Vienne (huile sur toile, 58,8 x 53 cm, GG 1928, de la collection de l'archiduc Léopold Guillaume à Bruxelles), et un autre contre un paysage et tenant une canne, en collection de Vittorio Cini (huile sur toile, 32 x 25,5 cm). Dans presque tous les portraits décrits, les modèles sont représentés dans de riches fourrures, y compris du lynx, qui étaient très chers et dont la Pologne et la Mazovie étaient les principaux exportateurs à cette époque. Lèvre inférieure saillante (prognathisme), dite lèvre des Habsbourg, trait héréditaire qui était présent et clairement évident dans la famille des Habsbourg, aurait été introduit dans la famille par Cymburge de Mazovie (1394/1397-1429), duchesse d'Autriche de 1412 à 1424. Dans son « Anatomie de la mélancolie » (1621), Robert Burton, écrivain anglais, l'utilise comme exemple de transmission héréditaire (d'après Manfred Draudt « Between Topographical Fact and Cliché: Vienna and Austria in Shakespeare and other English Renaissance Writing »). La mâchoire inférieure saillante est visible dans tous les portraits de Cariani et Licinio. La reconstruction virtuelle des visages des deux ducs montre également la « lèvre des Habsbourg ».
Portrait de Stanislas (1500-1524) et Janusz III (1502-1526), ducs de Mazovie par Giovanni Cariani, vers 1520, Musée du Louvre.
Portrait de Stanislas (1500-1524) et Janusz III (1502-1526), ducs de Mazovie par Edgar Degas d'après l'original de Giovanni Cariani, 1858-1860, Château de Saltwood.
Portrait de Stanislas (1500-1524) et Janusz III (1502-1526), ducs de Mazovie par l'atelier de Giovanni Cariani, vers 1520, Museum of Fine Arts à Boston.
Portrait de Stanislas (1500-1524) et Janusz III (1502-1526), ducs de Mazovie par Vittore Belliniano ou Giovanni Cariani, vers 1520, Museum of Fine Arts à Houston.
Portrait de Stanislas (1500-1524), duc de Mazovie par Vittore Belliniano ou Giovanni Cariani, vers 1520, Collection particulière.
Portrait de Stanislas (1500-1524), duc de Mazovie par l'atelier Giovanni Cariani, vers 1520, Collection particulière.
Portrait de Stanislas (1500-1524), duc de Mazovie par le peintre italien, très probablement Andrea Previtali, vers 1518, National Gallery de Londres.
Portrait de Janusz III (1502-1526), duc de Mazovie par l'atelier Giovanni Cariani, vers 1520, Collection particulière.
Portrait de Janusz III (1502-1526), duc de Mazovie tenant un livre de Bernardino Licinio, vers 1518-1524, Palais Royal de Turin.
Portrait de Janusz III (1502-1526), duc de Mazovie par Bernardino Licinio, vers 1518-1524, Collection particulière.
Portrait de Janusz III (1502-1526), duc de Mazovie tenant des gants par Bernardino Licinio, vers 1524-1526, Kunsthistorisches Museum de Vienne.
Portrait de Janusz III (1502-1526), duc de Mazovie tenant une canne par Bernardino Licinio, vers 1524-1526, collection de Vittorio Cini.
Portrait du duc Stanislas de Mazovie par Hans Krell
Un peintre allemand de la Renaissance, Hans Krell (1490-1565), peut-être formé dans l'atelier de Lucas Cranach l'Ancien à Wittenberg, a commencé sa carrière comme peintre de cour pour Georges (1484-1543), margrave de Brandebourg-Ansbach, un fils de Sophie Jagiellon, à sa cour d'Ansbach. Il suivit ensuite le margrave à la cour de Hongrie et entra au service de Louis II Jagellon, roi de Hongrie, de Croatie et de Bohême, où il servit comme peintre de cour à Prague, Bratislava et Buda de 1522 à 1526. Krell a accompagné le roi et la reine dans leurs voyages et a réalisé plusieurs portraits du roi, de ses proches et de ses courtisans.
En 1522, il réalise un certain nombre de portraits similaires dont celui de la reine Marie d'Autriche (1505-1558), épouse de Louis, à l'occasion de son couronnement en tant que reine de Bohême (1er juin 1522). Le portrait de Marie dans l'Alte Pinakothek de Munich était probablement destiné à servir de cadeau, et la date originale « 1522 » a très probablement été réécrite en « 152(2)4 ». Cette année-là, il peint également le margrave Georges (Musée national hongrois), son jeune frère Albert de Prusse (1490-1568), grand maître de l'ordre teutonique puis premier duc de Prusse (connu d'après une copie du XIXe siècle de Sixtus Heinrich Jarwart) et Jan Bezdružický de Kolowrat (1498-1526), chambellan de Louis Jagiellon (Château de Rychnov nad Kněžnou, probablement une copie de Jan Baltasar Rauch, réalisée avant 1716). Selon Dieter Koepplin, historien de l'art suisse, Krell a également peint la bataille d'Orsha, créée vers 1524-1530, qui était auparavant attribuée au cercle de Lucas Cranach l'Ancien. Le tableau, exposé au Musée national de Varsovie, représente la bataille de 1514 entre la Pologne-Lituanie et le Grand-Duché de Moscou. Cet oeuvre a très probablement été commandé par Constantin (vers 1460-1530), prince d'Ostroh, qui commandait les principales forces de Pologne-Lituanie. La connaissance détaillée de la bataille a été interprétée comme signifiant que l'artiste lui-même a participé à la bataille. Le tableau contient un possible autoportrait, représentant l'artiste en tant qu'observateur de la bataille. Après la mort de Louis, Krell s'installe à Leipzig, où il est documenté en 1533. Vers 1537, il crée un portrait d'Hedwige Jagellon (1513-1573), électrice de Brandebourg (pavillon de chasse Grunewald à Berlin), représentée dans sa robe de mariée avec le monogramme S de son père Sigismund I sur les manches. En 1522, il réalise également un portrait d'homme en manteau de fourrure, qui se trouvait dans la collection de Marczell von Nemes à Munich avant 1936 (huile sur panneau, 48,2 x 33,6 cm). Selon une inscription en latin, cet homme avait 22 ans en 1522 (ETATIS · SVE · ANNORVM · XXII · 1522 ·), exactement comme Stanislas (1500-1524), duc de Mazovie, fils d'Anna Radziwill. L'âge du duc de Mazovie a été confirmé sur une plaque de marbre de sa tombe dans la cathédrale de Varsovie, détruite pendant la Seconde Guerre mondiale. Selon l'inscription en latin il mourut en 1524 à l'âge de 24 ans (OBIERVNT. STANISAVS ANNO SALVTIS M.DXXIV AETATIS SVAE XXIV). L'homme ressemble beaucoup aux effigies du duc blond de Giovanni Cariani et Andrea Previtali et son costume est très proche de celui du roi Louis d'après son portrait par Krell réalisé en 1522 ou 1526 (Kunsthistorisches Museum de Vienne). En 1518, Stanislas et son frère Janusz ont commencé à régner indépendamment en Mazovie, cependant, leur mère Anna Radziwill a détenu le pouvoir réel jusqu'à sa mort en mars 1522. Elle a été enterrée dans l'église de Sainte Anne à Varsovie qu'elle a fondée, construite entre 1515-1521 par Bartłomiej Grzywin de Czersk sur la conception de Michael Enkinger de Gdańsk. Stanislas lui a commandé un monument funéraire, non conservé, l'une des premières sculptures de la Renaissance en Mazovie. Entre 1519-1520 Stanislas et son frère participèrent aux côtés de la Pologne à la guerre contre Albert de Prusse (1490-1568), grand maître de l'ordre teutonique, qui fit la guerre à son oncle Sigismond Ier. Parallèlement, Stanislas secrètement entama des pourparlers avec les chevaliers teutoniques pour un cessez-le-feu, qui eut finalement lieu en décembre 1520.
Portrait de Stanislas (1500-1524), duc de Mazovie, âgé de 22 ans par Hans Krell, 1522, Collection particulière.
Portrait de Beatrice Zurla, chambellane de Bona Sforza par Bernardo Licinio
Bona Sforza est arrivée en Pologne en 1518 avec une suite de treize nobles dames italiennes, dont la plus importante était Beatrice Zurla. Elle est issue d'une famille noble napolitaine et est devenue chambellane de la cour de la reine. Beatrice et une autre Ifigenia de nom inconnu étaient payées 100 florins par an et leur présence en Pologne est confirmée jusqu'en 1521, mais elles sont probablement restées beaucoup plus longtemps. Le poète et secrétaire de la reine Bona, Andrzej Krzycki, aurait appelé Beatrice « la peur des anges noirs et blancs ».
On en sait très peu sur sa vie ultérieure et sa famille proche. Elle était probablement mariée ou veuve car certaines sources l'appelaient une matrone (matrona) (d'après « Działalność Włochów w Polsce w I połowie XVI wieku: na dworze królewskim, w dyplomacji i hierarchii kościelnej », p. 29 ), c'est-à-dire une femme mariée dans la société romaine. Son grand attachement à Bona était très probablement une raison pour laquelle elle a décidé de quitter sa famille. En 1520, un certain noble Leonardo Zurla, peut-être le frère ou le mari de Beatrice, se construisit un magnifique palais à Crema, une ville de Lombardie près de Crémone, qui à partir de 1449 faisait partie de la République de Venise et appartenait auparavant au duché de Milan. En 1523, il fut envoyé à Venise avec deux autres orateurs, pour saluer le nouveau Doge Andrea Gritti. Le portrait attribué à Bernardo Licinio dans l'Ancienne Pinacothèque de Munich vers 1520 montre une femme d'apparence méditerranéenne. Le corsage de sa riche robe est brodé d'un motif de plante grimpante, symbole d'attachement, et elle tient sa main sur son sein droit. C'est une référence aux Amazones, une race scythe de guerrières, une fraternité très unie qui valorisait l'amitié, le courage et la loyauté et qui, selon Hellanicos de Lesbos, aurait retiré leur sein droit pour améliorer leur force d'arc (FGrHist 4 F 107 ). C'est donc un symbole d'attachement à une autre femme très importante. Le livre dans sa main gauche, non identifiable, pourrait être une référence au prénom du modèle et à la plus célèbre Beatrice de la littérature, la muse de Dante, Beatrice Portinari. Il est également possible que la couleur cramoisie de sa robe en tissu vénitien ait une signification symbolique. Jusqu'au milieu du XVIe siècle, la Pologne était le principal exportateur de cochenille polonaise utilisée pour produire une teinture cramoisie, elle est rapidement devenue un symbole national car la majorité de la noblesse polonaise était vêtue de cramoisi. Un autre symbole de sa nouvelle patrie était l'Aigle blanc, tout comme dans son bonnet. Elle est donc habillée comme le drapeau polonais d'aujourd'hui. Le tableau a été transféré à Munich en 1804 du château de Neubourg à Neubourg-sur-le-Danube. Le 8 juin 1642, une arrière-petite-fille de Bona, la princesse Anna Catherine Constance Vasa, staroste de Brodnica, épousa à Varsovie Philippe Guillaume, héritier du comte palatin de Neubourg. Elle apporta une dot considérable en bijoux, estimée en 1645 à la somme astronomique de 443 289 thalers, et en espèces, calculé à un total de 2 millions de thalers. À la fin du XVIe et au début du XVIIe siècle, de telles peintures de cabinet, comme le portrait à Munich, de personnes pas forcément apparentées, deviennent des objets très appréciés dans les collections princières et royales en Europe et leurs Kunstkammer (cabinets d'art). Un collectionneur passionné de ces objets était le cousin d'Anna Catherine Constance, l'archiduc Léopold-Guillaume, qui avait son portrait par Frans Luycx , et qui l'a accompagnée lors de sa visite à ses parents autrichiens et à la ville thermale de Baden-Baden d'août à octobre 1639. Il est fort probable que le portrait de la chambellane de la reine Bona se trouvait sur l'un des 70 chariots qui transportaient l'énorme dot d'Anna Catherine Constance à Neubourg.
Portrait de Beatrice Zurla, chambellane de Bona Sforza, reine de Pologne par Bernardo Licinio, vers 1520, Ancienne Pinacothèque de Munich.
Portrait de l'astrologue royal Luca Gaurico par Giovanni Cariani
Outre les dames nobles, des scientifiques sont également arrivés en Pologne avec Bona Sforza ou pour son mariage en avril 1518. Parmi eux se trouvaient Celio Calcagnini (1479-1541) de Ferrare, qui après son séjour à la cour polonaise a formulé une théorie sur les mouvements du terre semblable à celle proposée par Nicolas Copernic, et Luca Gaurico (1475-1558), dit Lucas Gauricus, astrologue et astronome, né dans le royaume de Naples. On ne sait pas quand il quitta Cracovie, mais selon certaines théories, il devait décider de la date et du programme artistique de la chapelle Sigismond à la cathédrale de Wawel - "Année 1519. Son Altesse, le roi Sigismond de Pologne, le 17 mai, le mardi après sainte-Sophie [...] à 11 heures, a commencé la construction de la chapelle royale de l'église cathédrale par des maçons italiens », selon l'entrée dans l' « Annuaire Świętokrzyski ».
Considéré comme l'un des diseurs de bonne aventure les plus renommés et les plus fiables, Gaurico a ensuite été astrologue du pape Paul III et de Catherine de Médicis, reine de France. Dans les années 1520, il édita quelques livres publiés à Venise, comme De rebus coelestibus aureum opusculum (1526) ou la première traduction latine du grec de l'Almageste de Ptolémée (1528), qui constituent la base des connaissances astronomiques en Europe et dans le monde islamique. Le portrait de Giovanni Cariani à Gemäldegalerie à Berlin (Inv. 2201), créé vers 1520, montre un homme tenant une sphère armillaire avec des signes du zodiaque, contre le paysage avec des collines (peut-être les Monts Euganéens, du grec Eugene - bien né), et l'oiseau volant à travers une brèche dans le mur de pierre vers la lumière de la connaissance. Il tient un manuscrit grec/byzantin (d'après "The Codex and Crafts in Late Antiquity" de Georgios Boudali). L'inscription sur le parapet en grec et en latin n'est pas claire et n'était probablement compréhensible que pour une personne qui a commandé ou reçu le tableau. Grec Σ ΣΕΠΙΓΙΝΟΜΕΝΟΙΣ (S Descendants) et une date en latin AN XI VIII (An 11 8). L'année 1518, lorsque Gaurico arriva en Pologne, était la 11e année du règne de Sigismond Ier l'Ancien, couronné le 24 janvier 1507, et en août 1518, les forces ottomanes assiégèrent Belgrade, qui était alors sous le règne du Royaume de Hongrie. Louis II, roi de Hongrie était le neveu de Sigismond. Les forces turques ont finalement capturé la ville le 28 août 1521 et ont continué à marcher vers le cœur de la Hongrie. Le grec Σ est donc le monogramme de Σιγισμούνδος - Sigismond pour qui le tableau a été créé. Il est hautement probable que Gaurico ait prédit en 1518 l'invasion turque et la chute de l'empire jagellonien en Europe centrale. La provenance du tableau est inconnue, il est possible qu'il ait été transféré à Berlin avec la dot d'Hedwige Jagellon, électrice de Brandebourg ou qu'il ait été pris de Pologne pendant le déluge (1655-1660). De telles peintures de cabinet "anciennes" deviennent très populaire dans les cabinets d'art du XVIIe siècle (Kunstkammer).
Portrait de l'astrologue royal Luca Gaurico (1475-1558) par Giovanni Cariani, vers 1520, Gemäldegalerie à Berlin.
Portraits de Magdalena Bonerówna et Nicolaus II Radziwill par Giovanni Cariani
Le 11 août 1527, la dame d'honneur de la reine Bona Magdalena Bonerówna (1505-1530) épousa à Cracovie Stanislaus Radziwill (ca. 1500-1531), fils de Nicolaus II Radziwill (1470-1521), surnommé Amor Poloniae, un magnat et homme d'État du Grand-Duché de Lituanie. Leur mariage a eu lieu dans les chambres du château royal de Wawel, de nombreuses personnalités y ont participé et le roi lui-même a négocié un règlement de propriété.
Magdalena, la plus jeune fille du marchand de Cracovie Jakob Andreas Boner (1454-1517) et de sa femme Barbara Lechner, a apporté à Stanislas une énorme dot de 12 000 ducats, soit près de trois fois plus que ce que les filles des magnats recevaient à cette époque. Jakob Andreas était le frère de Johann (Hans) Boner (1462-1523), un marchand de Landau in der Pfalz, qui en 1483 émigra à Cracovie. Il fit fortune dans les papeteries et comme marchand d'épices, de métaux, de bois, de bétail, etc. Il devint banquier du roi et principal fournisseur de la cour royale. Jakob Andreas dirigeait une entreprise familiale à Nuremberg et à Wrocław et en 1512, il s'installa à Cracovie, où il acheta à son frère une maison sur la place principale. Sa fille Magdalena est devenue une dame de la cour de la reine vers 1524 ou peut-être plus tôt. Un tableau de Giovanni Cariani du château royal de Wawel à Cracovie représente une femme blonde vêtue d'une robe des années 1520. Le tableau a été transféré à la collection du château royal en 1931 de la collection de Stanisław Niedzielski à Śledziejowice près de Wieliczka. Auparavant, il faisait partie de la collection de Wenzel Anton, prince de Kaunitz-Rietberg, chancelier d'État autrichien qui a contribué aux partages de la Pologne. Sa collection fut vendue aux enchères à Vienne en 1820 par ses héritiers. La même femme en costume similaire a été représentée comme Sainte Marie-Madeleine dans un autre tableau de Cariani montrant Sacra Conversazione avec la Vierge à l'Enfant, Marie-Madeleine et Saint Jérôme de la même période. Marie-Madeleine est une patronne de la prédication des femmes, de la Renaissance morale et des femmes pécheresses et saint Jérôme, qui a encouragé les femmes romaines qui l'ont suivi à étudier et a identifié comment une femme dévouée à Jésus devrait vivre sa vie, était un saint d'une importance particulière pour les femmes pendant la Renaissance. Au Musée national d'art de Biélorussie à Minsk, il y a un autre portrait de la même période, peint dans le style de Cariani, de la collection Radziwill. Sur la base de peintures et de gravures des XVIIe et XVIIIe siècles, il est identifié comme l'effigie de Nicolaus I Radziwill (vers 1440-1509) ou de Petras Mantigirdaitis (décédé en 1459). Cependant, un dessin du Musée de l'Ermitage, créé au milieu du XVIIe siècle ou avant (ОР-45835) porte l'inscription Nicolaus II Radziwill. Il s'agit donc d'un portrait du fils de Nicolaus Ier et beau-père de Magdalena Bonerówna qui fut voïvode de Vilnius à partir de 1507 et grand chancelier de Lituanie à partir de 1510. Le 25 février 1518, il reçut, en tant que premier membre de la famille, la titre princier (Reichsfürst) de l'empereur Maximilien I.
Portrait de Magdalena Bonerówna (1505-1530) en blanc par Giovanni Cariani, 1520-1527, Château Royal de Wawel à Cracovie.
Sacra Conversazione avec un portrait de Magdalena Bonerówna en Marie-Madeleine par Giovanni Cariani, 1520-1527, Collection privée.
Portrait du Prince Nicolaus II Radziwill (1470-1521) par Giovanni Cariani, vers 1520, Musée national d'art de Biélorussie à Minsk.
Portrait de Stanisław Łaski par Hans Suess von Kulmbach
Le portrait d'un jeune homme blond par Hans Suess von Kulmbach (monogramme entrelacé HK) à la Gemäldegalerie de Berlin, a été acquis avant 1918 auprès de la collection Richard von Kaufmann à Berlin. Selon l'inscription, l'homme avait 29 ans en 1520 (ETAS 29 / ANNO 1520), exactement comme Stanisław Łaski (1491-1550), également connu sous le nom de Stanislaus a Lasco ou Stanislaus von Strickenhoff, publiciste polonais, orateur, théoricien militaire, voyageur et diplomate.
Stanisław était le neveu de l'archevêque de Gniezno Jan Łaski (1456-1531) et le frère du célèbre personnage de la Réforme polonaise et secrétaire royal, Jan Łaski (1499-1560). De 1516 à 1518, il étudie à l'Université de la Sorbonne à Paris avec ses frères. Il retourna très probablement en Pologne en 1518, la même année où la reine Bona arriva en Pologne et Hans Suess von Kulmbach retourna à Nuremberg après quatre ans passés à Cracovie, où il peignit une grande série de panneaux importants pour l'église Sainte-Marie, d'autres peintures religieuses et portraits de la famille royale, dont seule l'effigie du roi Sigismond Ier l'Ancien est conservée en Pologne (Château de Gołuchów). Vers 1520, Łaski fit un pèlerinage en Palestine, où il reçut le titre de chevalier de Jérusalem. En chemin, il visita les Balkans, l'Afrique du Nord et la Sicile. En 1524, il rendit visite à Érasme de Rotterdam. La même année, il entre au service de François Ier, roi de France et en 1525, il prend part à la bataille de Pavie. C'est très probablement lors de son pèlerinage en 1520 qu'il put arriver à Nuremberg et commander son portrait à Suess.
Portrait de Stanisław Łaski (1491-1550) âgé de 29 ans par Hans Suess von Kulmbach, 1520, Gemäldegalerie à Berlin.
Conversation sacrée avec Bona Sforza et son fils en Vierge à l'Enfant par Francesco Bissolo
Le 1er août 1520, la reine Bona Maria Sforza (elle fut baptisée du nom de sa grand-mère, Bona Maria de Savoie) donna naissance à l'héritier tant attendu de Sigismond Ier, Sigismond Auguste. A cette occasion, le roi ordonna de frapper une médaille spéciale dédiée à « la Sainte Vierge, la Mère de Dieu pour l'heureuse naissance de son fils Sigismond » (selon l'inscription abrégée : B[EATAE] V[IRGINI] D[EI] P [ARENTI] P[ROPTER] F[ELICEM] N[ATIVITATEM] S[IGISMVNDI] INFANS SVI) et montrant la scène de l'Annonciation à la Vierge, pour souligner le rôle de la reine en tant que Mère des Rois (d'après Mieczysław Morka « The Beginnings of Medallic Art in Poland during the Times of Zygmunt I and Bona Sforza », 2008, p. 65).
L'effigie de la Vierge Marie blonde dans le tableau de Francesco Bissolo au Musée national de Varsovie, ressemble beaucoup à d'autres effigies de Bona. Ce tableau a été transféré au Musée de la collection Potocki dans leur palais de style italien à Krzeszowice près de Cracovie, nationalisé après la Seconde Guerre mondiale. Son histoire antérieure est inconnue, mais il est fort probable qu'elle ait été acquise par les Potocki en Pologne. La scène montre la Vierge et l'Enfant Jésus, le Roi des rois, l'épouse mystique de Jésus, sainte Catherine, dont le patronage s'étend aux enfants et à leurs nourrices, saint Pierre tenant en main la clef d'argent du pouvoir royal et saint Jean Baptiste, qui a été envoyé par Dieu pour annoncer la venue du Roi. Comme le trône polonais était électif et non héréditaire, le concept était sans aucun doute de renforcer les droits à la couronne pour l'enfant nouveau-né.
Conversation sacrée avec Bona Sforza et son fils en Vierge à l'Enfant par Francesco Bissolo, 1520-1525, Musée national de Varsovie.
Sacra Conversazione avec des portraits de Sigismond Ier et Bona Sforza par Bonifacio Veronese
Sigismond Ier, cinquième fils du roi Casimir IV Jagellon et d'Elisabeth d'Autriche (1436-1505), reçut le nom de son arrière-grand-père maternel, l'empereur romain germanique Sigismond de Luxembourg, roi de Hongrie, de Croatie et de Bohême. Saint Sigismond, son saint patron, était roi des Bourguignons et patron des monarques. Lorsque le père de Sigismond de Luxembourg, Charles IV, transféra les reliques de saint Sigismond à Prague en 1366, il devint saint patron du royaume de Bohême. En 1166, l'évêque Werner Roch apporta à Płock d'Aix-la-Chapelle une particule du crâne de saint Sigismond et le roi Casimir III le Grand commanda un reliquaire en 1370 aux orfèvres de Cracovie (Musée diocésain de Płock), plus tard orné du « diadème Piast » du XIIIe siècle.
Le roi était représenté comme donateur agenouillé dans plusieurs miniatures de son livre de prières, créé par Stanisław Samostrzelnik en 1524 (British Library) et comme l'un des mages dans l'Adoration des mages de Joos van Cleve, créé entre 1520-1534 (Gemäldegalerie à Berlin). Sous une telle forme, mais cette fois plus comme saint Sigismond, il est représenté dans le tableau de Bonifacio Veronese (né Bonifacio de' Pitati). Son effigie ressemble beaucoup au tableau de Titien à Vienne et de Joos van Cleve à Berlin, mais il est beaucoup plus jeune. Une riche couronne est placée à côté de lui et il est accompagné de son petit chien préféré. Le paysage derrière lui est de style très néerlandais, il est donc possible qu'il ait été commandé avec un tableau de Joos van Cleve, dans le cadre de la propagande internationale de l'État jagellonien. Le roi reçoit ou donne le globe à l'Enfant Jésus. Il a été élu, mais a été oint et couronné devant le Seigneur dans la cathédrale de Wawel, donc son pouvoir vient du Dieu. L'Enfant pourrait également représenter son fils nouvellement né Sigismond Auguste. La reine Bona est représentée comme sainte Elisabeth, cousine de Marie et mère de saint Jean-Baptiste. En tant que sainte patronne des femmes enceintes, de sa mère Isabelle d'Aragon, duchesse de Milan, et de sa parente éloignée, la puissante reine Isabelle I de Castille (Isabel, de la forme espagnole médiévale d'Elisabeth), elle était d'une importance particulière pour la jeune reine de Pologne. Sainte Elisabeth a conçu et donné naissance à Jean dans son âge avancé, donc le peintre l'a représentée plus âgée, l'effigie, cependant, est toujours très similaire au portrait de la « Duchesse Sforza » de Titien et à son portrait en Vierge Marie par Francesco Bissolo à Varsovie. La scène de la Visitation d'Elisabeth par Marie est l'une des plus importantes de son livre de prières créé par Stanisław Samostrzelnik entre 1527-1528, ornée de ses armoiries et la montrant sous les traits de la Vierge (Bodleian Library). L'Église a ajouté les paroles de sainte Elisabeth à la Vierge « Béni soit le fruit de tes entrailles » à la Salutation Angélique. Le tableau fait partie de la collection Médicis à Florence depuis le début du XVIIIe siècle (Galerie Palatine) et était auparavant attribué à Palma il Vecchio. Dans une collection privée à Rome, il y a une copie de ce tableau, peint dans le style de Bernardino Licinio.
Sacra Conversazione avec des portraits de Sigismund I et Bona Sforza par Bonifacio Veronese, vers 1520, Palais Pitti à Florence.
Sacra Conversazione avec des portraits de Sigismund I et Bona Sforza par l'atelier de Bernardino Licinio, vers 1520, Collection privée.
Adoration des Mages avec un portrait du roi Sigismond Ier l'Ancien par Joos van Cleve, vers 1520-1534, Gemäldegalerie à Berlin.
Portrait de Bona Sforza et de son fils en Vénus et Cupidon par Lucas Cranach l'Ancien
Entre 1655-1660, la République polono-lituanienne, créé en 1569 avec le soutien du dernier rejeton de la ligne masculine de Jagellon et fils de Bona, Sigismond Auguste, fut envahi par les pays voisins du nord, du sud, de l'est et de l'ouest - le déluge. Les résidences royales et de magnats à Varsovie, Cracovie, Grodno et Vilnius et ailleurs ont été saccagées et incendiées, ce qui a entraîné la perte d'œuvres de Cranach, de son fils et de son atelier et une perte de mémoire des effigies royales et de leur patronage.
Les effigies de monarques inconnus ont été détruites, mais les peintures érotiques étaient indéniablement intéressantes pour les simples soldats. Le portrait de Stockholm (Nationalmuseum, huile sur panneau, 90 x 49,5 cm, NM 259) ressemble beaucoup à d'autres effigies de Bona. Il est daté par des experts de 1520-1525 et la Suède était l'un des envahisseurs entre 1655-1660, mais nous ne pouvons que supposer qu'il a été pris à la Pologne. On pense que le tableau proviendrait d'un vol commis par les troupes suédoises à Prague en 1648, mais les descriptions d'inventaire ne permettent pas de confirmer pleinement cette hypothèse (inventaire de la collection de Prague de 1621 - n° 1138 ou 1293, inventaire de la reine Christine - n° 167 ou 217). Il est également très similaire dans la forme et les traits du visage au tableau de Wilanów, montrant Bona tenant un bouquet de myosotis. L'érotisme était très important pour la reine. Dans son portrait par le peintre vénitien d'environ 1520, elle est représentée avec une chasse au lapin sur son corsage, une allusion claire à sa fertilité. Le sujet de la Vénus nue était fréquent dans la peinture italienne de la Renaissance (Botticelli, Giorgione) et la peinture de Stockholm compte parmi les plus anciennes de Cranach, Bona fut donc la première à introduire le sujet à Cranach, créant ainsi une nouvelle mode ? Il s'agit d'une peinture érotique, intime, on ne peut donc chercher aucune référence à son statut de reine, c'est la ressemblance qui compte. « En tant que génitrice du peuple romain par l'intermédiaire de son fils Enée, Vénus signifiait la maternité » (d'après « Roman Commemorative Portraits: Women with the Attributes of Venus » de Linda Maria Gigante). Cette représentation a très probablement été inspirée par la coutume romaine qui a probablement été conservée dans les traditions locales en Italie à travers les âges, bien que des sculptures de la période flavienne sous l'apparence de Vénus et d'autres figures mythologiques soient redécouvertes - comme la statue d'une femme flavienne en Vénus de la Porta San Sebastiano à Rome, créée en 75 après JC (Musées du Capitole, numéro d'inventaire 09 001782) ou statue d'une matrone romaine sous les traits de Vénus, censée représenter Marcia Furnilla, une noble romaine qui était la deuxième et dernière épouse du futur empereur romain Titus ainsi que la tante du futur empereur Trajan, créé en 79-81 après JC (Ny Carlsberg Glyptotek à Copenhague, numéro d'inventaire 711). Béatrice d'Aragona de Naples, reine de Hongrie et de Bohême et petite-fille de son frère Bona Maria Sforza d'Aragona, toutes deux élevées dans le sud de l'Italie (plus au sud de Rome), connaissait sans doute parfaitement cette tradition. La fascination de Bona pour la Rome antique et sa culture est mieux illustrée par le nom qu'elle a donné à son premier fils - Auguste, après le premier empereur romain Gaius Octavius Augustus. La statuaire flavienne a largement inspiré de nombreux monuments funéraires en Pologne-Lituanie à la Renaissance. Au début de l'Empire, l'empereur et l'impératrice ont pris diverses formes divines, y compris la nudité. Les statues d'impératrices romaines déguisées en Vénus des périodes ultérieures incluent la statue de l'impératrice Sabine en Vénus Genetrix (Museo Archeologico Ostiense), la statue de l'impératrice Faustine la Jeune en Vénus Felix (Musées du Vatican) et du groupe de Mars et Vénus (Musées Capitolins), ainsi que la statue de sa fille, l'impératrice Lucille, en Vénus (Skulpturensammlung à Dresde) et du groupe de Mars et Vénus (Musée du Louvre). Aussi la célèbre tante de la reine Caterina Sforza (1463-1509), comtesse de Forli et dame d'Imola, était très probablement représentée sous les traits de Vénus et de Madone dans les peintures de Lorenzo di Credi. De même son autre parente célèbre Isabelle d'Este (1474-1539), marquise de Mantoue. Vers 1505-1506 Lorenzo Costa, peintre ferrarais, créa le tableau Allégorie du couronnement d'Isabelle pour son studiolo (cabinet d’étude). Dans cette scène, la marquise, au centre, est couronnée de laurier par Antéros (dieu de l'amour réciproque), qui est tenu par sa mère, Vénus (déesse de l'amour). La même femme est représentée dans deux autres tableaux attribués à Costa - comme la Madone dans la scène de l'Adoration de l'Enfant (collection particulière, huile sur panneau, 68,4 x 95,2 cm) et comme Vénus avec la corne d'abondance - cornucopia (collection particulière, huile sur panneau, 156 x 65 cm), tous deux peints entre 1505 et 1510. Après la naissance de son fils en 1520, Sigismond I fut fréquemment absent, occupé par la guerre avec la Moscovie (1512-1522) à la frontière nord-est, laissant sa femme à Cracovie dans le sud de la Pologne. Un petit tableau comme celui-ci serait un bon rappel de l'affection de sa femme. Si le tableau vient de Prague, il pourrait s'agir d'un cadeau fait aux proches de Sigismond.
Portrait de Bona Sforza et de son fils en Vénus et Cupidon par Lucas Cranach l'Ancien, vers 1521, Musée national de Stockholm.
Portrait de Bona Sforza et de son fils en Vierge à l'Enfant par Lucas Cranach l'Ancien
En 1623, l'hetman Marcin Kazanowski (1563-1636) fonda une église pour les Carmélites à Bołszowce (aujourd'hui Bilchivtsi en Ukraine). Il a très probablement ordonné à un peintre de Varsovie ou de Cracovie de copier une peinture de sa propre collection ou de la collection royale pour l'autel principal de la nouvelle église. La peinture, maintenant à Gdańsk, est étonnamment similaire à la Vierge à l'Enfant sous un pommier de Lucas Cranach l'Ancien au Musée de l'Ermitage.
Ce dernier tableau a été acquis par Nicolas Ier, empereur de Russie et roi de Pologne en 1843, donc peut-être d'une collection en Pologne. L'effigie de Marie (Maria) ressemble beaucoup aux effigies de Bona Sforza. Bona Maria Sforza a été baptisée avec les noms de sa grand-mère, Bona Maria de Savoie. En Pologne, le nom de Maria était alors réservé uniquement à la Vierge Marie, elle ne pouvait donc pas l'utiliser. Elle pouvait cependant se laisser représenter comme la Vierge, selon la coutume italienne, dans son livre de prières et ses peintures privées. Dans l'Antiquité, les déesses de la victoire étaient généralement représentées debout sur des pommes royales. Les chrétiens ont adapté le symbole en plaçant une croix au-dessus pour signifier le monde dominé par le christianisme. Par la suite, la « pomme impériale » devint un emblème important du pouvoir royal investi dans le monarque - l'orbe crucigère (d'après l'Encyclopaedia Britannica). Enfin la topographie et le château en arrière-plan sont très similaires à ceux visibles dans une estampe publiée en 1544 dans Cosmographia Universalis et montrant le château royal de Wawel à Cracovie. Il existe plusieurs exemplaires de ce tableau, dont certains ont probablement été réalisés par des copistes italiens ou néerlandais de Cranach car leur style est différent. L'un, enregistré dans les collections françaises avant 1833, fut ensuite vendu en Angleterre en 1919, l'autre appartenant aux barons de Stackelberg à Tallinn (Reval, qui devint un dominion de la Suède en 1561) fut vendu aux enchères à Düsseldorf en 1933.
Portrait de Bona Sforza et de son fils en Vierge à l'Enfant sous un pommier par Lucas Cranach l'Ancien, vers 1521-1525, Musée de l'Ermitage.
Portrait de Bona Sforza et de son fils en Vierge à l'Enfant de la collection Stackelberg à Tallinn par un suiveur de Lucas Cranach l'Ancien, vers 1521-1525, Collection privée, perdu.
Portrait de Bona Sforza et de son fils en Vierge à l'Enfant sous un pommier par un suiveur de Lucas Cranach l'Ancien, vers 1521-1525, Collection privée.
Portrait de Sigismond Auguste enfant
Le fait que le portrait existe dans au moins quatre versions différentes et dans des lieux différents : l'un a été acquis à Rome en 1839, l'autre se trouve à Gorhambury House en Angleterre depuis au moins le XVIIIe siècle, les deux autres aux États-Unis ont été acquis auprès de différentes collections européennes, indiquent que l'enfant représenté était une personne importante, un héritier du trône d'un grand pays européen. Aucun détail de la bonne peinture de la Renaissance n'était sans une signification symbolique, aussi le geste. L'enfant est représenté tenant une pomme (symbole séculaire du fruit de la connaissance et emblème du pouvoir royal - un orbe) dans sa main droite (champ d'action), tout en tenant sa main gauche sur son cœur (charitable et utile) (d'après « Dedication to the Light » de Peter Dawkins).
Le costume est similaire aux vêtements visibles dans les portraits des fils de François Ier de France du début des années 1520, cependant le geste de la main et les traits du visage sont étonnamment similaires à ceux visibles dans une estampe publiée à Cracovie en 1521 et montrant Sigismond Auguste enfant âgé d'un an. L'apparence du garçon (cheveux blonds, yeux foncés, mâchoire un peu rétractée) est également similaire à celles connues des effigies de la mère de Sigismond Auguste - Bona Sforza. Sigismond Auguste a les cheveux noirs dans ses portraits. La couleur des cheveux chez les enfants a tendance à s'assombrir avec l'âge alors le célèbre blond clair de Bona et ses filles était-il un autre tours de magie de Sforza vénéneux ? L'Experimenti compilé par la tante de Bona Caterina Sforza, comtesse de Forli est une compilation de recettes pour « guérir les maux de tête, la fièvre, la syphilis et l'épilepsie ; éclaircir les cheveux ou améliorer la peau ; traiter l'infertilité, fabriquer des poisons et des panacées ; produire des gemmes alchimiques et or » (d'après « Becoming a Blond in Renaissance Italy » de Janet Stephens). Selon les experts, les portraits ont été créés par différents ateliers vénitiens et flamands, c'est un autre indicateur qu'ils ont été commandés par la cour jagellonne multiculturelle.
Portrait de Sigismond Auguste (1520-1572) enfant tenant une pomme par un peintre flamand ou vénitien, vers 1521, The Clark Art Institute.
Portrait de Sigismond Auguste (1520-1572) enfant tenant une pomme par peintre vénitien, vers 1521, The Walters Art Museum à Baltimore.
Portrait de Sigismond Auguste (1520-1572) enfant tenant une pomme par peintre vénitien, vers 1521, Gorhambury House.
Portrait de Sigismond Auguste (1520-1572) enfant tenant une pomme par peintre vénitien, vers 1521, The Royal Collection.
Portrait de la reine Bona Sforza en Madone par Jan Gossaert
« Seigneurs polonais, sous quelle bonne étoile Vous avez amené la reine Bona ici ! Pour tout le charme de la terre italienne, Vous êtes venu avec Bona au pays de l'Ourse glaciale. Ô peuple heureux et royaume heureux, Si plus merveilleux que les autres grâce à leurs dirigeants ! Heureux chambres et lit nuptial, Quel abri tu donnes aux deux lumières du monde ! » (d'après la traduction polonaise par Edwin Je̜drkiewicz, Reginam proceres Bonam Poloni, Quam fausto dominam tulistis astro! Nam quidquid Latii fuit decoris Translatum est gelidam Bona sub Arcton. Felices populi, beata regna, Quam gentes dominis praeitis omnes ! Felices thalami, tori beati, Qui mundi geminum iubar fovetis), a écrit dans son épigramme latine intitulée « Sur la reine Bona » (De Regina Bona), le secrétaire de la reine Andrzej Krzycki (1482-1537), plus tard archevêque de Gniezno.
Witold Wojtowicz appelle cette poésie « un jeu avec la dimension sacrée du monde, rappelant les premiers versets de l'Évangile de Jean [...], l'associant à l'acte sexuel » et « sacralisation de l'érotisme » (d'après « Szkice o poezji obscenicznej i satyrycznej Andrzeja Krzyckiego », p. 47). Gerolamo Borgia (1475-1550), évêque de Massa Lubrense, appelait Bona dans son « A Bona Sforza » (Ad Bonam Sfortiadem), écrit après 1518 et publié à Venise en 1666, « la progéniture divine des Muses de Jupiter, bannie par les sauvages mœurs des hommes, libérant toutes les terres pour céder la place au Ciel » (divo Musae Iovis alma proles Ob feras mores hominum fugata, Omnibus terris liberat parumper Cedere Coelo). Vers 1520, Jan Gossaert (ou Gossart), alors peintre de la cour de Philippe de Bourgogne (1464-1524), évêque d'Utrecht, réalise un petit tableau représentant la Vierge à l'Enfant jouant avec le voile (huile sur panneau, 25,4 x 19,3 cm). La Vierge porte une tunique et un manteau bleus, comme signifiant l'amour céleste et la vérité céleste. Pour obtenir la divine couleur bleu céleste, Gossaert a utilisé de l'outremer et de l'azurite, des pigments précieux fabriqués à partir de pierres semi-précieuses moulues et de l'indigo organique considérablement moins cher d'Inde. L'outremer (ultramarinus), littéralement « au-delà de la mer », importé d'Asie par voie maritime, était fabriqué en broyant le lapis-lazuli en poudre, tandis que l'azurite, utilisée pour la sous-couche, provenait des montagnes inaccessibles. Tous étaient donc extrêmement coûteux. « En 1515, l'artiste florentin Andrea del Sarto a payé cinq florins pour une once d'outremer de haute qualité à utiliser sur une peinture de la Madone, l'équivalent d'un mois de salaire pour un petit fonctionnaire, ou de cinq ans de loyer pour un ouvrier vivant juste à l'extérieur de la ville » (d'après « The World According to Colour: A Cultural History » de James Fox). Dès le XIVe siècle, le principal centre d'approvisionnement de l'outremer en Europe était Venise. L'azurite était extraite en Europe, principalement en Hongrie et en Allemagne, mais aussi en Pologne depuis le Moyen Âge et exportée vers les Pays-Bas. En 1485, un Polonais Mikołaj Polak (Claeys Polains), a été poursuivi par la guilde brugeoise de Saint-Luc au conseil pour avoir utilisé de la lazurite polonaise inférieure. Le minerai a été extrait près de Chęciny et a été mentionné dans le manuscrit Chorographia Regni Poloniae de l'historien polonais Jan Długosz, écrit vers 1455-1480 : « Chęciny, une montagne […] regorgeant à la fois dans ses pentes et dans les environs de pierre d'azur et de cuivre » et dans Sarmatiae Europeae descriptio (Description de l'Europe sarmate) de l'écrivain polonais d'origine vénitienne Alessandro Guagnini dei Rizzoni (Aleksander Gwagnin), imprimé à Cracovie en 1578 : « Chęciny […] célèbre pour ses mines d'azur, où l'on trouve aussi de l'argent » (d'après « Handel pigmentami miedziowymi ze złóż świętokrzyskich w świetle źródeł archiwalnych » de Michał Witkowski et Sylwia Svorová Pawełkowicz). Le développement ultérieur des mines de Chęciny au XVIe siècle est dû à la reine Bona, qui a fait venir les premiers maîtres italiens et agrandi les mines dans les environs de Zelejowa (d'après « Prace » par Instytut Geologiczny, Volume 21, p. 94). Le pigment était très apprécié par la cour royale polono-lituanienne. En 1509, l'azurite de Chęciny, achetée à Léonard de Chęciny, fut utilisée pour peindre les pièces du château de Wawel. Le roi Sigismond I recommanda cet azur à son chambellan Stanisław Szafraniec dans une lettre de 1512 et il fut mentionné dans l'entrée dans l' « Annuaire Świętokrzyski » : « En 1517, le roi le plus serein de Pologne, Sigismond, restaurant le château de Cracovie l'orna d'un façon inédite avec des colonnes, des peintures, des fleurs dorées et d'azur ». En 1544, le peintre Piotr (probablement Pietro Veneziano) peint une croix en bois avec de l'azur pour les princesses. Les peintres appréciaient également ses propriétés - en 1520, le peintre Jan Goraj et Jan l'enlumineur achetèrent l'azurite de Chęciny, ainsi que le peintre de Nuremberg Sebald Singer en 1525, le même qui a dessiné plusieurs dessins pour le fondeur de cloches bruxellois Servius Aerts (Serwacy Arcz). Des pigments bleus coûteux ont été utilisés en abondance dans les livres de prières du roi Sigismond Ier l'Ancien (1524, British Library) et de son épouse Bona Sforza (1527-1528, Bibliothèque Bodléienne), tous deux créés par Stanisław Samostrzelnik. Le tableau de Gossaert était en 1917 dans la collection de Carl von Hollitscher (1845-1925), un entrepreneur autrichien et collectionneur d'art à Berlin. Il a été acheté en 1939 par le Mauritshuis à La Haye (numéro d'inventaire 830). L'inspiration de la peinture vénitienne, en particulier des Madones de Giovanni Bellini, est évidente. Vierge à l'Enfant espiègle signé par Bellini, créé vers 1476 (signature IOHANNES BELLINVS, Accademia Carrara) étant particulièrement proche de la peinture décrite. Gossaert s'est rendu à Rome en 1509, cependant, une telle inspiration directe de la peinture vénitienne et l'utilisation des pigments bleus mentionnés plus de dix ans après son retour d'Italie, indiquent que la personne qui a commandé l'œuvre aurait pu être italienne ou Gossaert avait reçu un dessin d'étude par un artiste italien pour créer un tableau pour un client très riche. La reine Bona Sforza, dont l'ami Jan Dantyszek voyagea fréquemment à Venise et aux Pays-Bas et qui commanda 16 tapisseries à Anvers en 1526, correspond à tous ces termes. Semblable à Anna van Bergen (1492-1541), marquise de Veere, la reine a commandé son effigie en Vierge à l'Enfant et le visage de la Vierge ressemblent fortement à ses portraits de Francesco Bissolo (vers 1520, National Gallery de Londres), de Cranach (1526, l'Ermitage, années 1530, Arp Museum, 1535-1540, Galerie nationale de Prague) et de Bernardino Licinio (années 1530, Government Art Collection, UK), tous identifiés par moi. Le succès de cette composition a probablement incité l'artiste à faire des copies, dans lesquelles, cependant, la ressemblance avec Bona n'est pas si évidente. La Vierge à l'Enfant jouant avec le voile de l'atelier de Jan Gossaert, très probablement achetée par Stanisław Kostka Potocki en France en 1808, se trouve au Palais royal de Wilanów à Varsovie (Wil.1008) une autre au Musée National de Varsovie (M.Ob.63). Une version de bonne qualité de la galerie Miączyński-Dzieduszycki à Lviv se trouvait dans le château royal de Wawel, perdu pendant la Seconde Guerre mondiale (huile sur panneau, 67 cm x 87,5 cm, inventaire des collections d'art de l'État - PZS de 1932 : 2158). De plus, le motif en forme d'étoile sur la nappe recouvrant la table aurait pu avoir une signification symbolique. Il peut être comparé au yantra d'Extrême-Orient, un schéma, principalement issu des traditions tantriques des religions indiennes, utilisé pour le culte des divinités dans les temples ou à la maison ou l'étoile de Bethléem dans l'Adoration des mages du livre de prières de Bona Sforza (Bibliothèque Bodléienne). L'étoile a conduit les mages dans leur voyage et l'enfant qu'ils ont visité a été appelé « la lumière du monde ». L'étoile à huit branches qui symbolise depuis l'étoile de Bethléem était également un ancien symbole de la planète Vénus. La « bonne étoile » a amené la reine Bona en Pologne.
Portrait de Bona Sforza d'Aragona (1494-1557), reine de Pologne en Vierge à l'Enfant jouant avec le voile par Jan Gossaert, 1520-1525, Mauritshuis.
Vierge à l'Enfant jouant avec le voile par l'atelier de Jan Gossaert, vers 1533, Palais de Wilanów à Varsovie.
Vierge à l'Enfant jouant avec le voile par l'atelier de Jan Gossaert, après 1531, Musée national de Varsovie.
Portraits d'Anna de Mazovie par Bernardino Licinio et Lucas Cranach l'Ancien
« Stanislas et Janusz, fils de Conrad, duc de Mazovie, des anciens rois polonais, le dernier rejeton mâle des princes de Mazovie, régnant avec bonheur pendant 600 ans. Les jeunes hommes ont tous deux excellé avec une bonne honnêteté et innocence, avec le pouvoir d'un prématuré et malheureux destin dans de courts intervalles, avec une grande tristesse de leurs sujets, sont morts : Stanislas, l'année du salut, 1524, à l'âge de 24 ans, et Janusz en 1526, à l'âge de 24 ; après la mort duquel l'héritage et le règne sur toute la Mazovie passèrent au roi de Pologne, Anna, la princesse, parée d'une virginité et d'une honnêteté sans pareille, fit ses frères avec des larmes amères [ce monument] », se lit l'inscription en latin sur la plaque funéraire des derniers ducs Mazovie (détruit pendant la Seconde Guerre mondiale).
Les ateliers de peinture vénitiens de la Renaissance avaient un grand avantage sur les ateliers allemands ou néerlandais. Les peintres ont progressivement modifié la technique, ce qui leur a permis de créer des peintures beaucoup plus rapidement et ils ont utilisé la toile, afin de pouvoir créer dans un format beaucoup plus grand. La toile était aussi beaucoup moins lourde que le bois et un seul homme pouvait transporter plusieurs tableaux à différents endroits. Beaucoup de ces peintures sont restées dans les ateliers d'artistes à Venise en tant que modello ou ricordo. Les femmes de deux portraits de Bernardino Licinio ressemblent beaucoup aux « frères de Mazovie ». Anna de Mazovie est née vers 1498 en tant que deuxième fille du duc Conrad III le Roux et d'Anna Radzwill. Elle avait une sœur aînée Sophie. En 1518, Casimir, margrave de Brandebourg-Kulmbach brisa une lance en son honneur lors du grand tournoi de joutes organisé pour célébrer le mariage de Sigismond et de Bona Sforza. Deux ans plus tard, le 17 septembre 1520 à Varsovie, sa sœur Sophie se marie par procuration à Étienne VII Bathory, palatin de Hongrie, et le 17 janvier 1521 elle part pour la Hongrie avec son entourage. Dans la nuit du 14 au 15 mars 1522, la duchesse Anna Radziwill mourut à Liw. Elle a été enterrée dans l'église Sainte-Anne de Varsovie. Sa fille Anna était désormais, à l'âge d'environ 24 ans, l'aînée de la famille en Mazovie. Le portrait de Licinio au Musée des Beaux-Arts de Budapest représente une jeune femme vêtue d'une simple chemise blanche, d'un manteau noir de satin vénitien doublé de fourrure et d'un bonnet de damas broché noir. Elle tient un livre ouvert sur un bloc de marbre avec une date 1522 (MDXXII) et une feuille de chêne solitaire. Le chêne était un symbole de pouvoir, d'autorité et de victoire à l'époque romaine. « Dans les moralisations, le chêne représentait la patience, la force de la foi et la vertu de l'endurance chrétienne face à l'adversité. En tant que tel, il était représenté comme l'attribut de Job et des saints martyrs dans l'art de la Renaissance » (d'après Simona Cohen, « Animals as Disguised Symbols in Renaissance Art », 2008, p. 86). La provenance du tableau en Hongrie n'est pas connue, il est donc fort possible qu'Anna de Mazovie ait envoyé à sa sœur Sophie son portrait en deuil de la mort de leur mère. En 1525, Albert de Prusse demande la main d'Anna en mariage. Ses efforts dynastiques ainsi que ses projets de marier Anna à son frère Guillaume de Brandebourg furent stoppés par la politique ferme de Bona Sforza. Peu de temps après, la reine Bona, ne voulant pas exacerber les conflits internes, a démissionné de la marier, malgré l'insistance des nobles de Mazovie, à son fils Sigismond Auguste. Les traits du visage de deux femmes dans les tableaux de Lucas Cranach l'Ancien intitulés Portrait d'une dame courtoise, dans une collection privée, et Vénus et Cupidon, dans Compton Verney, se ressemblent beaucoup. C'est aussi la même femme que dans les portraits de Licinio, ses traits de visage, sa lèvre inférieure saillante et son expression sont identiques. Le tableau de Compton Verney porte une date 1525 (indistincte), date à laquelle il fut proposé de marier Anna avec un neveu du roi de Pologne, nouvellement créé duc de Prusse (après sécularisation de l'état monastique des chevaliers teutoniques), qui était peint par Lucas Cranach l'Ancien à plusieurs reprises (par exemple, portrait au musée Herzog Anton Ulrich, daté de 1528). La femme à l'effigie d'une dame courtoise au large chapeau rouge décoré de plumes d'environ 1530 tenait très probablement une fleur dans sa main gauche, tout comme la reine Bona dans son portrait par Cranach au palais de Wilanów. Le peintre a peut-être oublié de l'ajouter ou changé le concept, ce qui pourrait indiquer que le tableau faisait partie d'une série dédiée à d'éventuels prétendants. En 1536, Anna épousa finalement Stanisław Odrowąż, voïvode de Podolie, qui déjà en 1530 envisageait de l'épouser. En mars 1526, presque deux ans après Stanislas, mourut Janusz III, le dernier membre masculin des Piasts de Mazovie. Dans son testament du 4 mars 1526, il laissa la majorité de ses biens en argent, bijoux, pierres précieuses, perles, or, argent et biens mobiliers à sa sœur Anna, et quelques vêtements à ses courtisans, comme une robe et un bonnet bordé de des zibelines à Piotr Kopytowski, châtelain de Varsovie ou une robe de soie à Wawrzyniec Prażmowski, châtelain de Czersk. L'organisation des funérailles a été reportée, pour attendre l'arrivée du roi Sigismond. La mort subite des deux jeunes ducs, en peu de temps, a fait naître le soupçon que leur mort n'était pas naturelle. Le principal suspect était Katarzyna Radziejowska, qui après avoir été séduite et abandonnée par les deux princes, aurait empoisonné les ducs et leur mère Anna Radziwill. La femme et son supposé complice Kliczewska ont avoué l'empoisonnement progressif du duc et tous deux ont été condamnés à endurer la mort horrible. La précipitation à exécuter la peine a soulevé encore plus de soupçons que, en fait, le véritable instigateur du crime était la reine Bona. L'explication logique était liée aux plans ambitieux de la reine pour Mazovie, qu'elle voulait pour son fils Sigismond Auguste. Cependant, le chroniqueur contemporain Bernard Wapowski, citant une scène dont il a été lui-même témoin, dément ces allégations : « Lorsque le jeune duc, réchauffé par l'exemple de quelques fêtards similaires, ordonna de lui verser du vin dans la gorge, à la suite de quoi, en deux semaines, il fit ses adieux au monde ». Malgré cela, des rumeurs se sont répandues et de plus en plus de gens ont commencé à accuser la reine de Pologne. Un groupe de nobles associés à la cour de Mazovie, s'opposant à l'incorporation du duché dans la couronne, a proclamé Anna duchesse. Peu de temps après, cependant, le Conseil ducal a conclu un compromis avec le roi de Pologne car l'incorporation était bénéfique pour eux. Anna a dû accepter le salaire de Sigismund I, les terres près de Goszczyn et Liw et le « Petit Manoir » (Curia Minor) au Château Royal de Varsovie comme résidence, jusqu'à ce qu'elle se marie. Le roi a mis en place une commission spéciale pour traiter de la question de la mort des ducs. Le 9 février 1528, il publie un édit dans lequel il déclare que les princes « n'ont pas été victimes d'une main humaine, mais que c'est la volonté du Seigneur Tout-Puissant qui a causé leur mort ». Le portrait par Bernardino Licinio au Castello Sforzesco de Milan, montre la même femme que dans le portrait de Budapest tenant un portrait d'homme, très similaire au portrait de Licinio représentant un homme tenant une canne (Janusz III). Elle est vêtue de noir et le corsage de sa riche robe est brodé d'un motif de chiens, symbole de loyauté et de fidélité. Le paysage en arrière-plan avec un château est très similaire au château de Płock, l'ancienne capitale de la Mazovie (jusqu'en 1262), de facto la capitale de la Pologne entre 1079 et 1138 et siège de l'un des plus anciens diocèses de Pologne, établi en 1075. Entre 1504-1522, l'évêque de Płock était Erazm Ciołek (1474-1522), diplomate, écrivain et mécène des artistes, qui voyagea à Rome, étudia à Bologne avec Filippo Beroaldo et négocia le mariage de Sigismond Ier avec Bona Sforza. Il fut suivi en 1522 par Rafał Leszczyński (1480-1527), éduqué à Padoue et secrétaire du prince Sigismond pendant son règne dans le duché de Głogów et après sa mort par Andrzej Krzycki (1482-1537), secrétaire de la reine Bona, patron des arts et un poète écrivant en latin, qui étudiait à Bologne auprès d'éminents humanistes. Dans ce tableau, Anna voulait exprimer qu'elle ne renoncerait pas à Mazovie.
Portrait d'Anna de Mazovie (vers 1498-1557) tenant un livre par Bernardino Licinio, 1522, Musée des Beaux-Arts de Budapest.
Portrait d'Anna de Mazovie (vers 1498-1557) en Vénus et Cupidon par Lucas Cranach l'Ancien, 1525, Compton Verney.
Portrait d'Anna de Mazovie (vers 1498-1557) tenant un portrait de son frère Janusz III par Bernardino Licinio, 1526-1528, Castello Sforzesco à Milan.
Portrait d'Anna de Mazovie (vers 1498-1557) dans un chapeau décoré de plumes par Lucas Cranach l'Ancien, vers 1530, Collection particulière.
Portrait de Constantin, prince d'Ostroh et Tatiana Olchanska par Giovanni Cariani
« L'hetman était un fidèle régaliste, et le monarque lui a rendu la pareille en lui confiant les plus hautes fonctions de l'État. Il l'a fait en violation de la loi car le prince d'Ostroh professait l'orthodoxie et les postes au Grand-Duché de Lituanie étaient réservés exclusivement pour les catholiques. Cela lui a valu l'envie de nombreux nobles lituaniens. Albertas Gostautas, qui avait une énorme influence, l'a accusé d'être un « homo novus de basse condition, issus des princes ruthènes les plus pauvres ». La dispute qui a éclaté entre eux n'était pas seulement basée sur l'animosité personnelle, c'était aussi un conflit idéologique. Gostautas était un séparatiste lituanien, le prince d'Ostroh, cependant, voyant la faiblesse militaire de la Lituanie, a préconisé une coopération étroite avec la Couronne. Utilisant le soutien de la cour royale, y compris la reine Bona, il était le protecteur le plus important de l'orthodoxie en Lituanie » (d'après « Konstanty Ostrogski (ok. 1460-1530) – Scypion ruski i litewski » de Wojciech Kalwat).
C'est Constantin qui, avec plusieurs magnats polonais, accueillit Bona en Pologne au nom du roi dans le village de Morawica le 13 avril 1518. Quelques jours plus tard, lors d'un défilé à Cracovie, les troupes privées du prince d'Ostroh se distinguaient parmi les troupes de magnats lituaniens défilant devant le couple royal et il occupait l'une des premières places aux côtés du roi lors d'une immense fête organisée après le mariage et le couronnement. Étant si proche de la cour italienne de la reine Bona, Constantin a sans aucun doute suivi la mode introduite ou imposée par elle, notamment en commandant ses effigies dans le même style et aux mêmes artistes que la reine. De nombreuses effigies de Sigismond I par Stanisław Samostrzelnik dans le livre de prières du roi (1524, British Library) le représentent comme un donateur agenouillé devant la Vierge ou le Christ. La même chose dans le livre de prières d'Albertas Gostautas (1528, bibliothèque universitaire de Munich) avec le roi représenté comme l'un des mages dans la scène de l'Adoration et le propriétaire agenouillé en prière devant son patron saint Adalbert de Prague. Magnat catholique de Lituanie, Georges Radziwill (1480-1541), surnommé « Hercule », compagnon et participant à toutes ses victoires, rejoint l'opposition menée par Constantin. En 1523, les deux amis se lient par le mariage de leurs enfants, le prince Ilia, alors âgé de douze ans et Anna, la fille aînée de Georges Radziwill, âgée seulement de cinq ans. Radziwill n'a pas voulu contracter de mariage pour sa fille, avec un jeune homme baptisé et élevé dans le rite grec, sans l'autorisation du Saint-Siège (quod cum illustris vir Constantinus Dux Ostrouiensis et Magni Ducatus Lithuaniae Campiductor generalis, Ruthenus juxta ritum Graecorum vivens, quendam filium suum Iliam nuncupatum, duodecim annorum existentem et Ruthenum, et ut Graeci faciunt baptisatum). Il demanda donc une dispense au pape Clément VII (Jules de Médicis), qui venait à peine d'être choisi comme successeur de saint Pierre. La parente du pape, Catherine de Médicis, future reine de France, a été représentée dans plusieurs portraits de Giovanni Cariani, identifiés par moi. Au nom des grands mérites du prince Constantin, Grand Hetman de Lituanie, et donc aussi de tout le peuple chrétien, la « Dispense du Souverain Pontife accordée à un certain Ilia le Ruthène, afin qu'il puisse contracter mariage » (Dispensatio Summi Pontificis data cuidam Iliae Rutheno, ut possit contrahere matrimonium) a été délivré le 5 mars 1523. Ilia était le premier fils de Constantin et le seul enfant de son premier mariage avec Tatiana Semenovna Olchanska. Elle était la cadette des deux filles du prince Semyon Yurievitch Olchanski et de la princesse Anastasia Semyonovna Zbarazhska et la seule héritière de la grande fortune de son père et de sa mère après la mort de sa sœur Anastasia en 1511. Tatiana et Constantin se sont mariés en 1509 et elle est décédée en 1522 à l'âge d'environ 42 ans. La même année, Constantin épousa pour la deuxième fois la jeune princesse Alexandra Olelkovich-Sloutska, qui donna naissance à son fils Constantin Vassili et à une fille Sophie. Le prince d'Ostrog fut le fondateur de nombreuses nouvelles églises orthodoxes, notamment dans la capitale du Grand-Duché de Lituanie - Vilnius. Comme la reine Bona, il entoura d'une vénération et d'une dévotion particulières la Vierge Marie. Au monastère de Mejyritch près de Kiev qu'il fonda le 12 mars 1523, il offrit une icône du XVe siècle de la Vierge à l'Enfant (Hodigitria), qui fut probablement apportée du mont Athos en cadeau du patriarche de Constantinople. Il a été enterré, selon son souhait, dans la cathédrale de la Dormition du monastère des grottes de Kiev (Laure de Pechersk), où en 1579 son fils Constantin Vassili lui a érigé une pierre tombale de style italien. Dans le Palazzo Barberini (Galleria Nazionale d'Arte Antica) à Rome se trouve le portrait d'un homme barbu des années 1520 dans la pose d'un donateur, peint par Giovanni Cariani (huile sur toile, 69 x 51,5 cm, numéro d'inventaire 1641). Il a été légué par Henriette Hertz en 1915 et avant 1896, il était dans la collection Bonomi-Cereda à Milan. L'homme porte un manteau de style oriental bordé d'une fourrure épaisse, semblable à celle visible dans de nombreux portraits de Constantin, prince d'Ostroh (par exemple au Musée historique de Lviv, Ж-1533, Ж-1707). Ses traits du visage, sa barbe et son chapeau distinctif sont presque identiques à ceux des effigies de Constantin au Musée régional de Bila Tserkva et au Musée national des arts de Biélorussie. Ce tableau faisait très probablement partie d'une composition plus large, comme dans certaines des Sacra Conversazione de Cariani représentant la Vierge à l'Enfant vénérée par les donateurs, par ex. peintures à l'Accademia Carrara à Bergame (numéros d'inventaire 205 (52) et 1064 (92)) et à Ca' Rezzonico à Venise, laissé inachevé par l'artiste ou endommagé et divisé en morceaux. Portrait d'une femme en prière au Castello Sforzesco de Milan (huile sur toile, 68 × 46 cm, numéro d'inventaire 26), ayant une composition et des dimensions similaires, est considéré comme une autre partie de ce tableau perdu. La peinture provient de la collection de Carlo Dell'Acqua à Milan et est parvenue au Musée grâce à la donation de Camillo Tanzi en 1881. La femme doit être identifiée comme l'épouse de l'homme, donc dans ce cas Tatiana Semenovna Olchanska. L'activité de l'artiste peut être divisée en trois périodes précisesː la première période à Venise à un jeune âge, la deuxième période de 1517 à 1523 à Bergame près de Milan, où il commence sa forme artistique personnelle et libre, la troisième période encore à Venise, où il a maintenu une collaboration active avec Bergame et où il est peut-être revenu dans les années suivantes. Si la peinture est restée inachevée dans l'atelier de l'artiste, c'est probablement à cause de la mort de Tatiana et du mariage ultérieur de Constantin en 1522. Comparaison de Sept portraits d'Albani (Sette Ritratti Albani ou courtisanes et leurs admirateurs, collection privée) et Femme allongée (Vénus dans un paysage) de Giovanni Cariani (The Royal Collection Trust, vue miroir) avec la même femme dans la même pose représentée habillée et nu, confirme l'utilisation fréquente de dessins de modèle par le peintre. Il est possible que le portrait de Constantin à Bila Tserkva de la fin du XVIIIe siècle soit une copie de l'original non conservé de Cariani. La même femme que dans la peinture de Cariani à Milan a également été représentée dans un autre portrait de la même période. Le tableau, aujourd'hui au Musée Civique de Bassano del Grappa (Museo Civico di Bassano del Grappa), provient de la collection du comte padouan Giuseppe Riva et a été légué en 1876 (huile sur toile, 84 x 67 cm). Il a été attribué à l'origine à Giorgione, Titien et Il Pordenone et maintenant à Bernardino Licinio (d'après « Il Museo civico di Bassano del Grappa ... » de Licisco Magagnato, Bruno Passamani, p. 71). Le tableau a un beau cadre d'époque et la femme tient un animal étrange, que l'on pensait être un chien ou un lionceau, mais il s'agit très probablement d'un singe. Le peintre a probablement reçu quelques dessins d'étude générale pour préparer cette effigie, et n'a pas vu le modèle et son animal, c'est pourquoi le singe ressemble plus à un chat de mer (Cattus Marinus) des armoiries nobles ruthéno-polono-lituaniennes de Kot Morski ou autre animal fantastique. En raison de tous ces facteurs, cette femme riche « exotique » a d'abord été considérée comme Caterina Cornaro, reine de Chypre, comme dans de nombreuses autres effigies de nobles dames inconnues d'Europe centrale et orientale. Il est à noter que le portrait du fils de Tatiana, Illia (1510-1539), prince d'Ostroh du palais de Cobourg à Vienne, identifié par moi, peut être attribué soit à Giovanni Cariani, soit à Bernardino Licinio, soit même aux deux, ce qui indique que les peintres auraient pu coopérer étroitement. Les singes enchaînés ont aussi une certaine symbolique à la Renaissance et « aux pieds de la Vierge Marie semble symboliser la suppression des péchés - sensualité, cupidité et excès de vices d'Eve vaincue par la vertu de la Vierge Marie » (d'après « 111 Masterpieces of the National Museum in Warsaw » par Dorota Folga-Januszewska, p. 81). Dans ce portrait peut donc être considéré comme l'incarnation de la passion érotique, symbole de la luxure et du contrôle des passions.
Portrait de Constantin (vers 1460-1530), Prince d'Ostroh par Giovanni Cariani, vers 1522, Palazzo Barberini à Rome.
Portrait de Tatiana Olchanska (vers 1480-1522), princesse d'Ostroh par Giovanni Cariani, vers 1522, Castello Sforzesco à Milan.
Constantine (vers 1460-1530), prince d'Ostroh et sa femme Tatiana Olchanska (vers 1480-1522) en donateurs devant la Vierge à l'enfant par Giovanni Cariani, vers 1522. Disposition possible de la peinture originale. © Marcin Latka
Portrait de Tatiana Olchanska (vers 1480-1522), princesse d'Ostroh tenant un singe par Bernardino Licinio, vers 1522, Musée Civique de Bassano del Grappa.
Portraits de Constantin, prince d'Ostroh et de son épouse Alexandra Olelkovich-Sloutska par Lucas Cranach l'Ancien et atelier
Lorsque le 12 juillet 1522 mourut la princesse Tatiana Olchanska, première épouse de Constantin, prince d'Ostroh (Konstanty Ostrogski), quelques jours plus tard, le 26 juillet à Vilnius, le prince conclut un contrat de pré-mariage avec Anastasia Mstislavska, princesse de Sloutsk et son fils Yuri concernant le mariage de sa fille - Alexandra. « Et si Dieu me donne, avec Sa Majesté la princesse Alexandra, des enfants, des fils ou des filles, je dois les aimer aussi, et m'occuper d'eux autant que notre premier fils, le prince Ilia, que nous avons avec ma première femme », a ajouté le prince dans le contrat. Ils se sont mariés peu de temps après. La mariée, née vers 1503, avait 19 ans et le marié, né vers 1460, avait 62 ans au moment de leur contrat de mariage.
Constantin, considéré comme un éminent commandant militaire et appelé le Scipion Ruthène, était l'homme le plus riche de la Ruthénie rouge (ouest de l'Ukraine), le plus grand propriétaire terrien de Volhynie et l'un des hommes les plus riches et les plus puissants du Grand-Duché de Lituanie. Il possédait 91 villes et villages et comptait environ 41 000 sujets. Les princes d'Ostroh, une branche de la dynastie des Riourikides prétendant être les descendants de Daniel de Galice (1201-1264), roi de Ruthénie et de Vladimir le Grand (vers 958-1015), prince de Novgorod et grand prince de Kiev, étaient l'une des plus anciennes familles princières de Pologne-Lituanie et a initialement utilisé saint Georges combattant le dragon comme blason. Sa nouvelle épouse, Alexandra Olelkovich-Sloutska, descendante de Vladimir Olgerdovich, grand prince de Kiev (entre 1362-1394), fils d'Algirdas, grand-duc de Lituanie, était liée à la dynastie jagellonne du côté maternel et paternel. Il est possible qu'entre 1494 et 1496, Constantin ait servi l'empereur Maximilien Ier et ait participé à sa campagne dans le nord de l'Italie. Pour sa victoire près d'Otchakiv sur les troupes de Mehmed I Giray, khan de Crimée le 10 août 1497, il reçut le titre de grand hetman de Lituanie comme la première personne à recevoir ce titre et en 1522 il devint le voïvode de Trakai, considéré comme le deuxième fonctionnaire le plus important après le voïvode et châtelain de Vilnius, et a reçu du roi le privilège d'apposer des sceaux de cire rouge (27 août 1522). Pour commémorer sa glorieuse victoire sur les forces de Vassili III, le grand-prince de Moscou lors de la bataille d'Orcha le 8 septembre 1514, il commanda très probablement un tableau représentant la bataille dans l'atelier de Lucas Cranach l'Ancien, attribué à Hans Krell (Musée national de Varsovie), peut-être l'un d'une série. Il est représenté trois fois dans cette œuvre à différentes étapes de la bataille. En 1514, l'hetman reçut la permission du roi Sigismond Ier de construire deux églises orthodoxes à Vilnius. Au lieu d'en construire une nouvelle, il décida de réparer et de reconstruire dans le style gothique deux anciennes églises délabrées, l'église de la Sainte Trinité et l'église Saint-Nicolas. Tout comme son ami, le roi de Pologne Sigismond Ier et sa jeune épouse Bona Sforza, lui et sa femme ont sans aucun doute commémoré des événements importants de leur vie et ont cherché à renforcer leur position et leurs alliances localement et à l'étranger à travers la peinture. Si le roi et sa femme étaient représentés sous l'apparence de différentes figures bibliques, pourquoi Constantin ne le pouvait-il pas ? Malgré sa loyauté envers les rois catholiques de Pologne et sa querelle avec le grand-duché orthodoxe de Moscou, Constantin est resté orthodoxe et il a encouragé la construction d'églises et d'écoles orthodoxes. En 1521, dans la demeure ancestrale des princes d'Ostroh et son siège principal, le château d'Ostroh, il entreprit la construction d'une nouvelle église en briques à l'emplacement d'une église orthodoxe plus ancienne construite entre 1446 et 1450. Cette dominante architecturale du château, alliant les éléments gothiques et byzantins, a été créé par un architecte vraisemblablement de Cracovie et dédié à l'Épiphanie, honorant la visite des trois mages au nouveau-né Jésus. Un tableau de l'Adoration des Mages au Musée historique de Bamberg, offert par le chanoine de la cathédrale Georg Betz (1768-1832), porte la date « 1522 » et la marque de Cranach, le serpent couronné. Il est connu de nombreuses versions, cependant seule celle-ci est signée et datée. Il y a une divergence notable avec le style de Cranach, l'œuvre a donc été créée par un élève de son atelier travaillant sur une commande à grande échelle et juste signée de la marque du dragon du maître. D'autres versions se trouvent à la Galerie d'art d'État de Karlsruhe, de la collection des margraves et grands-ducs de Bade, au Burg Eltz, ancienne propriété familiale des comtes d'Eltz-Kempenich et au musée Pouchkine de Moscou, de la galerie ducale à Gota. L'un tableau a été vendu en 1933 par la Galerie Helbing à Munich (lot 424) et un autre à Londres le 27 octobre 1993 (lot 155). La version miroir de la composition de la collection d'Edward Solly (1776-1848) se trouve à la Fondation des châteaux et jardins prussiens de Berlin-Brandebourg. Tous sont considérés comme des copies d'atelier. L'original était sans aucun doute une composition plus grande - l'autel. Les ailes fermées dans la conception de l'autel de Lucas Cranach l'Ancien dans les collections d'art de l'État à Weimar (Schloßmuseum) représentent une scène identique de l'Adoration des Mages. L'un des trois « sages de l'Occident » et la Vierge à l'enfant tenant un bol de pièces d'or sont au centre sur des panneaux séparés pour accentuer encore leur importance. Melchior, le vieil homme des trois mages, vénéré dans l'Église catholique romaine et orthodoxe orientale, était traditionnellement appelé le roi de Perse et apporta le don d'or à Jésus, signifiant le statut royal, symbole de richesse et de royauté sur terre. Lorsqu'il est ouvert, le dessin de l'autel à Weimar montre la scène du Christ cloué sur la croix dans le panneau central et saint Sébald (aile gauche) et saint Louis (aile droite) selon l'inscription en latin. L'inscription originale barrée sur la tête du saint roi à droite était très probablement « saint Sigismond ». Les deux effigies ne correspondent pas à l'iconographie la plus courante des deux saints. Saint Sébald était généralement représenté en pèlerin avec le bâton et le bonnet et saint Louis, roi de France avec la fleur de lys, le manteau et les autres parties des insignes français. Les inscriptions sont donc des ajouts ultérieurs et ne sont pas correctes. L'effigie du roi en armure tenant une épée, correspond parfaitement aux représentations de Constantin le Grand, saint Empereur et Égal aux Apôtres, tant dans l'Église orthodoxe orientale (icône du Musée de Nizhny Tagil, 1861-1881) que dans l'Église romaine (peinture de Cornelis Engebrechtsz dans l'Alte Pinakothek de Munich, vers 1517). L'effigie d'un saint évêque en face est saint Nicolas, qui était représenté en tant qu'évêque et tenant un évangéliaire dans les deux traditions chrétiennes (par exemple, l'icône de Saint Nicolas peinte en 1294 pour l'église de Lipno à Novgorod et un triptyque de Giovanni Bellini, créé en 1488 pour la Santa Maria Gloriosa dei Frari à Venise). Saint Nicolas était particulièrement important pour la reine Bona, amie de Constantin d'Ostroh, car la plupart des reliques de ce saint se trouvent dans sa ville de Bari. L'autel a donc été commandé à l'église de l'Épiphanie au château d'Ostroh et détruit pendant les guerres suivantes. À cette époque, le roi Sigismond I a commandé un triptyque de l'Adoration des Mages dans l'atelier de Joos van Cleve aux Pays-Bas, où il a été représenté comme l'un des Mages (Berlin), et sa femme Bona a été représentée comme la Vierge sous un pommier par Cranach (Saint-Pétersbourg). L'effigie d'un vieil homme barbu comme Melchior est très similaire à d'autres portraits connus de Constantin, prince d'Ostroh. La même femme qui prête ses traits à la Vierge Marie dans les peintures décrites a également été représentée dans une peinture moraliste des amants mal assortis par Lucas Cranach l'Ancien. Ce tableau, aujourd'hui au Musée des Beaux-Arts de Budapest, est signé avec la marque de l'artiste et daté « 1522 » dans le coin supérieur gauche. Le tableau se trouvait initialement dans la collection impériale de Vienne, il a donc été très probablement commandé par les Habsbourg, bien qu'il ne soit pas exclu qu'il ait été commandé par certains des opposants de Constantin en Pologne-Lituanie. L'hetman, comme le roi et sa femme Bona, soutient le roi élu de Hongrie, Jean Zapolya contre les Habsbourg et en mai 1528, il rencontra son envoyé Farkas Frangepán (1499-1546). La personne qui a commandé l'œuvre ne pouvait pas ridiculiser un haut responsable militaire, ce serait offensant et diplomatiquement inapproprié. Elle pourrait cependant se moquer de sa jeune « épouse trophée », profitant de son étreinte pour voler l'argent de sa bourse. Toutes les peintures mentionnées ont également une autre chose en commun - les pièces de monnaie. Le chapeau du vieil homme édenté dans la peinture de Budapest est orné d'une grande pièce de monnaie avec une inscription ambiguë, peut-être une anagramme humoristique ou une référence à la langue ruthène utilisée par Constantin. Des pièces de monnaie sont également visibles dans la majorité des portraits conservés du fils de Constantin et d'Alexandra, Constantin Vassili et la femme ressemble fortement aux effigies de Constantin Vassili, y compris celle visible dans une médaille d'or avec son portrait (trésor de la laure de Pechersk et de l'Ermitage). Elle était également représentée en Judith avec la tête d'Holopherne dans un tableau, aujourd'hui aux Musées des beaux-arts de San Francisco. Cette penture est attribuée à Hans Cranach, le fils aîné de Lucas Cranach l'Ancien qui fut actif à partir de 1527 et qui mourut à Bologne en 1537. L'œuvre, presque comme un pendant à un portrait de la reine Bona Sforza en Judith à Vienne, était à la fin du XVIIIe siècle dans la collection du roi Charles IV d'Espagne. Il ne peut être exclu que, comme le portrait de la reine, il ait été envoyé aux Habsbourg en Espagne. Au moins deux dessins préparatoires à ce portrait se trouvaient avant la Seconde Guerre mondiale à la galerie d'État de Dessau, perdus. Les deux étaient signés du monogramme IVM, un peintre inconnu de l'atelier de Lucas Cranach qui fut envoyé pour créer des dessins ou un peintre de la cour de Constantin, prince d'Ostroh et de sa femme. Le verso du plus grand dessin également signé du monogramme IVM, représente saint Georges combattant un dragon, symbole des princes d'Ostroh, étant ainsi une étude pour un autre tableau commandé par la famille et portant très probablement les traits du fils aîné de Constantin, Illia. La jeune épouse de Constantin lui donna deux enfants Constantin Vassili né le 2 février 1526 et Sophie, née avant 1528. Son mari mourut à Tourov, dans l'actuelle Biélorussie, le 10 août 1530 et fut enterré au monastère des grottes de Kiev (Laure de Pechersk), où en 1579 son fils Constantin Vassili lui érigea une magnifique pierre tombale de style italien.
Conception pour l'autel de Constantin (vers 1460-1530), Prince d'Ostroh, fermé, avec l'Adoration des Mages et effigies du fondateur et de sa femme comme Melchior et la Vierge par Lucas Cranach l'Ancien, vers 1522, Collections d'art de l'État à Weimar.
Conception pour l'autel de Constantin (vers 1460-1530), Prince d'Ostroh, ouvert, avec le Christ cloué à la Croix et les saints Nicolas et Constantin le Grand par Lucas Cranach l'Ancien, vers 1522, Collections d'art de l'État à Weimar.
Adoration des Mages avec des portraits de Constantin, prince d'Ostroh et de sa femme Alexandra Olelkovich-Sloutska en saint Melchior et la Vierge par l'atelier de Lucas Cranach l'Ancien, vers 1522, Galerie d'art d'État à Karlsruhe.
Adoration des Mages avec des portraits de Constantin, prince d'Ostroh et de sa femme Alexandra Olelkovich-Sloutska en saint Melchior et la Vierge par l'atelier de Lucas Cranach l'Ancien, vers 1522, Musée national des beaux-arts Pouchkine à Moscou.
Amants mal assortis, caricature d'Alexandra Olelkovich-Sloutska, princesse d'Ostroh par Lucas Cranach l'Ancien, 1522, Musée des beaux-arts de Budapest.
Portrait d'Alexandra Olelkovich-Sloutska, princesse d'Ostroh en Judith avec la tête d'Holopherne par Lucas Cranach l'Ancien ou Hans Cranach, vers 1530, Musées des beaux-arts de San Francisco.
Dessin préparatoire pour un portrait d'Alexandra Olelkovich-Sloutska, princesse d'Ostroh en Judith avec la tête d'Holopherne par le monogrammiste IVM ou atelier de Lucas Cranach l'Ancien, vers 1530, Galerie d'État à Dessau, perdu.
Dessin préparatoire pour un portrait d'Alexandra Olelkovich-Sloutska, princesse d'Ostroh en Judith avec la tête d'Holopherne (recto) par le monogrammiste IVM ou atelier de Lucas Cranach l'Ancien, vers 1530, Galerie d'État à Dessau, perdu.
Dessin préparatoire pour saint George combattant un dragon (verso), un crypto-portrait d'Illia (1510-1539), Prince d'Ostroh par le monogrammiste IVM ou atelier de Lucas Cranach l'Ancien, vers 1530, Galerie d'État à Dessau, perdu.
Portraits d'Anna et Katarzyna Górka par Lucas Cranach l'Ancien et peintres vénitiens
Le 23 mai 1511 mourut Andrzej Szamotulski des armoiries de Nałęcz, voïvode de Poznań, l'un des hommes les plus riches du pays, nommé commissaire à la frappe des monnaies en Pologne lors du sejm du couronnement de 1502. Selon l'inscription en latin sur son épitaphe en la collégiale de Szamotuły, il était « le meilleur sénateur de tout le Royaume, le plus distingué parmi les nations étrangères avec serviabilité, éloquence et prudence ». L'épitaphe sous la forme d'une plaque métallique de grande valeur artistique, certains historiens de l'art pensent qu'Albrecht Dürer était responsable de la conception, a été commandée à Nuremberg dans l'atelier Vischer et créée par Hermann Vischer le Jeune en 1505. L'atelier de Vischer a également créé les épitaphes et autres œuvres pour les Jagellons et les membres de la cour royale, comme l'épitaphe en bronze de Filippo Buonaccorsi, dit Callimaque, précepteur des fils du roi Casimir IV Jagellon par l'atelier d'Hermann Vischer le Jeune dans l'église de la Sainte Trinité à Cracovie, créée après 1496, épitaphe en bronze de Piotr Kmita de Wiśnicz, voïvode de Cracovie dans la cathédrale de Wawel par Peter Vischer l'Ancien, créée vers 1505, plaque de bronze du cardinal Frédéric Jagellon (1468-1503), également dans la cathédrale de Wawel, par Peter Vischer, commandée par le roi Sigismond Ier et créée en 1510, grille en bronze de la chapelle de Sigismond à la cathédrale de Wawel par l'atelier de Hans Vischer, coulée entre 1530-1532, ou tombeau en bronze du banquier du roi Sigismond Ier, Seweryn Boner et de sa femme Zofia Bonerowa née Bethman par Hans Vischer dans l'église Sainte-Marie de Cracovie, créée entre 1532-1538.
En 1941, l'épitaphe de Szamotulski a été pillée par l'armée allemande, ainsi que d'autres objets de valeur. Après presque cinquante ans, il a été retrouvé dans un entrepôt de musée dans ce qui était alors Leningrad (Saint-Pétersbourg) en Russie, et en décembre 1990, il a été renvoyé à Szamotuły. L'héritier de Szamotulski était sa fille unique Katarzyna Górkowa née Szamotulska. Elle était mariée à Łukasz II Górka (1482-1542) des armoiries de Łodzia, qui à partir de 1503, avec son beau-père, supervisa la Monnaie de la Grande Pologne et qui devint plus tard staroste général de la Grande Pologne (1508-1535) et châtelain de Poznań (1511-1535). En 1518, Górka faisait partie de la suite accueillant Bona Sforza et en 1526, il accompagna Sigismond Ier sur le chemin pour la Prusse et Gdańsk, au cours duquel il établit des contacts étroits avec Albert de Prusse. Il était un partisan de l'empereur Charles V et en 1530, il participa à une réunion d'envoyés polonais, hongrois, tchèques et saxons. Un tableau de 1529 fondé par Łukasz à la chapelle Górka de la cathédrale de Poznań, aujourd'hui dans le château de Kórnik, et attribué au soi-disant maître de Szamotuły, le montre en tant que donateur devant la scène de l'Annonciation à la Vierge, portant peut-être des traits de sa femme Katarzyna. Łukasz Górka et Katarzyna Szamotulska ont eu un fils Andrzej (1500-1551), qui en 1525 épousa Barbara Kurozwęcka (décédée en 1545), et deux filles Anna et Katarzyna (Catherine). Anna épousa en 1523 Piotr Kmita Sobieński, neveu du voïvode de Cracovie mentionné ci-dessus, et l'un des disciples les plus fidèles de la reine Bona Sforza. En 1523, il lui assure une dot de 1 000 ducats sur Wiśnicz et Lipnica et en 1531 une viagère. Il était maréchal de la cour de la couronne à partir de 1518 et grand maréchal de la couronne à partir de 1529 et célèbre mécène des arts, sa cour à Wiśnicz était l'un des meilleurs centres de la Renaissance polonaise. Katarzyna épousa en 1528 Stanisław Odrowąż (1509-1545), le protégé de Bona, qui après sa mort épousa en février 1536 la duchesse Anna de Mazovie. En 1528, Stanisław a assuré à Katarzyna une dot de 30 000 zlotys sur ses domaines Jarosław et autres, et sur le domaine royal Sambir (Sambor) en Ukraine. Selon d'autres sources, ils se sont mariés en 1530. En 1537, le roi Sigismond Ier achète le domaine de Sambir à Odrowąż et l'oblige à rendre 15 000 zlotys de la dot de sa femme décédée à son père Łukasz Górka. Stanisław était châtelain de Lviv à partir de 1533, staroste de Lviv à partir de 1534, avec le soutien de la reine Bona, et voïvode de Podolie à partir de 1535. Un tableau de la Vierge à l'Enfant qui se trouvait dans l'église Saint-Erasme de Sulmierzyce, volé en 1995, a probablement été offert à l'église par Jan Sulimierski (Sulimirski) vers 1550. Au XVIe siècle, la ville voisine de Wieluń a été incorporée dans les domaines privés de la reine Bona Sforza. Depuis lors, le château de Wieluń a souvent accueilli des épouses ou des sœurs royales. À partir de 1558, le voïvode de Łęczyca, plus au nord, était Łukasz III Górka (1533-1573), petit-fils de Łukasz II. Il a d'abord été membre de l'Unité des frères et a ensuite rejoint les luthériens, qui s'opposaient au culte des saints, en particulier de la Vierge Marie. Alors peut-être que la famille Sulimierski a reçu le tableau de quelqu'un de la famille royale ou de Łukasz III, après sa conversion. Stylistiquement, la peinture est datée d'environ 1525, tandis que le château sur une colline fantastique derrière la Vierge est très similaire au siège principal de la famille Górka, le château de Kórnik près de Poznań, construit à la fin du XIVe siècle et reconstruit après 1426. Par conséquent, l'effigie doit être identifié comme portrait d'Anna Górka, la fille aînée de Łukasz II, mariée en 1523 à Piotr Kmita. La même femme a également été représentée dans un portrait peint par Lucas Cranach l'Ancien de la collection Walters (mode d'acquisition inconnu) au Walters Art Museum de Baltimore, connu sous le nom d'effigie de Marie-Madeleine. « Ses cheveux sont lâches, ce n'est donc pas une femme mariée, dont les cheveux seraient discrètement contrôlés », selon la description du musée, ils pourraient donc être créés avant le mariage. Elle a également été représentée en robe italienne de satin brillant dans un portrait de la collection de David Goldmann (1887-1967) à Vienne. Ce tableau est attribué à Paris Bordone, bien qu'il soit également très proche du style de Giovanni Cariani, tous deux peintres liés aux Jagellons et à la reine Bona (donc aussi à Piotr Kmita Sobieński). Andrea Donati date cet élégant portrait vers 1525-1530. Une femme similaire était représentée dans un tableau qui, avant la Seconde Guerre mondiale, se trouvait dans une église paroissiale de Radoszyn (Rentschen) près de Poznań. L'église de Radoszyn a été fondée à la fin du XVe siècle par les religieuses du monastère cistercien de Trzebnica, qui possédaient le village jusqu'en 1810. Après la guerre, l'œuvre a été transférée au Musée national de Varsovie depuis le dépôt d'art allemand nazi de Szczytna (Rückers). Le tableau porte la date « 1530 » et la marque de l'atelier Cranach (sous la fenêtre). Le château sur un rocher fantastique à l'arrière-plan est très similaire aux vestiges du château de Szamotuły, visible sur la lithographie de Napoléon Orda de 1880. Le château médiéval de Szamotuły a probablement été construit dans la première moitié du XVe siècle. En 1496, Andrzej Szamotulski a garanti une dot à sa fille unique Katarzyna d'une valeur de 2 000 grzywnas d'argent « sur la moitié de la ville de Szamotuły ». Katarzyna épousa Łukasz II en 1499, apportant la partie de la ville héritée de son père, y compris le château, en dot. Vers 1518, Łukasz a reconstruit le siège. Le tableau de Varsovie est une copie d'atelier d'une œuvre de Cranach, connue par nombre d'exemplaires. Le meilleur se trouve à la National Gallery of Art de Washington, qui en 1929 était probablement à la Galerie H. Michels de Berlin. De nombreux auteurs soulignent l'inspiration claire de la peinture vénitienne (directe ou indirecte à travers les œuvres d'Albrecht Dürer) dans la composition, que l'on retrouve dans les Madones de Giovanni Bellini. Deux répliques, contenant un paysage, sont connues. L'un a été vendu par la Galerie Fischer à Lucerne le 21 novembre 1972 (lot 2355), l'autre, provenant d'une collection privée en Autriche, a été vendu en 1990 à Londres. Elle a également été représentée dans un portrait, similaire à celui d'Anna Górka au Walters Art Museum , portant un chapeau à larges bords avec une plume. Cette œuvre a été vendue aux enchères à Cologne en 1920. Elle tient une plante, peut-être un coing sacré pour Vénus et symbole de fertilité. « Plutarque a conseillé aux mariées grecques de manger un coing en préparation de leur nuit de noces » (d'après le « Illustrated Dictionary Of Symbols In Eastern And Western Art » de James Hall, p. 156). Une copie de ce portrait de la collection de Miklós Jankovich (1772-1846), collectionneur d'art et historien, se trouve au Musée des Beaux-Arts de Budapest. Elle a finalement été représentée sous les traits de Sainte Catherine d'Alexandrie dans une peinture de Sacra Conversazione par Bernardino Licinio, un autre peintre lié à la reine Bona. Le mari de Katarzyna, le protégé de la reine, en armure brillante, se tient à côté d'elle. Il représente très probablement saint Georges, un saint militaire vénéré dans l'Église catholique romaine et orthodoxe orientale, qui était un saint patron de la Lituanie. Stanisław ne pouvait pas être représenté comme son patron homonyme saint Stanislas de Szczepanów, car il était évêque. Ce tableau a été vendu en 2002 à New York. Alors que dans les peintures de Cranach, les deux sœurs ont un front haut, selon la mode du Nord, les femmes se rasaient les cheveux sur le devant pour obtenir cet effet, dans les peintures vénitiennes, leurs lignes de cheveux sont plus naturelles.
Portrait d'Anna Górka en Vierge à l'Enfant devant une pendaison tenue par un ange (Madone de Sulmierzyce) par Lucas Cranach l'Ancien, vers 1523, église Saint Erasme à Sulmierzyce, volée.
Portrait d'Anna Górka par Lucas Cranach l'Ancien, vers 1523, Walters Art Museum de Baltimore.
Portrait d'Anna Kmicina née Górka par Paris Bordone ou Giovanni Cariani, vers 1525-1530, Collection particulière.
Paragraph. Cliquer ici pour modifier.
Portrait de Katarzyna Górka par l'atelier de Lucas Cranach l'Ancien, vers 1523-1536, Musée des Beaux-Arts de Budapest.
Portrait de Katarzyna Górka en Vierge à l'Enfant grignotant des raisins par Lucas Cranach l'Ancien, vers 1528-1530, National Gallery of Art de Washington.
Portrait de Katarzyna Górka en Vierge à l'Enfant grignotant des raisins par l'atelier de Lucas Cranach l'Ancien, vers 1528-1530, Collection particulière (vendue à Londres).
Portrait de Katarzyna Górka en Vierge à l'Enfant grignotant des raisins par l'atelier de Lucas Cranach l'Ancien, vers 1528-1530, Collection particulière (vendue à Lucerne).
Portrait de Katarzyna Górka en Vierge à l'Enfant grignotant des raisins par l'atelier de Lucas Cranach l'Ancien, 1530, Musée national de Varsovie.
Sacra Conversazione avec des portraits de Stanisław Odrowąż et Katarzyna Górka par Bernardino Licinio, vers 1530, Collection particulière.
Portrait de Jakub Uchański par l'entourage de Hans Asper
Le portrait d'un inconnu des années 1520 peut également être attribué au cercle de la cour Renaissance des Jagellon. Il s'agit d'une effigie d'homme de 22 ans transférée au Musée national de Varsovie de la collection Krasiński de Varsovie. D'après l'inscription en latin il a été créé en 1524 (ANNO • DOMINI • MD • XXIIII / • ANNOS • NATVS • XXII • IAR / • RB • / • IW •), l'homme est donc né en 1502, tout comme Jakub Uchański (1502-1581).
Uchański a fait ses études à l'école collégiale de Krasnystaw. Puis il fut employé à la cour du voïvode de Lublin et staroste de Krasnystaw, Andrzej Tęczyński, devenant l'un des administrateurs des vastes domaines du voïvode. Tęczyński le recommanda au référendaire de la Couronne et au futur évêque de Poznań, Sebastian Branicki. Il a ensuite été secrétaire et administrateur du domaine de la reine Bona et Interrex (régent) lors des élections royales. Malgré le fait qu'en 1534, il fut ordonné prêtre, il favorisa secrètement la Réforme, desserrant la dépendance de l'Église catholique en Pologne vis-à-vis de Rome et soutenant même le concept d'une Église nationale. En tant que chanoine, il assista secrètement, avec Andrzej Frycz Modrzewski, à des disputes théologiques dans l'esprit dissident du confesseur de la reine Bona Francesco Lismanini (Franciszek Lismanin), un Grec né à Corfou. Le portrait de Varsovie est très similaire dans le style aux effigies créées par le peintre suisse Hans Asper, élève de Hans Leu le Jeune à Zurich, en particulier au portrait d'un principal artisan de la Réforme en Suisse, Huldrych Zwingli (1484-1531) de 1531 à le Kunstmuseum Winterthur. Même la signature de l'artiste est peinte dans un style similaire, mais les lettres ne correspondent pas. Selon la convention, le portrait de Varsovie est signé du monogramme IW ou VIV. Ce Monogrammiste IW, pourrait être un autre élève de Leu, qui quitta le pays pour la Pologne lors des épisodes d'iconoclasme à Zurich entre septembre et novembre 1523, attisé par la prédication incendiaire de Zwingli, qui conduisit, entre autres, à la destruction d'un grand une partie des oeuvres de son maître. Une autre explication possible est que le tableau a été créé par Asper, le monogramme fait partie de la titulature indéterminée d'Uchański (Iacobus de Vchanie ...) et l'artiste a intentionnellement utilisé un fond cramoisi pour désigner un étranger, un Polonais (cochenille polonaise).
Portrait de Jakub Uchański (1502-1581) âgé de 22 ans par l'entourage de Hans Asper, 1524, Musée national de Varsovie.
Portraits de Stanisław Oleśnicki et Bernard Wapowski par Bernardino Licinio
En 1516, avec Bernard Wapowski, Jan Dantyszek, Andrzej Krzycki et Stanisław Tarło, qui ont tous étudié à l'Académie de Cracovie, Stanisław Oleśnicki (1469-1539) des armoiries de Dębno, devient secrétaire du roi Sigismond Ier.
Il était le fils de Feliks Jan Oleśnicki et de Katarzyna Gruszczyńska et le neveu du Zbigniew Oleśnicki (1430-1493), évêque de Gniezno et primat de Pologne. À partir de 1492, il fut chanoine de Gniezno, chanoine de Sandomierz de 1517, chanoine de Cracovie de 1519, chantre de Gniezno de 1520 et député du roi au sejmik de la voïvodie de Cracovie à Proszowice en 1518 et en 1523. Il a également été secrétaire de la reine Bona Sforza. Un portrait signé de Bernardino Licinio (P · LYCINII ·) à la York Art Gallery montre un ecclésiastique tenant à deux mains un missel à moitié ouvert. Selon l'inscription en latin (M·D·XXIIII·ANNO · AETATIS · LV·) l'homme avait 55 ans en 1524, exactement comme Stanisław Oleśnicki, né en 1469. En 1524, Jacopo Filippo Pellenegra publie à Venise son « Operetta volgare », un recueil de poèmes adressés à la reine Bona et à sa mère Isabelle d'Aragon, duchesse de Milan. Le même homme était également représenté dans le tableau de Licinio à la Gemäldegalerie de Berlin, très probablement acquis en 1815 de la collection Giustiniani à Rome. Dans la collection privée, il y a un portrait d'un astronome de la même période, attribué à Giovanni Cariani, bien que stylistiquement aussi très proche de Licinio. Il tient des anneaux astronomiques composés de trois anneaux en laiton qui pivotaient l'un dans l'autre et gravés des heures du jour, des directions et d'autres mesures. C'était un instrument utilisé par les astronomes, les navigateurs et les géomètres (d'après « Gerardus Mercator: Father of Modern Mapmaking » d'Ann Heinrichs, 2007, p. 44). Bernard Wapowski (vers 1475-1535), dit Vapovius, considéré comme le « père de la cartographie polonaise » , qui avec Oleśnicki devint secrétaire royal en 1516, étudia avec Copernic à Cracovie, avant de partir pour l'Italie, où il étudia à Bologne entre 1503-1505 puis partit pour Rome. Il retourna en Pologne en 1515, alors qu'il avait environ 40 ans. Il devint chantre et chanoine de Cracovie en 1523. Trois ans plus tard, en 1526, il assista son ami Copernic, « avec qui il écrivit sur le mouvement de huit sphères » (motu octavae sphaerae), dans la cartographie du Royaume de Pologne et du Grand-Duché de Lituanie. La même année, il crée et publie à Cracovie sa carte la plus remarquable, la première carte à grande échelle (1:1 260 000) de la Pologne. Dans la Galerie nationale d'art de Lviv, il y a un portrait d'un astronome du peintre vénitien Marco Basaiti, créé en 1512 (huile sur toile, 101,5 x 80 cm), qui est traditionnellement identifié comme l'effigie de Nicolas Copernic (1473-1543). Le tableau est signé et daté sur le tableau : M. BASAITI FACIEBAT MDXII. Dans les années 1510-1512, Copernic dresse une carte de la Varmie et des frontières occidentales de la Prusse royale, destinée au congrès du conseil royal de Poznań. En 1512, avec le chapitre de Varmie, il prête serment d'allégeance au roi de Pologne. En 1909, le tableau se trouvait dans la collection du prince Andrzej Lubomirski à Przeworsk (d'après « Katalog wystawy obrazów malarzy dawnych i współczesnych urządzonej staraniem Andrzejowej Księżny Lubomirskiej » de Mieczysław Treter, article 33, p. 11). Une copie très probablement du XIXe siècle de ce tableau se trouve au Palais Royal de Wilanów à Varsovie (huile sur toile, 103 x 81,5 cm, numéro d'inventaire Wil.1850).
Portrait de Stanisław Oleśnicki (1469-1539), chantre de Gniezno par Bernardino Licinio, 1524, York Art Gallery.
Portrait de Stanisław Oleśnicki (1469-1539), chantre de Gniezno par Bernardino Licinio, vers 1524, Gemäldegalerie à Berlin.
Portrait d'un astronome, très probablement Bernard Wapowski (vers 1475-1535), appelé Vapovius par Bernardino Licinio, vers 1520, Collection privée.
Portrait de Nicolas Copernic (1473-1543) par Marco Basaiti, 1512, Galerie nationale d'art de Lviv.
Portrait de Nicolas Copernic (1473-1543) par un suiveur de Marco Basaiti, après 1512 (XIXe siècle ?), Palais de Wilanów à Varsovie.
Portrait de Jan Dantyszek par Dosso Dossi
La reine Bona entretenait des relations très étroites et cordiales avec la cour ducale de Ferrare, et notamment avec son cousin, le cardinal Ippolito d'Este (1479-1520), et son frère, Alphonse d'Este (1476-1534), duc de Ferrare, fils d'Éléonore de Naples (1450-1493). Ainsi, lorsqu'au printemps 1524 Sigismond Ier envoie son émissaire Jan Dantyszek (1485-1548) pour une nouvelle mission en Italie concernant l'héritage de la reine Bona, il visite également Ferrare. La légation avec Ludovico Alifio, chancelier de la cour de Bona, et une suite de 27 cavaliers quittèrent Cracovie le 15 mars 1524 et se dirigèrent vers Vienne. Ils se rendirent à Venise pour féliciter le nouveau doge puis à Ferrare, où ils passèrent 6 jours à profiter de l'hospitalité du duc Alphonse. Le retour à Venise eut lieu le 3 mai et de là ils embarquèrent sur un bateau pour Bari.
L'ambassade de Dantyszek a reçu un cadre riche et coûteux. Le viatique de la légation, c'est-à-dire l'argent pour l'équipement, les voyages, les séjours et les cadeaux, s'élevait à 500 florins hongrois (d'après « Jan Dantyszek : portret renesansowego humanisty » de Zbigniew Nowak, p. 126). Il y avait un échange constant de produits des deux pays entre Ferrare et Cracovie. « Nous informons Votre Majesté que nous avons reçu toutes les choses qu'elle nous a envoyées et qu'elle n'a pas besoin de s'expliquer avec nous car le cadeau était le plus beau » - rapporte la reine au duc Alphonse le 24 janvier 1522. Le 12 juin 1524, l'envoyé de Bona Giovanni Valentino (de Valentinis) écrivit au duc Alphonse : « Ces choses que Votre Majesté envoie dans une voiture venant de Bari, Sa Majesté Royale les attend avec une grande dévotion, comme les femmes ont l'habitude de le faire ». Il semble que de Pologne les fourrures, les chevaux, les zibelines, les faucons et les chiens de chasse les plus précieux aient été livrés à la cour de Ferrare. Lorsque Valentino partit fin janvier 1527 pour Ferrare, Bona rapporta au duc qu'elle envoyait par lui des « animaux de nos pays » (d'après « Królowa Bona, 1494-1557 : czasy i ludzie odrodzenia » de Władysław Pociecha, tome 2, pages 292-293). Dans son dernier testament, daté du 28 août 1533, le duc Alphonse incluait sa famille la plus proche et la reine Bona de Pologne, à qui il laissa l'un de ses meilleurs tapis (d'après « The King of Court Poets A Study of the Work Life and Times of Lodovico Ariosto » par Edmund Garratt Gardner, p. 355). Dantyszek a commandé des œuvres d'art à de nombreux artistes éminents qu'il a rencontrés au cours de ses voyages. Lorsqu'en mai 1530 il fut nommé à l'évêché de Chełmno, il commanda une médaille à Christoph Weiditz, actif à Augsbourg, qui la fit l'année suivante. Entre 1528 et 1529, Weiditz était en Espagne, travaillant vraisemblablement à la cour impériale de Charles V. Dantyszek envoya des copies de cette médaille à ses amis en Pologne et à l'étranger, dont la reine Bona, qui reçut cette œuvre de manière très critique. Fabian Wojanowski rapporta cela à Dantyszek dans une lettre de Cracovie, le 22 novembre 1531 : « Nous avons également beaucoup discuté de l'image de Votre Révérence. Sa Majesté l'a montrée à tout le monde plusieurs fois et à tout le monde, à la fois Sa Majesté et l'évêque de Cracovie [Tomicki], ainsi que M. Nipszyc, Gołcz et moi avons affirmé que s'il n'y avait pas eu l'inscription autour du buste, ils n'auraient pas reconnu qui il représentait ». La réponse de Dantyszek à cette opinion négative de ses amis fut de commander une autre médaille en 1532, cette fois au poète et médailleur néerlandais Jan Nicolaesz Everearts, dit Johannes Secundus (d'après « Caraglio w Polsce » de Jerzy Wojciechowski, p. 31). Weiditz créa plusieurs médailles à son effigie (la première datée de 1516, une autre de 1522, deux de 1529 et une de 1531). Le modèle en bois de la médaille de 1529 se trouve aujourd'hui à la Galerie de pièces du Bode-Museum de Berlin (numéro d'inventaire 18200344). Le principal artiste actif à la cour de Ferrare lors de la visite de Dantyszek était Dosso Dossi, qui vers 1524 a peint Jupiter, Mercure et la Vertu de la collection Lanckoroński (château royal de Wawel à Cracovie). Dosso, qui a également voyagé à Florence, Rome et surtout Venise, est finalement devenu le chef de file de l'école de Ferrare et l'un des artistes les plus importants de son temps. Au Nationalmuseum de Stockholm, se trouve un portrait d'homme coiffé d'un béret noir par Dosso Dossi, offert par Hjalmar Linder en 1919 (numéro d'inventaire NM 2163). Le tableau ou une copie a été très probablement documenté dans l'inventaire de la collection de la reine Christine de Suède à Rome en 1662 comme un portrait de Cesare Borgia, duc de Valentinois (Valentino, Valentin) par le Corrège. Plus tard ce tableau ou une autre version se trouva à Paris dans la collection des ducs d'Orléans au Palais-Royal et fut capturé dans une estampe de François Jacques Dequevauviller (1783-1848), réalisée en 1808 (Bibliothèque nationale du Portugal, numéro d'inventaire E. 477 V.). Certaines différences entre la gravure et la version de Stockholm sont visibles en arrière-plan - une fenêtre dans le tableau et un petit mur dans l'estampe. Il n'y a pas de cadre peint dans la gravure. La tour est différente et dans l'impression, la tour fait partie d'une autre structure, très probablement une église. Lors de la Révolution de 1848, une foule parisienne attaque et pille la résidence royale Palais-Royal, en particulier la collection d'art du roi Louis-Philippe. Il est possible que la version parisienne ait été détruite. Selon les auteurs de « Dosso Dossi: Court Painter in Renaissance Ferrara » (p. 231) le tableau de Stockholm était de 1798 dans la collection de Thomas Hope (1769-1831) en Angleterre. A noter que la gravure de Dequevauviller d'après le portrait de Nikolaus Kratzer par Hans Holbein le Jeune est très fidèle. La tenue de l'homme est clairement nord-européenne et très similaire à celle visible dans un portrait de Hans Dürr, daté de 1521 et dans un portrait de Wolff Fürleger, daté de 1527, tous deux de Hans Brosamer, peintre allemand actif à Nuremberg entre 1519-1529, où Sigismond I a commandé de nombreuses œuvres d'art de valeur. La tour en arrière-plan avec un toit en pente est également plus nord-européenne et similaire aux tours visibles dans une estampe publiée en 1694 et illustrant le siège de Grudziądz par les Suédois en 1655 (Obsidio civitatis et arcis Graudensis, Bibliothèque nationale de Pologne). Jan Dantyszek a terminé ses études élémentaires dans une école paroissiale de Grudziądz (Graudenz en allemand), une ville de Prusse polonaise. La tour (turris) est aussi une sorte de refrain ou de leitmotiv du drame sur Jan Dantyszek mis en scène en 1731 au Collège des Jésuites de Vilnius. Le personnage principal est un envoyé en 1525 de Sigismond Ier auprès de l'empereur et du roi d'Espagne Charles V, doté par l'empereur du titre de grand d'Espagne. Il fait un rêve dans lequel il voit une haute tour tomber sur ses épaules et s'appuyer sur lui : Incumbet humeris hic brevi Turris tuis. Cela signifie à la fois la prison et le plus grand honneur qui tombe sur les épaules - dans les scènes du couronnement du poète (d'après « Dantiscana. Osiemnastowieczny dramat o Janie Dantyszku » de Jerzy Starnawski). Comme dans le cas des portraits d'Anna van Bergen (1492-1541), marquise de Veere par Jan Gossaert et de son atelier, de l'empereur Charles Quint par des peintres néerlandais et italiens et des portraits de la reine Bona par Bernardino Licinio, il existe quelques différences, telles que couleur des yeux, dans les peintures de différents artistes, cependant, l'homme de la peinture de Dossi ressemble fortement aux effigies de Jan Dantyszek, en particulier ses portraits des ateliers de Jan Gossaert et Marco Basaiti (attribués par moi), ou une estampe anonyme de Ioannis de Curiis Dantisci episcopi olim Varmiensis poemata et hymni e Bibliotheca Zalusciana, publié à Wrocław en 1764, d'après un portrait perdu probablement de Crispin Herrant. Comme dans le portrait de l'atelier Gossaert, le modèle est encadré dans un cadre peint en noir, mais contrairement à la tradition nordique et aux portraits précités de Brosamer, il n'était pas nécessaire de mettre l'inscription. Tout le monde connaissait déjà le célèbre ambassadeur de Son Altesse le Roi de Pologne et Grand-Duc de Lituanie.
Portrait de Jan Dantyszek (1485-1548), ambassadeur du roi de Pologne par Dosso Dossi, vers 1524, Nationalmuseum de Stockholm.
Portrait de Jan Dantyszek (1485-1548), ambassadeur du roi de Pologne, de la collection des ducs d'Orléans, de François Jacques Dequevauviller d'après Dosso Dossi, 1808 d'après l'original d'environ 1524, Bibliothèque nationale du Portugal.
Portraits d'Anne Lascaris et Madeleine de Savoie par Giovanni Antonio Boltraffio et Bernardino Luini
Au début de 1524, Hieronim Łaski (1496-1541), Grand maître d'hôtel de la Couronne et ses frères Jan (1499-1560) et Stanisław (1491-1550), se rendirent à la cour de Saint-Germain-en-Laye, sous le prétexte officiel d'engager la France à faire la paix avec ses voisins en considération de la menace ottomane. Sa mission était de signer un traité avec le roi de France concernant principalement le duché de Milan et un double mariage. Antoine Duprat (1463-1535), Chancelier de France (et cardinal à partir de 1527) et René (Renato) de Savoie (1473-1525), Grand Maître de France et oncle du roi François Ier, qui traita avec Łaski au nom du roi, entreprit immédiatement de rédiger un traité d'alliance, comprenant des contrats de mariage entre les enfants des rois de Pologne et de France. Les cours polonaise et française ont sans doute échangé à cette occasion quelques cadeaux diplomatiques et effigies. Après avoir terminé sa mission à la cour de France, Hieronim Łaski retourna en Pologne au début de l'automne 1524, laissant ses frères à Paris. Jan se rendit à Bâle où il rencontra Érasme de Rotterdam et Stanisław rejoignit la cour de François Ier et l'armée française et participa à la bataille de Pavie en 1525. Il fut alors envoyé par Louise de Savoie (1476-1531), mère du roi François Ier et Régent de France, en Espagne.
Le demi-frère de Louise, René, qui lorsque François monta sur le trône de France fut nommé gouverneur de Provence et sénéchal de Provence, mourut à la bataille de Pavie. René épouse le 28 janvier 1501, Anne Lascaris (1487-1554). Comme comte de Tende, il fut succédé par son fils Claude de Savoie (1507-1566) puis par son autre fils Honorat II de Savoie, qui épousa Jeanne Françoise de Foix et dont l'arrière-petite-fille Marie-Louise de Gonzague devint reine de Pologne en 1645. Marie Louise a apporté en Pologne quelques tableaux de sa dot, dont une petite partie est conservée au monastère des Visitandines de Varsovie. Descendante de Claude de Savoie, Claire Isabelle Eugénie de Mailly-Lespine (1631-1685), parente éloignée, dame de compagnie et confidente de la reine Marie-Louise de Gonzague épousa en 1654 Krzysztof Zygmunt Pac (1621-1684), Grand porte-étendard de la Couronne. René de Savoie et Anne Lascaris ont également eu trois filles. Madeleine de Savoie (1510-1586), qui passa une partie de sa jeunesse à la cour de sa tante, Louise de Savoie, et sur sa décision elle épousa Anne de Montmorency (1493-1567), maréchal de France, peu après la mort de son père. Le contrat est signé le 10 janvier 1526 et la cérémonie se déroule au palais royal de Saint-Germain-en-Laye. Isabelle, la jeune (décédée en 1587), mariée en 1527 à René de Batanay, comte de Bouchage et Marguerite (décédée en 1591) mariée en 1535 à Antoine II de Luxembourg, comte de Ligny (décédé en 1557), frère de Françoise de Luxembourg-Ligny (décédé en 1566), margravine de Baden-Baden. Le portrait d'une jeune femme de la National Gallery of Art de Washington, créé dans le style de Bernardino Luini, est daté d'environ 1525. Elle tient un zibellino (martre subelline) sur sa main, un accessoire populaire pour les mariées comme talisman pour la fertilité, et debout devant un tissu vert, une couleur étant symbolique de la fertilité. Ce tableau a été acquis par la Galerie en 1937 et au XIXe siècle, il appartenait peut-être à la reine Isabelle II d'Espagne. Cette beauté de type Léonard de Vinci de la peinture de Washington pourrait devenir une muse pour Luini (les peintures peuvent également représenter ses sœurs), car ses traits peuvent être trouvés dans d'autres œuvres de ce peintre, cependant, seules quelques effigies sont les plus similaires et ressemblent davantage à des portraits, comme la Madone allaitante dans un robe verte au Musée national de Varsovie. Ce tableau se trouvait au XIXe siècle dans la collection de Konstanty Adam Czartoryski (1774-1860), le fils de la célèbre collectionneuse d'art la princesse Izabela Czartoryska (1746-1835), dans son palais de Weinhaus près de Vienne. En 1947, il a été acquis par le musée de Varsovie. Dans le palais royal de Wilanów à Varsovie, il y a deux peintures de Cupidons, peut-être acquises par Aleksandra Potocka, et supposées provenir de l'école de Léonard de Vinci dans l'inventaire de 1895. Ils sont aujourd'hui attribués à Aurelio Luini, fils de Bernardino. La conservation des deux tableaux a révélé qu'ils faisaient initialement partie d'une composition plus vaste représentant Vénus avec deux Amours, peut-être endommagés, découpés en morceaux puis repeints. La pose de ses jambes indique qu'il s'agissait d'un type de Vénus pudique, semblable à la statue d'Eve de la fin du XVe siècle sur l'abside de la cathédrale de Milan, attribuée au sculpteur vénitien Antonio Rizzo. L'un Cupidon tient un myrte, consacré à Vénus, déesse de l'amour et utilisé dans les couronnes de mariée, l'autre présente son arc à Vénus. Il est fort probable que les monarques polono-lituaniens Sigismond et Bona ou Janusz III, duc de Mazovie, dont le portrait par Bernardino Licinio, de l'ancienne collection des ducs de Savoie, se trouve au Palais Royal de Turin, aient reçu les effigies de la fille aînée du Grand Maître de France sous les traits de la Vierge et déesse de l'amour. La Vénus préservée de Bernardino Luini se trouve également à la National Gallery of Art de Washington. Elle a été offert à la Galerie en 1939 et au XIXe siècle, le tableau était en Angleterre. Le visage de la déesse est le même que dans le portrait mentionné d'une dame tenant un zibellino et Madone allaitante (Madonna Lactans) à Varsovie et le paysage derrière elle est étonnamment similaire à la vue de Tendarum Oppidum, publiée dans le Theatrum Statuum Sabaudiæ en 1682 à Amsterdam par Joan Blaeu. Elle montre Tende (Tenda) dans le coin sud-est de la France, le village à flanc de colline, dominé par le château de Lascaris et un monastère de montagne. En 1261, Guglielmo Pietro I di Ventimiglia, seigneur de Tende, épousa Eudoxie Lascarina, sœur de l'empereur byzantin Jean IV Lascaris. En 1509, le comté passa, par mariage, au prince de Savoie, René, dont la branche s'éteignit en 1754. La même femme, également vêtue d'une robe verte, était représentée comme sainte Marie-Madeleine tenant un récipient d'onguent. Ce tableau, également à la National Gallery of Art de Washington, était jusqu'en 1796 à la Pinacothèque Ambrosienne de Milan et plus tard dans la collection de Lucien Bonaparte, prince de Canino. Elle a également été représentée comme cette sainte dans la composition de Luini au San Diego Museum of Art montrant la Conversion de la Madeleine, très probablement aussi de la collection de Lucien Bonaparte. La même effigie que dans la Vénus à Washington a également été utilisée comme modèle dans deux tableaux de la collection royale française, tous deux conservés au Louvre. L'une montre la tentatrice biblique Salomé recevant la tête de saint Jean-Baptiste. Il fut acquis par le roi Louis XIV en 1671 auprès d'Everhard Jabach. Le second, représentant la Sainte Famille, a été acquis avant 1810. Dans toutes les peintures mentionnées, le visage d'une femme ressemble fortement à l'effigie de Madeleine de Savoie, duchesse de Montmorency et de sa fille aînée dans un vitrail numéro 14 de l'église Saint-Martin de Montmorency. Ce vitrail, créé vers 1563, est une composition pendante d'un vitrail d'Anne de Montmorency, l'époux de Madeleine. Il la montre agenouillée et recommandée par sa sainte patronne Marie-Madeleine dans une robe verte et ses armoiries en dessous. Au centre de la nef de l'église, qui servait de sépulture aux seigneurs de Montmorency, se trouvait le magnifique tombeau d'Anne de Montmorency et de son épouse Madeleine. Le gisant en marbre du connétable et de sa femme se trouve aujourd'hui au musée du Louvre à Paris. Il a été commandé par Madeleine et créé entre 1576-1582 par Barthélemy Prieur et Charles Bullant et la représente dans sa vieillesse et dans un costume couvrant presque tout son visage, cependant, aussi dans cette effigie une certaine ressemblance est visible. Une femme très similaire a été représentée dans une peinture d'une dame avec une chaîne avec des scorpions dans une robe verte au Columbia Museum of Art, peinte dans le style de Léonard. Son costume est plutôt du tournant du XVe et XVIe siècle, il s'agit donc de la mère de Madeleine, Anne Lascaris. Elle est née en novembre 1487, sous le signe astrologique du Scorpion. Alors qu'elle n'avait que 11 ans, elle épousa en février 1498 Louis de Clermont-Lodève, mais son mari mourut quelques mois seulement après le mariage. Le 28 janvier 1501, à l'âge de 13 ans, elle épouse René. En astrologie, les différents signes du zodiaque sont identifiés avec différentes parties du corps. Le Scorpion, le signe qui régit les organes génitaux, est le plus sexuellement chargé de tous les signes du zodiaque et associé à la fertilité. L'œuvre provient de la collection du comte Potocki du château de Zator et du palais de Jabłonna à Varsovie. À Zator, le portrait a été vu par Emil Schaeffer (1874-1944), historien de l'art, journaliste et dramaturge autrichien, qui l'a décrit dans un article publié dans le Beiblatt für Denkmalpflege en 1909. Le château des ducs Piast à Zator a été construit au XVe siècle et agrandi au XVIe siècle après avoir été acquis par le roi Jean Albert en 1494. Plus tard, le domaine de Zator appartenait à différentes familles nobles et magnats, dont Poniatowski, Tyszkiewicz, Wąsowicz et Potocki, tandis que le palais néoclassique de l'évêque Michał Jerzy Poniatowski, frère du roi Stanislas II Auguste Poniatowski, à Jabłonna près de Varsovie, a été construit par l'architecte royal Domenico Merlini entre 1775-1779. En 1940, pendant la Seconde Guerre mondiale, le portrait a été emmené en Italie et vendu à la famille des princes Contini Bonacossi à Florence. En 1948, l'œuvre est acquise par la Samuel H. Kress Foundation et offerte au Columbia Museum of Art en 1961. Ce portrait peut donc être lié, avec une forte probabilité, à la collection de la reine Marie-Louise de Gonzague ou de Claire Isabelle Eugénie de Mailly-Lespine (plus connue en Pologne-Lituanie sous le nom de Klara Izabella Pacowa), descendantes d'Anne Lascaris. Une copie de ce portrait, attribué au Maître de la Vierge à la balance, d'après l'œuvre du Louvre, ou à un disciple de Léonard de Vinci, qui se trouvait dans une collection à New York avant février 1913, la montre dans une robe de soie dorée.
Portrait d'Anne Lascaris (1487-1554), comtesse de Tende avec une chaîne avec des scorpions par Giovanni Antonio Boltraffio, vers 1500-1505, Columbia Museum of Art.
Portrait d'Anne Lascaris (1487-1554), comtesse de Tende dans une robe de soie dorée par Giovanni Antonio Boltraffio ou suiveur, vers 1500-1505, Collection privée.
Portrait de Madeleine de Savoie (1510-1586) tenant un zibellino par Bernardino Luini, vers 1525, National Gallery of Art de Washington.
Portrait de Madeleine de Savoie (1510-1586) en Madone allaitante (Madonna Lactans) par Bernardino Luini, vers 1525, Musée national de Varsovie.
Portrait de Madeleine de Savoie (1510-1586) en Marie-Madeleine par Bernardino Luini, vers 1525, National Gallery of Art de Washington.
La Conversion de la Madeleine avec un portrait de Madeleine de Savoie (1510-1586) par Bernardino Luini, vers 1520-1525, San Diego Museum of Art.
Portrait de Madeleine de Savoie (1510-1586) en Salomé recevant la tête de saint Jean-Baptiste par Bernardino Luini, vers 1525, Musée du Louvre.
La Sainte Famille avec un portrait de Madeleine de Savoie (1510-1586) par Bernardino Luini, vers 1525, Musée du Louvre.
Portrait de Madeleine de Savoie (1510-1586) en Vénus contre la vue idéalisée de Tende par Bernardino Luini, vers 1525, National Gallery of Art de Washington.
Cupidon avec un arc, fragment d'un plus grand tableau « Vénus avec deux Amours » de l'atelier de Bernardino Luini, vers 1525, Palais Wilanów à Varsovie.
Cupidon avec un myrte, fragment d'un plus grand tableau « Vénus avec deux Amours » de l'atelier de Bernardino Luini, vers 1525, Palais Wilanów à Varsovie.
Portrait de la reine Bona Sforza en Marie-Madeleine et en sainte-Hélène par Lucas Cranach l'Ancien
Le 11 février 1524 mourut à Bari Isabelle d'Aragon, duchesse de Milan, mère de Bona Sforza d'Aragona, qui après l'effondrement des Sforza à Milan et de sa famille à Naples, reçut le titre de duchesse de Bari et princesse de Rossano. Les duchés que Bona a hérités de sa mère ont été impliqués dans la lutte entre les forces françaises et espagnoles des Habsbourg pour le contrôle de l'Italie. Lorsque l'empereur Charles Quint reconquit Milan aux Français en 1521, Francesco II Sforza, membre d'une branche rivale de la famille, en fut nommé duc.
Craignant l'influence croissante des Habsbourg, Bona s'efforce de resserrer la coopération avec la France. En juillet 1524, Hieronim Łaski signa un traité avec la France à Paris au nom de Sigismond Ier, qui annula l'alliance polonaise avec les Habsbourg convenue au Congrès de Vienne de 1515. Il fut convenu qu'Henri, le fils cadet du roi de France François Ier ou le roi d'Écosse Jacques, épousera une des filles de Sigismond Ier, Hedwige ou Isabelle, et que Sigismond Auguste épousera une fille de François Ier. Déterminé à reconquérir la Lombardie, François Ier, concurrent de Charles Quint pour la dignité impériale, envahit la région à la mi-octobre 1524. Il est cependant vaincu et fait prisonnier à Pavie le 25 février 1525, garantissant le contrôle espagnol de l'Italie. Cette bataille a radicalement changé la situation de Bona. Les projets de mariage avec la cour de France avaient été annulés et Bona dut accepter les fiançailles de son fils unique avec Elisabeth d'Autriche, fille du frère cadet de Charles V, Ferdinand et de sa femme Anne Jagellon. L'empereur triomphant hésitait à reconnaître les droits de Bona à la succession de sa mère. Les efforts diplomatiques de la cour polonaise ont finalement été couronnés de succès et le 24 juin 1525, Ludovico Alifio, chancelier de la cour de Bona, a finalement pris en son nom les possessions italiennes héritées. Le tableau de Cranach de 1525 à Cologne, une ville impériale, dont l'archevêque était l'un des électeurs du Saint Empire romain germanique et le principal officiant lors de la cérémonie du couronnement de l'empereur, montre Bona comme une femme pécheresse, Marie-Madeleine, dont Jésus avait chassé des démons et qui est ensuite devenu un important disciple et interlocuteur de Jésus (Luc 8:2). Elle est représentée avec un vase d'onguent, en référence à l'Onction de Jésus, et ses cheveux recouverts d'un voile pénitentiel translucide. La forêt est symbolique de la souffrance religieuse du pénitent, tandis que le cerf est un symbole du Christ. Les saints Eustache et Hubert se sont convertis au christianisme en voyant un cerf avec une croix. Enfin le paysage à droite est très similaire à la vue de Mola (aujourd'hui Mola di Bari), cité vénitienne proche de Bari, avec Castel Novo, château aragonais, resté fidèle à Naples, publiée par Georg Braun & Frans Hogenberg en 1582. La vue de gauche peut être comparée à la topographie de Rossano, une ville construite sur un gros rocher. Le contexte du portrait de Bona sous les traits de sainte-Hélène tenant la croix par Lucas Cranach l'Ancien au Cincinnati Art Museum est similaire. La croix du sacre des monarques polonais était un reliquaire de la Vraie Croix (Vera Crux) de l'empereur byzantin Manuel Comnène, créée au XIIe siècle, aujourd'hui à Notre-Dame de Paris. Comme la légendaire chercheuse de la Vraie Croix, Hélène, impératrice de l'Empire romain et mère de l'empereur Constantin le Grand, Bona a trouvé la vérité et le droit chemin et sous les traits de sainte impératrice s'adresse à l'empereur Charles Quint. Le tableau est daté de 1525 et a été acquis de la collection des princes du Liechtenstein à Vienne. Son histoire antérieure est inconnue. Il est fort possible qu'il ait été initialement dans la collection impériale et qu'il ait été envoyé par Bona aux Habsbourg.
Portrait de la reine Bona Sforza (1494-1557) en Marie-Madeleine par Lucas Cranach l'Ancien, 1525, Wallraf-Richartz-Museum.
Portrait miniature de la reine Bona Sforza (1494-1557) par Lucas Cranach l'Ancien, vers 1525, collection particulière.
Portrait de la reine Bona Sforza (1494-1557) en sainte-Hélène par Lucas Cranach l'Ancien, 1525, Cincinnati Art Museum.
Portraits d'Hedwige Jagellon et de sa belle-mère Bona Sforza contre les paysages idéalisées de Cracovie par Lucas Cranach l'Ancien
1526 est une année très importante pour les Jagellons. En janvier, le principal port du royaume, Gdańsk, et d'autres villes de la Prusse royale se sont révoltés contre la Couronne. En mars, le duché de Mazovie était tombé aux mains de la Couronne après la mort sans héritier du dernier membre masculin des Piasts de Mazovie, Janusz III (Bona était accusé d'avoir empoisonné le duc).
Le 22 mai 1526, Bernardino de Muro et Andrea Melogesio, au nom des habitants de Rossano, ont prêté serment d'allégeance à Bona Sforza et Sigismond l'Ancien dans la cathédrale de Wawel, soi-disant « Hommage italien ». Et finalement, en août, l'Empire ottoman envahit la Hongrie et le neveu de Sigismond Ier, Louis II, roi de Hongrie, de Croatie et de Bohême, fut tué à la bataille de Mohács. Les portraits de dames de la forteresse de Cobourg datés par des experts d'environ 1526 et de l'Ermitage, daté 1526 sur le rebord de la fenêtre, ressemblent beaucoup aux miniatures d'Hedwige et de sa belle-mère Bona de la même période. Les traits du visage et les costumes sont presque identiques. La topographie des paysages, bien qu'idéalisée et vue à travers le prisme de l'art de Cranach, correspond parfaitement à la capitale du Royaume - Cracovie. Dans le portrait d'Hedwige, on peut voir le château royal de Wawel et la Vistule vers l'abbaye de Tyniec au sud, comme dans une estampe publiée en 1544 dans Cosmographia Universalis, et dans le portrait de Bona, on peut distinguer la colline de Wawel avec la tour de Sandomierz vers Monastère de Zwierzyniec au nord.
Portrait de la princesse Hedwige Jagellon (1513-1573) contre la vue idéalisée de Cracovie par Lucas Cranach l'Ancien, vers 1526, Veste Cobourg.
Portrait de la reine Bona Sforza (1494-1557) contre la vue idéalisée de Cracovie par Lucas Cranach l'Ancien, 1526, Musée de l'Ermitage.
Portrait de la reine Bona Sforza (1494-1557) par l'atelier de Lucas Cranach l'Ancien, vers 1526, Château de la Fasanerie à Eichenzell.
Portrait de la reine Bona Sforza (1494-1557) par Lucas Cranach l'Ancien, vers 1526, vendu à l'Hôtel Drouot à Paris le 30 octobre 1942, perdu.
Portrait de la princesse Hedwige Jagellon en Madone par Jan Gossaert
En 2021, le Château Royal de Varsovie achète un portrait représentant Jan Dantyszek (Johannes Dantiscus), dit le « Père de la diplomatie polonaise » (vendu chez Lempertz, Auction 1185, Cologne, Lot 1513, huile sur bois, 42 x 30 cm). Cette œuvre, décrite comme un portrait d'érudit par un maître allemand vers 1530, provient d'une collection privée du nord de l'Allemagne et il s'agit d'une copie ou plutôt d'une version d'un tableau du Musée de l'Université Jagellonne à Cracovie (numéro d'inventaire 1987). Le tableau a ensuite été attribué à un copiste d'« un peintre néerlandais d'après Jan Gossaert ?, vers 1654 » (d'après « A Polish Envoy in England - Ioannes Dantiscus’s Visit to 'a Very Dear Island' » de Katarzyna Jasińska-Zdun, p. 3). La composition de l'effigie ressemble beaucoup au portrait d'un érudit de Jan Gossaert à la Staatsgalerie de Stuttgart, tandis que le costume et les mains du modèle ont été peints dans le même style que dans le portrait d'Anna van Bergen (1492-1541), Marquise de Veere en Madone à l'Enfant de l'atelier de Jan Gossaert (vendu chez Lempertz, Auction 1118, Cologne, Lot 1513). Une autre version de ce portrait, attribuée à Jacob van Utrecht, peintre flamand ayant travaillé à Anvers et à Lübeck, a été vendue à New York en 1945 (Parke-Bernet Galleries, collection de John Bass, 25 janvier 1945, lot 12).
Dantyszek s'est associé à la cour royale du roi Jean Ier Albert et plus tard du roi Sigismond Ier l'Ancien en tant que diplomate et secrétaire royal. Il est né Johann(es) von Höfen-Flachsbinder en 1485 à Gdańsk (en latin Gedanum ou Dantiscum), où les influences hollandaises et flamandes deviennent prédominantes au XVIe siècle. En tant que diplomate, il a souvent voyagé à travers l'Europe, notamment à Venise, en Flandre et aux Pays-Bas. En 1522, il se rend à Vienne, puis via Nuremberg, Ulm, Mayence, Cologne et Aix-la-Chapelle jusqu'à Anvers. Là, il attend de nouvelles instructions du roi, qui lui ordonne de se rendre en Espagne. De Calais, il se rendit par bateau d'abord en Angleterre, à Cantorbéry et à Londres, puis en octobre 1522 en Espagne. De là, il voyage en bateau de La Coruña à Middelburg, capitale de la province de Zélande dans les Pays-Bas d'aujourd'hui. Par Bergen en Brabant (12 mai) et Anvers, il se rend à Malines, où il séjourne à la cour de l'archiduchesse Marguerite d'Autriche, gouverneure des Pays-Bas des Habsbourg. Puis, via Cologne et Leipzig, il arrive à Wittenberg, où il rencontre Luther et Melanchthon. À l'été 1523, il retourne en Pologne. Au printemps 1524, le roi l'envoie pour une nouvelle mission en Italie concernant l'héritage de la reine Bona dans le sud de l'Italie. Via Vienne, il se rend à Venise, puis à Ferrare, puis par bateau de Venise à Bari. D'Italie il repart - à travers la Suisse et la France - vers l'Espagne, vers Valladolid. En 1524, il est à Madrid, à la cour impériale et en 1526 à Gênes (d'après « Królowa Bona, 1494-1557 : czasy i ludzie odrodzenia », tome 2, par Władysław Pociecha, p. 228). Au bout de quelques années, en 1528, Dantyszek voulut retourner en Pologne et fut interpellé par Sigismond Ier, mais cette fois l'empereur, qui se rendait en Italie, aux Pays-Bas et en Allemagne, le retint à sa cour et l'envoyé l'accompagna (d'après « Polska slużba dyplomatyczna XVI-XVIII wieku » par Zbigniew Wójcik, p. 56). À cette époque, en 1524, le peintre sud-néerlandais Jan Gossaert (vers 1478-1532), également connu sous le nom de Jan Mabuse, revint de Duurstede à Middelburg, où il fut enregistré comme résident entre 1509 et 1517, peu après son retour d'Italie. Il devient peintre de la cour d'Adolphe de Bourgogne (1489-1540), marquis de Veere et amiral des Pays-Bas. D'après Het Schilder-boeck de Karel van Mander, publié pour la première fois en 1604 à Haarlem, vers 1525 ou avant lorsqu'il travaillait à la cour du grand-oncle d'Adolphe, Philippe de Bourgogne, lui et son atelier ont créé une série de peintures représentant « un image de Marie dans laquelle le visage a été peint après la femme du marquis et le petit enfant après son enfant ». Le portrait déguisé d'Anna van Bergen et de son fils ou de sa fille est connu de plusieurs versions avec des différences mineures, notamment la couleur des yeux - bleu pour certains, marron pour d'autres (ex. vendu chez Christie's, 7 décembre 2018, lot 113). Gossaert a également créé plusieurs autres effigies de la marquise de Veere. Dantyszek a également commandé des œuvres d'art à de nombreux artistes éminents qu'il a rencontrés au cours de ses voyages. Lorsqu'en mai 1530 il fut nommé à l'évêché de Chełmno, il commanda une médaille à Christoph Weiditz, actif à Augsbourg, qui la fit l'année suivante. Entre 1528 et 1529, Weiditz était en Espagne, travaillant vraisemblablement à la cour impériale de Charles V. Dantyszek envoya des copies de cette médaille à ses amis en Pologne et à l'étranger, dont la reine Bona (d'après « Caraglio w Polsce » de Jerzy Wojciechowski, p. 31). Weiditz créa plusieurs médailles à son effigie (la première datée de 1516, une autre de 1522, deux de 1529 et une de 1531). Semblable à la marquise de Veere et aux membres de la famille royale danoise, Dantyszek pouvait également commander une série de ses portraits dans l'atelier de Gossaert. On sait qu'en 1494 un peintre néerlandais nommé Johannes de Zeerug séjourna à la cour du roi Jean Ier Albert, que Sokołowski identifia à Jan Gossaert (d'après « Malarstwo polskie: Gotyk, renesans, wczesny manieryzm » de Michał Walicki, p. 33). Son portrait au Musée de l'Université Jagellonne a également été peint sur bois - détrempe et huile sur bois de chêne, et a des dimensions similaires (40,5 x 29,3 cm, numéro d'inventaire 1985). Cette version est étonnamment similaire, tant dans le style que dans la composition, aux œuvres signées du peintre vénitien Marco Basaiti (vers 1470-1530) - notamment le portrait de Nicolas Copernic, créé en 1512 (huile sur toile, Galerie nationale d'art de Lviv) et le portrait de un gentilhomme en noir, créé en 1521 (huile sur panneau, Accademia Carrara à Bergame, signé M. BAXITI. F. MDXXI). Il est fort possible que Dantyszek ait commandé une copie de son portrait à l'atelier de Gossaert à Venise ou vice versa, une copie du portrait à l'atelier de Basaiti aux Pays-Bas. Le tableau du musée de l'Université Jagellonne a été repeint au XIXe siècle et ces interventions ont été supprimées lors de la restauration en 1992. Sur la base de l'examen du support du tableau, certains chercheurs datent le tableau de la fin du XVIe siècle, mais selon le note en français du XIXe siècle au verso sur le cadre il y avait initialement une inscription en latin : Johannes Dantiscus serenissimi Poloniae regis orator Aetatis 48 anno 1531 (d'après « Portret w Gdańsku ... » d'Aleksandra Jaśniewicz, p. 381), selon laquelle il montre Dantyszek en 1531 à l'âge de 48 ans. Les cadres ont généralement été ajoutés plus tard et la date n'est pas très précise car d'après l'inscription Dantyszek serait né en 1483 et non en 1485 comme le prétendent la majorité des sources. Dantyszek, qui devint en 1529 chanoine du chapitre de Varmie, puis - évêque de Chełmno, servit également d'intermédiaire dans des commandes de portraits, comme l'effigie de Mauritius Ferber (1471-1537), prince-évêque de Varmie, créé en 1535 par Crispin Herrant, élève de Dürer et entre 1529-1549 peintre de la cour du duc Albert de Prusse à Königsberg (d'après « Malarstwo polskie: Gotyk, renesans, wczesny manieryzm » par Michał Walicki, p. 339) ou le portrait de la princesse Isabelle Jagellon (1519-1559), commandée en 1537 par la reine Bona. À la galerie Colonna de Rome, dans la salle des tapisseries, se trouve un portrait d'une dame en Vierge à l'Enfant de Jan Gossaert (numéro d'inventaire 2029, huile sur bois, 42,8 x 32 cm). Son visage ressemble beaucoup à d'autres effigies de la princesse Hedwige Jagellon (1513-1573) par Cranach (en Vénus à Berlin et en Madone à Madrid) et son portrait en robe noire par Titien (Vienne), toutes identifiées par moi. Semblable au portrait de la cousine d'Hedwige Anna Jagellon (1503-1547), reine d'Allemagne, de Bohême et de Hongrie en Vénus par Cranach (Galerie Borghèse à Rome, datée de 1531), le pape ou les cardinaux devraient recevoir l'image de cette importante princesse catholique. En Pologne, il existe plusieurs peintures de Gossaert et de son atelier. La Vierge à l'Enfant dans un cadre architectural se trouve au palais royal de Wilanów à Varsovie (Wil.1591), ainsi qu'une version de la Vierge à l'Enfant jouant avec le voile (Wil.1008), toutes deux considérées comme faisant partie de la collection de Stanisław Kostka Potocki (1755-1821). Une autre Vierge à l'Enfant jouant avec le voile de la collection d'Izabela Piwarska se trouve au Musée national de Varsovie (M.Ob.63), tandis que Pélée et Thétis avec le jeune Achille se trouve au château royal de Wawel (ZKWawel 4213). Portrait d'Isabelle d'Autriche, reine du Danemark par Jan Gossaert du château de Tarnowski à Dzików, créé vers 1514, a été perdu pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce dernier tableau a été acquis avant 1795 par le roi Stanislas Auguste. Il ne peut être exclu qu'il ait été envoyé en Pologne-Lituanie en cadeau dès 1514.
Portrait d'Isabelle d'Autriche, reine de Danemark par Jan Gossaert, vers 1514, château de Tarnowski à Dzików, perdu.
Portrait de Jan Dantyszek (1485-1548) par l'atelier de Marco Basaiti, années 1520, Musée de l'Université Jagellonne.
Portrait de Jan Dantyszek (1485-1548) par l'atelier de Jan Gossaert, années 1520, Château Royal de Varsovie.
Portrait de Jan Dantyszek (1485-1548) par Jacob van Utrecht, années 1520, collection privée.
Portrait de la princesse Hedwige Jagellon (1513-1573) en Vierge à l'Enfant par Jan Gossaert, vers 1526-1532, Galerie Colonna à Rome.
Portrait de Jan Janusz Kościelecki par Giovanni Cariani
Si un atelier à l'étranger offrait un service de haute qualité à un prix raisonnable et était facilement accessible, pourquoi créer les structures localement, ce qui serait beaucoup plus coûteux et chronophage ? Cela expliquerait pourquoi les monarques jagellons n'employaient aucun maître éminent à leur cour directement et en permanence, comme Raphaël à la cour pontificale en Italie, Jean Clouet et son fils François en France, Alonso Sánchez Coello en Espagne, Cristóvão de Morais au Portugal, Hans Holbein en Angleterre, Lucas Cranach en Saxe ou Jakob Seisenegger en Autriche. Aujourd'hui, nous appelons externalisation des pratiques similaires, cependant, pour certains historiens de l'art à la fin du XIXe et au début du XXe siècle, l'absence d'atelier de peinture éminent et permanent en Pologne-Lituanie au XVIe siècle, était une preuve d'infériorité des monarchies électives jagellonnes.
Le peintre de la cour de Sigismond et Bona Sforza aurait non seulement besoin de satisfaire la demande locale de peintures en Pologne-Lituanie, mais aussi dans les possessions italiennes de Bona et leurs vastes relations italiennes, allemandes et internationales. Le choix de Venise, située sur le chemin de Bari et de l'atelier de Cranach, qui approvisionnait tous les parents de Sigismond en Allemagne, était évident. Avant 1523, Jan Janusz Kościelecki, cousin de Beata Kościelecka, fille d'Andrzej Kościelecki et de Katarzyna Telniczanka, fut nommé châtelain du château de la ville royale d'Inowrocław. En 1526, il reçut également le titre de châtelain de Łęczyca. Le château royal là-bas, où se tenaient les Sejms et où Ladislas Jagellon reçut un envoyé hussite qui lui offrit la couronne tchèque, était l'un des plus importants de la Couronne. En tant que châtelain de Łęczyca, il était présent à Gdańsk en tant que témoin d'un document délivré le 3 mai 1526 par Sigismond Ier, lorsque les ducs de Poméranie ont rendu hommage de Lębork et Bytów. Jan Janusz Kościelecki de Kościelec (Joannes a Cosczielecz) des armoiries d'Ogończyk est né en 1490 en tant que fils unique de Stanisław, voïvode de Poznań à partir de 1525 et de sa femme née Oporowska. En 1529, il était député de l'assemblée générale de Varsovie auprès du roi en Lituanie. Un portrait attribué à Giovanni Cariani ou Bernardino Licinio dans la Gallerie dell'Accademia de Venise (inventaire cat. 300) montre un homme blond vêtu d'un grand manteau noir, à larges manches doublées d'une fourrure d'hermine très chère. Sous le manteau, il porte une longue robe noire et sur ses mains, il porte une paire de gants en cuir, typiques des hommes de haut rang social. Selon l'inscription en latin sur le socle à côté de lui, l'homme avait 36 ans en 1526 (MDXXVI/ANN. TRIGINTASEX), exactement comme Jan Janusz Kościelecki quand il est devenu châtelain de Łęczyca. Le tableau provient de la collection Contarini à Venise (transféré en 1838) et était considéré comme un portrait du noble vénitien Gabriele Vendramin (1484-1552), cependant, les dates de sa vie ne correspondent pas à l'inscription. Il est également considéré comme un pendant à un portrait de dame en robe noire dans le même musée (inventaire cat. 304), en raison de dimensions et de composition similaires, mais les proportions ne sont pas similaires et le costume de la dame est plus des années 1530 et pas 1520. Les membres de la famille Contarini étaient de fréquents envoyés de la Sérénissime vénitienne en Pologne-Lituanie, comme Ambrogio Contarini, qui s'est rendu deux fois en Pologne entre 1474 et 1477, ou Giovanni Contarini, qui lors d'une audience à Lublin en 1649 a informé le monarque polonais de la victoire de la flotte vénitienne sur la flotte ottomane. Il est également possible que le tableau ait été laissé comme modello dans l'atelier du peintre et ait ensuite été acquis par les Contarini. Jan Janusz mourut en 1545 et son fils aîné Andrzej (1522-1565), courtisan royal et voïvode de Kalisz à partir de 1558, construisit en 1559 un mausolée à l'église romane de Kościelec sur les plans de Giovanni Battista di Quadro, pour lui-même et son père. Leur monument funéraire, l'un des meilleurs du genre, a été créé par l'atelier de Giovanni Maria Padovano à Cracovie et transporté à Kościelec.
Portrait de Jan Janusz Kościelecki (1490-1545), châtelain de Łęczyca âgé de 36 ans par Giovanni Cariani, 1526, Gallerie dell'Accademia de Venise.
Sigismund I et Katarzyna Telniczanka comme David et Bethsabée par Lucas Cranach l'Ancien
Selon la Bible, le roi David, alors qu'il se promenait sur le toit du palais, aperçoit par hasard la belle Bethsabée, la femme d'un soldat loyal de son armée, se baignant. Il l'a désirée et l'a mise enceinte.
Très probablement vers 1498, lorsque le prince Sigismond (1467-1548) fut fait duc de Głogów par son frère Vladislas II de Bohême et de Hongrie, il rencontra une dame morave ou silésienne Katarzyna Telniczanka (vers 1480-1528). Elle devint sa maîtresse et lui donna trois enfants : Jan (1499-1538), Regina (vers 1500-1526) et Katarzyna (vers 1503-1548). En 1509, alors qu'il était déjà roi de Pologne, Sigismond décida de se marier. Cette même année, Katarzyna était mariée à l'ami de Sigismond, Andrzej Kościelecki, qui a été nommé grand trésorier de la couronne en récompense. Le seul enfant né de cette union, Beata (1515-1576), plus tard une dame de la cour de la reine Bona, était également réputé être l'enfant du roi. Kościelecki mourut le 6 septembre 1515 à Cracovie, la première épouse de Sigismond, Barbara Zapolya, décéda la même année le 2 octobre 1515 et près de trois ans plus tard, le 15 avril 1518, il épousa Bona. Pendant cette période, Katarzyna était sans aucun doute proche de Sigismond et ses filles ont été élevées avec sa seule fille légitime à l'époque, Hedwige Jagellon (1513-1573), qui en 1535 s'est installée à Berlin en tant que nouvelle électrice de Brandebourg, prenant une importante dot et de nombreux souvenirs de famille avec elle. Le petit tableau de Cranach de 1526, acquis en 1890 par la Gemäldegalerie de Frau Medizinalrat Klaatsch à Berlin (panneau, 38,8 x 25,6 cm, 567B), montre une scène courtoise avec Bethsabée baignant ses pieds dans la rivière. Le personnage principal n'est cependant pas Bethsabée, ni le roi David debout sur une haute terrasse à gauche. C'est une dame au premier plan à droite, qui a très probablement commandé le tableau. Son effigie et son costume ressemblent étonnamment au portrait de la reine Bona tenant un bouquet de myosotis créé la même année (Palais de Wilanów, Wil.1518). Elle tient les chaussures de Bathsheba, un signe clair d'approbation pour la maîtresse royale Telniczanka, une compagne de longue date de son mari, qui a été dépeinte comme Bethsabée. On pourrait également distinguer deux des filles de Telniczanka à gauche, très probablement Katarzyna, qui selon certaines sources aurait épousé la même année George III, comte de Montfort, et Regina, décédée à Cracovie le 20 mai 1526. Il y a aussi le roi Sigismond en tant que roi biblique David - le roi était représenté comme le roi Salomon, le fils de David, dans le tondo en marbre dans sa chapelle funéraire à la cathédrale de Wawel et peut-être aussi comme le roi David (ou le banquier du roi Jan Boner). À côté de lui, il y a son fils Jan, qui était son secrétaire depuis 1518 et en 1526, il était prévu de faire de lui un duc de Mazovie et de le marier à la princesse Anne de Mazovie. Cette miniature pourrait être considérée comme une preuve ordonnée par Bona pour être envoyée au roi, occupé des affaires de l'État dans le nord de la Pologne, que deux de ses femmes vivent en paix et en harmonie à Cracovie dans le sud de la Pologne. La même femme, Bethsabée - Telniczanka, a également été représentée dans le petit tableau qui se trouvait avant la Seconde Guerre mondiale dans le palais Branicki à Varsovie, converti en ambassade britannique en 1919. Il est considéré comme perdu, mais selon Friedländer, Rosenberg 1979, n° 247, il se trouve dans une collection privée de New York (panneau, 37,5 x 23,5 cm). L'œuvre montre Vénus avec Cupidon volant du miel, qui a été interprétée comme une allégorie du plaisir et des douleurs de l'amour. Un fragment d'inscription latine se lit comme suit : « Et nous recherchons ainsi des plaisirs transitoires et dangereux / Qui sont mêlés de tristesse et nous font souffrir » (SIC ETIAM NOBIS BREVIS ET PERITVRA VOLVPTAS / QUAM PETIMVS TRISTI MIXTA DOLORE NOCET). L'effigie de la femme inconnue de la National Gallery de Londres (panneau, 35,9 x 25,1 cm, NG291), créée vers 1525, correspond parfaitement au portrait de la fille aînée de Telniczanka, Regina Szafraniec, dans le tableau de Berlin. Le 20 octobre 1518, dans la cathédrale de Wawel, elle a épousé le staroste de Chęciny et un secrétaire royal, Hieronim Szafraniec. La lettre M sur son corsage est une référence à sa sainte patronne, Maria Regina Caeli, latin pour Marie, Reine du Ciel, car le nom de Marie (Maria) était à cette époque en Pologne réservé uniquement à la Vierge. La peinture de Vénus au musée Herzog Anton Ulrich à Brunswick (panneau, 41 x 26,5 cm, GG26), par Lucas Cranach l'Ancien, est stylistiquement proche du portrait d'Anna de Mazovie en Vénus à Compton Verney, elle devrait donc être datée d'environ 1525. À l'origine, Vénus à Brunswick était accompagnée d'un Cupidon sur le côté gauche, cependant il a été repeint en 1873 en raison de son état abîmé. Le visage et la pose de Vénus sont presque identiques au portrait de Regina Szafraniec par Cranach à Londres. Le tableau a été enregistré dans l'inventaire du palais des ducs de Brunswick-Wolfenbüttel à Salzdahlum de 1789 à 1803, il est donc possible qu'il provienne de la collection de la belle-soeur de Regina Sophia Jagiellon, duchesse de Brunswick-Wolfenbüttel. Le portrait d'une jeune femme avec une pomme, symbole de la mariée dans la pensée grecque antique, d'environ 1525, également perdu pendant la Seconde Guerre mondiale (panneau, 59,5 x 25,5 cm), est très similaire à l'effigie de l'une des filles de Telniczanka dans le tableau de Berlin. Il s'agit sans doute de Katarzyna, comtesse de Montfort. Avant la guerre, ce tableau était conservé dans le palais de la famille poméranienne Puttkamer à Trzebielino près de Słupsk, qui faisait alors partie du Reich allemand. Une autre version de cette effigie se trouve à la Fondation Bemberg à Toulouse (panneau, 31 x 26 cm, INV1016).
Sigismund I et Katarzyna Telniczanka comme David et Bethsabée par Lucas Cranach l'Ancien, 1526, Gemäldegalerie à Berlin.
Katarzyna Telniczanka en Vénus avec Cupidon volant du miel par Lucas Cranach l'Ancien, 1526-1528, Palais Branicki à Varsovie, perdu pendant la Seconde Guerre mondiale.
Portrait de Regina Szafraniec (vers 1500-1526), fille naturelle du roi Sigismond I par Lucas Cranach l'Ancien, vers 1525-1526, National Gallery de Londres.
Portrait de Regina Szafraniec (ca. 1500-1526) en Vénus par Lucas Cranach l'Ancien, vers 1525, Musée Herzog Anton Ulrich à Brunswick.
Portrait de Katarzyna, comtesse de Montfort (vers 1503-1548), fille naturelle du roi Sigismond I par Lucas Cranach l'Ancien, vers 1525-1526, Palais Puttkamer à Trzebielino, perdu pendant la Seconde Guerre mondiale.
Portrait en buste de Katarzyna, comtesse de Montfort (vers 1503-1548), fille naturelle du roi Sigismond I par Lucas Cranach l'Ancien, vers 1525-1526, Fondation Bemberg à Toulouse.
Portrait de Bona Sforza tenant myosotis par Lucas Cranach l'Ancien
En février 1526, le roi Sigismond I se rendit de Cracovie dans le sud de la Pologne à la Poméranie dans le nord pour prendre une position active contre la révolte de Gdańsk et d'autres villes de la Prusse royale. Il se rendit ensuite en Mazovie, qui était tombée aux mains de la Couronne après la mort sans héritier des derniers princes de la maison de Piast. Il retourna dans la capitale le 23 septembre 1526. Il fut absent pendant près d'un an laissant sa seconde épouse Bona Sforza enceinte à Cracovie (le 1er novembre 1526, elle donna naissance à sa fille Catherine Jagellon).
Le portrait de femme par Lucas Cranach l'Ancien daté de 1526 et provenant de l'ancienne collection du palais royal de Wilanów (très probablement acquis avant 1743), ressemble beaucoup aux effigies de Bona Sforza. Il est de petites dimensions (34,9 x 23,8 cm), un bon article à emporter en voyage ou à envoyer à quelqu'un avec une lettre d'amour. La femme tient un bouquet de myosotis, symbole du véritable amour et de la fidélité et tient sa main gauche sur son ventre.
Portrait de Bona Sforza tenant des myosotis par Lucas Cranach l'Ancien, 1526, Palais de Wilanów à Varsovie.
Portrait d'Hedwige Jagellon tenant une pomme par Lucas Cranach l'Ancien et atelier
En 1527, la princesse Hedwige Jagellon (1513-1573), âgée de seulement 14 ans, fille unique du roi Sigismond Ier l'Ancien et de sa première épouse Barbara Zapolya, était l'une des épouses les plus ardemment désirées d'Europe.
Parmi les innombrables prétendants à sa main figuraient les fils de l'électeur de Brandebourg et Stanislas, duc de Mazovie en 1523, Frédéric de Gonzague, proposé par le pape Clément VII et Jacques V, roi d'Écosse proposé par François Ier, roi de France en 1524, Janusz III, duc de Mazovie, Frédéric de Gonzague (encore) et François II Sforza, duc de Milan en 1525, Gustav Ier Vasa, roi de Suède et François Ier, roi de France proposé par son oncle Jan Zápolya, roi de Hongrie en 1526, Louis X, duc de Bavière en 1527 et en 1528 et Luis de Portugal, duc de Beja en 1529 etc. Le portrait d'une dame tenant une pomme de la Pinacothèque du château de Prague par Lucas Cranach l'Ancien et atelier de 1527 ressemble fortement au portrait d'Hedwige représenté dans sa robe de mariée avec le monogramme S de son père par Hans Krell de 1537, et un portrait de sa mère par Cranach. Il est également très similaire dans sa composition et son format au portrait de sa belle-mère Bona Sforza tenant des myosotis daté de 1526 (palais de Wilanów), donc les deux portraits pourraient être commandés dans l'atelier de Cranach en même temps. Elle tient une pomme, symbole de longue date de la royauté - l'orbe royal, et un symbole fort de la mariée dans la pensée grecque antique (Sappho, Plutarque).
Portrait de la princesse Hedwige Jagellon (1513-1573) tenant une pomme par Lucas Cranach l'Ancien et atelier, 1527, Pinacothèque du château de Prague.
Portraits de Sigismond Auguste et d'Isabelle Jagellon par Lucas Cranach l'Ancien
« En 1525, lorsque les envoyés de Charles Quint vinrent à Cracovie, apportant l'Ordre de la Toison d'or au roi Sigismond, la reine leur offrit en cadeau des portraits d'elle-même, de son mari et ... d'Isabelle, et non de son fils - l'héritière du trône - ce qui semblerait plus approprié. Elle voulait sans doute rappeler à la cour des Habsbourg qu'elle avait une fille - une jolie fille - qui serait bientôt en âge de se marier. Il semble que Bona accepterait - malgré son attitude hostile vers l'Autriche - pour épouser l'un des Habsbourg. Après tout, l'archiduc d'Autriche était le meilleur parti d'Europe » (d'après « Izabela Jagiellonka, królowa Węgier » de Małgorzata Duczmal, p. 73).
Cette année-là, Bona dut également accepter les fiançailles de son fils unique Sigismond Auguste avec Elisabeth d'Autriche (1526-1545), la fille aînée de Ferdinand Ier d'Autriche et d'Anne Jagellon. Les parents d'Elisabeth ont indéniablement également reçu des portraits d'enfants de Sigismond et de Bona, ainsi que d'autres importantes cours royales et princières à proximité. Les portraits d'un jeune garçon et d'une fille plus âgée par Lucas Cranach l'Ancien, proviennent de la collection Julius Böhler à Munich, détenue conjointement avec August Salomon, Dresde, par l'intermédiaire de Paul Cassirer, Berlin. Ils ont été acquis par la National Gallery of Art de Washington en 1947. Le garçon porte une couronne de bijoux sur la tête qui suggèrent ses fiançailles. La jeune fille, cependant, n'a pas de guirlande sur la tête, elle doit donc être sa sœur, exactement comme Sigismond Auguste (1520-1572), fiancé à Elisabeth d'Autriche en 1526 ou 1527, et sa sœur aînée Isabelle Jagellon (1519-1559). L'effigie du garçon est similaire au portrait de Sigismond Auguste enfant dans une tunique rouge du Wallraf-Richartz-Museum, créé par Lucas Cranach l'Ancien en 1529. Lui et sa sœur portent des vêtements de damas vénitien cramoisi, typiques de la noblesse polonaise, peut-être acquise à Venise par le marchand juif Lazare de Brandebourg, probablement expulsé de ce pays en 1510, envoyé à Venise en tant qu'expert commercial par Sigismond Ier. Lazare a également acquis des perles pour la reine. Le pourpoint d'un garçon est brodé d'or et de soie et montre la scène d'une chasse au lapin, une allusion à la fertilité, exactement comme dans le portrait de la mère de Sigismond Auguste Bona Sforza d'Aragona par le peintre vénitien, peut-être Francesco Bissolo, dans le National Gallery à Londres. Le geste de la main du garçon, comme s'il tenait l'orbe royal, est une information claire, qui sera élu le prochain roi de Pologne après Sigismond I.
Portrait du prince Sigismond Auguste (1520-1572) enfant par Lucas Cranach l'Ancien, vers 1527, National Gallery of Art de Washington.
Portrait de la princesse Isabelle Jagellon (1519-1559) enfant par Lucas Cranach l'Ancien, vers 1527, National Gallery of Art de Washington.
Adoration des mages avec des portraits de Jan Leszczyński, de son épouse Marie de Marcellanges et de l'empereur Frédéric III par Joos van Cleve et atelier
Vers 1526, Rafał Leszczyński (décédé en 1592), plus tard voïvode de Brześć Kujawski, fils unique de Jan Leszczyński (décédé en 1535), est né. Son père, fils de Kasper, chambellan de Kalisz, et de Zofia d'Oporów, était un courtisan royal. Avant 1512, après la mort de son père, Jan devient chambellan de Kalisz et staroste de Radziejów. En 1518, il était le staroste de Koło, le 4 juillet 1519, il a agi en tant que receveur général de la Grande Pologne et en 1520, il a été nommé douanier de Kalisz. Dès le 21 février 1525, Jan Leszczyński devient châtelain de Brześć Kujawski et le 9 juin 1533, il agit comme chambellan adjoint du roi à Kalisz et Konin. Après la mort de son frère Rafał, secrétaire de Sigismond Ier et évêque de Płock, en 1527, Jan resta l'unique propriétaire des domaines Leszczyński, dont le noyau était Gołuchów et Przygodzice. Peu de temps après, il agrandit la demeure familiale - le château de Gołuchów près de Kalisz (construit avant 1443 et 1507).
L'épouse de Jan était Marie de Marcellanges (Maryna de Makrelangch), veuve de Jarosław de Wrząca Sokołowski (décédée en 1517/18), bailli du roi de Bohême et de Hongrie Vladislas II Jagellon, châtelain de Ląd et staroste de Koło. Ils se sont mariés avant janvier 1520 (le 25 janvier 1520, Jan a fixé une dot de 2 000 zlotys à sa femme). Marie, issue d'une famille aisée du Bourbonnais (seigneurs d'Arson près d'Ebreuil, de Vaudot, de La Grange, de Ferrières et autres), était dame de compagnie d'Anne de Foix-Candale, troisième épouse du roi Vladislas II. En 1520, avec sa femme, Jan a conclu un accord avec le primat Jan Łaski et Wojciech Sokołowski, staroste de Brześć Kujawski, tuteurs des enfants de Marie de son premier mariage (deux filles et cinq fils), pour la fourniture de ces soins et pour le bien-être des mineurs. En 1522, Marie fonda un autel dans la collégiale de Radziejów et quatre ans plus tard, en 1526, Wojciech Lubieniecki obtint d'elle le consentement d'acheter le bureau du wójt (advocatus) dans le village de Dąbie. En 1531, Jan Leszczyński nomma les tuteurs de son fils Rafał - le comte Andrzej Górka, son cousin Rafał et son neveu Roch Koźmiński. Il a également eu une fille, Dorota. Il mourut en 1535, peu avant le 30 juin (d'après « Teki Dworzaczka - Leszczyńscy h. Wieniawa »). Le grand-père de Jan - Rafał Leszczyński (décédé en 1501), était un courtisan de l'empereur Frédéric III, fils de Cymburge de Mazovie, en 1473 il reçut de lui le titre de comte (selon Paprocki) et en 1476, en complément des armoiries, une couronne d'or avec un lion. En 1489, Rafał était également un envoyé du roi auprès de Frédéric III. Le tableau de l'Adoration des mages au Musée national de Poznań (huile sur panneau, 156 x 89,5, numéro d'inventaire Mo 133) a été peint à peu près au même moment qu'un tableau similaire représentant le roi Sigismond Ier comme l'un des mages (Gemäldegalerie à Berlin, 578) et comme dans le tableau à l'effigie du roi, l'artiste place la scène sur fond d'une architecture magnifique, presque palatiale, avec des arcs de la Renaissance italienne soutenus par de riches colonnes. L'homme au chapeau noir et veste grise à droite est identifié comme un autoportrait de l'artiste. Ce peintre est Joos van Cleve car le tableau est évidemment dans son style et il est similaire à d'autres effigies du peintre anversois, en particulier son autoportrait en saint Renaud des ailes extérieures de l'autel de saint Renaud, commandé par la Confrérie de saint Renaud à Gdańsk (Musée national de Varsovie, M.Ob.2190). « Cette méthode - donner à la figure sainte son propre visage - s'est développée en relation avec le type iconographique de saint Luc peignant la Madone : Van der Weyden, Dirk Bouts et Gossart se sont présentés comme un peintre saint. Mais vers 1515, lors de la création de l'autoportrait de Gdańsk, non seulement le principe du « portrait allégorique » a été popularisé - présentant le donateur sous la forme d'un saint (des exemples classiques incluent l'évêque Albert de Brandebourg en saint Erasme de Grünewald ou Lukas Paumgartner en saint Eustache de Dürer) mais aussi un autoportrait allégorisé sous les figures de saints a gagné un précédent aussi important que l'image de Dürer de son propre visage, se référant sans ambiguïté aux images du Christ (1500) » (d'après « Nieznane autoportrety Joosa van Cleve ... » de Jan Białostocki, p. 468) La qualité de la peinture de Poznań est légèrement inférieure à celle des peintures mentionnées à Berlin et Varsovie qui indiquent une plus grande implication de l'atelier du peintre, peut-être comme l'une d'une série de compositions similaires commandées par le même commanditaire. Presque au centre de la composition se trouve saint Gaspard, identifié comme ayant apporté l'encens (comme symbole de divinité) à Jésus (d'après « Explanation of the Epistles and Gospels ... » de Léonard Goffiné, Georg Ott, p. 83), dans un riche manteau doublé de fourrure de lynx et bonnet crinale. Derrière lui se tient un homme en costume oriental, tenant un arc, probablement un guerrier tatar. Saint Gaspard regarde soit le spectateur soit la Vierge Marie, et cette disposition indique clairement qu'il s'agit d'un portrait de l'homme qui a commandé ce tableau. Le vieil homme représenté comme saint Melchior agenouillé à côté de lui a la chaîne de l'Ordre de la Toison d'or autour du cou, indiquant qu'il s'agit d'une autre effigie d'une personne réelle. Il a une ressemblance frappante avec l'empereur Frédéric III d'après une estampe de A. Ehrenreich s.c. à la Bibliothèque nationale d'Autriche (XIXe siècle, signé à tort Friedrich IV), son portrait à la vieillesse présenté lors de l'exposition de Basse-Autriche en 2019, ainsi qu'une effigie de la tapisserie avec la Légende de Notre Dame du Sablon/Zavel d'environ 1518, dessinée par Bernard van Orley (Musée de la Ville de Bruxelles) et surtout des portraits déguisés en Melchior dans les scènes de l'Adoration des mages, tous réalisés après sa mort, au XVIe siècle, vraisemblablement dans le cadre des efforts de glorification par son fils Maximilien Ier. L'Empereur était notamment représenté dans la scène de l'Épiphanie par le Maître de Francfort (Musée royal des Beaux-Arts d'Anvers et Kunsthistorisches Museum de Vienne) et avec son fils Maximilien en Gaspard et l'épouse de Maximilien Marie de Bourgogne en Madone dans un triptyque de Maître de Francfort (The Phoebus Foundation). De telles œuvres d'art de propagande destinées à légitimer le règne d'un nouveau monarque avaient probablement pour but de renforcer le règne des Habsbourg aux Pays-Bas, d'où l'identification du visage de la Vierge à l'effigie de l'enfant unique de Charles le Téméraire, duc de Bourgogne, semble la conclusion naturelle. C'est très probablement le successeur de Maximilien, l'empereur Charles V (1500-1558) ou ses partisans, qui en 1519 commandèrent la peinture de l'Adoration des mages à Marco Cardisco, peintre actif principalement à Naples, aujourd'hui au Musée Civique de Castel Nuovo à Naples. Il comprend des portraits déguisés de Ferdinand Ier de Naples (1424-1494) et de son fils Alphonse II de Naples (1448-1495), arrière-grand-père et grand-père de Bona Maria Sforza d'Aragona (1494-1557), reine de Pologne et grande-duchesse de Lituanie, et Charles Quint, roi de Naples à partir de 1516, comme le troisième des mages. Un portrait très similaire de l'empereur Frédéric III en Melchior agenouillé a été inclus dans un autre tableau de Joos van Cleve, aujourd'hui à la Gemäldegalerie Alte Meister à Dresde (huile sur panneau, 110 x 70,5 cm, numéro d'inventaire Gal.-Nr. 809). Le tableau a été mentionné pour la première fois à Dresde en 1812 et il est généralement daté d'environ 1517-1518 ou 1512-1523. Il existe plusieurs exemplaires de ce tableau et dans l'un d'eux, provenant de l'abbaye de Heiligenkreuz près de Vienne, aujourd'hui en collection privée, la Vierge Marie présente les traits de l'archiduchesse Marguerite d'Autriche (1480-1530), gouvernante des Pays-Bas des Habsbourg, fille de Maximilien Ier et Marie de Bourgogne. L'Adoration des mages de Poznań provient de la collection Mielżyński, tout comme le tableau représentant le roi Sigismond Ier et sa famille par l'atelier de Lucas Cranach l'Ancien (Musée national de Poznań). Seweryn Mielżyński a fait don de sa collection à la Société des Amis des Sciences à Poznań en 1870. En raison du monogramme visible en bas à gauche du tableau, lu comme « L », le tableau était considéré comme l'œuvre de Lucas van Leyden. Il a ensuite été considéré comme un faux, mais il pourrait aussi s'agir de la marque du propriétaire - Leszczyński. En conclusion, le fondateur du tableau représenté au centre de la composition doit être identifié comme étant Jan Leszczyński, châtelain de Brześć Kujawski, dont le grand-père a reçu le titre de Frédéric III. La femme représentée comme Marie, dont les traits sont également uniques et non similaires à la version de Dresde, est donc l'épouse de Jan, Marie de Marcellanges, qui a donné naissance à son fils unique au moment de la création du tableau. De telles représentations étaient populaires dans le pays d'origine de Marie, la France, depuis le Moyen Âge, l'une des plus anciennes et des plus connues est le portrait d'une favorite et maîtresse en chef du roi Charles VII, Agnès Sorel (1422-1450) en Vierge allaitante (Madonna Lactans), peinte vers 1452 par Jean Fouquet (Musée Royal des Beaux-Arts d'Anvers). L'effigie d'Agnès a été commandée dans le cadre d'un diptyque, dit diptyque de Melun, par Étienne Chevalier (mort en 1474), qui fut trésorier de France sous le règne du roi Charles VII (à partir de 1452) et qui commanda son portrait comme donateur avec son saint patron saint Étienne agenouillé devant la Madone-Agnès (Gemäldegalerie à Berlin). Selon Vasari, Giulia Farnèse (1474-1524), maîtresse du pape Alexandre VI, et la sœur du pape Paul III, appelée concubina papae ou sponsa Christi, a également été représentée comme Madone dans une fresque détruite « L'Investiture divine » par Pinturicchio dans les appartements Borgia. Cette fresque controversée a été divisée en fragments - la Vierge à l'Enfant fera partie de la collection Chigi, pendant le pontificat d'un pape anti-népotiste Alexandre VII (1599-1667), entre 1655 et 1667. « Au-dessus de la porte d'un appartement dans ledit palais, il a dépeint la signora Giulia Farnèse sous le visage d'une Madone, et, dans le même tableau, la tête du pape Alexandre dans une figure qui l'adore » (In detto palazzo ritrasse, sopra la porta d'una camera, la signora Giulia Farnese nel volto d'una Nostra Donna; e nel medesimo quadro, la testa d'esso papa Alessandro che l'adora), décrit l'œuvre de Pinturicchio Vasari en 1568 (d'après « Regesto dei documenti di Giulia Farnese » par Danilo Romei, Patrizia Rosini, p. 357). Cependant, en 1612, Aurelio Recordati, lié au duc de Mantoue, ordonna à Giovanni Magni de faire une copie du tableau par le peintre Pietro Fachetti, aujourd'hui en collection privée (d'après « Sulle tracce di Giulia Farnese ... » de Cristian Pandolfino). De telles représentations sous l'apparence de divinités, très probablement ressuscitées pendant la Renaissance de l'époque romaine, étaient incontestablement populaires aussi en Pologne-Lituanie où la culture latine et italienne était si forte. Peu de temps après sa mort, Antinoüs, un jeune Grec de Bithynie et un favori et amant de l'empereur romain Hadrien fut déifié (en octobre 130, Hadrien proclama Antinoüs divinité). De nombreuses sculptures et reliefs en marbre de ce bel homme conservés dans différents musées du monde, dont certains le dépeignent comme Sylvanus, divinité de bois et terres incultes (Palazzo Massimo alle Terme à Rome), comme le dieu Mercure (buste de la collection de Catherine II, aujourd'hui au Musée de l'Ermitage), comme Bacchus, dieu de la vendange et de la fertilité (Musée Archéologique National à Naples), comme Osiris, dieu égyptien de la fertilité, de l'agriculture et de l'au-delà (Musées du Vatican), comme Agathodémon, un éminent dieu civique serpentin, qui a servi de protecteur spécial d'Alexandrie (Antikensammlung à Berlin), comme un héros divin Ganymède (Lady Lever Art Gallery) et bien d'autres. A cette époque, les commandes de peinture et les importations en Pologne-Lituanie depuis la Flandre ont augmenté, l'un des rares exemples survivants est mentionné l'autel de saint Renaud à Varsovie et le triptyque du roi Sigismond Ier à Berlin, mais aussi l'Adoration des mages avec un donateur des armoiries d'Odrowąż du maître de 1518, peintre flamand appartenant à l'école stylistique du maniérisme anversois, aujourd'hui au Musée national de Varsovie (huile sur panneau, 71,5 x 54,5 cm, 185976 MNW). Il provient de l'église de Jasieniec, au sud de Varsovie. L'effigie du donateur et les armoiries d'Odrowąż ont été ajoutées plus tard en Pologne par un peintre local moins qualifié. Le tableau est daté d'environ 1525, donc ce donateur pourrait être Jan Chlewicki de Chlewiska des armoiries d'Odrowąż, prévôt de Sandomierz en 1525, formé à l'Académie de Cracovie. Dans les années 1450, la famille Leszczyński a commandé une peinture votive de la Vierge intronisée avec leurs portraits en tant que donateurs, aujourd'hui dans l'église paroissiale de Drzeczkowo, dans l'atelier de Wilhelm Kalteysen, un peintre formé probablement à Aix-la-Chapelle, Cologne et aux Pays-Bas et actif à Wrocław, qui faisait alors partie du royaume de Bohême. Les Habsbourg ont consacré beaucoup d'efforts et d'argent à la diffusion de l'image de Frédéric III dans l'Europe de la Renaissance, et tout comme aujourd'hui, beaucoup de gens veulent avoir une photo avec un politicien ou une célébrité, les Leszczyński ont également cherché à accroître leur influence en se présentant avec l'empereur qui leur a accordé le titre. Le choix de saint Gaspard comme son image par Jan Leszczyński a probablement été dicté par le désir de rendre hommage à son père - Kasper (Gaspard), chambellan de Kalisz.
Adoration des mages avec des portraits de Jan Leszczyński (décédé en 1535), de sa femme Marie de Marcellanges et de l'empereur Frédéric III par Joos van Cleve et atelier, vers 1527, Musée national de Poznań.
Adoration des mages avec le portrait de l'empereur Frédéric III (1415-1493) par Joos van Cleve, 1512-1523, Gemäldegalerie Alte Meister à Dresde.
Adoration des mages avec le portrait de l'empereur Frédéric III (1415-1493) et de sa petite-fille l'archiduchesse Marguerite d'Autriche (1480-1530) par suiveur de Joos van Cleve, 1512-1530, collection privée.
Adoration des mages avec un donateur des armoiries d'Odrowąż, très probablement Jan Chlewicki, prévôt de Sandomierz par le maître de 1518, vers 1525, Musée national de Varsovie.
Portraits de Barbara Kolanka par Lucas Cranach l'Ancien
Alors que après le déluge (1655-1660) catastrophique et les invasions étrangères qui ont suivi, la République polono-lituanienne entrait dans une période de grand chaos politique, l'instabilité et la pauvreté, l'un des envahisseurs et ancien fief, la Prusse ducale élevé à une grande puissance et prospérité comme une monarchie absolue gouvernée depuis Berlin. Entre 1772 et 1795, la monarchie des Habsbourg, le Royaume de Prusse et l'Empire russe se sont partagé les terres de la République, ce qui a entraîné l'élimination de la Pologne et de la Lituanie souveraines pendant 123 ans.
En 1796, le prince Antoni Henryk Radziwill épousa la princesse Louise de Prusse, une nièce du défunt roi prussien Frédéric le Grand, qu'elle a rencontré lorsque la famille royale prussienne rendit visite à ses parents en 1795 dans leur palais Nieborów près de Łowicz. Antoni Henryk a fréquenté l'Université de Göttingen et il était un courtisan du roi Frédéric-Guillaume II de Prusse. En tant que propriétaire de grands domaines, il voyageait fréquemment entre Berlin, Poznań, Varsovie, Nieborów et Saint-Pétersbourg. Peu de temps après le mariage, il acheta le palais rococo Schulenburg à Berlin, Wilhelm-Strasse 77, qui devint sa résidence principale, désignée par la suite le palais Radziwill. Les Radziwill étaient parmi les magnats les plus riches et les plus puissants de Pologne-Lituanie et l'une des neuf familles qui avaient été princes impériaux depuis 1515 (princeps imperii, Reichsfürst), autorisées à détenir le titre de prince depuis 1569 dans la noble république autrement sans titre. Les parents d'Antoni Henryk, Helena Przeździecka et Michał Hieronim Radziwill, étaient des collectionneurs d'art renommés, possédant des œuvres de Hans Memling (Annonciation au Metropolitan Museum of Art), Rembrandt (Lucrèce au Minneapolis Institute of Art) ou Willem Claesz. Heda (Nature morte au Musée national de Varsovie). Leurs portraits ont été peints par des artistes éminents comme Louise Élisabeth Vigée Le Brun et ils possédaient indéniablement aussi de nombreux autres tableaux issus de différents domaines Radziwill, notamment lors de la confiscation de la propriété principale des Radziwill, les domaines de Nesvizh, Olyka et Mir en Biélorussie et en Ukraine par le tsar Alexandre Ier en 1813. De nombreux objets liés à Radziwill ont également été transférés en Allemagne avec la dot de la princesse Louise Charlotte Radziwill (1667-1695), qui était l'épouse du margrave Louis de Brandebourg et épousa plus tard Charles Philippe du Palatinat-Neubourg, comme la coupe en or Radziwill par Hans Karl à Munich. La famille Radziwill a vécu dans son palais berlinois jusqu'à ce qu'il devienne trop petit. En 1869, le Premier ministre prussien Otto von Bismarck, connu pour son amère hostilité envers les Polonais, acheta le palais pour le gouvernement de l'État prussien. Il a ensuite été agrandi pour Adolf Hitler en tant que chancellerie du Reich et démoli en 1949. En 1874, l'État allemand a également acquis le palais Raczyński à Berlin, qui a été démoli pour construire le bâtiment du Reichstag. L'acquisition des deux bâtiments, célèbres pour leurs collections d'art et en tant que centres de la culture polonaise dans la capitale allemande, était hautement symbolique et parfois considérée comme une tentative d'effacer l'héritage et la culture polonaise. Vers 1512, Georges Radziwill (1480-1541), surnommé « Hercule », épousa Barbara Kolanka ou Kołówna (décédée en 1550) des armoiries de Junosza, célèbre pour sa beauté descendante directe d'Elizabeth Granowska de Pilcza, la reine consort de Ladislas II de Pologne (Jogaila de Lituanie). Ils eurent trois enfants Nicolas surnommé « le Rouge » (1512-1584), Anna Elisabeth (1518-1558) et Barbara (1520/23-1551). Dès leur plus jeune âge, Georges Hercule a arrangé les mariages les plus avantageux pour ses filles afin de former des alliances bénéfiques. En 1523, Anna Elisabeth était fiancée au fils de Konstanty Ostrogski, Grand Hetman de Lituanie, Illia (Eliasz Aleksander). Cette alliance a été formée pour opposer le grand chancelier de Lituanie et voïvode de Vilnius Albertas Gostautas, successeur de son farouche adversaire Nicolas II Radziwill (1470-1521), frère de Georges Hercule. Bientôt, cependant, lorsque le poste de châtelain de Vilnius fut vacant après la mort de Stanislovas Kesgaila (décédé en 1527), George Hercule se rangea du côté des Albertas et fiancé Anna à son fils Stanislovas, payant au roi Sigismond Ier l'Ancien une promesse de 10 000 de la monnaie lituanienne pour son futur mariage. Le châtelain de Vilnius était le deuxième plus haut fonctionnaire de la voïvodie de Vilnius, subordonné au voïvode, Albertas Gostautas. De cette façon, Anna a eu deux fiancés en même temps. En 1536, Georges Hercule a exigé qu'Illia remplisse le contrat de mariage, mais pas avec Anna Elisabeth, mais avec sa sœur Barbara. Il a refusé, car il est tombé amoureux de Beata Kościelecka. Le mode de vie controversé de Barbara Kolanka et de ses filles a été source de stigmatisation, de rumeurs et de diffamation. Anna Elisabeth, avant son mariage, a été accusée d'inconduite sexuelle et d'avoir des enfants illégitimes et sa sœur Barbara, après son mariage, qu'elle a eu jusqu'à 38 amants, selon le chanoine Stanisław Górski, et « qu'elle a égalé ou dépassé sa mère en disgrâce, et a été marquée par de nombreuses taches de luxure et d'impudeur » (Itaque cum adolevisset et priori marito collocata esset, ita se gessit, ut matrem turpitudine aut aequarit aut superarit et multis libidinis et impudicitiae maculis notata fuerit), selon Stanisław Orzechowski. C'était la cadette de deux sœurs Barbara qui, le 17 mai 1537, épousa Stanislovas Gostautas. Lorsqu'il mourut cinq ans plus tard, le 18 décembre 1542, en tant que dernier descendant mâle de la famille Gostautas, Barbara et plus tard sa famille héritèrent d'une grande partie de son énorme fortune, devenant ainsi les nobles les plus influents du Grand-Duché de Lituanie. Peu de temps après, Barbara Radziwll est devenue la maîtresse du roi Sigismond Auguste. Le portrait d'une femme en sainte Barbe par Lucas Cranach l'Ancien d'environ 1530 se trouvait à la fin du XIXe siècle dans la collection de Geheimrat (le titre des plus hauts fonctionnaires conseillers des cours impériales, royales ou princières du Saint Empire romain) Lucas à Berlin, maintenant au Sammlung Würth à Schwäbisch Hall, Allemagne (bois, 73 x 56,5 cm, inv. 9325). Sa riche tenue et ses bijoux indiquent ses nobles origines. Elle est poursuivie par son père, qui l'a gardée enfermée dans une tour afin de la préserver du monde extérieur. La topographie et la forme générale de la ville avec une église et un château sur une colline à droite est très similaire à la vue de Vilnius par Tomasz Makowski de 1600. La même femme a également été représentée comme la princesse violée par saint Jean Chrysostome (pénitence de saint Jean Chrysostome), tenant sa fille, maintenant à la Wartburg-Stiftung à Eisenach (bois, transféré sur toile et contreplaqué, 60,5 x 37,5 cm, WSE M 0002). Le saint à longue barbe, particulièrement vénéré dans le monde orthodoxe et à peine visible au-dessus de la tête de l'enfant, expie sa culpabilité en séduisant et en tuant la princesse en rampant à quatre pattes comme une bête. Jean s'imposa la pénitence et son bébé prononça miraculeusement ses péchés pardonnés. Le château en arrière-plan peut également être comparé au château de Vilnius. Le tableau est donc un message au voïvode Albertas Gostautas et à ses partisans, que Georges Hercule regrette ses actions contre lui, il est digne de devenir le châtelain du château de Vilnius et de son territoire environnant et sa fille est digne d'être fiancée avec le fils du voïvode. La peinture était avant 1901 dans la colletion de Graf Einsiedel à Berlin. La femme, dans un costume et une pose similaires, était représentée comme sainte Barbe assise devant un drapé de velours vert, dans un tableau qui se trouvait avant 1932 dans la collection privée de Brunswick (bois, 55 x 38 cm). Elle a également été représentée comme Lucrèce, la belle et vertueuse épouse d'un commandant Lucius Tarquinius Collatinus, dont le suicide a précipité une rébellion qui a renversé la monarchie romaine. Le tableau était probablement dans la collection de Franz Reichardt (1825-1887) à Munich et a été coupé en forme ovale au XVIIème ou XVIIIème siècle (bois, 33,5 x 24,5 cm, Sotheby's à Londres, 6 décembre 2017, lot 6). Dans une effigie similaire, pleine longueur de Lucrèce de la fin des années 1520 à l'Alte Pinakothek de Munich (bois, 194 x 75 cm, inv. 691), les traits de son visage sont identiques au portrait de Sammlung Würth. Le tableau est répertorié dans l'inventaire de 1641 du cabinet d'art de Maximilien Ier (1573-1651), duc de Bavière (provenance confirmée la plus ancienne), qui échangea des tableaux avec les Vasa polono-lituaniens. Elle fut finalement représentée dans le répertoire des trois autres variantes populaires des portraits historiés. L'une est Vénus et Cupidon de Cranach l'Ancien provenant de la collection de William Schomberg Robert Kerr (1832-1870), 8e marquis de Lothian, aujourd'hui conservée à la National Gallery of Scotland à Édimbourg (bois, 38,1 x 27 cm, NG 1942). L'inventaire de la Kunstkammer du château de Radziwill à Lubcha de 1647 répertorie un tableau de Vénus et d'Amour, un ancien tableau d'Adam et Eve et de saint Jean dans le désert, signé L. C. ainsi qu'un tondo avec Madone et Madone à l'Enfant offert par Antoni Tyszkiewicz (d'après « Galerie obrazów i "Gabinety Sztuki" Radziwiłłów w XVII w. » de Teresa Sulerzyska, p. 93). « Vénus et Hercule de Lucas Cranach », mentionné dans le registre des peintures de Boguslas Radziwill (1620-1669) de 1657 (AGAD 1/354/0/26/84), pourrait être un autre portrait déguisé de Kolanka, cette fois accompagné de son mari Georges « Hercule ». « L'Art ancien de Lucas Cranach » et « Peinture similaire d'un centaure » dans ce registre suggèrent qu'une série entière représentant les actes d'Hercule aurait pu être créée par Cranach et son atelier pour les Radziwill, à l'instar de la série représentant « Les Travaux d'Hercule » (Musée Herzog Anton Ulrich). L'effigie de la Vierge dans le tableau de Cranach au musée Pouchkine (bois, 58 x 46 cm, Ж-2630) ressemble beaucoup au portrait de Barbara dans Sammlung Würth. Le paysage derrière Marie est entièrement fantastique dans la partie supérieure, cependant dans la partie inférieure est très similaire à la vue de Trakai en Lituanie par Tomasz Makowski, créée vers 1600. Donjon central, délabré dans l'estampe de Makowski, entouré de murs avec des tours, le pont menant à l'Ile du Château, les pêcheurs sur le lac, sont quasiment identiques. Le tableau était depuis 1825 à l'Ermitage de Saint-Pétersbourg et en 1930, il a été transféré au Musée Pouchkine à Moscou. Son histoire antérieure est inconnue, donc la provenance des domaines de Radziwill ne peut être exclue. Il est daté par diverses sources d'environ 1520 à 1525. En 1522, grâce au soutien de la reine Bona, Georges Hercule, époux de Barbara, reçut la châtellenie du château de Trakai, une importante structure défensive protégeant Trakai et Vilnius, capitale du Grand-Duché, l'un des bureaux les plus importants de Lituanie. Cette nomination était liée aux efforts de la reine pour obtenir un soutien pour le projet d'élévation de son fils Sigismond Auguste au trône grand-ducal. En 1528, George Hercule fut également nommé maréchal de la cour de Lituanie et grand hetman de Lituanie en 1531. Lorsqu'en 1529, Sigismond Ier l'Ancien accepta d'approuver le premier statut de Lituanie, qui élargissait encore les droits de la noblesse, son fils Sigismond Auguste est proclamé grand-duc de Lituanie. En tant qu'épouse du maréchal de la cour, qui s'occupait de la cour et de la sécurité des dames, Barbara était la femme la plus importante de la cour ducale de Vilnius après la reine et la grande-duchesse Bona Sforza. Elle a indéniablement soutenu la politique de la reine et son portrait en Judith avec la tête d'Holopherne d'environ 1530 au Museo de Arte de Ponce à Porto Rico (bois, 87 x 82,6 cm, 60.0143) est l'expression de son soutien. Un tableau de « Judith » fait partie des tableaux appartenant à Boguslas Radziwill, qui possédait plusieurs tableaux de Cranach.
Portrait de Barbara Kolanka (décédée en 1550) en Vierge à la treille par Lucas Cranach l'Ancien, vers 1522, Musée national des beaux-arts Pouchkine à Moscou.
Portrait de Barbara Kolanka (décédée en 1550) en princesse de la légende de saint Jean Chrysostome par Lucas Cranach l'Ancien, vers 1527-1530, Wartburg-Stiftung à Eisenach.
Portrait de Barbara Kolanka (décédée en 1550) en sainte Barbe par Lucas Cranach l'Ancien, vers 1527, Collection particulière.
Portrait de Barbara Kolanka (décédée en 1550) en Vénus et Cupidon par Lucas Cranach l'Ancien, vers 1527-1537, National Gallery of Scotland.
Portrait de Barbara Kolanka (décédée en 1550) en Lucrèce par Lucas Cranach l'Ancien, vers 1527, Collection particulière.
Portrait de Barbara Kolanka (décédée en 1550) en Lucrèce par Lucas Cranach l'Ancien, vers 1527-1530, Alte Pinakothek à Munich.
Portrait de Barbara Kolanka (décédée en 1550) en sainte Barbe par Lucas Cranach l'Ancien, vers 1530, Sammlung Würth.
Portrait de Barbara Kolanka (décédée en 1550) en Judith avec la tête d'Holopherne par Lucas Cranach l'Ancien, vers 1530, Musée d'Art de Ponce.
Portraits du courtisan royal Stanisław Bojanowski par Bernardino Licinio
Un peintre de la Renaissance, Bernardino Licinio, est très probablement né à Poscante au nord de Bergame et près de Milan vers 1489. Sa famille était bien établie à Murano et à Venise à la fin du XVe siècle et il y fut enregistré pour la première fois comme peintre en 1511.
Le portrait de Licinio au musée Pouchkine montre un jeune Stanisław Bojanowski (1507-1555), âgé de vingt et un ans, un noble et un courtisan influent qui devint secrétaire du roi Sigismond Auguste en 1543. Il est représenté en żupan rouge (de l'arabe dіubbah ou giubbone, giuppone, giubba en italien) de soie vénitienne et vêtu d'un manteau de fourrure, tenant une main sur sa ceinture et l'autre sur un volume de poésie de Pétrarque (F PETRARCHA). Le tableau a été acheté par le musée en 1964 de la collection d'Anatol Zhukov à Moscou, qui l'a acquis en 1938. Son histoire antérieure est inconnue, il ne peut donc pas être exclu qu'il ait été acquis en Pologne. Bojanowski était un homme instruit, amateur de poésie italienne, il a peut-être, comme beaucoup de Polonais, étudié à Padoue et/ou Bologne, lorsqu'il a pu commander son portrait à Venise toute proche, ou comme ses mécènes royaux il a envoyé un dessin à son effigie à Licinio. Il aurait été l'auteur du livre perdu des « mauvais romans », tel qu'il était exprimé dans les Actes de la République Babinienne. « Boianowski Stanisław, un courtisan. / Ils auraient pu l'appeler Boianowski [Craintif], / Mais par son propre titre, je pourrais l'appeler Śmiałowski [Courageux]. / Car hardiment à tout le monde, sans aucune flatterie, / Il a dit la vérité honnête jusqu'au ressentiment » (Boianowski Stanisław, dworzanin. / Moglić go tak s przezwiska, nazwać Boianowskim, / Ale własnym tytułem, mogł go zwać Smiałowskim. / Bowiem smiele każdemu, bez pochlebstwa wszego, / Namowił szczyrey prawdy, aż szło do żywego), a écrit sur Bojanowski dans son Bestiaire (Zwierziniec/Zwierzyniec), publié en 1562, le poète et prosateur polonais Mikołaj Rej. Outre l'âge (ANNO AETATIS SVE. XXI), la date du portrait est également mentionnée, 1528 (MD. XXVIII), date à laquelle le « Livre du courtisan » (Il Cortegiano) de Baldassare Castiglione a été publié pour la première fois à Venise. Bojanowski, astucieux et plein d'esprit, modèle d'un noble typique de la Renaissance, est devenu une figure de proue du « Courtisan polonais » (Dworzanin polski) de Łukasz Górnicki, une paraphrase du Il Cortegiano de Castiglione publié à Cracovie en 1566. Il est très probable que Bojanowski a acheté un volume de la première édition de l'œuvre de Castiglione. À partir de 1543, après la création d'un cour séparé de Sigismond Auguste à Vilnius, il fut l'adjoint de Jan Przerębski, le chef de la chancellerie. Il accomplit des missions diplomatiques pour le roi. En 1551, hetman Jan Tarnowski le proposa ou Jan Krzysztoporski (dont le portrait de Licinio se trouve au palais de Kensington), « à la fois laïcs et partisans bien connus des innovations religieuses » (d'après « Papiestwo-Polska 1548-1563: dyplomacja » par Henryk Damian Wojtyska, p. 336), comme envoyés à Rome. Il est possible que ce soit lui qui apporta à Florence en 1537 le portrait de la reine Bona Sforza par l'atelier de Lucas Cranach l'Ancien et sa fille la princesse Isabelle Jagellon nue (Vénus d'Urbino) par Titien, tous deux créés à cette époque et installés à Villa del Poggio Imperiale, remplissant une mission secrète pour la reine. Le même homme que dans le tableau de Moscou a également été représenté dans une autre toile de Licinio, aujourd'hui au Palazzo Pitti à Florence (numéro d'inventaire Palatina 69, 1912). Selon l'inscription latine sur un socle en pierre dans le coin inférieur gauche du tableau, il a été créé en 1537 et l'homme avait 30 ans (AETA. ANNOR / XXX / MDXXXVII), exactement comme Bojanowski à cette époque. Il porte un manteau doublé de fourrure chère et tient une lettre, très probablement les lettres de créance de l'envoyé. Son effigie à longue barbe ressemble plus au buste de Bojanowski de son épitaphe. Il est enterré dans l'église de la Sainte Trinité à Cracovie, où son épitaphe de grès et de marbre rouge, très probablement créée par l'atelier du sculpteur formé en Venise, Giovanni Maria Mosca dit Padovano (qui a créé les monuments funéraires de deux épouses de Sigismond Auguste), porte une inscription en latin qui suit : STANISLAVS BOIANOWSKI / EX MAIORI POLONIA PA / TRIIS BONIS CONTENTVS / ESSE NOLENS AVLAM ET / EIVS PROISSA SECVTVS AN. / DNI. M.D.L.V. XVII IVNII. CRA / COVIAE MORITVR ANTE / QVAM VIVERE DIDICISSET / AETATIS SVAE XXXXVIII (Stanislas Bojanowski de Grande Pologne, ne voulant pas se contenter de la cour de son pays, et suivant ses promesses, il mourut à Cracovie en l'an de grâce 1555 le 17 juin, avant d'avoir appris à vivre, à l'âge de 48 ans).
Portrait du courtisan royal Stanisław Bojanowski (1507-1555), âgé de 21 ans par Bernardino Licinio, 1528, Musée des beaux-arts Pouchkine à Moscou.
Portrait du courtisan royal Stanisław Bojanowski (1507-1555), âgé de 30 ans par Bernardino Licinio, 1537, Palazzo Pitti à Florence.
Portraits de Christine de Saxe et Elisabeth de Hesse par Lucas Cranach l'Ancien
Christine de Saxe, la fille aînée de Barbara Jagellon, duchesse de Saxe, est née le 25 décembre 1505. Alors qu'elle avait presque 18 ans, le 11 décembre 1523, elle épousa le landgrave Philippe Ier de Hesse (1504-1567) à Kassel pour forger une alliance entre la Hesse et la Saxe. L'année suivante, en 1524, après une rencontre personnelle avec le théologien Philipp Melanchthon, Landgrave Philippe embrassa le protestantisme et refusa d'être entraîné dans la ligue anti-luthérienne formée en 1525 par le père de Christine, le duc Georges de Saxe, un fervent catholique.
Le duc Georges a senti le danger que sa fille soit initiée à la religion luthérienne en Hesse. Il a été informé par son secrétaire que certains à la cour de Philippe étaient des luthériens, alors il a exhorté sa fille à rester fidèle à la foi de ses pères et à résister à l'enseignement luthérien. Dans une lettre à son père de Kassel, datée du 20 février 1524, Christine lui assure qu'elle ne deviendra pas une « Martinis » (luthérienne) : « Je voudrais te remercier pour les bonnes instructions que tu m'as données, oh que je vais pas devenir une martinis, vous n'avez pas de soucis » (Ich bedank mich keigen Ewer genaden der guten underrichtunge, di mir Ewer g. gethan haben, och das ich nicht martinis sal werden darf Ewer g. kein sorge vor haben). En mars 1525, cependant, à l'âge de 21 ans, le landgrave Philippe se déclare publiquement en faveur d'une nouvelle religion et exproprie les monastères de Hesse. Le 11 mars 1525, la landgravine Christine, convaincue par son mari, écrit à son père en tant que disciple de Luther, un ardent témoignage de sa foi nouvelle. C'est à cette occasion qu'elle commanda son portrait en Judith biblique au peintre de la cour de Saxe, Lucas Cranach l'Ancien, inspiré de la peinture italienne et vénitienne (Botticelli, Vincenzo Catena). Le portrait de la collection de l'Université de Syracuse ressemble beaucoup aux effigies de la sœur, de la mère et du frère de Christine par Cranach ainsi qu'à l'effigie de sa grand-mère maternelle Elisabeth d'Autriche (1436-1505), reine de Pologne par Anton Boys. Ses doubles portraits avec son mari, à Kassel par Jost vom Hoff et au château de Gripsholm près de Stockholm, ont été créés longtemps après sa mort à la fin du XVIe ou XVIIe siècle et ressemblent davantage au portrait de l'épouse morganatique du landgrave, Margarethe von der Saale. Christine et sa sœur cadette Magdalena (1507-1534), future margravine de Brandebourg, sont représentées comme des proches de Sigismond Ier dans De Jegellonum familia liber II, publié à Cracovie en 1521. Christine aimait son mari, mais malgré son sacrifice et son dévouement, il ne l'a jamais désirée ni aimée (das ich nihe liebe oder brunstlichkeit zu irr gehabt), comme il l'a déclaré plus tard, et dès 1526, il a commencé à considérer la licéité de la bigamie. Le 27 août 1515, le frère de Christine, Jean de Saxe (1498-1537) épouse à Marbourg Elisabeth de Hesse (1502-1557), sœur du landgrave Philippe de Hesse. La mariée a continué à vivre à Marburg, où elle est née et ce n'est qu'en janvier 1519 qu'elle a déménagé à Dresde. En 1529, à l'invitation du landgrave Philippe, le colloque de Marbourg eut lieu au château de Marbourg qui tenta de résoudre une dispute entre Martin Luther et Ulrich Zwingli sur la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie. Comme la Salomé biblique, Elisabeth était entre deux camps, « l'ancienne religion » de la famille de son mari et « la nouvelle religion » de son frère. Elisabeth s'est penchée vers les enseignements luthériens et elle s'est constamment battue pour son indépendance contre le vieux duc Georges, le père de Jean, et ses fonctionnaires. Jean et Elisabeth ont également été représentés comme des parents de Sigismund I dans De Jegellonum familia liber II. Le couple est resté sans enfant et lorsque Jean est mort en 1537, Elisabeth a déménagé à Rochlitz. Salomé avec la tête de saint Jean-Baptiste de la collection Esterhazy du Musée des Beaux-Arts de Budapest (acquis en 1871) représente une femme en riche costume sur fond de château, dont la forme et la topographie sont très proches des vues du Château de Marburg du début des XVIe et XVIIe siècles. Ce portrait est connu sous de nombreuses versions, créées par l'atelier Cranach. Parmi les meilleurs figurent des exemplaires du palais royal de Wilanów à Varsovie (inscrits à l'inventaire de 1696) et du Germanisches Nationalmuseum de Nuremberg (avant 1811 dans la collection Holzhausen de Francfort-sur-le-Main), qui a été coupé en deux. Les traits du visage d'une dame ressemblent beaucoup à l'effigie d'Elisabeth de Hesse du soi-disant Sächsischen Stammbuch, créé en 1546 par l'atelier de Cranach et les traits du visage de son frère landgrave Philip dans son portrait au Nationalmuseum de Stockholm. La même femme a également été représentée en Vénus dans un tableau de la collection d'Emil Goldschmidt à Francfort (acquis avant 1909), aujourd'hui à la National Gallery de Londres. Elle tend la main pour attraper une branche du pommier derrière elle, une allusion aux peintures d'Eve de Cranach. Une pomme est un symbole de tentation sexuelle et un symbole du pouvoir royal, mais aussi un symbole de nouveaux départs et d'une nouvelle foi. Une citation le plus souvent attribuée à Martin Luther se lit comme suit : « Si je savais que le monde devait finir demain, je planterais un pommier aujourd'hui ». La peinture ressemble beaucoup à l'effigie de Katarzyna Telniczanka, maîtresse de Sigismond Ier, en Vénus avec Cupidon volant du miel (perdue pendant la Seconde Guerre mondiale). Le tableau était inscrit en latin, pas en allemand, il a donc probablement été envoyé à des catholiques à l'étranger, peut-être en cadeau au couple royal polonais Sigismond et Bona Sforza.
Portrait de Christine de Saxe (1505-1549), landgravine de Hesse en Judith avec la tête d'Holopherne par Lucas Cranach l'Ancien, 1525, Syracuse University Art Galleries, New York.
Portrait d'Elisabeth de Hesse (1502-1557), princesse héréditaire de Saxe en Vénus et Cupidon (Cupidon se plaignant à Vénus) par Lucas Cranach l'Ancien, 1527-1530, National Gallery de Londres.
Portrait d'Elisabeth de Hesse (1502-1557), princesse héréditaire de Saxe en Salomé avec la tête de saint Jean Baptiste par Lucas Cranach l'Ancien, vers 1530, Musée des Beaux-Arts de Budapest.
Portrait d'Elizabeth de Hesse (1502-1557), princesse héréditaire de Saxe en Salomé avec la tête de Saint Jean Baptiste par l'atelier de Lucas Cranach l'Ancien, vers 1530, Palais Wilanów à Varsovie.
Portrait d'Elisabeth de Hesse (1502-1557), princesse héréditaire de Saxe par l'atelier de Lucas Cranach l'Ancien, vers 1530, Germanisches Nationalmuseum de Nuremberg.
Portraits d'Anna de Brandebourg par Lucas Cranach l'Ancien
Un tableau représentant Vénus et Cupidon en voleur de miel de Lucas Cranach l'Ancien au palais de Güstrow, daté de 1527, est très similaire à l'œuvre de la National Gallery de Londres, les femmes sont cependant différentes. Le peintre a utilisé la même effigie dans un petit tableau de la Vierge à l'Enfant de 1525, qui appartenait à la famille souabe Stein en 1549 (date et armoiries au dos du tableau), aujourd'hui au Palais Royal de Berchtesgaden.
Le tableau de Güstrow provient de l'ancienne collection du domaine (acquise par le Musée en 1851). Le château médiéval de Güstrow, à l'origine une colonie slave, a été reconstruit dans le style Renaissance entre 1558 et 1565 pour Ulrich III, duc de Mecklembourg-Güstrow (1527-1603) par un architecte italien Francesco de Pario (Franciscus Pahr), qui avait auparavant construit une cour à arcades du château de Brzeg. La mère d'Ulrich était Anna de Brandebourg (1507-1567), la fille aînée de Joachim I Nestor (1484-1535), électeur de Brandebourg. Le 17 janvier 1524 à Berlin, elle épousa le duc Albert VII de Mecklembourg-Güstrow (1486-1547), et quelques mois plus tard elle donna naissance à son premier enfant Magnus, qui mourut en couches. Alors que le frère aîné d'Albert, Henri V de Mecklembourg-Schwerin, a promu la Réforme, Albert s'y est opposé, bien qu'il se soit également penché vers la doctrine luthérienne (selon la lettre de Luther à Georg Spalatin du 11 mai 1524). Henri rejoignit la ligue protestante de Torgau le 12 juin 1526 contre la ligue catholique de Dessau du père d'Anna et, en 1532, il se déclara publiquement en faveur de Luther. Alors que le duc Albert cède l'église paroissiale de Güstrow aux protestants en 1534, Anna se détourne du luthéranisme pour devenir catholique et après la mort de son mari en 1547, elle s'installe à Lübz, qui était la seule partie du pays qui avait pas rejoint la Réforme luthérienne. Les traits du visage d'une femme dans les deux peintures décrites ressemblent beaucoup au frère d'Anna de Brandebourg, Joachim II Hector, électeur de Brandebourg et à son fils Ulrich. Son portrait dans l'abbatiale de Doberan a été créé par Cornelius Krommeny en 1587, vingt ans après sa mort. La tradition romaine antique de représentation sous l'apparence de divinités a été indéniablement l'un des facteurs qui ont repoussé les gens du catholicisme romain pendant la Réforme. Leurs dirigeants parfois impopulaires se sont présentés comme la Vierge et les saints.
Portrait d'Anna de Brandebourg (1507-1567), duchesse de Mecklembourg en Vierge à l'Enfant par Lucas Cranach l'Ancien, 1525, Palais Royal de Berchtesgaden.
Portrait d'Anna de Brandebourg (1507-1567), duchesse de Mecklembourg en Vénus et Cupidon par Lucas Cranach l'Ancien, 1527, Palais Güstrow.
Portraits des ducs de Silésie par Lucas Cranach l'Ancien et atelier
En 1526, Louis II Jagellon, roi de Hongrie, de Croatie et de Bohême, mourut lors de la bataille de Mohács et les forces ottomanes entrèrent dans la capitale de la Hongrie, Buda. Le sultan reconquit Buda en 1529 et l'occupa finalement en 1541. L'illustre palais royal de style italien de la capitale hongroise fut saccagé et incendié et la célèbre Bibliotheca Corviniana fut en grande partie transférée à Istanbul. La chute de la monarchie jagellonne en Hongrie et en Bohême a été indéniablement considérée par beaucoup comme la punition de Dieu pour les péchés, également à l'intérieur de l'union.
Les monarchies électives jagellonnes et leurs alliés avec leurs femmes audacieuses, libérées et puissantes (selon le texte du pape Pie II sur les nobles dames en Lituanie, entre autres), le multiculturalisme et la liberté religieuse représentaient tout ce que les hommes pieux et prudes et leurs épouses obéissantes, à l'intérieur et en dehors de l'union, avaient peur. Ils devraient détruire cette débauche et sa mémoire et introduire leur propre ordre. Ils garderont cependant pour eux les peintures de nus et érotiques. Le 14 novembre 1518, quelques jours avant sa sœur et quelques mois après son oncle Sigismond Ier, roi de Pologne, Sophie de Brandebourg-Ansbach (1485-1537), épouse le duc Frédéric II de Legnica (1480-1547). Sophie, était une fille de Sophie Jagellon, margravine de Brandebourg-Ansbach-Kulmbach et cousine de Louis II Jagiellon, tandis que son mari était membre de la dynastie polonaise Piast, qui était d'abord marié à la tante de Sophie Elisabeth Jagellon (1482-1517), était un vassal de la couronne de Bohême. Le duché de Legnica, créé lors de la fragmentation du royaume de Pologne en 1248, était un fief de Bohême à partir de 1329. En tant que fils de Ludmilla de Poděbrady, fille de Georges de Poděbrady (qui fut élu roi de Bohême en 1458), dans sa jeunesse il passa quelque temps à la cour du roi Vladislas II Jagellon à Prague. En 1521, après la mort de son jeune frère Georges (1481/1483-1521), il hérite du duché de Brzeg. Georges Ier de Brzeg, frère de Frédéric, marié le 9 juin 1516 avec Anna de Poméranie (1492-1550). Elle est née en tant que fille aînée du duc Bogislav X de Poméranie et de sa seconde épouse Anna Jagellon (1476-1503), fille du roi Casimir IV de Pologne. Ils n'avaient pas d'enfants et selon les dernières volontés de son mari, Anna a reçu le duché de Lubin en dot avec le droit à vie à un gouvernement indépendant. Le règne d'Anna à Lubin a duré vingt-neuf ans et, après sa mort, il est tombé au duché de Legnica. Même si Gustave Ier Vasa, roi de Suède de 1523, a envoyé une légation à Brzeg portant une proposition de mariage à Anna, selon la révision de Nicolaus von Klemptzen de la chronique de Poméranie (Chronik von Pommern), Anna est restée célibataire. Lorsqu'en 1523 le riche Frédéric II, qui était déjà duc de Legnica, Brzeg, Chojnów et Oława, acheta la principauté de Wołów au noble hongrois Jean Thurzo, frère de l'évêque de Wrocław, Jean V Thurzo, il encercla presque de ses domaines le principal centre économique de la Basse-Silésie - la ville de Wrocław. La même année, il se convertit au luthéranisme et accorde à la population la liberté religieuse. En 1528 ou 1529, son prédicateur radical Caspar Schwenckfeld, selon lequel la Vierge Marie « n'était qu'un conduit par lequel la "chair céleste" était passée » (d'après John Roth, James Stayer, « A Companion to Anabaptisme and Spiritualism, 1521-1700 », p. 131), a été banni par le duc, à la fois de la cour et du pays. À peine cinq ans plus tard, le duc a considérablement modifié son approche de la liberté de religion. En 1534, il publie un édit contre les cérémonies du culte catholique dans le duché de Legnica. Il renforça les fortifications de Brzeg, provoquées par la menace de l'invasion turque de la Silésie, ordonna de démolir l'église de la Vierge Marie et le monastère dominicain et il établit des contacts particulièrement étroits avec l'électeur de Brandebourg. À l'automne 1536, une réunion de famille eut lieu à Francfort-sur-l'Oder et il fut décidé d'épouser les enfants de l'électeur et du duc de Legnica. Un an plus tard, le 18 octobre 1537, l'électeur de Brandebourg Joachim II se rend à Legnica, où un document est signé concernant un double mariage et conclut un traité d'héritage mutuel. L'épouse de Frédéric II, Sophie, est décédée plus tôt cette année-là, le 24 mai 1537 à Legnica. L'autre union importante des maisons royales de Pologne et de Bohême, Piast et Poděbrady, Anna de Głogów-Żagań (1483-1541) et Charles Ier (1476-1536), duc de Ziębice-Oleśnica (Münsterberg-Oels) régnait sur les autres principautés près de Wrocław. Anna, le dernier membre survivant de la branche Głogów-Żagań des Piasts de Silésie, et Charles se sont mariés le 3 mars 1495 (le contrat de mariage a été signé le 7 janvier 1488). Charles, qui est resté catholique pendant la Réforme, est devenu gouverneur de Silésie en 1524. Il est né à Kłodzko, et bien que lui et ses frères aient vendu le comté à leur futur beau-frère Ulrich von Hardegg en 1501, lui et ses descendants a continué à utiliser le titre de comte de Kłodzko. Entre 1491 et 1506, les Jagellons, dont Sigismond, régnèrent à Głogów, une partie de l'héritage d'Anna. Le roi de Pologne a renoncé à ses prétentions sur le duché en 1508, tandis que sa femme, Bona Sforza, tentait encore de le réintégrer au royaume de Pologne en 1522, 1526 et 1547. Un petit tableau de Lucas Cranach l'Ancien et de son atelier au Metropolitan Museum of Art de New York montre une scène mythologique du Jugement de Pâris. Mercure, le dieu des échanges et du commerce et l'assistant du succès, en armure et coiffe fantastiques, vient d'amener devant Pâris, le fils du roi Priam de Troie, les trois déesses dont il doit juger de la beauté. Il tient la pomme de la discorde, qui, selon le mythe, portait l'inscription - « Pour la plus belle ». Chaque déesse a tenté avec ses pouvoirs de soudoyer Pâris; Junon a offert le pouvoir, Minerve, la sagesse et l'habileté à la guerre et Vénus a offert l'amour de la plus belle femme du monde, Hélène de Troie. Pâris a accepté le cadeau de Vénus et lui a décerné la pomme. Ce tableau est daté d'environ 1528 par ressemblance avec un autre, daté Jugement de Pâris à Bâle. L'armure princière à la mode et le chapeau de Pâris des années 1520, ainsi que la composition de la scène, reflètent parfaitement les principales cours princières autour de Wrocław à cette époque. On distingue dans cette scène courtoise Frédéric II de Legnica-Brzeg, candidat à la couronne de Bohême après la mort du roi Louis en 1526, comme Pâris, et son épouse Sophie de Brandebourg-Ansbach, qui commanda très probablement le tableau, car elle est au centre de la composition, comme Vénus. Charles Ier de Ziębice-Oleśnica, gouverneur en chef de la Silésie à partir de 1527, est le « filou divin » Mercure, fils de Jupiter, roi des dieux. À côté de lui se trouve sa femme Anna de Głogów-Żagań en Junon, l'épouse de Jupiter, reine des dieux, protectrice des femmes et associée au mariage et à la fertilité. Junon tient sa main sur le bras de Minerve, la déesse vierge de la sagesse, de la justice et de la victoire et pointe vers Cupidon (qui signifie « désir »), le fils de la déesse de l'amour Vénus et du dieu de la guerre Mars, qui tire une flèche sur Minerve. La dernière déesse est Anna de Poméranie, duchesse de Lubin. Le château sur un rocher fantastique en arrière-plan est également « déguisé ». C'est la principale résidence ducale de Silésie à cette époque, le château de Legnica, « habillé » en palais du roi Priam à Troie. La disposition et la forme générale de l'édifice correspondent parfaitement au château de Legnica (est-ouest) d'après la vue de Legnica de Matthäus Merian, créée vers 1680, ou un dessin anonyme de 1604 à la Herzog August Bibliothek à Wolfenbüttel. Le tableau était jusqu'en 1889 dans la collection de Freiherr von Lüttwitz dans leur palais Lüttwitzhof à Ścinawka Średnia dans le comté de Kłodzko. Le palais, initialement une maison construite en 1466, a été agrandi et reconstruit pendant la Renaissance et le baroque. À partir de 1628, il appartenait aux jésuites de Kłodzko et après la dissolution de l'ordre en 1773, il fut acquis par la famille von Lüttwitz, qui en fut propriétaire entre 1788 et 1926. Ścinawka Średnia n'est pas loin de Ząbkowice Śląskie (Frankenstein), où en 1522 ou 1524 Charles Ier a commencé la reconstruction du château gothique original des ducs de Ziębice dans le style Renaissance. Une autre version de cette composition datée « 1528 » se trouve au Kunstmuseum Basel. À partir de 1936 environ, il faisait partie de la collection Hermann Göring et porte les armoiries de Marschall von Bieberstein, une ancienne famille noble de Meissen, qui s'est installée en Silésie au début du XVIe siècle, ainsi qu'en Poméranie et en Prusse au XVIIIe et XIXe siècles. Les protagonistes sont les mêmes et sont disposés dans le même ordre, cependant le château se trouve maintenant sur le côté gauche du tableau et correspond à la disposition ouest-est du château de Legnica. Il y a aussi un dessin au musée Herzog Anton Ulrich à Brunswick, très probablement une étude pour la version bâloise ou d'une autre peinture non conservée. Les mêmes personnes ont également été représentées dans deux compositions très similaires de Cranach et de son atelier, à l'Anhaltische Gemäldegalerie Dessau et à la Staatliche Kunsthalle Karlsruhe. Le tableau de Dessau a été endommagé pendant la Seconde Guerre mondiale. Il provient de l'ancienne collection des Princes d'Anhalt-Dessau. Vers 1530, la principauté d'Anhalt-Dessau était gouvernée par trois fils de Marguerite de Ziębice (1473-1530), sœur aînée de Charles Ier, qui fut également régente dans les premières années de son règne. Les « dieux » sont placés dans le même ordre, mais l'accent est davantage mis sur Anna de Poméranie-Minerve qui regarde le spectateur. Elle était alors candidate pour épouser le fils aîné de Marguerite de Ziębice, Jean V d'Anhalt-Zerbst (1504-1551), il épousa cependant le 15 février 1534 la belle-sœur d'Anna, Marguerite de Brandebourg (1511-1577), veuve duchesse de Poméranie. Le château au sommet de la colline est différent et il est similaire sur la version de Karlsruhe, où les protagonistes ont été réarrangés et Anna de Poméranie ressemble plus à Vénus. Ce tableau se trouvait à la fin du XVIIe siècle dans le château de Toužim (Theusing) en Bohême (numéro d'inventaire 42). Le seigneur de Toužim en 1530, lors de la création de ce tableau, était Henri IV (1510-1554), burgrave de Plauen et Meissen, qui le 19 septembre 1530 obtint une confirmation de son fief de l'empereur Charles V et à l'été 1532 il épousa Marguerite, comtesse de Salm et de Neubourg. Il est fort possible qu'il ait reçu plus tôt un portrait de la duchesse de Lubin. La pose et les traits d'Anna ainsi que le château en arrière-plan sont presque identiques avec une petite peinture de Vénus avec Cupidon volant du miel également de 1530, qui était avant la Seconde Guerre mondiale dans les collections d'art de l'État à Weimar, aujourd'hui dans une collection privée. Le château de ces peintures ressemble beaucoup au château de Lubin et à la chapelle catholique visibles dans l'estampe publiée en 1738. Une autre effigie d'Anna en Vénus créée par l'atelier de Cranach en 1530 est connue à partir de deux exemplaires du début du XVIIe siècle, très probablement créés par un peintre flamand actif à Prague. Les deux ont probablement été prises par l'armée suédoise à Prague en 1648 ou à Lubin en 1641, lorsque le château a été conquis et détruit par les troupes suédoises. L'un était avant 2013 dans une collection privée à Stockholm et l'autre de la collection Transehe-Roseneck au Jaungulbene Manor (ancien territoire de la Livonie suédoise) se trouve au Metropolitan Museum of Art de New York. Vers 1530, Anna était également représentée en Judith avec la tête d'Holopherne. Ce tableau, très probablement de la collection des évêques catholiques de Wrocław dans leur palais de Nysa, se trouve de 1949 au Musée de Nysa. La principale protagoniste des peintures décrites du Jugement de Pâris, Sophie de Brandebourg-Ansbach en Vénus, est également connue par d'autres effigies. Dans une grande Vénus d'environ 1518, à la Galerie nationale du Canada à Ottawa, ses traits sont similaires à ceux de la peinture de Bâle, ainsi que dans la miniature de Vénus et Cupidon volant du miel datée de 1529 à la National Gallery de Londres. Dans ce dernier tableau, le château en arrière-plan ressemble au château de Legnica vu de l'est. Les traits du visage de la Vierge dans le Wallraf-Richartz-Museum datée « 1518 » sont identiques à ceux visibles dans la peinture de Vénus à Ottawa et la tour du château sur le rocher fantastique derrière est similaire à la plus petite tour orientale du château de Legnica. Cette Madone était très probablement dans la collection de la famille noble hongroise Festetics, avant d'être vendue à Vienne en 1859. Une autre version de la Vénus à Ottawa, peinte sur toile, peut-être une copie du XVIIe siècle d'un original perdu, se trouve au Schlossmuseum de Weimar. Le prototype de cette Vénus était très probablement le tableau de la collection impériale de Vienne dont seul Cupidon a conservé (Kunsthistorisches Museum). Des copies de Madone du Wallraf-Richartz-Museum se trouvent au North Carolina Museum of Art de Raleigh, propriété avant 1940 de l'industriel viennois Philipp von Gomperz (1860-1948), et au Bonnefantenmuseum de Maastricht, propriété privée en Pays-Bas avant la Seconde Guerre mondiale. Une autre version simplifiée de Madone du Wallraf-Richartz-Museum sur fond sombre et datée « 1516 », se trouve dans une collection privée. En 1961, le panneau se trouvait dans la collection Schwartz à Mönchengladbach. Stylistiquement, il semble s'agir d'une copie beaucoup plus tardive, la date de 1516 peut donc être commémorative et ne pas correspondre à la date réelle de création de l'œuvre. En 1516, le mari de Sophie, Frédéric II de Legnica, devint gouverneur de la Basse-Silésie. La composition des personnages correspond à la Madone de Karlsruhe (portrait d'Anna de Głogów-Żagań). L'effigie de Sophie du Wallraf-Richartz-Museum était, comme un modèle, utilisé dans une autre Vierge à l'Enfant datée « 1529 » dans le Kunstsammlung Basel, qui a été vendu en Augsbourg en 1871 et dans un fragment d'un portrait en Lucrèce d'environ 1530 à la Beaverbrook Art Gallery de Fredericton. Elle était également représentée dans deux autres peintures de Lucrèce, à la fois son visage et sa pose sont très similaires à ceux visibles dans la peinture de Karlsruhe. La tour du château à l'arrière-plan dans les deux peintures est similaire aux tours du château de Legnica. L'un de ces portraits de Lucrèce, en collection privée, est signé avec le symbole de l'artiste « I W » et daté « 1525 ». Maître IW ou monogramiste IW, était un peintre tchèque ou saxon de la Renaissance, formé dans l'atelier de Lucas Cranach l'Ancien, et actif entre 1520-1550 principalement dans le nord-ouest de la Bohême. L'autre Lucrèce, datée de « 1529 », aujourd'hui à la Fondation Sarah Campbell Blaffer à Houston, est similaire au portrait de la sœur cadette de Sophie, Anna de Brandebourg-Ansbach (1487-1539), duchesse de Cieszyn en Lucrèce, créé juste un an plus tôt en 1528 (Musée national de Stockholm). Une version de Lucrèce à Houston, plus déshabillée, se trouve au pavillon de chasse Grunewald à Berlin. Le tableau se trouvait probablement à l'origine au palais de la ville de Potsdam et en 1811, il a été enregistré au palais de Sanssouci. Une Madone, semblable à celle de la Kunstsammlung Basel (portrait de Sophie de Brandebourg-Ansbach), se trouve au palais Johannisburg à Aschaffenburg. Il provient de la collection Oettingen-Wallerstein, une famille qui avait des liens avec la Prusse et la Bohême. Ce tableau est attribué au suiveur de Lucas Cranach l'Ancien et daté d'environ 1520-1530. Il représente le modèle devant un rideau tenu par deux anges, motif de glorification, et aussi comme médium artistique pour rehausser la tridimensionnalité des personnages. La dernière femme de cette « trinité divine », Anna de Głogów-Żagań, était également représentée dans d'autres œuvres de Cranach et de son atelier. Comme Sophie, duchesse de Legnica-Brzeg, Anna a également commandé ses effigies en Vénus et en Vierge en 1518. La Vierge à l'Enfant qui était avant la Seconde Guerre mondiale dans la collégiale de Głogów, aujourd'hui très probablement au musée Pouchkine à Moscou, était datée « 1518 ». Son visage ressemble beaucoup aux autres effigies d'Anna des tableaux du Jugement de Pâris. L'Enfant tient une pomme, symbole du péché originel, mais aussi symbole du pouvoir royal (le roi Sigismond Ier, fut duc de Głogów entre 1499 et 1506) et d'un nouvel enseignement (en 1518, les premiers sermons de Luther sur les indulgences et la grâce ont été publiés à Wrocław). Le château sur la montagne derrière la Vierge peut être comparé à la principale forteresse de Silésie à cette époque, le château de Kłodzko. Une copie d'atelier de ce tableau se trouve à la Galerie nationale de Norvège à Oslo. Une autre version de cette composition se trouve à Karlsruhe, et comme le Jugement de Pâris là-bas, elle provient du château de Toužim en Bohême. L'effigie de la Vierge de Głogów a été copiée dans le grand tableau de Vénus, semblable à celui d'Ottawa, qui se trouvait au début du XXe siècle dans la collection Kleiweg van Zwaan à Amsterdam, aujourd'hui au Musée d'art de l'Université de Princeton. Le tableau de Lucrèce encadré par un arc Renaissance au Bonnefantenmuseum de Maastricht est similaire à Lucrèce de la galerie d'art Beaverbrook à Fredericton. Il est attribué à l'atelier de Lucas Cranach l'Ancien ou soi-disant Maître de la messe de St Grégoire et avant 1940, il était dans une collection privée à Amsterdam. Alors que Lucrèce à Fredericton porte les traits du visage de Sophie de Brandebourg-Ansbach, celle de Maastricht a le visage d'Anna de Głogów-Żagań, semblable à la Madone d'Oslo et à la Vénus du musée d'art de l'Université de Princeton. La Lucrèce de Maastricht possède une copie au Musée de Haldensleben, datée « 1519 ». Le portrait d'Anna de Głogów-Żagań en Vénus avec Cupidon volant du miel, semblable aux portraits d'Anna de Poméranie, copié par le même peintre flamand, se trouve à la Galerie nationale de Prague. L'original a été perdu, cependant, en raison de la similitude avec les effigies du Jugement de Pâris et avec les portraits d'Anna de Poméranie, il doit être daté d'environ 1530. Le château en arrière-plan est un grand manoir gothique, semblable à celui du portrait d'Anna de Głogów-Żagań en Judith au Musée national d'art occidental de Tokyo. Exactement comme le château de Ziębice, siège principal de la duchesse et de son mari vers 1530, qui a été construit comme un grand manoir après 1488 dans la partie orientale de la ville, à proximité de la porte gothique de Nysa et de l'église Saint-Georges. Le tableau en Judith a également été copié par un peintre flamand au début du XVIIe siècle, aujourd'hui dans la collection privée. Toutes deux appartenaient vraisemblablement à la collection d'Agnes von Waldeck (1618-1651), abbesse du monastère de Schaaken, arrière-petite-fille de Barbara de Brandebourg-Ansbach (1495-1552), Landgravine de Leuchtenberg, sœur cadette de Sophie de Brandebourg-Ansbach, Duchesse de Legnica-Brzeg. En 1530, Anna de Głogów-Żagań avait 47 ans, mais le peintre la dépeint comme une jeune fille, se basant peut-être sur le même dessin préparatoire qui a été utilisé pour créer la Vierge à Karlsruhe. Il n'aurait pas pu faire autrement, les dieux ne vieillissent pas. En 2022, le Musée national de Wrocław a récupéré un important tableau de l'atelier ou du cercle de Lucas Cranach l'Ancien. Il provient de la chapelle ducale de l'abbaye de Lubiąż et représente la Lamentation du Christ. Des membres de la famille du marchand saxon Konrad von Günterode (1476-1535) et de son épouse Anna Alnpeck (1494-1541), comme en témoignent les armoiries de la partie inférieure du tableau, ont été immortalisés dans la scène de deuil de Christ à côté des personnages bibliques : Marie - la mère de Jésus et Jean l'évangéliste. Selon Piotr Oszczanowski « la singularité de cette œuvre réside dans le fait que dans le voisinage immédiat du Christ décédé apparaissent des personnages séculiers, des personnes spécifiques connues sous leur nom, dont la réaction à l'événement semble assez ambiguë. Aucun des héros profanes du tableau ne dirige son regard vers le corps du Christ mort, qui est représenté de manière presque véristique, et certains d'entre eux - et d'une manière vraiment provocante - établissent un contact visuel avec le spectateur » (d'après « Obraz z pracowni Lucasa Cranacha st. w Muzeum Narodowym we Wrocławiu »). Il convient également de noter que l'effigie de la Vierge Marie est comme un reflet miroir d'Anna Alnpeck tenant le corps du Christ.
Portrait d'Anna de Głogów-Żagań (1483-1541), duchesse de Ziębice-Oleśnica en Vierge à l'Enfant par Lucas Cranach l'Ancien, 1518, Collégiale de Głogów, perdue.
Portrait d'Anna de Głogów-Żagań (1483-1541), duchesse de Ziębice-Oleśnica en Vierge à l'Enfant par un disciple de Lucas Cranach l'Ancien, vers 1518, Galerie nationale de Norvège à Oslo.
Portrait d'Anna de Głogów-Żagań (1483-1541), duchesse de Ziębice-Oleśnica en Vierge à l'Enfant par Lucas Cranach l'Ancien, vers 1518, Staatliche Kunsthalle Karlsruhe.
Portrait d'Anna de Głogów-Żagań (1483-1541), duchesse de Ziębice-Oleśnica en Vénus avec Cupidon par l'atelier de Lucas Cranach l'Ancien, vers 1518, Musée d'art de l'Université de Princeton.
Portrait d'Anna de Głogów-Żagań (1483-1541), duchesse de Ziębice-Oleśnica en Lucrèce par l'atelier de Lucas Cranach l'Ancien, vers 1519, Bonnefantenmuseum à Maastricht.
Portrait de Sophie de Brandebourg-Ansbach (1485-1537), duchesse de Legnica-Brzeg nue (Vénus) par Lucas Cranach l'Ancien, vers 1518, Musée des beaux-arts du Canada à Ottawa.
Portrait de Sophie de Brandebourg-Ansbach (1485-1537), duchesse de Legnica-Brzeg en Vénus et Cupidon par atelier ou suiveur de Lucas Cranach l'Ancien, après 1518, Schlossmuseum de Weimar.
Cupidon, fragment de portrait de Sophie de Brandebourg-Ansbach (1485-1537), duchesse de Legnica-Brzeg en Vénus et Cupidon par Lucas Cranach l'Ancien, après 1518, Kunsthistorisches Museum de Vienne.
Portrait de Sophie de Brandebourg-Ansbach (1485-1537), duchesse de Legnica-Brzeg en Vierge à l'Enfant par Lucas Cranach l'Ancien, 1518, Wallraf-Richartz-Museum.
Portrait de Sophie de Brandebourg-Ansbach (1485-1537), duchesse de Legnica-Brzeg en Vierge à l'enfant par Lucas Cranach l'Ancien, vers 1518, North Carolina Museum of Art de Raleigh.
Portrait de Sophie de Brandebourg-Ansbach (1485-1537), duchesse de Legnica-Brzeg en Vierge à l'enfant par l'atelier de Lucas Cranach l'Ancien, vers 1518, Bonnefantenmuseum à Maastricht.
Portrait de Sophie de Brandebourg-Ansbach (1485-1537), duchesse de Legnica-Brzeg en Vierge à l'enfant par l'atelier de Lucas Cranach l'Ancien, vers 1529, Collection privée.
Portrait de Sophie de Brandebourg-Ansbach (1485-1537), duchesse de Legnica-Brzeg en Vierge à l'Enfant par Lucas Cranach l'Ancien, 1529, Kunstsammlung Basel.
Portrait de Sophie de Brandebourg-Ansbach (1485-1537), duchesse de Legnica-Brzeg en Vierge à l'Enfant par suiveur de Lucas Cranach l'Ancien, vers 1530, Palais Johannisburg à Aschaffenburg.
Portrait de Sophie de Brandebourg-Ansbach (1485-1537), duchesse de Legnica-Brzeg en Lucrèce par Lucas Cranach l'Ancien, vers 1530, Galerie d'art Beaverbrook à Fredericton.
Portrait de Sophie de Brandebourg-Ansbach (1485-1537), duchesse de Legnica-Brzeg en Lucrèce par Maître IW, 1525, Collection privée.
Portrait de Sophie de Brandebourg-Ansbach (1485-1537), duchesse de Legnica-Brzeg en Lucrèce par Lucas Cranach l'Ancien, 1529, Sarah Campbell Blaffer Foundation à Houston.
Portrait de Sophie de Brandebourg-Ansbach (1485-1537), duchesse de Legnica-Brzeg en Lucrèce par Lucas Cranach l'Ancien, vers 1529, pavillon de chasse de Grunewald.
Portrait des ducs de Legnica-Brzeg, Ziębice-Oleśnica et Lubin dans la scène du Jugement de Pâris contre la vue idéalisée du château de Legnica par Lucas Cranach l'Ancien et atelier, ca. 1528, Metropolitan Museum of Art.
Dessin d'étude pour le portrait des ducs de Legnica-Brzeg, Ziębice-Oleśnica et Lubin dans la scène du Jugement de Pâris contre la vue idéalisée du château de Legnica par Lucas Cranach l'Ancien et atelier, vers 1528, Musée Herzog Anton Ulrich à Brunswick.
Portrait des ducs de Legnica-Brzeg, Ziębice-Oleśnica et Lubin dans la scène du Jugement de Pâris contre la vue idéalisée du château de Legnica par Lucas Cranach l'Ancien et atelier, 1528, Kunstmuseum Basel.
Portrait des ducs de Legnica-Brzeg, Ziębice-Oleśnica et Lubin dans la scène du Jugement de Pâris contre la vue idéalisée du château de Lubin par Lucas Cranach l'Ancien et atelier, 1530, Staatliche Kunsthalle Karlsruhe.
Portrait des ducs de Legnica-Brzeg, Ziębice-Oleśnica et Lubin dans la scène du Jugement de Pâris contre la vue idéalisée du château de Lubin par Lucas Cranach l'Ancien et atelier, ca. 1530-1533, Anhaltische Gemäldegalerie Dessau.
Portrait de Sophie de Brandebourg-Ansbach (1485-1537), duchesse de Legnica-Brzeg en Vénus avec Cupidon volant du miel par Lucas Cranach l'Ancien, 1529, National Gallery de Londres.
Portrait d'Anna de Głogów-Żagań (1483-1541), duchesse de Ziębice-Oleśnica en Vénus avec Cupidon volant du miel par le cercle de Roelant Savery à Prague d'après l'original de Lucas Cranach l'Ancien et l'atelier, début du XVIIe siècle d'après l'original d'environ 1530, Galerie nationale de Prague.
Portrait d'Anna de Głogów-Żagań (1483-1541), duchesse de Ziębice-Oleśnica en Judith avec la tête d'Holopherne par Lucas Cranach l'Ancien, vers 1530, Musée national d'art occidental à Tokyo.
Portrait d'Anna de Poméranie (1492-1550), duchesse de Lubin en Vénus avec Cupidon volant du miel par Lucas Cranach l'Ancien et atelier, 1530, Collection privée.
Portrait d'Anna de Poméranie (1492-1550), duchesse de Lubin en Vénus avec Cupidon volant du miel par le cercle de Roelant Savery à Prague d'après l'original de Lucas Cranach l'Ancien et l'atelier, début du XVIIe siècle d'après l'original de 1530, Metropolitan Museum of Art.
Portrait d'Anna de Poméranie (1492-1550), duchesse de Lubin en Vénus avec Cupidon volant du miel par le cercle de Roelant Savery à Prague d'après l'original de Lucas Cranach l'Ancien et l'atelier, début du XVIIe siècle d'après l'original de 1530, Collection privée.
Portrait d'Anna de Poméranie (1492-1550), duchesse de Lubin en Judith avec la tête d'Holopherne par l'atelier de Lucas Cranach l'Ancien, vers 1530, Musée de Nysa.
Lamentation du Christ avec des membres de la famille du marchand Konrad von Günterode (1476-1535) et de sa femme Anna Alnpeck (1494-1541) par l'atelier ou le cercle de Lucas Cranach l'Ancien, années 1530, Musée national de Wrocław.
Portraits de la duchesse Anna de Cieszyn par Lucas Cranach l'Ancien
Le 1er décembre 1518, la princesse Anna de Brandebourg-Ansbach (1487-1539), troisième fille de Sophie Jagellon, margravine de Brandebourg-Ansbach et cousine de Louis II, roi de Hongrie, de Croatie et de Bohême, épousa le prince Venceslas de Cieszyn, de la dynastie Piast. Plus tôt cette année-là, son oncle, Sigismond Ier, roi de Pologne et grand-duc de Lituanie, épousa Bona Sforza.
Venceslas a été nommé co-dirigeant de son père en 1518 sous le nom de Venceslas II et duc de Cieszyn (Teschen), l'un des duchés silésiens, créé en 1290 lors de la division féodale de la Pologne. Le duché était un fief des rois de Bohême depuis 1327 et fut incorporé aux terres de la couronne de Bohême en 1348. Anna lui donna un fils, décédé peu de temps après sa naissance, et deux filles, Ludmila et Sophie. Le deuxième fils de Venceslas - Venceslas III Adam est né après la mort de son père le 17 novembre 1524. Le vieux duc Casimir II, qui a survécu à ses deux fils, est décédé le 13 décembre 1528. Depuis sa naissance, comme son seul héritier, Venceslas III Adam fut placé sous la tutelle de son grand-père, qui le fit fiancer à Marie de Pernštejn (1524-1566) alors qu'il n'avait qu'un an. Dans son testament, le duc légua son duché à son petit-fils sous la régence de sa mère Anna de Brandebourg-Ansbach et du magnat bohémien Jean IV de Pernštejn (1487-1548), dit « Le Riche ». Le jeune duc est envoyé faire ses études à la cour impériale de Vienne. Après la mort de Louis II lors de la bataille de Mohács en 1526, les Habsbourg ont pris la partie occidentale de la Hongrie et de la Bohême. La Hongrie et la Bohême étaient toutes deux des monarchies électives et l'objectif principal du nouveau souverain, Ferdinand Ier, était d'établir une succession héréditaire des Habsbourg et de renforcer son pouvoir dans les territoires précédemment gouvernés par les Jagellons, également dans les duchés silésiens. Un tableau de Lucas Cranach l'Ancien ou de l'atelier à Kassel montre une femme sous la forme allégorique de l'héroïne biblique Judith, qui a habilement vaincu un ennemi qui a feint l'amitié. Son chapeau, au lieu d'une broche, est orné d'une pièce d'or, dite jocondale frappée au Royaume de Bohême de 1519 à 1528. Le lion de Bohême couronné avec le titre du roi Louis, LVDOVICUS PRIM[us]: [D] GRACIA: R[ex]: BO[hemiae]: est clairement visible. Les nouvelles monnaies frappées par Ferdinand Ier en 1528 montrent ses armoiries personnelles au revers et son effigie à cheval, au milieu d'un groupe de sujets lui rendant hommage à l'avers. Au fond du tableau se trouve une ville lointaine de Béthulie, mais le château au sommet d'une colline fantastique ressemble beaucoup à la forme du château de Cieszyn, visible sur un dessin de 1645. Une autre version ultérieure de cette peinture de l'atelier de Lucas Cranach l'Ancien, peinte dans les années 1530, se trouve à la Galerie nationale d'art de Lviv. La même femme est également représentée en Lucrèce, l'héroïne romaine et victime des abus du tyran, dont le suicide a déclenché la révolution politique, au Nationalmuseum de Stockholm (très probablement prise à Prague par l'armée suédoise). Il est daté de 1528 et le château au sommet du rocher fantastique est similaire au château de Fryštát utilisé par les ducs de Cieszyn comme deuxième siège. Le château a été construit en 1288 et reconstruit dans la première moitié du XVe siècle par la duchesse Euphémie de Mazovie. Les traits du visage d'une femme dans un tableau de Lucas Cranach l'Ancien, qui se trouvait dans une collection privée à Munich en 1929, sont presque identiques au tableau de Stockholm. Elle tient une grappe de raisin, symbole chrétien du sacrifice rédempteur, et deux pommes, symbole du péché originel et fruit du salut. Comme dans la peinture de Stockholm, le paysage en arrière-plan est fantastique, cependant, la disposition générale du château est identique à celle du château de Fryštát. Ce tableau date également de 1528. En 1528, Jean IV de Pernštejn, nommé gouverneur de Moravie par Ferdinand Ier en 1526, transféra la cour ducale au château de Fryštát. La veuve duchesse Anna, sans aucun doute, s'est opposée à toutes ces actions contre son pouvoir et a commandé quelques peintures, pour exprimer son mécontentement. Le célèbre Lucas Cranach, le peintre de la cour de sa tante Barbara Jagellon, duchesse de Saxe voisine, qui s'opposait également aux Habsbourg, était le choix évident.
Portrait d'Anna de Brandebourg-Ansbach (1487-1539), duchesse de Cieszyn en Judith avec la tête d'Holopherne par Lucas Cranach l'Ancien ou atelier, 1526-1531, Gemäldegalerie Alte Meister à Kassel.
Portrait d'Anna de Brandebourg-Ansbach (1487-1539), duchesse de Cieszyn en Judith avec la tête d'Holopherne par l'atelier de Lucas Cranach l'Ancien, années 1530, Galerie nationale d'art de Lviv.
Portrait d'Anna de Brandebourg-Ansbach (1487-1539), duchesse de Cieszyn en Lucrèce par Lucas Cranach l'Ancien, 1528, Nationalmuseum de Stockholm.
Portrait d'Anna de Brandebourg-Ansbach (1487-1539), duchesse de Cieszyn tenant une grappe de raisin par Lucas Cranach l'Ancien, 1528, Collection particulière.
Portraits des Jagellon par Bernhard Strigel
« Ainsi, le roi de Pologne a conduit plus d'un millier et demi de cavaliers, vêtus de vêtements hongrois - ceux-ci sont appelés hussards, et également vêtus d'allemand, mais il y avait aussi des Polonais, des Ruthènes, des Moscovites, des captifs turcs et des Tatars avec leur cavalerie et une foule de trompettistes avec de grandes trompettes au son fort », décrit l'entrée à Vienne en 1515 de Sigismond Ier, élu monarque de Pologne-Lituanie, Jean Cuspinien ou Cuspinianus (1473-1529), humaniste et diplomate germano-autrichien (d'après « O muzykach, muzyce i jej funkcji ... » de Renata Król-Mazur p. 40).
En 1502, Cuspinien épousa Anna Putsch, 17 ans, fille du valet impérial. A l'occasion du mariage, il fit peindre par Lucas Cranach l'Ancien un portrait de lui-même et de sa femme. Ils ont eu huit enfants. Un an après la mort de sa femme, en 1514, il se remarie avec Agnes Stainer. Il entreprit de nombreuses missions diplomatiques en Hongrie, en Bohême et en Pologne. Cuspinien fut ambassadeur de l'empereur Maximilien Ier en Hongrie en 1510-1515 et 1519. Il contribua à la préparation du Congrès des Princes et du double mariage Habsbourg-Jagellon à Vienne en 1515, entre les petits-enfants de l'empereur et les enfants du roi Vladislas II Jagellon. Les détails des négociations sont connus parce que Cuspinian en a tenu des registres méticuleux et les a publiés dans son Congressus Ac Celeberrimi Conventus Caesaris Max. et trium regum Hungariae, Bohemiae Et Poloniae In Vienna Panoniae, mense Iulio, Anno M.D.XV. facti, brevis ac verissima descriptio. L'empereur récompensa ses services en le nommant son conseiller et préfet de la ville de Vienne. En janvier 1518, il accompagna la princesse milanaise Bona Sforza à Cracovie pour son mariage avec le roi Sigismond, en novembre 1518, il remit au roi Louis II Jagellon les insignes de l'Ordre de la Toison d'or, et en avril et mai 1519, il termina avec succès le difficile tâche d'assurer le vote de Louis comme roi de Bohême pour Charles Quint lors de la prochaine élection de l'empereur. En 1520, il commanda un portrait de lui-même avec sa seconde épouse Agnes et ses fils issus de son premier mariage Sebastian Felix et Nicolaus Christostomus. Cuspinien porte un chapeau de fourrure, semblable à celui représenté dans un portrait créé entre 1432-1434 à Venise par Michele Giambono, aujourd'hui au Palazzo Rosso à Gênes, et censé représenter l'un des princes bohémiens ou hongrois venus en Italie en 1433 pour le couronnement de l'empereur Sigismond. L'effigie de Cuspinien et de sa famille a été peinte en octobre 1520 à Vienne par Bernhard Strigel (décédé en 1528), peintre de cour de l'empereur (huile sur panneau, 71 x 62 cm, vendu chez Sotheby's à Londres, le 04 juillet 2018, lot 13, aujourd'hui au Strigel-Museum de Memmingen). L'identité des modèles est principalement connue grâce à l'inscription en latin au revers, qui donne également de nombreuses informations sur le peintre. Selon l'inscription sur le tableau, il représente des personnages bibliques, membres de la Sainte Parenté, la famille de Notre-Seigneur - Cuspinien inscrit comme Zébédée (ZEBEDEVS), le père de Jacques et Jean, deux disciples de Jésus, au-dessus de sa tête, sa femme Agnes comme Marie Salomé (SALOME VXOR .I. PACIFICA / QVIA FILIOS PAC S GENVIT), l'une des Trois Maries qui étaient filles de sainte Anne, son fils aîné est saint Jacques le Grand (JACOBVS MAIOR / CHRISTO.COEVVS) et le plus jeune est saint Jean l'Apôtre (IOANNES [...] E / CHRIS [...]). Des représentations similaires étaient populaires à cette époque, l'une des meilleures étant le Retable de la Sainte Parenté de Lucas Cranach l'Ancien (Musée Städel à Francfort-sur-le-Main), peint en 1509, dans lequel l'empereur Maximilien Ier, le conseiller impérial Sixte Oelhafens, Frédéric le Sage, électeur de Saxe et son frère Jean le Constant et leurs familles étaient représentés comme des membres de la famille de Jésus. Un autre avec un autoportrait putatif de Cranach, peint vers 1510-1512, se trouve à l'Académie des Beaux-Arts de Vienne. L'inscription derrière le portrait de Cuspinien mentionne également « le premier panneau » (PRIMA TABVLA) avec « des images de Maximilien César Auguste, de Marie la duchesse de Bourgogne, fille du duc Charles, de leur fils Philippe du royaume de Castille, Charles V Empereur Auguste, Ferdinand l'Infant d'Espagne, des archiducs et neveux de l'Empereur et Louis roi de Hongrie et de Bohême », aujourd'hui au Kunsthistorisches Museum de Vienne (huile sur panneau, 72,8 x 60,4 cm, numéro d'inventaire GG 832). Il a probablement été peint après le double mariage en 1515 et le panneau a été enregistré dans la collection de portraits impériaux à Vienne dans les années 1590. Certains membres de la famille impériale représentée dans le tableau étaient déjà décédés lors de sa création entre 1515 et 1520, comme la première épouse de l'empereur Marie de Bourgogne, décédée en 1482, et leur fils Philippe le Beau, décédé en 1506. Comme dans le portrait de la famille de Cuspinien, des inscriptions peintes au-dessus des têtes des modèles évoquent les noms des membres d'une autre branche de la Sainte Parenté, la famille de Marie de Cléophas - Maximilien a été inscrit comme Cléophas, frère de saint Joseph marié à Marie, la mère de Jésus (CLEOPHAS . FRATER . CARNALIS . IO= / SEPHI: MARITI DIVAE VIRG . MARIÆ), son fils Philippe comme Saint Jacques le Mineur (I / JACOBVS: MINOR EPVS: / HIEROSOLIMITANVS .), sa mère Marie de Bourgogne comme Marie de Cléophas (ou Clopas), dite belle-sœur de la Vierge Marie (MARIA CLEOPHÆ SOROR / VIRG . MAR PVTATIVA MA= / TER TERA . D . N .), petits-fils de l'empereur en disciples de Jésus - Charles, futur empereur, comme saint Simon le Zélote (II / SIMON ZELOTES CONSO= / BRINVS . DNI . NRI .) et son frère Ferdinand, également futur empereur, en saint Joseph Barsabbas, surnommé Justus (III / IOSEPH IVSTVS). L'image de Louis de Hongrie, que Maximilien avait adopté en 1515, n'était pas inscrite en termes bibliques, ce qui a conduit certains érudits à suggérer que son effigie ne faisait pas partie de la composition initiale. Jusqu'en 1919, au revers du portrait de famille de l'empereur Maximilien Ier, il y avait une représentation de la famille de Marie, mère de Jésus, la plus importante des Trois Maries, séparée par la suite en divisant le panneau (huile sur panneau, 72,5 x 60 cm, numéro d'inventaire GG 6411). Cette composition n'est pas mentionnée dans l'inscription au dos du portrait de Cuspinien, ainsi que toutes les références bibliques. La famille de la Vierge a donc été ajoutée plus tard, après 1520 et avant la mort de l'artiste en 1528 dans sa ville natale de Memmingen, ainsi que toutes les inscriptions faisant référence à la bible. Ces images (IMAGINES) n'étaient donc initialement que des portraits de l'Empereur et de son conseiller. Lorsque cette peinture supplémentaire a été ajoutée, le cycle a été transformé en une sorte de triptyque, un autel de maison en trois parties avec des familles de trois filles de sainte Anne - Marie, mère de Jésus, Marie de Cléophas et Salomé, appelée Marie Salomé. La légende des trois filles de sainte Anne, proposée par Haymon d'Auxerre au milieu du IXe siècle, mais rejetée par le Concile de Trente, a été incluse dans la Légende dorée (Legenda aurea) de Jacques de Voragine, écrite vers 1260. Un belle miniature de Legenda aurea sive Flores sanctorum, illuminée par deux miniaturistes actifs à Padoue et Venise, le soi-disant Maître du Bréviaire Barozzi et Antonio Maria da Villafora (ou Giovanni Pietro Birago et Antonio Mario Sforza), propriété, à partir de 1525, de Krzysztof Szydłowiecki, chancelier de la Couronne (Bibliothèque nationale de Pologne, Rps BOZ 11), montre sainte Anne et ses filles dans la Nativité de la Bienheureuse Vierge Marie (NATIVITAS BEATE VIRGINIS MARIE). Ce manuscrit a été créé dans les années 1480 pour Francesco Vendramini, membre d'une famille vénitienne influente. La famille de Marie montre la Vierge, Reine des Cieux (MARIA . ILLABIS . REGINA / VIRGINITATIS' IDEA) avec son fils Jésus-Christ, Notre Sauveur (HIESVS CHRISTVS / SERVATOR NOSTER) et Élisabeth, épouse de Zacharie, et tante maternelle de Marie (ELIZABETH / COGNATA / MARIÆ / VIRG) avec son fils Jean-Baptiste, sanctifié dans le sein maternel (IOANNES BAPTISTA SANCTIFICATVS / IN VTERO) qui tient une bande avec inscription en latin « Voici l'Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde » (ECCE AGNUS DEI QUI TOLLIT PECCATA MUNDI) et désignant le fils de Marie. Les deux principaux personnages masculins, derrière Marie et Élisabeth sont Joseph, marié à la Vierge Marie (IOSEPH MARI/TVS VIRG) et, très probablement, Ephaim, mari d'Esmeria et père de Zacharie, le mari d'Élisabeth, car ces deux-là sont debout derrière lui - Esmeria, sœur cadette d'Anne, mère de Marie (ESMERIA . SOROR . AN/NAE MINOR NATV) et son fils Zacharie, père de Jean le Baptiste (ZACHARIAS). Il n'y a pas d'inscription expliquant son rôle, il pourrait donc s'agir aussi d'Aaron, le père de sainte Élisabeth. Ces deux hommes figuraient dans un autre tableau attribué à Strigel ou à son atelier, aujourd'hui au Musée national de Varsovie (huile sur panneau, 34,5 x 36 cm, M.Ob.1771 MNW). Il représente les saints Antoine le Grand et Paul de Thèbes, les Pères du désert, vénérés parmi les églises orthodoxes et catholiques. Le tableau a été acheté par le musée de la collection de Zbigniew Kamiński à Varsovie en 1974. Saint Joseph/Antoine le Grand ressemble beaucoup aux effigies du roi Sigismond Ier, en particulier une gravure sur bois de la « Chronique du monde entier » (Kronika wszytkiego świata) de Marcin Bielski, publié à Cracovie en 1551, et une miniature de l'atelier de Lucas Cranach le Jeune, peinte à Wittenberg (Musée Czartoryski). Sa lèvre inférieure saillante des Habsbourg/ducs de Mazovie est parfaitement visible, comme dans le portrait de Hans von Kulmbach (château de Gołuchów). L'autre homme, Ephaim-Aaron/Paul de Thèbes, avec une longue barbe ressemble aux effigies du frère aîné de Sigismond, Vladislas II (1456-1516), qui fut élu roi de Bohême, roi de Hongrie et de Croatie, surtout son visage du Congrès des princes à Vienne par Albrecht Dürer et de la médaille connue de la gravure du XIXe siècle à la Bibliothèque nationale autrichienne. En 1515 ou avant, Strigel réalise un portrait de Vladislas, son fils et sa fille, dans un tableau dévotionnel avec ses armoiries, montrant saint Ladislas de Hongrie intercédant auprès de la Vierge pour le roi et ses enfants (Musée des Beaux-Arts de Budapest, numéro d'inventaire 7502). Lui et sa femme, qui devrait être identifiée comme la troisième épouse de Vladislas II, Anne de Foix-Candale (1484-1506), ont été représentés dans un autre tableau de Strigel dans des costumes très similaires, aujourd'hui à la National Gallery of Art de Washington, vendu à Londres en 1900. Il montre sainte Marie Salomé (inscription SANCTA MARIA SALOME sur auréole de figure féminine) et sa famille, c'est l'une des deux ailes, qui faisaient partie d'un retable qui représentait probablement la Sainte Parenté (huile sur panneau, 125 x 65,7 cm, 1961.9.89). Si le tableau a été créé vers 1526-1528, les deux fils de Marie Salomé, saint Jacques (SANCTVS IACOBVS MA) et saint Jean (SANCTV IOHANES EWAN), visibles dans le tableau doivent être identifiés comme étant Louis II, le fils unique de Vladislas II et Anne de Foix-Candale, décédée le 29 août 1526 lors de la bataille de Mohács et Jean Zapolya (décédé en 1540), frère de la première épouse de Sigismond I Barbara (1495-1515), qui revendiquait le trône de Hongrie. L'homme en habit vert à droite de Marie Salomé pourrait donc être le père de Jean Zapolya - Étienne (mort en 1499), palatin du royaume de Hongrie ou le père d'Anne Gaston de Foix (1448-1500), comte de Candale. L'aile homologue représente sainte Marie de Cléophas (SANCTA MARIA CLEOP[H?]E) et ses quatre saints fils - Jude, Simon, Joseph et Jacques (SANCTVS IVDAS XPI APOSTOLV, SCTVS SIMON, ST[ ]SANCTVS IOSEPHI, SANCTVS IACOBVS MINOR AIPHE) (huile sur panneau, 125,5 x 65,8 cm, 1961.9.88). A côté d'elle se tient son mari saint Cléophas et les effigies du couple correspondent parfaitement aux parents de la Vierge Marie du tableau de Vienne - sainte Anne (ANNA VNICUVM VIDVI/MATIS SPECIMEN) et son mari Joachim (IOACHIM VNICVS / MARITVS ANNÆ), patron des pères et des grands-pères. La lèvre inférieure saillante de Marie de Cléophas/sainte Anne indique qu'elle est incontestablement une Habsbourg, il s'agit donc du portrait d'Élisabeth d'Autriche (1436-1505), dite la « mère des rois » (ou la « mère des Jagellon »), semblable à celui d'Antoni Boys au Kunsthistorisches Museum de Vienne (GG 4648). Tous ses fils qui deviennent rois sont représentés dans ce tableau, y compris le plus jeune vivant vers 1526-1528, Sigismond Ier, assis sur ses genoux, ainsi qu'Alexandre Jagellon, Jean Ier Albert et Vladislas II. Le mari d'Élisabeth Casimir IV Jagellon (1427-1492) a donc été représenté comme saint Cléophas/saint Joachim dans les peintures de Washington et de Vienne et ses traits du visage correspondent à la contrepartie du portrait d'Élisabeth par Antoni Boys à Vienne (GG 4649). Le vieil homme debout à côté du couple dans la peinture de Washington est identifié pour représenter l'empereur Frédéric III (1415-1493), fils de Cymburge de Mazovie, mais son effigie ressemble également à des portraits posthumes du père d'Élisabeth Albert le Magnanime (1397-1439), duc d'Autriche, par son épouse (jure uxoris) roi de Hongrie, de Croatie, de Bohême, élu roi des Romains sous le nom d'Albert II par Boys et de la chronique de Bohême (Université Charles de Prague). Un autre homme de la peinture viennoise avec la famille de la Vierge a aussi clairement les traits des Habsbourg - Zacharie, le mari de sainte Élisabeth. Son visage ressemble aux effigies de Ferdinand (1503-1564), archiduc d'Autriche - un portrait par cercle de Jan Cornelisz Vermeyen et une miniature, très probablement de Hans Bocksberger l'Ancien, tous deux au Kunsthistorisches Museum de Vienne. La femme représentée comme sainte Élisabeth est donc son épouse Anna Jagellon (1503-1547), l'aînée et fille unique du roi Vladislas II et d'Anne de Foix-Candale. C'est grâce à ce mariage que Ferdinand a pu revendiquer la couronne de Bohême et de Hongrie. Bientôt, grâce au succès de leur politique matrimoniale dynastique, les Habsbourg pouvaient véritablement revendiquer « Que les autres fassent la guerre; toi, heureuse Autriche, fais des mariages » (Bella gerant alii, tu felix Austria nube - épigramme attribuée à Matthias Corvin, roi de Hongrie) et « Tout le monde est soumis à l'Autriche », comme dans leur devise A.E.I.O.U. (Austriae est imperare orbi universo). Ferdinand a immédiatement demandé aux parlements de Hongrie et de Bohême de participer en tant que candidat aux élections. L'union avec les Jagellon ainsi que l'enfant né d'Anna - Maximilien, né le 31 juillet 1527 à Vienne, donnèrent à l'archiduc certains droits également au trône électif de Pologne-Lituanie, que Maximilien et ses fils revendiquèrent lors des élections de 1573, 1575 et 1587. Beaucoup de gens ont compris ce que la règle des Habsbourg signifiait pour l'Europe centrale - prédominance de la culture et de la langue allemandes, intolérance religieuse et absolutisme, ils n'ont donc pas été élus avec succès. Les Habsbourg étaient des maîtres de la propagande et employaient les meilleurs artistes, comme Albrecht Dürer, à cette fin. Des copies du portrait de l'empereur Maximilien et de sa famille par Strigel ont été envoyées à différentes cours royales et ducales en Europe - une copie ancienne, très probablement originaire de la collection royale espagnole, se trouve à l'Académie royale des beaux-arts de San Fernando à Madrid (collection de Manuel Godoy, premier secrétaire d'État d'Espagne, numéro d'inventaire 0856). C'est probablement Maximilien qui a commandé un portrait du jeune Louis Jagiellon. La couronne d'œillets que le garçon porte dans ses cheveux lâches fait directement allusion à l'union politiquement souhaitée avec la Maison d'Autriche (Kunsthistorisches Museum de Vienne, GG 827). Comme l'a dit l'historien Hugh Trevor Roper, pour l'empereur Maximilien "tous les arts étaient de la propagande » (d'après « Easily Led: A History of Propaganda » d'Oliver Thomson, p. 169). « Certes, l'art lui-même était censé donner une belle apparence au souverain ; le symbolisme effusif le liant, lui et sa famille, à la divinité ainsi qu'à des vertus telles que la sagesse, la clémence, la piété et la bravoure étaient de la propagande flagrante. Cependant, ce n'était pas de la propagande de masse visant le grand public. Peu de gens ont réellement vu l'art que ces dirigeants ont commandé. Au contraire, le mécénat était un marketing ciblé, configurant le statut de la dynastie à d'autres élites » (« The Habsburgs: The History of a Dynasty » de Benjamin Curtis, p. 50). Une femme a parfaitement compris cette stratégie et a répondu avec des moyens similaires - Bona (Maria) Sforza, la princesse milanaise que Cuspinien a escortée à Cracovie. Elle et son fils Sigismond Auguste sont représentés comme la Vierge et l'Enfant dans le tableau de Vienne. L'image de Bona est similaire à ses portraits en Judith et Madone par Cranach de la même période. Le fils de Ferdinand en Jean-Baptiste confirme le droit divin de son fils d'être élu comme successeur de son mari.
Les Jagellon (famille de Bona Sforza et du roi Sigismond Ier) comme la famille de la Vierge Marie par Bernhard Strigel, 1527-1528, Kunsthistorisches Museum de Vienne.
Famille d'Élisabeth d'Autriche (1436-1505) et Casimir IV Jagellon (1427-1492) comme la famille de Marie de Cléophas par Bernhard Strigel, 1526-1528, National Gallery of Art de Washington.
Famille d'Anne de Foix-Candale (1484-1506) et Vladislas II Jagellon (1456-1516) comme la famille de Marie Salomé par Bernhard Strigel, 1526-1528, National Gallery of Art à Washington.
Portrait de Sigismond I (1467-1548) et Vladislas II Jagellon (1456-1516) en saints Antoine et Paul par Bernhard Strigel ou suiveur, 1515-1528, Musée national de Varsovie.
Portrait de Bona Sforza en Judith avec la tête d'Holopherne par Lucas Cranach l'Ancien
En 1530, Bona Maria Sforza a remporté une importante bataille. En 1527, à la suite d'une chute de cheval, la reine accouche prématurément de son deuxième fils, Albert, qui meurt à la naissance. Après cet événement, elle ne pouvait plus avoir d'enfants. Cette même année, elle a été représentée comme la Vierge Marie, selon la coutume italienne, dans son livre de prières, créé par Stanisław Samostrzelnik, exposant ses beaux cheveux devant des dames habillées à la manière allemande et vaguement basé sur les gravures allemands.
Le trône polonais était électif et les Hohenzollern allemands (qui ont repris la Prusse) et les Habsbourg (qui ont pris à Jagellons la couronne de Bohême et de Hongrie) étaient des proches de son fils ayant des droits sur la couronne. Pour lui assurer le trône, elle a proposé une élection vivente rege sans précédent (l'élection d'un successeur du vivant du roi). Malgré l'énorme opposition des seigneurs polono-lituaniens, Sigismond Auguste, âgé de dix ans, fut d'abord nommé grand-duc de Lituanie, puis couronné roi de Pologne le 20 février 1530. A cette époque, il est devenu à la mode à la cour de sa belle-sœur Barbara Jagellon, en Saxe voisine, d'être représentée sous les traits de Judith. L'héroïne biblique, intelligente et rusée, qui ayant séduit puis décapité le général assyrien qui assiégea sa ville avec sa propre épée, était une parfaite préfiguration d'un Sforza typique. Le sujet, bien connu de l'art italien, n'a pas été aussi exploré dans l'art du Nord avant Cranach, Bona a-t-elle donc été la première à l'introduire auprès du peintre allemand ? Le tableau est dans la collection impériale depuis au moins 1610, l'a-t-elle donc personnellement envoyé aux Habsbourg en signe de sa victoire ? Cranach et son atelier ont peint plusieurs copies de cette Judith. Une copie très précise se trouve dans le château de Forchtenstein en Autriche (numéro d'inventaire B481), qui appartenait à la maison de Habsbourg au XVIe siècle et en 1622, Nikolaus Esterházy, fondateur de la lignée hongroise occidentale de la famille, reçut le château de l'empereur Ferdinand II. Dans la Staatsgalerie de Stuttgart, il existe une version différente de la peinture (numéro d'inventaire 643), acquise en 1847 de la collection de Friedrich Freiherr von Salmuth à Heidelberg. Il est possible qu'il provienne de la collection de Louis V (1478-1544), comte palatin du Rhin (château d'Heidelberg), qui en 1519 vota pour Charles V aux élections impériales, après avoir reçu d'importants pots-de-vin des Habsbourg. Deux autres exemplaires du tableau à Vienne sont en collection privée, l'un a été vendu à Berlin (Rudolph Lepke, 5 mai 1925, lot 130), l'autre à Munich (Neumeister, 3 décembre 2008, lot 576). Un autre artiste, très probablement Joseph Heinz l'Ancien (1564-1609), peintre de la cour de l'empereur Rodolphe II, à qui le tableau est attribué, a peint vers 1600-1605 une réinterprétation de Judith en Salomé avec la tête de saint Jean-Baptiste, très probablement une copie d'une version perdue de Cranach (Kunsthistorisches Museum de Vienne, numéro d'inventaire 862). À cette époque, Heinz réalisa des portraits du petit-fils de Bona, le roi Sigismond III Vasa (vers 1604, Alte Pinakothek à Munich) et de sa future épouse Constance d'Autriche, petite-fille d'Anna Jagellon (1503-1547), qu'il épousa en 1605 à Cracovie (1604, Clark Art Institute et Kunsthistorisches Museum). Il est possible que vers 1604, Heinz ou l'un de ses élèves se soit rendu à Varsovie ou à Cracovie pour créer le portrait du roi de Pologne, emportant avec lui le portrait d'une mariée (probablement le tableau du Clark Art Institute), et il a créé une copie à l'effigie de la célèbre grand-mère du roi, la reine Bona. Salomé de Heinz est identifiable dans les inventaires de la collection impériale à Vienne entre 1610-1619.
Portrait de Bona Sforza d'Aragona (1494-1557), reine de Pologne en Judith avec la tête d'Holopherne par Lucas Cranach l'Ancien, vers 1530, Kunsthistorisches Museum de Vienne.
Portrait de Bona Sforza (1494-1557) en Judith avec la tête d'Holopherne par Lucas Cranach l'Ancien, vers 1530, château de Forchtenstein.
Portrait de Bona Sforza d'Aragona (1494-1557), reine de Pologne en Judith avec la tête d'Holopherne par Lucas Cranach l'Ancien, vers 1530, Staatsgalerie Stuttgart.
Portrait de Bona Sforza (1494-1557) en Salomé avec la tête de saint Jean Baptiste par Joseph Heinz l'Ancien d'après Lucas Cranach l'Ancien, vers 1604, Kunsthistorisches Museum de Vienne.
Portrait de Bona Sforza en Vierge à l'Enfant caressant le divin visage de la Vierge par Lucas Cranach l'Ancien
« La nouvelle épouse Bona du roi Sigismond au visage céleste, Brillant comme une divinité Avec des dons rares de l'âme. Le cadeau de Vénus est une beauté de son visage, la raison de Minerve » (en partie d'après la traduction polonaise d'Antonina Jelicz, « Antologia poezji polsko-łacińskiej : 1470-1543 », p. 166, Alma Sismundi nova nupta regis Bona caelesti decorata vultu Dotibus raris animi refulgens Numinis instar. Cui dedit pulchrum Venus alma vultum Et caput Pallas), loue la beauté divine de la reine Bona Sforza vers 1518 dans son épigramme latine intitulée « À la gloire de la reine Bona » (In laudem reginae Bonae), secrétaire de la reine Andrzej Krzycki (1482-1537), plus tard archevêque de Gniezno.
La même effigie que dans la Judith de Cranach à Vienne, presque comme un modèle, a été utilisée dans un tableau de la Vierge à l'Enfant devant un rideau tenu par des anges, aujourd'hui au Städel Museum de Francfort (numéro d'inventaire 847). Le tableau est signé par Lucas Cranach l'Ancien avec l'insigne de l'artiste à gauche (serpent ailé) et daté d'environ 1527-1530. Il a été acquis en 1833 auprès du marchand d'art Metzler à Mayence. Au XVIe siècle, l'archevêque-électeur de Mayence avait le droit d'élire l'empereur. De 1514 à 1545, ce poste fut occupé par le cardinal Albert de Brandebourg (1490-1545), le même à qui le roi Sigismond Ier demanda dans une lettre du 9 juillet 1536 d'intervenir à la cour de Berlin dans les problèmes conjugaux de sa fille. Le cardinal Albert était un mécène renommé des arts et il était fréquemment peint par Cranach et représenté sous les traits de différents saints. En 1525, Cranach peint un portrait du cardinal en saint Jérôme dans son étude (Hessisches Landesmuseum Darmstadt, GK 71) et un an plus tard (1526), il crée une effigie similaire (John and Mable Ringling Museum of Art à Sarasota, SN 308) dans lequel, cependant, un sablier sur le mur près de la fenêtre a été remplacé par une image de Madone. Le cardinal possédait indéniablement de nombreux tableaux de la Vierge par Cranach. Dans le tableau de Francfort, l'Enfant caresse le divin visage de la Vierge. Le fond a été peint avec une azurite coûteuse qui, au XVIe siècle, était également extraite à Chęciny en Pologne. L'effigie et la composition peuvent être comparées à d'autres portraits de la reine Bona en Madone par Cranach et son atelier à Prague et à Gdańsk, créés entre 1535-1540. Le 19 juillet 1525, l'archevêque de Mayence participe à la fondation de la Ligue anti-luthérienne de Dessau. Alors que Jan Benedykt Solfa (1483-1564), le médecin royal de Sigismond Ier et de Bona, écrivait à Erasme de Rotterdam sur la nécessité de défendre la foi catholique et par une analyse méticuleuse, il essayait de montrer la fausseté des arguments utilisés par partisans de la Réforme, Piotr Tomicki (1464-1535), archevêque de Cracovie et vice-chancelier de la Couronne, écrit dans une lettre au doyen de Gniezno, Marcin Rambiewski (mai 1527), que « dans un royaume libre, tant les opinions et les voix doivent toujours être libres » (in libero regno et sententias et voces liberos esse semper decet). Dans une lettre au secrétaire de la reine, Ludovico Alifio, il présente une attitude similaire envers la foi, parlant du libre choix de religion (d'après « Podkanclerzy Piotr Tomicki (1515-1535) : polityk i humanista » d'Anna Odrzywolska-Kidawa, p. 236).
Portrait de Bona Sforza (1494-1557) en Vierge à l'Enfant caressant le divin visage de la Vierge par Lucas Cranach l'Ancien, vers 1527-1530, Musée Städel.
Portrait de Sigismond Auguste enfant par Lucas Cranach l'Ancien
Le portrait d'un garçon du Wallraf-Richartz-Museum, daté en bas à gauche 1529, peut, par conséquent, être identifié comme le fils de Bona. Sigismond Auguste, fut élevé au Grand-Duché de Lituanie le 18 octobre 1529 et le 18 décembre 1529, la Diète de Piotrków le proclama roi de Pologne.
Il fut couronné l'année suivante dans les vêtements similaires à ceux visibles sur le portrait. L'inventaire du Trésor du Royaume de 1555 mentionne : « des tibalia (bas), une dalmatique, des gants et une petite épée » et l'inventaire de 1599 mentionne : « une robe de velours à galons d'or, dans laquelle le roi Auguste était couronné ». Seules ses chaussures sur une plate-forme recouverte de velours rouge sont conservées, aujourd'hui au château de Wawel. Le garçon porte une couronne de bijoux avec une plume, qui marque traditionnellement un engagement. En 1527, Sigismond Ier accepta de marier son fils avec sa cousine qui n'avait que huit mois, Elizabeth d'Autriche (1526-1545), et proposa des fiançailles après l'âge de sept ans de l'archiduchesse.
Portrait de Sigismond Auguste (1520-1572) enfant en tunique rouge par Lucas Cranach l'Ancien, 1529, Wallraf-Richartz-Museum.
Portraits de Frédéric II de Gonzague en le Christ par Titien et suiveurs
Dans sa lettre de juin 1529 de Vilnius à Alphonse d'Este (1476-1534), duc de Ferrare, Giovanni Andrea Valentino (de Valentinis) de Modène, médecin de la cour de Sigismond Ier et de Bona Sforza, relate un événement assez particulier. La reine Bona montrait au barbier de la cour, Giacomo da Montagnana de Mantoue, le portrait du marquis Frédéric II de Gonzague (1500-1540) qu'on venait de lui apporter. Il a écrit qu'elle l'a démontré « avec la même cérémonie avec laquelle le manteau de saint Marc est montré à Venise », de sorte que le barbier devait s'agenouiller devant lui les mains jointes, rapporte Valentino dans une lettre à Alphonse (d'après « Królowa Bona, 1494-1557 : czasy i ludzie odrodzenia », tome 3, p. 187). Il faisait très probablement référence à la fête des reliques de Notre-Dame (28 mai), lorsque des parties de la robe, du manteau, du voile et de la ceinture de la sainte Vierge sont exposées à la vénération des fidèles à Venise. Montagnana était le représentant du marquis à la cour de Pologne à partir de 1527 et cette remarque clairement ironique n'était pas sans raison.
Gonzague était connu dans toutes les cours européennes pour sa vie dissolue et tenta de racheter ses péchés, au moins officiellement, pour faire annuler le contrat de mariage avec Marie Paléologue (1508-1530), célébré le 15 avril 1517. Il accuse Marie et sa mère Anne d'Alençon d'avoir tenté d'empoisonner sa maîtresse Isabella Boschetti. Le 6 mai 1529, convaincu par Isabelle d'Este, la mère de Frédéric, le pape Clément VII annule le mariage, qui ne sera jamais consommé. Il fut ensuite fiancé à Julie d'Aragona de Naples (1492-1542), la fille de Frédéric Ier de Naples et parent éloigné de la reine Bona, par l'empereur Charles V, qui donna à Frédéric le titre convoité de duc de Mantoue en 1530. Comme petit-fils d'Éléonore de Naples (1450-1493), le duc était également parent de la reine Bona. Frédéric n'a jamais épousé Julie, mais en 1531, il a épousé Marguerite Paléologue (1510-1566), la sœur de sa première femme. Il souffrit longtemps de la syphilis et mourut le 28 juin 1540 dans sa villa de Marmirolo. Dans son célèbre portrait de Titien, aujourd'hui au musée du Prado à Madrid, il porte un pourpoint de velours bleu, peint avec de l'outremer coûteux, avec des broderies d'or. A son cou pend un précieux chapelet en or et lapis-lazuli qui témoigne de sa foi, signe visible de sa rédemption du passé tumultueux. Similaire est le rôle du chien maltais, plus approprié comme symbole de fidélité pour les portraits féminins que pour les portraits masculins. Ce portrait a très probablement été réalisé en 1529 car le 16 avril de cette année-là, Frédéric s'excusa auprès de son oncle Alphonse d'Este d'avoir retenu Titien « parce qu'il a commencé un portrait de moi que je désire ardemment voir terminé » (perché ha conienzo un retratto mio qual molto desidero sii finito). La comparaison avec l'une des reliques les plus sacrées de la République de Venise dans la lettre de Valentino indique que le portrait de Frédéric était du peintre vénitien, Titien dans ce cas, et que le marquis était représenté comme un saint chrétien ou même comme le Christ, le Rédempteur des péchés, ce qui explique cette vénération inhabituelle. Nous ne le saurons probablement jamais avec certitude car les collections jagellonnes ont été pillées, détruites et dispersées en raison des multiples invasions du pays et de l'appauvrissement qui a suivi lorsque de nombreux objets de valeur qui ont survécu ont été vendus. Liées aux liens familiaux des maisons régnantes, les collections royales de Pologne-Lituanie étaient sans aucun doute aussi somptueuses que celles d'Espagne, d'Autriche et de Florence, sinon plus riches. Des effigies de parents et de membres des maisons régnantes étaient fréquemment échangées. Portrait de Laurent de Médicis (1492-1519), duc d'Urbin en Rédempteur du monde (Salvator Mundi) par Giovanni Cariani ou Bernardino Licinio, créé vers 1516 (Musée national de Wrocław), était très probablement un tel cadeau diplomatique. Au Kunsthistorisches Museum de Vienne, qui contient de nombreuses collections familiales de la maison de Habsbourg, il y a une peinture du Christ comme le Rédempteur du monde, tenant sa main sur une boule de cristal, qui signifie le monde et fait allusion à la validité universelle de la rédemption et à Dieu créateur de lumière (huile sur toile, 82,5 x 60,5 cm, numéro d'inventaire GG 85). Les érudits datent l'œuvre vers 1520-1530 et l'inclusion d'une inscription en hébreu sur la tunique du Christ faisant référence à la Kabbale suggère que l'œuvre a été commandée par un mécène bien éduqué. Ce tableau a été attribué à l'atelier du Titien et il a été mentionné dans le trésor de la collection impériale au début du XVIIIe siècle. Après un examen approfondi de la toile en 2022, elle est désormais considérée comme un véritable Titien. La radiographie a révélé une composition complètement différente en dessous - une Vierge à l'Enfant. Titien, comme le Tintoret et d'autres ateliers vénitiens, réutilisait fréquemment d'autres toiles. Peut-être que cette Madone était un tableau pour lequel l'artiste n'a pas reçu de paiement ou qu'il s'agissait d'une étude pour un autre tableau. Il a également révélé que le visage avait changé, le modèle avait initialement des sourcils plus nets et un nez plus épais. Malgré ces changements, la ressemblance avec le portrait mentionné de Frédéric avec un chapelet est frappante. La barbe, les lèvres et une bande brodée sur sa tenue se ressemblent beaucoup, ce qui suggère que Titien et son atelier utilisaient le même ensemble de dessins d'étude et ne faisaient que changer des éléments de la composition. La ressemblance avec deux autres portraits du duc de Mantoue par l'atelier du Titien (1539-1540, collection privée) et suiveur, peut-être le flamand Anton Boys, qui a copié de nombreux portraits de la collection impériale (Kunsthistorisches Museum de Vienne), est également visible. Il est possible que le visage du Christ ait été repeint par un peintre de la cour des Habsbourg après le Concile de Trente (1545-1563), alors que de telles représentations n'étaient plus de mise. Le Christ sortant du tombeau (Résurrection) est visible au revers d'une pièce d'or scudo del sole de Frédéric II de Gonzague avec ses armoiries de 1530-1536, portant des inscriptions en latin : FEDERICVS II MANTVA DVX I / SI LABORATIS EGO REFICIAM (Si vous travaillez, je vous donnerai du repos). Belle pièce en or du père de Frédéric, François II de Gonzague (1466-1519), marquis de Mantoue avec son buste, conçu par Bartolomeo Melioli entre 1492-1514, le montre dans une coiffure et une barbe évoquant les représentations de Jésus à la Renaissance. Une autre version de l'atelier de Titien à Cobham Hall, collection des comtes de Darnley, montre le même modèle en le Christ bénissant (huile sur toile, 73,6 x 57 cm). En 1777, il était dans la collection Vitturi à Venise et plus tôt dans la collection Ruzzini, également à Venise. Carlo Ruzzini (1653-1735), qui a reconstruit le Palazzo Ruzzini était le 113e doge, il est donc possible que le tableau se trouvait à l'origine dans les collections d'État de la République. Une effigie similaire du Christ avec le même modèle, bien que plus de profil, comme dans la pièce mentionnée de François II de Gonzague, se trouve au Palais Pitti à Florence (huile sur toile, 77 x 57 cm, Palatina 228). Elle est également datée vers 1530 ou 1532 (« Sauveur » mentionné dans une lettre du 23 mars 1532). En 1652, le tableau se trouvait dans la garde-robe de Vittoria della Rovere, il était donc antérieur, soit dans les collections familiales des ducs d'Urbino, soit envoyé aux Médicis en cadeau. Bien qu'attribuée à Titien, cette œuvre peut aussi être considérée comme issue de l'atelier ou d'un suiveur comme Bonifacio Veronese (Bonifacio de' Pitati), dont le style est très proche. La Sacra Conversazione de Bonifacio avec des portraits de Sigismond Ier et de Bona Sforza se trouve également au Palais Pitti. Une copie de ce tableau, probablement du début du XIXe siècle, a été vendue en 2004 (Bonhams Londres, 21 avril 2004, lot 39). Cette diversité de représentations et de provenance des collections ducales suggère également qu'il s'agit d'un portrait déguisé d'un personnage important.
Portrait de Frédéric II de Gonzague (1500-1540), marquis de Mantoue avec un chapelet autour du cou et un chien par Titien, vers 1529, Musée du Prado à Madrid.
Portrait de Frédéric II de Gonzague (1500-1540), marquis de Mantoue en le Rédempteur du monde (Salvator Mundi) par Titien ou atelier, vers 1529, Kunsthistorisches Museum de Vienne.
Portrait de Frédéric II de Gonzague (1500-1540), duc de Mantoue en Christ bénissant par l'atelier de Titien, vers 1530-1532, Cobham Hall.
Portrait de Frédéric II de Gonzague (1500-1540), duc de Mantoue en le Christ par un suiveur de Titien, peut-être Bonifacio Veronese, vers 1530-1532, Palais Pitti à Florence.
Portrait de Frédéric II de Gonzague (1500-1540), duc de Mantoue en le Christ par un suiveur de Titien, début du XIXe siècle (?), collection privée.
Comments are closed.
|
Artinpl est un projet éducatif individuel pour partager des connaissances sur les œuvres d'art aujourd'hui et dans le passé en Pologne.
Si vous aimez ce projet, veuillez le soutenir avec n'importe quel montant afin qu'il puisse se développer. © Marcin Latka Catégories
All
Archives
April 2023
|