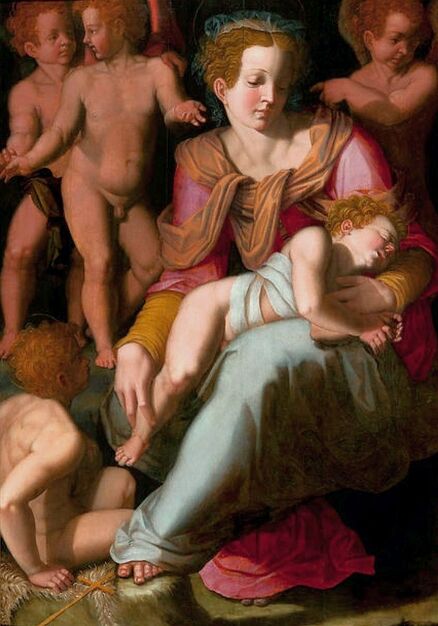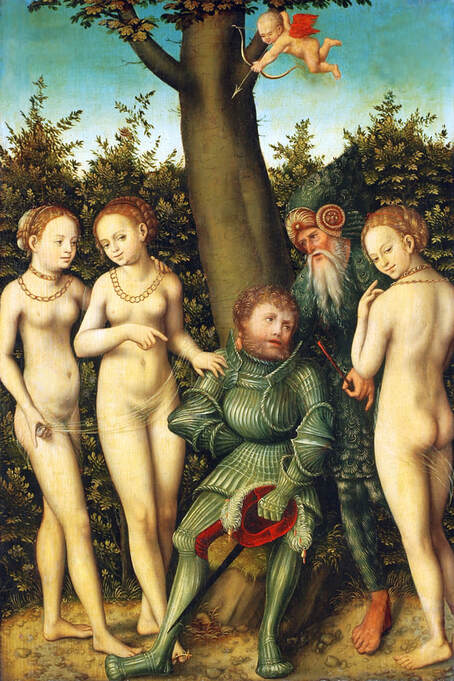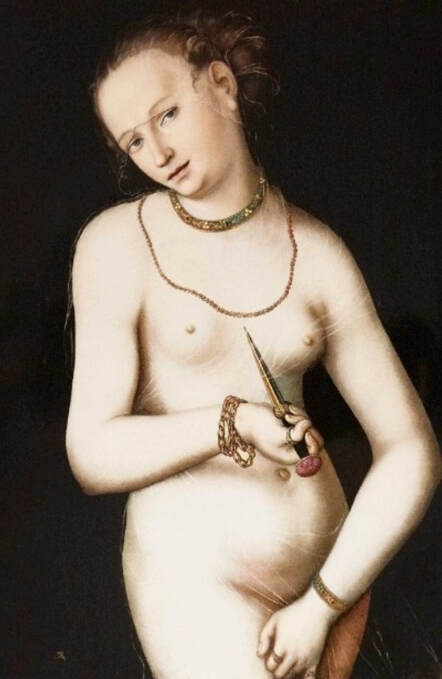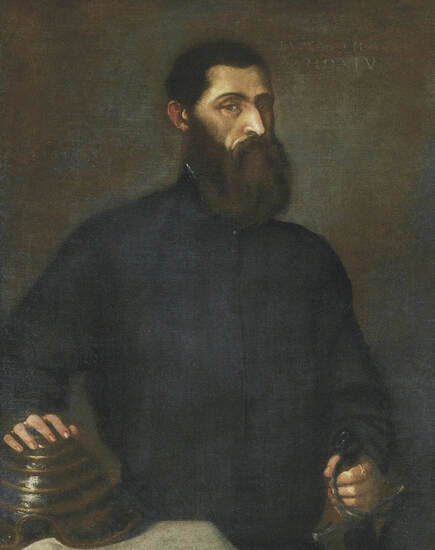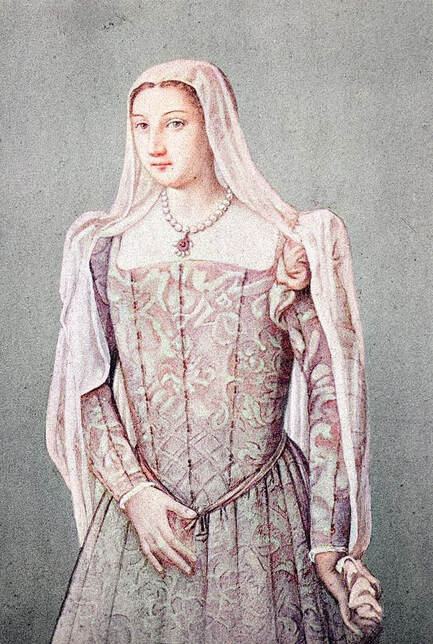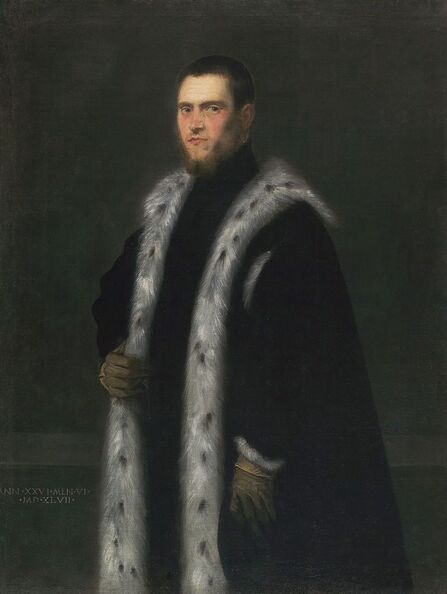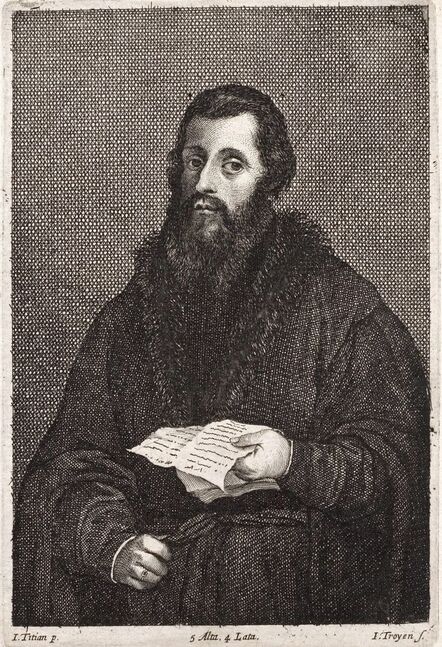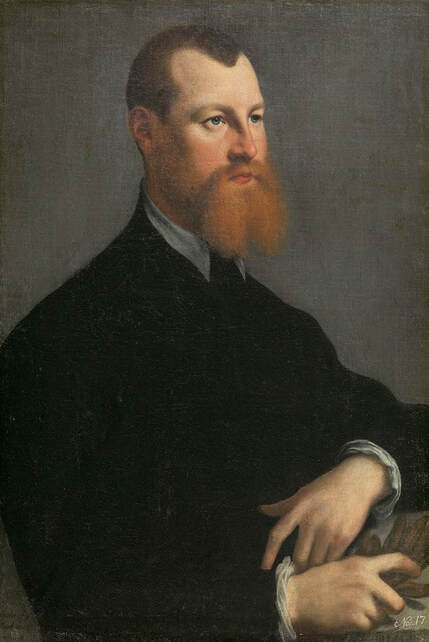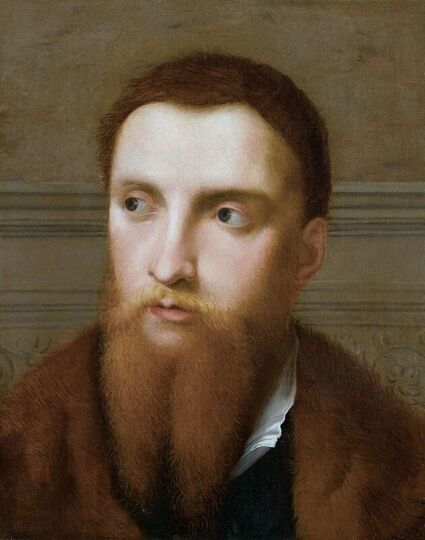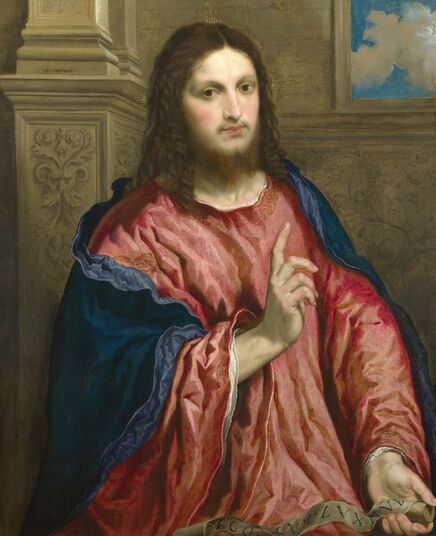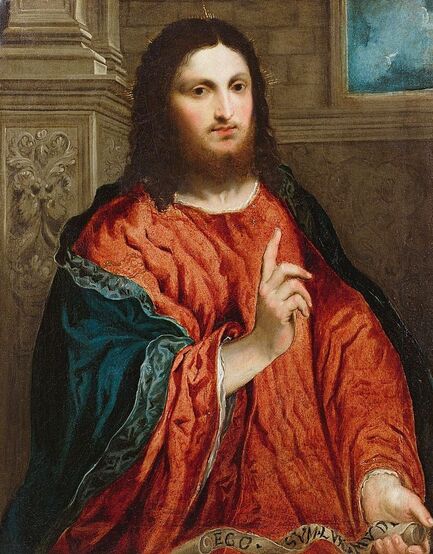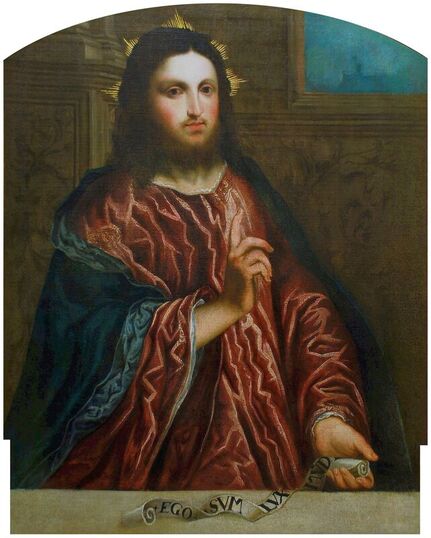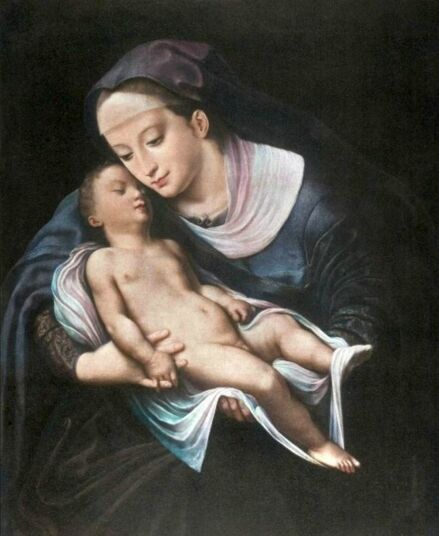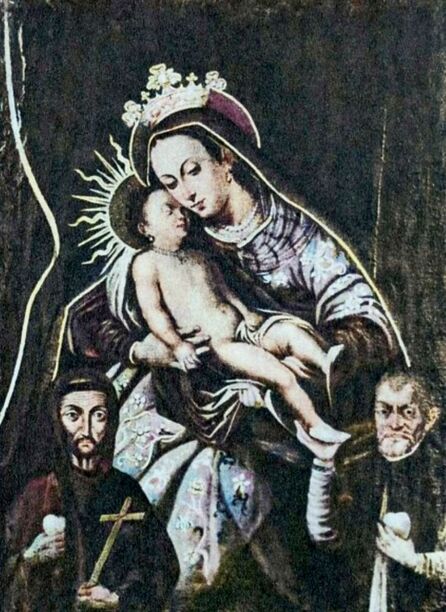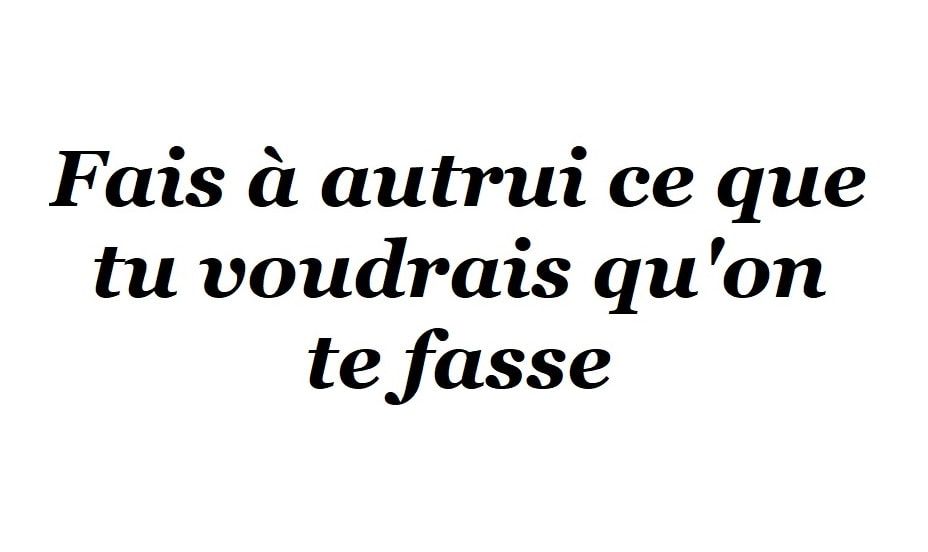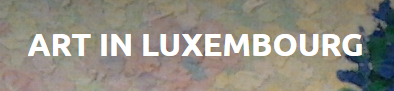|
Portraits d'Isabelle Jagellon et Jean Sigismond Zapolya par Jacopino del Conte et Tintoret
Quelques mois seulement après son arrivée en Hongrie, le 7 juillet 1540 à Buda, Isabelle Jagellon a donné naissance à son fils unique Jean Sigismond Zapolya. 15 jours après sa naissance, son père mourut subitement le 22 juillet 1540 et l'enfant Jean Sigismond fut élu roi par une assemblée noble hongroise à Buda et Isabelle comme régente. L'évêque d'Oradea, George Martinuzzi (Frater Georgius), a repris la tutelle. La revendication du trône de Jean Sigismond a été contestée par Ferdinand Ier d'Autriche. Sous prétexte de vouloir protéger les intérêts de Jean, le sultan Soliman le Magnifique fait envahir le centre de la Hongrie en 1541 et occuper Buda.
Après le départ de la cour royale hongroise de Buda, la reine Isabelle s'installe à Lipova puis du printemps 1542 à l'été 1551 dans l'ancien palais épiscopal d'Alba Iulia en Transylvanie. Isabella était jeune, connue pour sa beauté et réprimandée pour ses goûts dispendieux. Elle a commencé la reconstruction de l'ancien palais épiscopal d'Alba Iulia dans le style Renaissance. Cette décennie a été une période d'hostilités incessantes et de conflits féroces avec Martinuzzi. Isabelle a gardé une correspondance régulière avec ses parents italiens, y compris son troisième cousin, Ercole II d'Este, duc de Ferrare et son proche conseiller était Giovanni Battista Castaldo, un chef mercenaire italien (condottiere), premier marquis de Cassano, général impérial et commandant en service de l'empereur Charles V et de son frère cadet, l'archiduc Ferdinand I. Castaldo était un mécène des arts et ses effigies conservées ont été créées par les meilleurs artistes liés à la cour espagnole - Titien (portrait en collection privée), Antonis Mor (portrait en Musée Thyssen-Bornemisza) et Leone Leoni (buste de l'église de San Bartolomeo in Nocera Inferiore et médaille de la Wallace Collection). En juillet 1551, face à des forces supérieures, Isabelle se rend et accepte de céder la Transylvanie en échange des duchés silésiens (Opole, Racibórz, Ziębice, Ząbkowice Śląskie) et d'autres territoires offerts par Ferdinand. Les duchés silésiens se sont avérés ruinés après le règne antérieur des Hohenzollern, à qui Ferdinand les a remis pendant 20 ans en échange d'un prêt. Il n'y avait même pas de résidence pouvant accueillir la cour d'Isabelle. Elle est partie vers la Pologne où elle a vécu avec sa famille pendant les cinq années suivantes. Pour lui assurer un revenu, son frère lui a accordé Krzepice et Sanok, tandis que sa mère lui a donné Wieluń. Elle retourna en Transylvanie en 1556 avec son fils. Isabella s'est entourée d'étrangers - principalement des Italiens et des Polonais. Son secrétaire était Paolo Savorgnano de Cividale del Friuli et le médecin personnel Giorgio Biandrata, spécialisé en gynécologie. En 1539, Biandrata publie un traité médical de gynécologie intitulé Gynaeceorum ex Aristotele et Bonaciolo a Georgio Blandrata medico Subalpino noviter excerpta de fecundatione, gravitate, partu et puerperio, une compilation tirée des écrits d'Aristote et de l'Enneas muliebris de Ludovico Bonaccioli, dédiée à la reine Bona Sforza et sa fille, Isabelle Jagellon. En 1563, Jean Sigismond Zapolya en fit son médecin et conseiller personnel. Biandrata était un unitaire et l'un des co-fondateurs des Églises Unitariennes en Pologne et en Transylvanie. D'après « The Art of Love: an Imitation of Ovid, De Arte Amandi » de William King, publié à Londres en 1709 (page XXI), « Isabelle Reine de Hongrie, vers l'an 1540, montra à Petrus Angelus Barcæus [Pier Angelio Bargeo], lorsqu'il était à Belgrade, un stylo en argent avec cette inscription, Ovidii Nasonis Calamus; indiquant qu'il avait appartenu à Ovide. Cela n'avait pas longtemps été trouvé parmi quelques vieilles ruines, et l'estimé comme une pièce vénérable de l'antiquité » (également dans : « The Original Works of William King », publié en 1776, p. 114). Ce fragment donne une certaine impression de la qualité du mécénat et de la collection d'Isabelle. Le portrait de Matthias Corvin, roi de Hongrie, de Croatie et de Bohême au Musée des beaux-arts de Budapest a été peint dans le style d'Andrea Mantegna, peintre italien et étudiant en archéologie romaine né à Isola di Carturo en République vénitienne, qui a probablement jamais visité la Hongrie. Un portrait du fils de Matthias, Jean Corvin, dans l'Alte Pinakothek de Munich est attribué à Baldassare Estense, un peintre qui a travaillé à la cour des ducs d'Este à Ferrare de 1471 à 1504 et qui n'a probablement jamais visité la Hongrie. Il en va de même pour la médaille avec buste de la reine Béatrice d'Aragon de Naples, troisième épouse de Matthias à la National Gallery of Art de Washington, créée dans le style de Giovanni Cristoforo Romano, un sculpteur né à Rome qui travailla plus tard comme médailleur pour les cours de Ferrare et de Mantoue. Après la mort d'Isabelle le 15 septembre 1559, Jean Sigismond prit le contrôle du pays. Il parlait et écrivait huit langues : hongrois, polonais, italien, latin, grec, roumain, allemand et turc. Il était un amoureux passionné des livres, ainsi que de la musique et de la danse et savait jouer de nombreux instruments de musique. Malgré sa silhouette élancée, il adorait la chasse et utilisait la lance à ces occasions. Il se convertit du catholicisme au luthéranisme en 1562 et du luthéranisme au calvinisme en 1564. Environ cinq ans plus tard, il devint le seul monarque unitarien de l'histoire et en 1568 il proclama la liberté de religion à Turda. Dans le traité de Spire de 1570 entre Jean Sigismond et l'empereur, la Transylvanie fut reconnue comme une Principauté indépendante sous vassalité des Ottomans et Jean Sigismond renonça à son titre royal. Après la mort de Jean Sigismond le 14 mars 1571, son oncle Sigismond II Auguste, roi de Pologne, et ses tantes héritent d'une partie de ses trésors. Le nonce papal Vincenzo dal Portico a rapporté de Varsovie à Rome le 15 août 1571 la valeur énorme de l'héritage évalué par certains à 500 000 thalers, ce que le roi a nié, affirmant qu'il ne valait que 80 000 thalers. La légation polonaise revenant d'Alba Iulia au début du mois d'août 1571 n'apporta qu'une partie des objets de valeur à Varsovie, dont un grand nombre d'objets et de bijoux en or et en argent, dont « 1 couronne avec laquelle la reine fut couronnée ; 1 sceptre d'or ; 1 orbe d'or » (1 corona, qua regina coronata est; 1 sceptrum aureum; 1 pomum aureum), « 4 grands vases antiques et démodés » (4 magnae, antiquae et vetustae amphorae), mais aussi des tableaux comme « l'autel d'or , dans laquelle figure l'image de la Bienheureuse Marie, évaluée à cent quarante-huit florins hongrois » (altare aureum, in quo effigies Beatae Mariae, aestimatum centum quadraginta octo item Ungaricorum) ou « portrait de Gastaldi - 4 fl. dans le monnaie » (item Gastaldi effigies - 4 fl. in moneta), peut-être l'effigie de Giacomo Gastaldi (vers 1500-1566), un astronome et cartographe italien, qui a créé des cartes de la Pologne et de la Hongrie ou de Giovanni Battista Castaldo. « L'image de Castaldi dans un cadre en argent doré » (Imago Castaldi ex argento inaurato fuso), peut-être même la même effigie de Titien vendue par la galerie Dickinson, a été incluse dans la liste des objets hérités par le roi et ses sœurs. Parmi l'héritage, il y avait aussi une effigie de la reine Bona, mentionnée dans la lettre de la reine de Suède Catherine Jagellon à sa sœur Sophie, datée du 22 août 1572 à Stegeborg. « Le reste de l'héritage de l'infante, qui sera bientôt là, vaut 70 à 80 mille thalers » (vi resta il legato, della infanta, che sara presto qua che e di valore di 70 in 80 millia tallari) a ajouté dal Portico dans son message sur l'héritage d'Intante Anna Jagellon (d'après Katarzyna Gołąbek, « Spadek po Janie Zygmuncie Zápolyi w skarbcu Zygmunta Augusta »). Le tableau de la Vierge à l'Enfant avec saint Jean et des anges du Musée national de Varsovie, attribué à Jacopino del Conte, a été acheté en 1939 à F. Godebski. L'effigie de la Vierge est identique au portrait d'Isabelle Jagellon au Samek Art Museum. Le tableau a donc été commandé peu après la naissance du fils d'Isabelle en 1540. Les deux tableaux ont été peints sur panneau de bois et sont stylistiquement très proches des peintres maniéristes florentins Pontormo, Bronzino ou Francesco Salviati. En 1909, dans la collection de Przeworsk du prince Andrzej Lubomirski, qui possédait également le portrait de Nicolas Copernic de Marco Basaiti, il y avait une peinture (huile sur bois, 53,5 x 39 cm) attribuée à l'école florentine du XVIe siècle, « peut-être Jacopo Carrucci appelé Jacopo da Pontormo (1494-1557) », représentant la Vierge à l'Enfant (d'après « Katalog wystawy obrazów malarzy dawnych i współczesnych urządzonej staraniem Andrzejowej Księżny Lubomirskiej » de Mieczysław Treter, point 34, p. 11). À la National Gallery de Londres, il y a un portrait d'un garçon d'environ dix ans, également attribué à Jacopino del Conte, dans un riche costume princier semblable à celui visible dans un portrait de l'archiduc Ferdinand (1529-1595), âgé de 19 ans, gouverneur de Bohême, fils d'Anna Jagellonica et de Ferdinand Ier, au Kunsthistorisches Museum, peint par Jakob Seisenegger en 1548. Il a également été peint sur panneau de bois. Selon la description de Gallery, « bien que les portraits en pied étaient courants à Venise et dans ses états, où les tableaux étaient normalement peints sur toile, ils étaient rares à Florence où la peinture sur panneaux de bois persistait plus longtemps », il est donc possible qu'il ait été créé par un peintre florentin actif ou formé à Venise, comme Salviati qui a réalisé un portrait du frère d'Isabelle, le roi Sigismond II Auguste (Mint Museum of Art à Charlotte). Le portrait d'un garçon à Londres a d'abord été attribué à Pontormo, Bronzino ou Salviati et a été acheté à Paris en 1860 à Edmond Beaucousin. Il faisait autrefois partie de la collection du duc de Brunswick, tandis qu'en 1556, lorsqu'Isabelle est revenue avec son fils en Transylvanie, sa mère Bona est partie par Venise pour Bari dans le sud de l'Italie, la sœur cadette d'Isabelle, Sophie Jagellon, a épousé le duc Henri V et est partie à Brunswick-Wolfenbüttel, prenant une importante dot et sans doute des portraits des membres de la famille royale. Le même garçon, bien qu'un peu plus âgé, figurait également dans un tableau qui se trouvait avant 1917 dans la collection de Wojciech Kolasiński à Varsovie, inclus dans le catalogue de sa collection vendue à Berlin (pièce 102). Il a été peint sur fond vert et attribué à Jacopo Pontormo. Le garçon a un ordre sur sa poitrine, semblable à la croix des Chevaliers Hospitaliers (Chevaliers de Malte), ennemis des Ottomans, comme la croix visible sur le manteau de Ranuccio Farnèse (1530-1565), 12 ans, qui a été créé le prieur titulaire du Prieuré de Venise de l'Ordre en 1540, dans son portrait par Titien, ou à la croix de l'Ordre de l'Éperon d'Or, qui a été fréquemment décerné par les monarques hongrois, comme en 1522, quand István Bárdi a été nommé chevalier de l'éperon d'or par le roi Louis II en présence de plusieurs nobles de haut rang. Il a finalement été représenté comme un homme adulte dans un tableau de Jacopo Tintoretto (Tintoret), qui a ensuite été dans la collection de l'ambassadeur d'Espagne à Rome et plus tard vice-roi de Naples, Don Gaspar Méndez de Haro, 7e marquis de Carpio, comme ses initiales D.G.H. sont inscrits au revers de la toile avec une couronne ducale. Le tableau a été plus tard dans la collection du prince Brancaccio à Rome et a été vendu lors d'une vente aux enchères à Londres en 2011. Selon la note de catalogue (Sotheby's, 06 juillet 2011, lot 58): « Le chapeau inhabituel avec sa broche ornée n'était pas couramment vu sur les modèles vénitiens de cette période et a conduit certains à suggérer que le modèle était un visiteur de Venise plutôt qu'un natif de la ville ». Si l'oncle de Jean Sigismond, Sigismond Auguste, a commandé ses effigies dans l'atelier du Tintoret à Venise, il en serait de même pour Jean Sigismond. Un autre prétendant à la couronne hongroise, Ferdinand d'Autriche, a également commandé ses effigies à l'étranger, comme un portrait de Lucas Cranach l'Ancien au palais de Güstrow, daté « 1548 » ou un portrait par Titien de la collection royale espagnole, créé au milieu du XVIe siècle, les deux se basant très probablement sur des dessins préparatoires et ne voyant pas le modèle. Dans les trois portraits, le garçon/homme ressemble beaucoup aux effigies de la tante paternelle de Jean Sigismond, Barbara Zapolya, reine de Pologne, et de sa mère par Cranach et son atelier.
Portrait d'Isabelle Jagellon (1519-1559), reine de Hongrie en Vierge à l'Enfant avec Saint Jean et anges par Jacopino del Conte, vers 1540, Musée national de Varsovie.
Portrait de Jean Sigismond Zapolya (1540-1571), roi de Hongrie en enfant par Jacopino del Conte, vers 1550, National Gallery de Londres.
Portrait de Jean Sigismond Zapolya (1540-1571), roi de Hongrie en garçon de la collection Kolasiński par Jacopino del Conte, vers 1556, Collection particulière.
Portrait de Jean Sigismond Zapolya (1540-1571), roi de Hongrie par le Tintoret, années 1560, Collection particulière.
Portraits de Hurrem Sultan et de sa fille Mihrimah par Titien et atelier
« Puisse Allah accorder longue vie à Votre Majesté Royale et faire d'un jour mille jours. L'humble transmet : Lorsque j'ai reçu votre lettre remplie d'amour, j'étais si heureux et content qu'il est difficile de l'exprimer avec des mots. [...] Avec cette lettre de sympathie, afin de ne pas être des mots vides, nous envoyons deux paires de chemises et pantalons avec ceintures, six mouchoirs et serviettes de toilette. Nous vous demandons de les accepter et d'en profiter, même si les vêtements envoyés ne sont pas dignes de vous. Si Dieu le veut, la prochaine fois je les rendrai plus ornés. En conclusion : que votre Dieu vous accorde longue vie et que votre état dure pour toujours. Haseki Sultan », est une lettre de 1549 (956) de Hurrem Sultan (vers 1504-1558), épouse principale et légale du sultan ottoman Soliman le Magnifique, au monarque élu de Pologne-Lituanie Sigismond II Auguste (Archives centrales des documents historiques de Varsovie, regest KDT, nr 103). Un cadeau sous forme de sous-vêtements est l'expression d'une intimité particulière entre la sultane et le roi, qui portait des chemises confectionnées par ses sœurs (selon des documents de 1545 et septembre 1547).
Hurrem, « la joyeuse » en persan, est connue des Européens sous le nom de Roxelane - de Roxolania, le nom de Ptolémée pour la Ruthénie (en particulier l'Ukraine), alors partie de la Pologne-Lituanie. Selon la « Légation importante » de Samuel Twardowski (Przeważna legacya iaśnie oświeconego książęcia Krzysztopha Zbaraskiego...), publiée en 1633 à Cracovie, elle était la fille d'un prêtre orthodoxe ukrainien de Rohatyn et elle fut faite prisonnière par les Tatars (z Rochatyna popa była córa, / Oddana niewolnicą do szaraju). Elle a conquis le cœur du sultan, qui en 1526 a conquis Buda, la capitale de la Hongrie, mettant fin au règne des Jagellons dans cette partie de l'Europe. Twardowski affirme que la captive aurait recouru à la sorcellerie : « Et ainsi il la rendra libre / Et lui permettra d'accéder à ses chambres privées et à son lit ; Mais ce n'était pas suffisant pour la ruthène rusée / Utilisant une vieille femme karaïte pour cela, / Par des coups furtifs et des sorts chauds / Elle a mis le venin dans les os de Soliman, / Que l'amour du vieil homme a ravivé ». Brisant la tradition ottomane, il épousa Roxelane vers 1533, faisant d'elle son épouse légale, et elle fut la première épouse impériale à recevoir le titre de Haseki Sultan. En réponse à la critique des sujets de Soliman selon lesquels il avait pris « une esclave sordide » (niewolnice podłej) comme épouse, selon Twardowski, son mari a affirmé qu'elle était « du pays polonais, du sang royal vient et genre » et qu'elle était une sœur du roi Sigismond (Że ją siostrą Soliman królewską nazywa [...] Ztąd Zygmunta naszego szwagrem swym mianował). Il est tentant de croire que la reine Bona, qui gérait Rohatyn à partir de 1534/1535 dans le cadre du domaine royal, était derrière tout cela et que ces deux femmes ont empêché une nouvelle invasion de l'Europe centrale par l'Empire ottoman. « La guerre non pas au détriment du royaume, mais plutôt pour la défense » (Woyna nie ku skazie królestwa, ale raczey ku obronie) était la doctrine officielle de l'État du « Royaume de Vénus, déesse de l'amour » - République polono-lituanienne sous le règne de la reine élue Anna Jagellon, fille de Bona Sforza, bien qu'à l'intérieur du royaume même il y ait eu des hommes désireux de le briser. Elle a été publiée en 1594 à Cracovie dans les « Statuts et registres des privilèges de la Couronne » (Statuta y metrika przywileiow Koronnych) de Stanisław Sarnicki sous une effigie de Jan Zamoyski, Grand Hetman de la Couronne. Hurrem Sultan avait quatre fils nommés Mehmed (1521), Selim (1524), Bayezid (1525) et Cihangir (1531) et une fille Mihrimah Sultan (1522). Il y avait aussi un fils Abdullah, mais il est mort à l'âge de 3 ans. En tant que sultana (mot italien pour épouse ou parente d'un sultan), Roxelane a exercé une très forte influence sur la politique de l'État et elle a soutenu des relations pacifiques avec la Pologne-Lituanie. Outre Sigismond Auguste (lettres de 1548 et 1549), elle correspond également avec sa sœur Isabelle, reine de Hongrie (1543) et sa mère la reine Bona. Jan Kierdej alias Said Beg, qui a été capturé par les Turcs lors du siège de son château familial à Pomoriany en Ruthénie rouge en 1498, alors qu'il avait huit ans, s'est rendu trois fois en Pologne en tant qu'envoyé ottoman (1531, 1538 et 1543). Lorsqu'en janvier 1543, Kierdej vint avec l'ambassade du sultan auprès de Sigismond l'Ancien, il apporta également les paroles de la sultane à la reine Bona. Les deux femmes voulaient retarder ou empêcher le mariage de Sigismond Auguste avec l'archiduchesse Élisabeth d'Autriche. La reine de Pologne, connue pour son goût artistique hors du commun, a acquis des œuvres d'art et des bijoux dans de nombreux endroits, dont la Turquie (d'après « Klejnoty w Polsce... » d'Ewa Letkiewicz, p. 57). Les contacts directs de Roxelane avec les dirigeants de la république vénitienne ne sont pas documentés, mais c'est à Venise que la plupart de ses ressemblances fictives ou fidèles ont été créées. On peut supposer qu'une grande partie de cette « production » de portraits était destinée au marché polono-lituanien. De nombreux Vénitiens vivaient en Pologne-Lituanie et en Turquie et de nombreux Polonais étaient sans aucun doute intéressés par la vie de la « sultane ruthène ». Le fils de Roxelane, sultan Selim II (1524-1574), connu sous le nom de Selim « le blond » en raison de son teint clair et de ses cheveux blonds, prit comme concubine Nurbanu Sultan (Cecilia Venier Baffo), membre d'une famille patricienne vénitienne bien connue, et l'épousa légalement vers 1571. Dix lettres écrites par Nurbanu entre 1578 et 1583 à plusieurs ambassadeurs et au doge conservées à Venise. Selon Vasari, le peintre vénitien Titien, bien qu'il n'ait jamais visité Istanbul, a été chargé par Soliman le Magnifique de peindre sa femme Roxelane (Sultana Rossa) et leur fille Mihrimah (Camerie) (d'après « Images on the Page... » de Sanda Miller , p. 84). Le portrait de Titien de Camerie et de sa mère a également été mentionné par Ridolfi. Lui et son célèbre atelier ont également peint le sultan et des copies de ces effigies se trouvent au Kunsthistorisches Museum de Vienne et dans une collection privée. Pour créer les peintures, Titien a dû utiliser des dessins ou des miniatures envoyés de Turquie. Après la Seconde Guerre mondiale, une seule image peinte connue de la reine Bona Sforza, créée de son vivant ou à une époque proche, a survécu dans les anciens territoires de la République polono-lituanienne. Il s'agit d'une miniature d'un cycle représentant la famille Jagellon (aujourd'hui au musée Czartoryski), réalisée par l'atelier de Lucas Cranach le Jeune (1515-1586) à Wittenberg, en Allemagne, vers 1553 sur la base d'un dessin ou d'une autre miniature envoyée de Pologne-Lituanie. Fait intéressant, deux effigies de sultanes ottomanes ont également survécu, l'une est un portrait traditionnellement identifié comme Roxelane au musée historique de Lviv en Ukraine et l'autre est une ressemblance de sa fille Mihrimah au musée de Mazovie à Płock en Pologne. Tous deux ont été créés au XVIe siècle et proviennent de collections historiques de l'ancienne République. Le portrait de Lviv est une petite peinture sur bois (38 x 26 cm) et provient de la collection de l'Ossolineum, qui l'a reçu en 1837 de Stanisław Wronowski. L'effigie de Mihrimah à Płock a également été peinte sur bois (93 x 69,7 cm) et provient de la collection de la famille Ślizień déposée par eux chez les Radziwill à Zegrze près de Varsovie pendant la Première Guerre mondiale. Avant la Seconde Guerre mondiale dans le salon rouge de le palais Zamoyski à Varsovie, il y avait un portrait de la « Sultane turque », brûlé en 1939 avec tout le mobilier du palais (d'après « Ars Auro Prior » de Juliusz Chrościcki, p. 285). De tels portraits sont également documentés en Pologne-Lituanie beaucoup plus tôt. L'inventaire de 1633 du château de Radziwill à Lubcha en Biélorussie (Archives centrales des documents historiques de Varsovie, 1/354/0/26/45) répertorie « Une peinture d'une dame avec l'inscription Favorita del gran turcho » (36). L'inscription en italien indique que le tableau a très probablement été réalisé en Italie. L'nventaire des peintures de la collection de la princesse Louise Charlotte Radziwill (1667-1695), établi en 1671, répertorie les représentations suivantes de femmes turques, dont certaines peuvent être de Titien : « Turkini en turban joue de l'alto » (295), « Une jeune femme turque avec une plume » (315), « Une jeune femme de Turquie » (316), « Turkini en turban et en zibeline, une femme à ses côtés » (418) (d'après « Inwentarz galerii obrazów Radziwiłłów z XVII w. » de Teresa Sulerzyska). Certaines effigies autrefois considérées comme représentant Catherine Cornaro sont aujourd'hui identifiées comme des portraits de Roxelane, comme le tableau de Florence aux attributs de sainte Catherine d'Alexandrie - roue cassante et auréole (Galerie des Offices, Inv. 1890, 909). Il est entré dans la Galerie en 1773 avec l'attribution à Véronèse, mais plus tard l'inscription latine Titiani opus - 1542 a été retrouvée au dos. Un portrait très similaire inscrit en français ROSSA FEMME DE SOLIMAN EMPEREUR DES TURCS se trouve dans la collection royale du palais de Kensington (RCIN 406152). Son costume est également nettement ottoman. Une autre version de ce tableau se trouvait avant 1866 dans la collection Manfrin à Venise et Samuelle Levi Pollaco a créé une gravure du tableau avec l'inscription : CATTERINA CORNARO REGINA DI CIPRO. Sa tenue est légèrement différente, et on peut voir trois pyramides en arrière-plan, très probablement les trois principales pyramides de Gizeh en Égypte, à l'époque une province de l'Empire ottoman (l'Égypte a été conquise par les Turcs ottomans en 1517). Le monastère orthodoxe de sainte Catherine d'Alexandrie, construit sur ordre de l'empereur byzantin Justinien Ier sur le site où Moïse est censé avoir vu le buisson ardent, sacré pour le christianisme, l'islam et le judaïsme, se trouve également en Égypte (péninsule du Sinaï). Roxelane était la fille d'un prêtre orthodoxe, c'est pourquoi ce monastère revêtait sans aucun doute une importance particulière pour elle dans tout l'Empire ottoman. Une copie réduite de cette effigie attribuée à l'atelier de Titien a été vendue sous le titre de « Portrait de Caterina Cornaro » (Christie's Londres, 9 juillet 2021, lot 214). Une autre version en buste de ce portrait par un disciple de Titien se trouve à Knole House, Kent (NT 129882). Le peintre a utilisé le même visage dans sa célèbre Vénus au miroir, aujourd'hui à la National Gallery of Art de Washington (numéro d'inventaire 1937.1.34). Ce tableau est resté en possession de l'artiste jusqu'à sa mort, où il aurait pu inspirer les visiteurs à commander des tableaux similaires pour eux-mêmes, ou il aurait pu servir de modèle aux membres de l'atelier à reproduire. Il est également possible qu'il ait voulu avoir une effigie de cette belle femme, l'une de ses meilleures clientes. Le tableau est généralement daté d'environ 1555, cependant, il est possible qu'il ait été peint beaucoup plus tôt, car « le style et la technique picturale de Titien n'ont jamais été uniformes et pouvaient varier d'une œuvre à l'autre, ainsi que d'une décennie à l'autre », comme l'a noté Peter Humfrey dans l'entrée de la galerie pour la peinture (21 mars 2019). La radiographie de 1971 révèle que Titien a réutilisé une toile qui représentait autrefois deux personnages de trois quarts debout côte à côte, peut-être un travail non accepté par un client, et il a fait pivoter la toile de 90 degrés. Fern Rusk Shapley a comparé le double portrait avec la soi-disant Allégorie d'Alfonso d'Avalos d'environ 1532 (Louvre à Paris). Le portrait d'Alfonso d'Avalos avec une page, autrefois propriété du roi Jean III Sobieski et du roi Stanislas Auguste Poniatowski (J. Paul Getty Museum, numéro d'inventaire 2003.486), est daté d'environ 1533. Giorgio Tagliaferro a suggéré que le double portrait a été commencé par le jeune Paris Bordone alors qu'il était assistant dans l'atelier de Titien (probablement vers 1516 pendant deux ans). Dans le miroir tenu par un cupidon, elle ne semble pas se voir, mais quelqu'un qui la regarde, probablement un homme, son mari. Un autre cupidon couronne sa tête d'une couronne de fleurs. Cette œuvre est considérée comme la plus belle version subsistante d'une composition exécutée dans de nombreuses variantes par Titien et son atelier, dont certaines des meilleures se trouvent au musée de l'Ermitage, acquise en 1814 de la collection de l'impératrice Joséphine à Malmaison près de Paris (numéro d'inventaire ГЭ-1524), et à la Gemäldegalerie de Dresde (numéro d'inventaire Gal.-Nr. 178). Une version qui appartenait au roi d'Espagne (perdue) a été copiée par Peter Paul Rubens (Musée National Thyssen-Bornemisza à Madrid, 350 (1957.5)). La même femme, dans une pose et un costume similaires à l'œuvre à Florence, a été représentée dans une peinture attribuée à l'atelier de Titien, aujourd'hui au John and Mable Ringling Museum of Art à Sarasota, en Floride (numéro d'inventaire SN58). Il provient de la collection Riccardi à Florence, vendue à Lucien Bonaparte (1775-1840), frère cadet de Napoléon Bonaparte, exactement comme le « Portrait de la duchesse Sforza » (Portrait de la reine Bona Sforza) de Titien. Par conséquent, les deux portraits - de la reine de Pologne et de la sultane de l'Empire ottoman ont très probablement été créés en même temps à Venise et envoyés à Florence. Elle tient un petit animal de compagnie, probablement un vison ou une belette, talisman de la fertilité. La fleur dans son décolleté pourrait indiquer qu'elle est une mariée ou une femme nouvellement mariée. Une version légèrement différente de ce tableau se trouve dans une collection privée. Elle a également été représentée dans un autre portrait de Titien (National Gallery of Art, Washington, 1939.1.292), vêtue d'une robe verte similaire, une couleur symbolique de la fertilité. Elle tient une pomme dans ses mains, ce qui dans l'art évoque souvent la sexualité féminine. Ce tableau appartenait probablement à Michel Particelli d'Hémery (1596-1650) à Paris, France. L'Alliance franco-ottomane, l'une des alliances étrangères les plus durables et les plus importantes de France, a été formée en 1536 entre le roi de France François Ier et le sultan Soliman Ier. Sans aucun doute, le roi de France avait des portraits du sultan et de sa femme influente. Il existe de nombreuses variantes et copies de ce portrait. Dans un tableau similaire de la collection privée de Veneto (vendu à Dorotheum à Vienne, 17.10.2017, lot 233) sa robe ottomane est rose, un symbole de mariage, et elle prépare sa couronne de mariée (similaire à celle visible sur sa tête dans la version de Washington). Le style de ce tableau est particulièrement proche de Giovanni Cariani. Il serait plutôt inhabituel si une noble chrétienne de Venise serait vêtue de tenue ottomane pour son mariage. Par conséquent, à travers ces portraits, « la Ruthène » voulait annoncer le monde qu'elle n'est pas une concubine, mais une femme légale d'un sultan. Après 1543, un suiveur de Titien, très probablement Alessandro Varotari (1588-1649), connu sous le nom de Il Padovanino, a copié une autre version de ce tableau avec un modèle tenant un vase vide (Gemäldegalerie Alte Meister à Dresde, Gal.-Nr. 173). Le portrait identifié comme Roxelane de la collection de Sir Richard Worsley à Appuldurcumbe House, île de Wight (1804, comme par « Gentile Bellino ») par un suiveur de Titien la représente tenant un vase vide. Avec l'inscription latine sur la colonne « tout est vanité » (OMNIA VANITAS), cela pourrait symboliser une grande perte. Le 7 novembre 1543, le fils aîné de Hurrem Sultan, le prince Mehmed, mourut à Manisa, probablement de la variole. La sultane connaissait très probablement le latin, car la communauté catholique romaine était présente à Rohatyn depuis le Moyen Âge. Son grand turban et son visage ressemblent au portrait de Lviv. Le style de ce tableau est également proche de Giovanni Cariani. Semblable à la ressemblance de Lviv, l'effigie de Mihrimah (Camerie) à Płock a également une contrepartie réalisée par l'atelier de Titien, aujourd'hui à la Courtauld Gallery de Londres, une copie d'un original perdu de Titien. Ce tableau provient de la collection du comte Antoine Seilern (1901-1978), collectionneur d'art anglo-autrichien et historien de l'art. Comme sa mère, elle était représentée avec une roue cassante, utilisée pour identifier sainte Catherine d'Alexandrie. Une étude pour ce portrait de Titien ou de son atelier se trouve à l'Albertina de Vienne (numéro d'inventaire 1492). Le portrait de Camerie du Musée Fabre de Montpellier (numéro d'inventaire 65.2.1) a été réalisé par Sofonisba Anguissola (signature : PINXIT SOPHONISBE ANGUSSOLA VIRGO CRE. XIII SUCC). Comme la reine Bona, qui a régné avec succès dans le monde dominé par les hommes, « la Ruthène » était bien consciente du pouvoir de l'image et a transmis la splendeur de son règne à travers des peintures créées par l'atelier vénitien de Titien.
Portrait de Hurrem Sultan (Roxelane, vers 1504-1558) en mariée par l'atelier de Titien, vers 1533, John and Mable Ringling Museum of Art à Sarasota.
Portrait de Hurrem Sultan (Roxelane, vers 1504-1558) en mariée par l'atelier de Titien, vers 1533, Collection particulière.
Portrait de Hurrem Sultan (Roxelane, vers 1504-1558) en mariée tenant une pomme par Titien, vers 1533, National Gallery of Art de Washington.
Portrait de Hurrem Sultan (Roxelane, vers 1504-1558) en mariée tenant sa couronne de mariée par l'atelier de Titian ou Giovanni Cariani, vers 1533, Collection particulière.
Portrait de Hurrem Sultan (Roxelane, vers 1504-1558) tenant un vase vide par un suiveur de Titien, très probablement Alessandro Varotari, après 1543, Gemäldegalerie Alte Meister à Dresde.
Portrait de Hurrem Sultan (Roxelane, vers 1504-1558) en Vénus avec un miroir par Titien, vers 1533 ou après, National Gallery of Art à Washington.
Portrait de Hurrem Sultan (Roxelane, vers 1504-1558) en Vénus avec un miroir par l'atelier de Titien, vers 1533 ou après, Musée de l'Ermitage.
Portrait de Hurrem Sultan (Roxelane, vers 1504-1558) en Vénus avec un miroir par l'atelier de Titien, vers 1533 ou après, Gemäldegalerie à Dresde.
Portrait de Hurrem Sultan (Roxelane, vers 1504-1558) avec des pyramides par Titien, vers 1542, Collection particulière.
Portrait de Hurrem Sultan (Roxelane, vers 1504-1558) en sainte Catherine d'Alexandrie par l'atelier de Titien, 1542, Galerie des Offices.
Portrait de Hurrem Sultan (Roxelane, vers 1504-1558) par l'atelier de Titien, vers 1542, Collection particulière.
Portrait de Hurrem Sultan (Roxelane, vers 1504-1558) par suiveur de Titien, vers 1542, Knole House.
Portrait de Hurrem Sultan (Roxelane, vers 1504-1558) tenant un vase vide par suiveur de Titien ou Giovanni Cariani, vers 1543, Collection particulière.
Dessin préparatoire pour un portrait de Mihrimah Sultan (Camerie, 1522-1578) par Titien ou atelier, après 1541, Albertina à Vienne.
Portrait de Mihrimah Sultan (Camerie, 1522-1578) en sainte Catherine d'Alexandrie par l'atelier de Titien, après 1541, Courtauld Gallery à Londres.
Portrait de Mihrimah Sultan (Camerie, 1522-1578) par un peintre inconnu d'après Titien, après 1541, Musée de Mazovie à Płock.
Portrait du courtisan royal Jan Krzysztoporski par Bernardino Licinio
L'interprétation de l'architecture classique par l'architecte vénitien Andrea Palladio (1508-1580), connue sous le nom de palladianisme, relancée par les architectes britanniques du début du XVIIIe siècle, est devenue le style architectural dominant jusqu'à la fin du siècle. L'œuvre de l'architecte et ses effigies deviennent des biens très demandés.
C'est pourquoi un propriétaire d'un portrait d'un noble inconnu par Bernardino Licinio, peut-être un peintre, a décidé d'en faire le portrait d'un architecte célèbre. Il a ajouté une inscription en latin (ANDREAS. PALADIO. A.) et une équerre et un compas dans la main droite du modèle pour rendre sa « falsification » encore plus probable. Le portrait, aujourd'hui au palais de Kensington, a été acquis en 1762 par le roi George III de Joseph Smith, consul britannique à Venise. Les attributs en bois d'un simple architecte contrastent fortement avec le costume opulent du modèle, un pourpoint cramoisi de soie vénitienne, des bagues en or avec des pierres précieuses et un manteau doublé de fourrure orientale chère. De plus, l'homme représenté est de type plus oriental qu'italien. Le compas, cet instrument coûteux, généralement en métal, est clairement exposé dans les portraits d'architectes de Lorenzo Lotto, tandis que dans le portrait par Licinio est à peine visible. Le petit doigt est une preuve que les attributs ont été ajoutés plus tard, car son apparence est anatomiquement impossible pour tenir une équerre et un compas. Selon l'inscription originale (ANNOR. XXIII. M.DXLI), le modèle avait 23 ans en 1541, exactement comme Jan Krzysztoporski (1518-1585), un noble des armoiries de Nowina du centre de la Pologne. Entre 1537 et 1539, il étudie à l'école luthérienne de Wittenberg, sous la direction de Philip Melanchthon, recommandé par « le père de la démocratie polonaise » Andrzej Frycz Modrzewski. Puis il se rendit pour poursuivre ses études à Padoue (entré sous le nom de loannes Christophorinus), où le 4 mai 1540, il fut élu conseiller de la nation polonaise. En janvier 1541, il accueille à Trévise, près de Venise, le chancelier Jan Ocieski (1501-1563) en route pour Rome. Après son retour en Pologne, il fut admis à la cour royale le 2 juillet 1545 et en 1551, il fut nommé secrétaire royal. Il fut envoyé du roi Sigismond Auguste auprès du pape Jules III en 1551, de Joachim II Hector, électeur de Brandebourg en 1552 et d'Isabelle Jagellon, reine de Hongrie en 1553. Adepte du calvinisme, il fonda une congrégation de cette religion dans son domaine de Bogdanów, près de Piotrków Trybunalski. Il avait également une grande bibliothèque dans son manoir fortifié de brique à Wola Krzysztoporska, qu'il a construit, détruit pendant les guerres suivantes.
Portrait du courtisan royal Jan Krzysztoporski (1518-1585) par Bernardino Licinio, 1541, palais de Kensington.
Portraits de Jan Krzysztoporski, Jan Turobińczyk et Wandula von Schaumberg par Hans Mielich
Vers 1536, un peintre allemand Hans Mielich (également Milich, Muelich ou Müelich), né à Munich, se rend à Ratisbonne, où il travaille sous l'influence d'Albrecht Altdorfer et de l'école du Danube. Il y resta jusqu'en 1540, date à laquelle il retourna à Munich. A cette époque, de 1539 à 1541, Ratisbonne fut un lieu de rencontres entre représentants des différentes communautés chrétiennes et de débats entre catholiques et protestants, culminant lors du Colloque de Ratisbonne, aussi appelé Diète de Ratisbonne (1541). Parmi les personnes vivement intéressées par les débats figuraient Jan Łaski (Johannes a Lasco, 1499-1560), un réformateur calviniste polonais, impliqué plus tard dans le projet de traduction de la Bible de Radziwill, qui étudia à Mayence à l'hiver 1539/40, et Wandula von Schaumberg (1482-1545), princesse-abbesse de l'abbaye impériale d'Obermünster à Ratisbonne de 1536, qui siège et vote à la Diète impériale. En 1536, Mielich a créé une peinture de la Crucifixion du Christ avec son monogramme, la date et les armoiries de la famille von Schaumberg, aujourd'hui au Landesmuseum de Hanovre, très probablement commandée par Wandula.
Un portrait d'une vieille femme riche en robe noire, bonnet blanc et guimpe par Hans Mielich au Museu Nacional d'Art de Catalunya à Barcelone, dépôt de la collection Thyssen-Bornemisza, provient de la collection d'un mystérieux comte J. S. Tryszkiewicz dans son château français de Birre. Aucune personne de ce type et aucun château de ce type ne sont confirmés dans les sources, mais le comte Jan Tyszkiewicz, décédé à Paris le 9 juin 1901, était propriétaire du château de Birzai en Lituanie et fils du célèbre collectionneur d'art, Michał Tyszkiewicz. La famille ainsi que le château étaient connus différemment dans les différentes langues de la nation multiculturelle, d'où l'erreur est justifiée. Avant la famille Tyszkiewicz, le château de Birzai était le siège principal de la branche calviniste de la famille Radziwill. Selon une inscription en allemand, la femme du tableau avait 57 ans en 1539 (MEINES ALTERS IM . 57 . IAR . / 1539 / HM), exactement comme Wandula von Schaumberg, qui comme les Radziwill était la princesse impériale. En 1541, l'artiste se rendit à Rome, probablement à l'instigation du duc Guillaume IV de Bavière. Il resta en Italie jusqu'en 1543 au moins et après son retour, le 11 juillet 1543, il fut admis à la guilde des peintres de Munich. Hans était un peintre de la cour du prochain duc, Albert V de Bavière et de sa femme Anne d'Autriche (1528-1590), fille d'Anne Jagellon (1503-1547) et sœur cadette d'Élisabeth d'Autriche (1526-1545), première épouse de Sigismond II Auguste. Albert et Anna se sont mariés le 4 juillet 1546 à Ratisbonne. En route pour Rome, Mielich s'arrêta très probablement à Padoue, où en 1541 Andreas Hertwig (1513-1575), membre d'une famille patricienne de Wrocław, obtint le diplôme de docteur utroque iure à l'âge de 28 ans. Hertwig commanda son portrait, aujourd'hui au Musée national de Varsovie. Le 10 décembre 1540, Jan Ocieski des armoiries de Jastrzębiec (1501-1563), secrétaire du roi Sigismond Ier partit en mission diplomatique depuis Cracovie en Italie. Il est possible qu'il ait été accompagné de Jan Turobińczyk (Joannes Turobinus, 1511-1575), spécialiste de Cicéron et d'Ovide, qui après des études à Cracovie en 1538 devint secrétaire de l'évêque de Płock et autre secrétaire du roi, Jakub Buczacki, et pendant deux ans, il a déménagé à la cour épiscopale de Pułtusk. Lorsque Buczacki mourut le 6 mai 1541, il perdit son protecteur et partit pour Cracovie, où il décida de poursuivre ses études. Jan a ensuite été ordonné prêtre vers 1545, il a enseigné le droit romain et il a été élu recteur de l'Académie de Cracovie en 1561. Un portrait d'un homme tenant des gants au Germanisches Nationalmuseum de Nuremberg ressemble beaucoup au portrait d'Andreas Hertwig à Varsovie. Selon l'inscription au dos, l'homme représenté est également Andreas Hertwig, d'où le portrait est attribué au soi-disant maître du portrait d'Andreas Hertwig. Les traits du visage, cependant, ne correspondent pas et selon l'inscription originale en latin, l'homme avait 30 ans le 8 mai 1541 (M D XXXXI / D VIII MAI / AETATIS XXX), exactement comme Jan Turobińczyk lorsque la nouvelle de la mort de son protecteur pouvait lui atteindre en Italie et qu'il pourrait décider de changer de vie et de reprendre des études. Un autre portrait similaire à l'effigie d'Andreas Hertwig à Varsovie est en collection privée. Le jeune homme vêtu d'un riche costume était représenté sur un fond vert. Selon l'inscription en latin, il avait 25 ans le 22 novembre 1543 (M. D. XLIII. DE. XX. NOVEMBE / .AETATIS. XXV), exactement comme Jan Krzysztoporski, qui à cette époque était encore en Italie. Les traits de son visage sont similaires au portrait de Bernardino Licinio créé à peine deux ans plus tôt, en 1541 (palais de Kensington). La différence de couleur des yeux est probablement due à la technique et au style de peinture. Les bagues à son doigt sont presque identiques sur les deux peintures et les armoiries sur la chevalière visible sur le portrait de 1543 sont très similaires aux armoiries de Nowina comme le montre l'Armorial de l'Europe et de la Toison d'or du XVe siècle (Bibliothèque nationale de France). Les lettres sur la chevalière peuvent être lues comme IK (Ioannes Krzysztoporski). Au début du XVIIe siècle, le peintre de la cour des Vasa polono-lituaniens était Christian Melich, qui, selon certaines sources, serait originaire d'Anvers. Ceci, cependant, n'exclut pas la possibilité qu'il était un parent de Hans Mielich. Il a créé l'une des plus anciennes vues de Varsovie, aujourd'hui à Munich, probablement de la dot d'Anne Catherine Constance Vasa.
Portrait de la princesse-abbesse Wandula von Schaumberg (1482-1545) âgée de 57 ans, du château de Radziwill à Birzai par Hans Mielich, 1539, Museu Nacional d'Art de Catalunya.
Portrait de Jan Turobińczyk (1511-1575) âgé de 30 ans par Hans Mielich, 1541, Germanisches Nationalmuseum de Nuremberg.
Portrait de Jan Krzysztoporski (1518-1585) âgé de 25 ans par Hans Mielich, 1543, Collection particulière.
Portraits de Françoise de Luxembourg-Ligny par Hans Besser et atelier de Lucas Cranach le Jeune
Les rues, les maisons, les temples, les bains publics et autres édifices de la Grèce antique et de Rome étaient pleins de statues, de fresques et de mosaïques montrant des dieux et des dirigeants nus. Sûrement dans de telles températures dans le sud de l'Europe, où Bona Sforza a grandi, il était plus facile de se déshabiller que de s'habiller. Plus au nord la situation était tout à fait opposée, pour se protéger du froid, les gens s'habillaient et pouvaient rarement voir de la nudité, donc devenaient plus prudes à cet égard. La Renaissance a redécouvert les statues et peintures nues de l'antique et aujourd'hui certaines émissions télévisées ont réinventé le concept qu'il est bon de voir un partenaire potentiel nu avant tout engagement, du moins pour certaines personnes.
En 1549, l'empereur Charles Quint (1500-1558) a commandé une statue en bronze de lui-même en tant que dieu ancien nu et l'armure amovible, afin que la statue puisse être habillée. La sculpture, réalisée à Milan par les sculpteurs italiens Leone et Pompeo Leoni, fut présentée à l'empereur à Bruxelles en 1556 puis transportée à Madrid, aujourd'hui au Musée du Prado (numéro d'inventaire E000273). En 1535, Françoise de Luxembourg-Ligny, fille du comte Charles Ier de Ligny et de Charlotte d'Estouteville, épouse Bernard III, margrave de Bade-Bade. Françoise était comtesse de Brienne et de Ligny et héritière du comté de Roussy. Elle avait environ 15 ans et le marié 61 ans au moment de leur mariage. Près d'un an après le mariage, elle donna à son mari un fils Philibert, né le 22 janvier 1536. Bernard mourut le 29 juin 1536 et leur deuxième fils Christophe naquit le 26 février 1537, à titre posthume. Les années suivantes furent remplies de disputes sur la garde des enfants, revendiquée par leur oncle Ernest, margrave de Bade-Durlach qui favorisait le luthéranisme et le duc Guillaume IV de Bavière, époux de la nièce de Bernard, Marie-Jacobée de Bade-Sponheim, un catholique fervent. En accord avec Françoise, son fils aîné Philibert passe une partie de sa jeunesse à la cour du duc Guillaume IV à Munich. Françoise se remarie le 19 avril 1543 avec le comte Adolf IV de Nassau-Idstein (1518-1556), plus de son âge, et elle lui donne trois enfants. En 1549, Hans Besser, peintre de la cour de Frédéric II, électeur palatin réalise une série de portraits des fils aînés de Françoise, Philibert et Christophe (à Munich, des collections des ducs de Bavière et à Vienne, de la collection des Habsbourg). En 1531, Frédéric de Palatin était candidat à la main de la princesse Hedwige Jagellon, il a dû recevoir son portrait, très probablement sous le « déguisement » populaire de Vénus et Cupidon. Un tableau montrant Vénus et Cupidon dans l'Alte Pinakothek de Munich d'environ 1540 est peint sous la forme typique des Vénus de Cranach. Son style, cependant, n'est pas typique de Cranach et de son atelier, c'est pourquoi ce tableau est également attribué à un copiste de Cranach du début du XVIIe siècle, Heinrich Bollandt. Le tableau a été acquis en 1812 au palais de Bayreuth. En 1541, un petit-fils de Sophie Jagellon, sœur du roi Sigismond Ier de Pologne, Albert Alcibiade, margrave de Brandebourg-Kulmbach reçoit Bayreuth. Il assista l'empereur Charles Quint dans sa guerre contre la France en 1543 mais abandonna bientôt Charles et rejoignit la ligue qui proposait de renverser l'empereur par une alliance avec le roi Henri II de France. Il passa les dernières années de sa vie à Pforzheim avec la famille de sa sœur Kunigunde, mariée à Charles II de Bade, neveu de Bernard III. Albert Alcibiade n'était pas marié, donc le mariage avec une margravine veuve de Bade et une femme noble française serait parfait pour lui. Une répétition légèrement différente et un peu plus petite du tableau à Munich a été vendue à Bruxelles le 7 novembre 2000. Une peinture similaire, du palais de Rastatt, a été découpée en morceaux avant 1772 et des fragments conservés se trouvent maintenant à la Staatliche Kunsthalle Karlsruhe (Vénus avec un diadème et Cupidon avec une flèche). Le palais de Rastatt a été construit entre 1700 et 1707 par un architecte italien pour le margrave Louis-Guillaume de Bade-Bade, descendant direct de Françoise de Luxembourg-Ligny. La même femme que dans les peintures mentionnées ci-dessus a également été représentée dans une série de portraits par l'atelier de Lucas Cranach le Jeune. Probablement tous la représentaient en Salomé et certains d'entre eux ont été coupés plus tard, afin que la partie supérieure puisse être vendue comme un portrait et la partie inférieure comme saint Jean-Baptiste. En se basant sur la tenue de la femme, ils devraient être datés de la fin des années 1530 ou du début des années 1540, mais l'un de ces portraits de l'ancienne collection du palais Friedenstein à Gotha, où se trouve une effigie d'Hedwige Jagellon en Vierge, est daté de 1549. Une copie de ce dernier tableau de la collection des ducs de Brunswick se trouve au musée Herzog Anton Ulrich. Le portrait maintenant à la Staatsgalerie à Aschaffenburg, provient de la collection d'art d'Hermann Goering et d'autre, vendu en 2012, faisait partie de la collection du prince Serge Koudacheff à Saint-Pétersbourg, avant 1902. Un autre, signé du monogramme HVK, figurait avant 1930 dans l'inventaire de Veste Coburg. Il existe également une version en Judith avec la tête d'Holopherne au Palais de Sanssouci à Potsdam et plusieurs tableaux où la femme était représentée dans la scène satirique du couple mal assorti, dont certains sont attribués à un autre copiste du XVIIe siècle de Cranach, Christian Richer. Les traits du visage de toutes ces effigies ressemblent beaucoup aux portraits des fils de Françoise de Luxembourg-Ligny par Hans Besser et stylistiquement certaines de ces œuvres sont très proches des portraits de ce peintre de cour.
Portrait de Françoise de Luxembourg-Ligny (décédée en 1566), margravine de Bade-Bade en Vénus et Cupidon par Hans Besser ou atelier de Lucas Cranach le Jeune, vers 1540, Alte Pinakothek à Munich.
Portrait de Françoise de Luxembourg-Ligny (décédée en 1566), margravine de Bade-Bade en Vénus avec un diadème par Hans Besser ou atelier de Lucas Cranach le Jeune, vers 1540, Staatliche Kunsthalle Karlsruhe.
Portrait de Françoise de Luxembourg-Ligny (décédée en 1566), margravine de Bade-Bade par l'atelier de Lucas Cranach le Jeune, 1535-1549, Staatsgalerie à Aschaffenburg.
Portrait de Françoise de Luxembourg-Ligny (décédée en 1566), margravine de Bade-Bade par l'atelier de Lucas Cranach le Jeune, 1535-1549, Collection particulière.
Portrait de Françoise de Luxembourg-Ligny (décédée en 1566), margravine de Bade-Bade par le monogramiste HVK, 1535-1549, Collection particulière.
Portrait de Françoise de Luxembourg-Ligny (décédée en 1566), margravine de Bade-Bade en Salomé par l'atelier de Lucas Cranach le Jeune, 1549, Palais Friedenstein à Gotha.
Couple mal assorti, caricature de Françoise de Luxembourg-Ligny (décédée en 1566), margravine de Bade-Bade et son mari par l'atelier de Lucas Cranach le Jeune ou Christian Richter, 1535-1566 ou début XVIIe siècle, Collection particulière.
Portraits de Barnim IX de Poméranie-Szczecin, sa femme et ses trois filles par Lucas Cranach l'Ancien, son fils et son atelier
En 1543, trois filles de Barnim IX, duc de Poméranie-Szczecin et de son épouse Anna de Brunswick-Lunebourg, Marie (1527-1554), Dorothée (1528-1558) et Anna (1531-1592), atteignirent l'âge légal du mariage (12). Cette même année, le 6 mai 1543, le jeune cousin de Barnim, le roi Sigismond Auguste de Pologne épousa Elisabeth d'Autriche (1526-1545).
Trois des sœurs de Sigismond Auguste, Sophie, Anna et Catherine, étaient également célibataires et l'oncle de Barnim, Sigismond I, espérait trouver un mari convenable pour chacune d'elles. En raison de la parenté des familles régnantes de Pologne-Lituanie et de Poméranie, elles ont sans doute échangé quelques effigies. Près d'un an plus tard, le 16 juillet 1544, Marie, la fille aînée de Barnim, épousa le comte Otto IV de Holstein-Schaumburg-Pineberg (1517-1576). Dorothée dut attendre dix ans de plus pour épouser le comte Jean Ier de Mansfeld-Hinterort (décédé en 1567) le 8 juillet 1554 et Anna se maria trois fois, d'abord avec le prince Charles Ier d'Anhalt-Zerbst (1534-1561) en 1557, puis au burgrave Henri VI de Plauen (1536-1572) en 1566 puis au comte Jobst II de Barby-Mühlingen (1544-1609) en 1576. Un petit tableau d'Hercule et Omphale de Lucas Cranach l'Ancien et de l'atelier du Musée national de Varsovie est très similaire au tableau de la collection Mielżyński de Poznań, montrant la famille de Sigismond Ier en 1537. Les dimensions (48,7 x 74,8 cm / 48 x 73 cm), la composition, même les poses et les costumes sont très similaires. Ce tableau a très probablement été transféré pendant la Seconde Guerre mondiale au dépôt d'art d'Allemagne nazie à Kamenz (Kamieniec Ząbkowicki), peut-être du musée des beaux-arts de Silésie à Wrocław. Vers 1543, le souverain de la ville voisine de Legnica était Frédéric II, comme Barnim, un fervent partisan de la Réforme et son parent éloigné. Les deux ducs avaient des liens étroits avec la Pologne-Lituanie voisine. Le fils cadet de Frédéric, Georges, futur Georges II de Legnica-Brzeg, n'était pas marié à cette époque. Il ne peut être exclu que la famille régnante de Legnica ait reçu ce portrait à la mode de la famille de Barnim sous les traits de héros mythologiques. L'œuvre correspond parfaitement à la maison régnante de Poméranie-Szczecin vers 1543 et les traits du visage d'Hercule et d'Omphale sont très similaires à d'autres portraits de Barnim IX et de sa femme. La peinture décrite ci-dessus est une version réduite d'une composition plus grande qui se trouvait dans la collection Stemmler à Cologne, maintenant dans une collection privée. Il est très similaire au portrait de la famille de Barnim en Hercule et Omphale de 1532 à Berlin (perdu). L'effigie de Marie de Poméranie-Szczecin avec un canard au-dessus d'elle, symbole de fidélité conjugale et d'intelligence, est presque identique à l'effigie de sa mère Anna de Brunswick-Lunebourg du tableau antérieur. L'ensemble de la composition est basé sur un dessin préparatoire conservé au Musée des estampes et des dessins de Berlin (Kupferstichkabinett, numéro d'inventaire 13712), signé d'un monogramme L.G., très probablement réalisé par l'élève de Cranach envoyé à Szczecin ou un peintre de la cour de Barnim. Toutes les filles de Barnim, y compris la plus jeune Sibylla, née en 1541, ont été représentées dans un grand tableau créé par Cornelius Krommeny en 1598 et montrant l'arbre généalogique de la Maison de Poméranie, aujourd'hui au Musée national de Szczecin. Un portrait d'une jeune femme en Salomé dans la couronne nuptiale sur sa tête au Musée des Beaux-Arts de Budapest, est presque identique à l'effigie de Marie de Poméranie-Szczecin dans les deux peintures mentionnées d'Hercule et Omphale. Ce portrait a été enregistré en 1770 dans le château de Bratislava, siège officiel des rois de Hongrie, puis transféré dans les collections impériales de Vienne. La même femme était représentée en Lucrèce dans la peinture de l'atelier de Lucas Cranach l'Ancien, qui était avant 1929 dans une collection privée à Amsterdam, aujourd'hui dans l'Alte Pinakothek à Munich et en Vénus avec Cupidon comme le voleur de miel de la collection des Princes du Liechtenstein à Vienne, aujourd'hui au Musée Kröller-Müller à Otterlo. Un portrait d'une dame en Judith en robe verte à la Galerie nationale d'Irlande à Dublin, acheté en 1879 de la collection de M. Cox à Londres, correspond parfaitement à l'effigie de Dorothée de Poméranie-Szczecin dans les peintures décrites. Sa pose et sa tenue sont très similaires à celles de la mère de Dorothée dans les deux peintures d'Hercule et d'Omphale. Deux représentations de Lucrèce attribuées à Lucas Cranach le Jeune, l'une provenant de la galerie Attems à Gorizia, aujourd'hui au palais Eggenberg à Graz et l'autre achetée en 1934 par le Kunstmuseum Basel, sont également très proches de l'effigie de Dorothée. Salomé avec la tête de saint Jean-Baptiste dans la couronne nuptiale, qui était autrefois dans la collection du roi de Wurtemberg, maintenant au Bob Jones University Museum and Gallery à Greenville est identique à l'effigie de la plus jeune fille de Barnim dans la peinture de Varsovie. Le peintre a évidemment utilisé le même dessin modèle pour créer les deux miniatures. Une autre Salomé très similaire, attribuée à Cranach le Jeune, provient de la collection du château d'Ambras construit par l'archiduc Ferdinand II d'Autriche (1529-1595), deuxième fils d'Anna Jagellon et de l'empereur Ferdinand Ier. Elle fut offerte en 1930 par Gustaf Werner au Musée d'art de Göteborg. Le peintre a ajouté un paysage fantastique en arrière-plan. Enfin, il y a une peinture de Vénus et Cupidon en tant que voleur de miel de la même période au Germanisches Nationalmuseum de Nuremberg, également attribuée à Cranach le Jeune. Le visage de Vénus est identique au portrait d'Anna de Poméranie-Szczecin dans le tableau de la collection Stemmler. Le tableau provient de la résidence des évêques catholiques de Freising, où il était connu sous le nom de sainte Julienne. Il ne peut être exclu qu'il ait appartenu à l'origine à la collection royale polono-lituanienne et qu'il ait été transféré à Neuburg an der Donau avec la collection de la princesse Anna Catherine Constance Vasa ou apporté en Bavière par une autre éminente dame polono-lituanienne. Au Musée national de Varsovie, il y a aussi une peinture montrant un sujet moralisateur du couple mal assorti par l'atelier de Lucas Cranach l'Ancien ou son fils du troisième quart du XVIe siècle. Le tableau a été acquis par le Musée en 1865 auprès de la collection d'Henryk Bahré. La femme a glissé sa main dans la bourse du vieil homme, ce qui ne laisse aucun doute sur le fondement de cette relation. Son visage et son costume sont basés sur le même ensemble de dessins modèles qui ont été utilisés pour créer des portraits d'Anna de Poméranie-Szczecin. Le tableau est de grande qualité, donc le mécène qui l'a commandé était riche. Alors que Georgia de Poméranie (1531-1573), fille de Georges Ier, frère de Barnim, épousa en 1563 un noble polonais et un luthérien, Stanisław Latalski (1535-1598), staroste d'Inowrocław et de Człuchów, sa cousine Anna opta pour le titre de princes allemands héréditaires dans ses mariages ultérieurs. Il est donc possible que ce tableau ait été commandé par la cour royale ou un magnat de Pologne-Lituanie.
Dessin préparatoire au portrait de Barnim IX de Poméranie-Szczecin, de sa femme et de ses trois filles en Hercule chez Omphale par le monogrammiste L.G. ou atelier de Lucas Cranach l'Ancien, vers 1543, Musée des Estampes et Dessins de Berlin.
Portrait de Barnim IX de Poméranie-Szczecin, sa femme et ses trois filles comme Hercule chez Omphale par Lucas Cranach l'Ancien et atelier, vers 1543, Collection privée.
Portrait de Barnim IX de Poméranie-Szczecin, sa femme et ses trois filles comme Hercule chez Omphale par Lucas Cranach l'Ancien et atelier, vers 1543, Musée national de Varsovie.
Portrait de Marie de Poméranie-Szczecin (1527-1554) en Salomé avec la tête de saint Jean Baptiste par Lucas Cranach l'Ancien, vers 1539-1543, Musée des Beaux-Arts de Budapest.
Paragraph. Kliknij tutaj, aby edytować.
Portrait de Marie de Poméranie-Szczecin (1527-1554) en Lucrèce par l'atelier de Lucas Cranach l'Ancien, vers 1543, Alte Pinakothek à Munich.
Portrait de Marie de Poméranie-Szczecin (1527-1554) en Vénus avec Cupidon en tant que voleur de miel par Lucas Cranach l'Ancien ou son fils, vers 1543, Musée Kröller-Müller à Otterlo.
Portrait de Dorothée de Poméranie-Szczecin (1528-1558) en Judith avec la tête d'Holopherne par l'atelier de Lucas Cranach l'Ancien, vers 1543-1550, Galerie nationale d'Irlande.
Portrait de Dorothée de Poméranie-Szczecin (1528-1558) en Lucrèce par Lucas Cranach le Jeune, vers 1543-1550, Palais d'Eggenberg à Graz.
Portrait de Dorothée de Poméranie-Szczecin (1528-1558) en Lucrèce par Lucas Cranach le Jeune, vers 1543-1550, Kunstmuseum Basel.
Portrait d'Anna de Poméranie-Szczecin (1531-1592) en Salomé avec la tête de saint Jean Baptiste par Lucas Cranach l'Ancien, vers 1543, Musée et galerie de l'Université Bob Jones à Greenville.
Portrait d'Anna de Poméranie-Szczecin (1531-1592) en Salomé avec la tête de saint Jean Baptiste par Lucas Cranach le Jeune, vers 1543-1550, Musée d'art de Göteborg.
Portrait d'Anna de Poméranie-Szczecin (1531-1592) en Vénus et Cupidon en tant que voleur de miel par Lucas Cranach le Jeune, vers 1543-1550, Germanisches Nationalmuseum.
Couple mal assorti, caricature d'Anna de Poméranie-Szczecin (1531-1592) par l'atelier de Lucas Cranach l'Ancien ou son fils, troisième quart du XVIe siècle, Musée national de Varsovie.
Portrait de Sigismond Auguste en armure par Giovanni Cariani
« Venez avec joie les pauvres gens et buvez gratuitement l'eau que Bona, reine de Pologne a fournie » (Pauperes sitientes venite cum laetitia et sine argento. Bibite aquas, quas Bona regina Poloniae preparavit) est l'inscription latine sur l'une des deux citernes qui est encore près de la cathédrale de Bari, l'autre, dont il n'y a plus de traces aujourd'hui, était située dans la zone de l'église de San Domenico et seule l'inscription est connue (Bona regina Poloniae preparavit piscinas. Pauperes sitientes venite cum laetitia et sine argento). La reine fut une grande bienfaitrice de cette ville archiépiscopale et, entre autres dons opportuns, multiplia les fontaines publiques. Depuis la Pologne, elle dirigea de nombreuses interventions dans son duché pour améliorer la vie et la prospérité des habitants, construisant des canaux, des puits, aidé les églises avec des dons.
Bona a également tenté d'étendre ses possessions en Italie. En 1536, elle acheta la ville de Capurso et en 1542, elle acheta également le comté de Noia et Triggiano. Pour atteindre le montant nécessaire à l'achat du comté (68 000 ducats), elle a imposé de nouvelles taxes, et à cette occasion la municipalité de Bari s'est plainte que Modugno près de Bari est « louée et aimée plus que cette ville (Bari) de V.M. (Votre Majesté) » (laudata e amata più di questa città (Bari) dalla M.V. (maestà vostra)). La reine se souciait beaucoup de ses principautés héréditaires de Bari et Rossano et voulait que son fils en hérite. Parmi les nombreux Italiens de la cour royale polono-lituanienne, beaucoup venaient de Bari. Dans les années 1530 et 1540, il y avait deux médecins de Bari à la cour - Giacomo Zofo (Jacobus Zophus Bariensis), qui s'appelait Sacrae Mtis phisicus en 1537, et Giacomo Ferdinando da Bari (Jacobus Ferdinandus Bariensis), qui publia deux traités à Cracovie (De foelici connubio serenissimi Ungariae regis Joannis et S. Isabellae Poloniae regis filiae, 1539 et De regimine a peste praeservativo tractatus, 1543). En 1537, il y avait aussi Scipio Scholaris Barensis Italus, secrétaire royal et prévôt de Sandomierz, Cleofa, sous-chanteur de la cathédrale Saint-Nicolas de Bari (Cleophas Succantor Ecclac S. Nicolai, Barensis) qui était le frère de Sigismondo, le chef royal, Teodoro de Capittelis et Sabino de Saracenis. Sur la recommandation de Bona, en 1545, l'avocat Vincenzo Massilla (ou Massilio, 1499-1580) élabora le code de droit coutumier de Bari (Commentarii super consuetudinibus praeclarae civitatis Bari) rédigé à Cracovie pendant les années de résidence à la cour polonaise et complété à Padoue, d'abord publié en 1550 par Giacomo Fabriano puis par Bernardino Basa à Venise en 1596. Massilla était un juriste bien connu et devint conseiller de la reine. En 1538, il occupa le poste de gouverneur de Rossano et s'installa à Cracovie en tant que vérificateur général des États féodaux détenus par Bona Sforza dans le sud de l'Italie. Elle a également demandé la permission de nommer les évêques de Bari et de Rossano, mais le pape a refusé. En 1543, la reine Bona revint à son projet de vente du duché de Rossano et à cette fin, le représentant de la ville de Rossano - Felice Brillo (Britio) vint en Pologne. Quelques années plus tard, le 30 août 1549, Luigi Zifando de Bari (Siphandus Loisius hortulanus Italus Barensis) fut admis comme jardinier royal. Plusieurs personnes de Modugno près de Bari étaient au service de la reine et plus tard de son fils Sigismond Auguste, comme Girolamo Cornale, mort à Varsovie, et les prêtres Vito Pascale et Scipione Scolaro ou Scolare (Scholaris) mentionné. Quand en Pologne, en 1550, Pascale se construit un palais à Modugno (Palazzo Pascale-Scarli), dont l'architecture est attribuée à l'influence de l'architecte florentin Bartolomeo Berecci travaillant en Pologne. La cour du fils de Bona Sigismond Auguste à Vilnius était également dominée par les Italiens, comme deux chanteurs de la reine, Erasmo et Silvester, l'incisor gemmarum Jacopo Caraglio, le pharmacien Floro Carbosto, le serrurier - Domenico, les bâtisseurs - Gasparus et Martinus, le sculpteur Bartholomeo, le musicien Sebaldus, harpiste Franciscus, gardien des étalons royaux italiens Marino, orfèvres: Antonio, Vincentino, Christoforus et Bartholomeo, tailleur Pietro et le maçon Benedictus. Le roi privilégiait le style italien dans sa tenue vestimentaire et il portait généralement un caftan court italien de soie noire ou un caftan allemand en tissu noir de Vicence par-dessus la chemise. La partie la plus chère de sa tenue était un bonnet de zibeline, un manteau germak en damas noir, doublé de fourrure de loir, et une épée italienne dorée, « un cadeau de Bari ». Parmi les meubles coûteux de son appartement de trois pièces dans le nouveau château de Vilnius se trouvaient des miroirs vénitiens - l'un d'eux dans des cadres précieux décorés de perles et d'argent. Le verre vénitien a été livré à la cour par les marchands de Vilnius, Morsztyn et Łojek (d'après « Zygmunt August : Wielki Książę Litwy do roku 1548 » de Ludwik Kolankowski, p. 329, 332). Dans la galerie Parmeggiani de Reggio Emilia (Musei Civici), il y a un « Portrait d'un guerrier », attribué à Giovanni Cariani, mort à Venise en 1547 (huile sur toile, 95 x 77 cm, numéro d'inventaire 76). Il provient de la collection de Luigi Francesco Giovanni Parmeggiani (1860-1945), anarchiste italien, faussaire, marchand d'art et collectionneur, qui avant d'inaugurer sa galerie en 1928 dans sa ville natale, a vécu principalement à Bruxelles, Londres et Paris. Le jeune homme tient sa main sur un casque. Son armure coûteuse indique qu'il est membre de l'aristocratie, un chevalier, et le paysage derrière lui représente sans aucun doute son château. Une seule tour est visible et une église à droite. Cette disposition et la forme des tours correspondent au château de Bari (Castello Normanno-Svevo, Ciastello) et à la cathédrale de Bari (Arciuescouato) vus de la « porte royale » (Porta Reale) et représentés dans une gravure du début du XVIIIe siècle par Michele Luigi Muzio (structures C, A et H). Le visage de l'homme rappelle beaucoup les images du jeune Sigismond Auguste, considéré à l'époque comme le successeur de sa mère dans le duché de Bari. Les peintures de l'école vénitienne sont parmi les plus précieuses liées à Bari ou à la région - Saint Pierre le Martyr de l'église Santa Maria la Nova à Monopoli de Giovanni Bellini, Vierge à l'Enfant sur un trône avec saint Henri d'Uppsala et saint Antoine de Padoue par Paris Bordone ou Vierge à l'enfant avec sainte Catherine d'Alexandrie et sainte Ursule avec un donateur de la famille Ardizzone de la cathédrale de Bari par Paolo Veronese (Pinacothèque métropolitaine de Bari).
Portrait de Sigismond II Auguste en armure contre la vue du château de Bari par Giovanni Cariani, ca. 1543, Galerie Parmeggiani à Reggio Emilia.
Portrait de Barbara Radziwill, Elisabeth d'Autriche et Sigismond Auguste en Flore, Junon et Jupiter par Paris Bordone
Ovide dans Fasti V raconte l'histoire de Junon, reine des dieux, agacée par son mari Jupiter pour avoir produit Minerve de sa propre tête par le coup de hache de Vulcain, se plaignit à Flore, déesse de la fertilité et des plantes en fleurs. Flora, lui offrit en secret une fleur, en touchant laquelle les femmes sont immédiatement devenues mères. C'est par ce moyen que Junon a donné naissance au dieu Mars. La Renaissance a représenté Flore sous deux aspects, Flore Primavera, incarnation de l'amour conjugal sincère, et Flore Meretrix, prostituée et courtisane qu'Hercule a gagnée pour une nuit dans un pari.
Parce que la mère d'Hercule était mortelle, Jupiter l'a mis au sein de sa femme, sachant qu'Hercule acquerrait l'immortalité grâce à son lait et selon le mythe, les gouttelettes de lait se cristallisaient pour former la Voie lactée. En tant que Junon Lucina (Junon la porteuse de lumière), elle veillait sur la grossesse, l'accouchement et les mères et en tant que Junon Regina (Junon la reine), elle était la déesse patronne de Rome et de l'Empire romain. La grande popularité des œuvres d'Ovide en Pologne-Lituanie-Ruthénie, poétiquement appelée Sarmatie, a laissé sa marque sur le caractère des décorations de nombreux bâtiments à travers le pays, y compris les résidences royales, qui étaient sans doute remplis de nombreux motifs ovidiens. Ceux créés après le déluge, dans les années 1680, conservés au palais de Wilanów et au pavillon de bains Lubomirski à Varsovie (d'après les gravures d'Abraham van Diepenbeeck). « Au XVIe siècle, les liens d'Ovide avec la Sarmatie ont donné naissance à la légende selon laquelle il aurait vécu en Pologne, aurait appris à parler la langue polonaise, serait mort et enterré près de la mer Noire, c'est-à-dire à l'intérieur des frontières de la République polono-lituanienne. On prétendait qu'Ovide était le premier poète polonais, et que sa « naturalisation » et la « découverte de sa tombe » ont façonné la conscience des classes dirigeantes et des élites de la République » (d'après « Ovidius inter Sarmatas » de Barbara Hryszko, p. 453, 455). Ses célèbres « Métamorphoses » traitaient de la transformation des êtres humains en d'autres entités et de la déification des descendants de Vénus, déesse de l'amour. Les œuvres latines d'Andrzej Krzycki (Andreas Cricius, 1482-1537), secrétaire de la reine Bona, s'inspirent ouvertement de l'œuvre d'Ovide et Piotr Wężyk Widawski dans sa paraphrase d'un fragment des « Métamorphoses » intitulé « Philomela [...] Sous la image de la déesse Vénus » (Philomela. Morale. To iest S. Ksiąg rozmáitych Autorow wykład obycżáyny. Pod Obraz Boginiey Wenery), publiée à Cracovie en 1586, « écrivait non seulement qu'Ovide était très populaire et largement connu en Pologne, mais il a également exprimé sa conviction qu'Ovide était venu en Pologne, où il avait appris la langue polonaise et était devenu Polonais ». Dans le tableau de Paris Bordone au musée de l'Ermitage (huile sur toile, 108 x 129 cm, numéro d'inventaire ГЭ-163), Flore reçoit des fleurs et des herbes de Cupidon, dieu du désir et de l'amour érotique et fils de Mars et de Vénus. Cupidon couronne également la tête de Junon avec une couronne. La reine des dieux prend les herbes de la main de Flora, espérant qu'elle n'a pas été remarquée par son mari Jupiter Dolichenus, le roi « oriental » des dieux tenant une hache, qui se tient derrière elle. Le tableau provient de la collection de Sir Robert Walpole à Houghton Hall, vendue à l'impératrice Catherine II de Russie en 1779. Le message du tableau est clair, grâce à la maîtresse la reine est féconde. Les protagonistes sont donc le roi « oriental » Sigismond Auguste en Jupiter, sa première épouse la reine Elisabeth d'Autriche, fille du roi des Romains en Junon, et la maîtresse de Sigismond Auguste Barbara Radziwill en Flore.
Portrait de Barbara Radziwill, Elisabeth d'Autriche et Sigismond Auguste en Flore, Junon et Jupiter par Paris Bordone, 1543-1551, Musée de l'Ermitage.
Portraits de Barbara Radziwill et de sa mère en Venus Pudica par Vincent Sellaer et l'entourage de Michiel Coxie
Avant 1550, le roi Sigismond Auguste commandait des tissus aux meilleurs ateliers de Bruxelles. Les tapisseries préservées de cette riche collection, aujourd'hui au château royal du Wawel et dans d'autres musées, représentent des histoires bibliques, un monde luxuriant de plantes et d'animaux exotiques, le monogramme du roi SA dans un riche décor Renaissance et les armoiries de la Pologne et la Lituanie. Les dessins des tapisseries figuratives ont été réalisés par le peintre flamand Michiel Coxie (1499-1592), « très célèbre parmi les artisans flamands » (molto fra gli artefici fiamminghi celebrato), selon Giorgio Vasari. Surnommé le Raphaël flamand, Coxie était le peintre de la cour de l'empereur Charles Quint et de son fils le roi Philippe II d'Espagne, bien qu'il ne se soit probablement jamais rendu en Espagne. Il s'inspire ou copie fréquemment des maîtres italiens comme Raphaël, Michel-Ange, Titien ou Sebastiano del Piombo, mais aussi de l'antiquité classique. Sa Chute morale de l'humanité (Enlèvement d'épouses humaines par les fils des dieux) avec une femme nue au centre de la composition, réalisée par l'atelier de Jan de Kempeneer entre 1548 et 1553 (Château Royal de Varsovie, ZKW/511), est le meilleur exemple.
Coxie était également un portraitiste renommé. Il réalise l'effigie de Christine de Danemark (Allen Memorial Art Museum, numéro d'inventaire 1953.270) et son autoportrait en saint Georges, portant la même armure que l'empereur Charles Quint lors de la bataille de Mühlberg en 1548 dans un tableau du Titien (Musée du Prado, P00410, remarqué par Roel Renmans, Flickr, 23 février 2015), dans l'aile gauche du triptyque de saint Georges (Musée Royal des Beaux-Arts, Anvers, 373). Il a probablement également créé une copie du portrait équestre de l'empereur mentionné par Titien. Au Musée national de Varsovie se trouve une intrigante peinture représentant une femme nue, réalisée par l'entourage de Michiel Coxie, peut-être son atelier (huile sur panneau, 60 x 49 cm, M.Ob.2158 MNW). Le style de cette œuvre est le même que celui du portrait de la reine Barbara Radziwill en Madone à l'Enfant endormi vendu en 2020 (huile sur panneau, 95 x 76 cm, Sotheby's Londres, 23 septembre 2020, lot 33). Le visage est également le même, comme si le peintre utilisait le même ensemble de dessins d’étude pour créer les deux œuvres. On dit qu'il représente sainte Marie-Madeleine pénitente, car dans certaines copies, la femme était représentée avec l'attribut typique de cette sainte - une boîte d'onguent en albâtre (Wadsworth Atheneum Museum of Art). Le tableau a été acquis avant 1979. Certains exemplaires sont attribués à Bernaert de Ryckere (collection particulière, 70 x 50 cm) ou, plus idéalisé, à l'école florentine (collection particulière, 62 x 52 cm). La version conservée au Louvre, acquise auprès d'une collection inconnue à Nice en 1946 (huile sur panneau, 73 x 55 cm, RF 1946 9), est attribuée au peintre flamand. La figure féminine dans les peintures est interprétée différemment comme Marie-Madeleine, Bethsabée, Lucrèce ou Cléopâtre. Dans certains cas, cela est soutenu par les attributs correspondants, mais dans d'autres cas, la figure apparaît sans autres objets explicatifs. Les recherches attribuent généralement les œuvres à Frans Floris, Michiel Coxie ou Vincent Sellaer et leurs ateliers. Il est possible que l'original ait été réalisé par un peintre italien ou plus précisément vénitien, car les peintres flamands ont copié ou se sont inspirés de leurs œuvres. Une copie de l'Allégorie de l'Amour (Femme nue et homme avec des miroirs) par l'atelier du Titien (original à National Gallery of Art, Washington), identifiée comme portraits déguisés d'Alphonse Ier d'Este et Laura Dianti ou Frédéric II de Gonzague et Isabella Boschetti, vendue en 1992, est attribué à Michiel Coxie (Dorotheum à Vienne, 18 mars 1992, lot 64). Une composition de miroir très similaire a été vendue à Berlin en 2020 (huile sur panneau, 45,5 x 32 cm, Galerie Bassenge, 26 novembre 2020, lot 6003). Mais le visage de la femme est différent. Elle est également beaucoup plus âgée que la femme du tableau de Varsovie. Il n’y a aucun attribut, c’est pourquoi l’image est interprétée comme une représentation de Vénus – une Vénus vieillissante dans la posture de la chaste Vénus Pudica. Cela signifierait finalement que l’œuvre pourrait être interprétée comme une allégorie cachée de la vanité. Il est difficile aujourd’hui de déterminer quelle version pourrait être originale, mais en supposant que les deux peintres aient créé des copies de la même composition, nous devrions conclure que les peintures représentent une mère et une fille. La jeune femme du tableau de Varsovie regarde sa mère, qui à son tour regarde le spectateur. La femme aînée est donc la mère de la reine Barbara et elle ressemble aux effigies de Barbara Kolanka (décédée en 1550) par Lucas Cranach l'Ancien. De telles représentations étaient populaires au milieu du XVIe siècle et souvent une ressemblance générale et un contexte suffisent à déterminer le modèle, comme dans le cas du portrait de Diane de Poitiers (1499-1566), favorite du roi Henri II de France, en Pax, déesse de la paix (Allégorie de la Paix), à moitié nue, par Ecole de Fontainebleau (Musée National du Bargello à Florence). D'autres exemples incluent plusieurs portraits nus « déguisés » d'Agnolo Bronzino, comme le portrait de Cosme I de Médicis (1519-1574), grand-duc de Toscane en Orphée (Philadelphia Museum of Art), le portrait d'Andrea Doria (1466-1560) en Neptune (Pinacothèque de Brera à Milan), la Descente du Christ dans les limbes avec plusieurs portraits contemporains (Basilique Santa Croce à Florence) et portrait du cardinal Jean de Médicis le Jeune (1543-1562), âgé de seize ans, en saint Jean-Baptiste (Galerie Borghèse à Rome). Depuis le XVIIe siècle, de nombreux tableaux de la collection Radziwill ont été transférés à Berlin par différents moyens. L'inventaire des peintures de la collection de la princesse Louise Charlotte Radziwill (1667-1695), qui vécut à Berlin, Königsberg et Heidelberg, dressé en 1671, recense de nombreuses représentations de ce type, comme un grand panneau représentant une femme nue (794 ) et plusieurs effigies de sainte Marie-Madeleine (357, 369, 531, 792, 855, 867) (d'après « Inwentarz galerii obrazów Radziwiłłów z XVII w. » de Teresa Sulerzyska). Dans le contexte des commentaires connus sur Barbara Radziwill et sa mère, bien que probablement exagérés, ces effigies semblent également exactes. Stanisław Orzechowski, a écrit que Sigismond Auguste « veut chercher sa force et son courage auprès de son épouse au service de Vénus » et a déclaré, entre autres, que Barbara « avait une mère dont on disait toujours du mal à cause de sa luxure, de son impudeur, empoisonnement et sorcellerie » et le courtisan royal Stanisław Bojanowski a ajouté que Barbara « a continué à se rougir le visage pour nous tromper jusqu'à [son] dernier souffle », même lorsqu'il était clair que la maladie ne pouvait pas être guérie (après « Nieprzyzwoite małżeństwo » par Anna Odrzywolska, p. 69).
Portrait de Barbara Kolanka en Vénus Pudica par Vincent Sellaer, vers 1545-1550, Collection particulière.
Portrait de Barbara Radziwill en Vénus Pudica par le cercle de Michiel Coxie, vers 1545-1550, Musée National de Varsovie.
Jugement de Pâris avec des portraits d'Hedwige Jagellon et des membres de sa famille par l'atelier Lucas Cranach l'Ancien ou Lucas Cranach le Jeune
Le 15 février 1545, le double mariage fut célébré avec une grande splendeur à Berlin. La princesse Sophie de Legnica (1525-1546), la fille de Frédéric II (1480-1547), duc de Legnica, Brzeg et Wołów, et sa seconde épouse, Sophie de Brandebourg-Ansbach (1485-1537), épousa Jean-Georges de Brandebourg (1525-1598), fils de Magdalena de Saxe (1507-1534) et de Joachim II Hector (1505-1571), électeur de Brandebourg, tandis que la sœur de Jean-Georges, Barbara (1527-1595), épousa Georges (1523- 1586), frère de Sophie de Legnica. Le mariage cimenta l'alliance des Piast silésiens et des Hohenzollern conclue le 18 octobre 1537 à Legnica avec les fiançailles des enfants princiers.
Les deux épouses, Sophie (petite-fille de Sophie Jagellon, margravine de Brandebourg-Ansbach) et Barbara (petite-fille de Barbara Jagellon, duchesse de Saxe), et l'électrice de Brandebourg - Hedwige Jagellon (1513-1573) étaient liées. Hedwige était la seconde épouse de Joachim II Hector et ils eurent six enfants - leur premier fils, Sigismond (1538-1566), futur évêque de Magdeburg et Halberstadt, fut nommé d'après le père d'Hedwige. Après que Joachim II a introduit la foi évangélique dans l'électorat, l'électrice est restée catholique. Au début de 1551 (selon d'autres sources à l'automne 1549), Joachim II et Hedwige se sont rendus dans la forêt de Schorfheide près de Berlin pour une chasse au sanglier. Le couple électoral vivait au pavillon de chasse de Grimnitz. Le 7 janvier 1551, alors qu'ils allaient se promener à l'étage supérieur le matin, le sol pourri s'effondra sous eux et Hedwige tomba dans la pièce du dessous. Elle aurait refusé un traitement médical par pudeur. Bien que l'électrice se soit rétablie, son bassin, ses pieds et ses hanches étaient si gravement blessés qu'elle a dû utiliser des béquilles pour le reste de sa vie. Joachim, qui pendait entre deux poutres sur lesquelles il s'appuyait des mains et des bras, fut sauvé de la chute par un serviteur. Il est devenu dégoûté de sa femme estropiée et il a pris des concubines. L'électrice se réconcilie avec son mari neuf ans plus tard, en 1560, lorsque la célébration des noces d'argent coïncide avec le mariage de leur seconde fille, Hedwige (1540-1602), avec Jules de Brunswick-Lunebourg (1528-1589), beau-fils de Sophie Jagellon (1522-1575), duchesse de Brunswick. Au lieu de la compassion chrétienne, des gens méchants répandaient des rumeurs sur la punition de Dieu, parce que l'électrice était catholique et étrangère, ne parlant pas allemand (du moins au début). Le frère cadet de l'électeur, le margrave Hans von Küstrin (1513-1571), un fervent luthérien, a même affirmé que ce terrible accident s'était produit après deux images de la Vierge Marie en or ou en argent provenant du trésor de la cathédrale de Berlin (peut-être des icônes ruthènes ou byzantines de la Vierge Hodegetria) ont été amenés à Hedwige et elle et ses dames de la cour sont tombées avec les images. Il décrit l'accident dans une lettre à Andrzej I Górka (1500-1551), châtelain de Poznań, qui se trouvait dans les archives de la famille royale prussienne à Berlin (d'après « Jagiellonki polskie w XVI wieku », tome 3, p. 282). Il ajouta également que « le sol n'était ni pourri ni abîmé nulle part, pas même là où il s'était effondré » et que « deux ou trois jours avant l'accident, une grande lumière apparut dans le ciel au-dessus de la maison de Grimnitz » (Es ist aber sonsten der Boden an diesem gebew an keinem ort verstockt, verfault und schadhafft gewesen, auch an den enden nicht do er eingangen. Item ein zwen oder drey tage zuvor, ehe denn diese Ding gescheen, bey der nacht, hatt sich ueber dem hause Grimnitz, so weit sich allein desselben Vmbkreiss erstreckt, ein grosser luchter glanz um Himmell erhoben). Selon une autre légende, il ne s'agissait pas d'un accident mais d'un attentat à la vie de l'électeur préparé par l'amant d'Hedwige, un noble polonais, invité du couple princier. Il avait scié les lattes du parquet afin d'éliminer son rival. Pris de remords après un résultat inattendu de son action, il devient ermite (d'après « Allgemeine Encyklopädie der Wissenschaften und Künste » de 1871, tome 1, numéro 91, p. 352). À Grimnitz, Joachim II rencontra la belle épouse du maître fondeur d'armes et de cloches, qui était donc connue sous le nom de « belle fondeuse » (Die Schöne Gießerin), Anna Dieterich née Sydow, et en fit sa maîtresse. Son mari, Michael Dieterich, décédé en 1561, fut le dernier gérant de la fonderie électorale de Grimnitz. Anna Sydow a vécu de nombreuses années dans le pavillon de chasse de Grunewald, que Joachim a construit en 1542-1543, et lui a donné deux enfants. L'affaire avec elle aurait commencé après l'accident, bien qu'il n'y ait aucune preuve claire de cela, ils pourraient donc se rencontrer beaucoup plus tôt. On sait très peu de choses sur la vie d'Hedwige. En tant que polonaise-lituanienne, femme et catholique, elle n'était pas très estimée dans l'historiographie du Brandebourg. Elle accompagna son mari aux Diètes d'Empire - en 1541 à Ratisbonne et en 1547 à Augsbourg. Elle correspondait avec sa demi-sœur Isabelle, reine de Hongrie et son demi-frère Sigismond Auguste. Dans une lettre datée de Varsovie, le 17 septembre 1571 (aujourd'hui au château royal de Wawel), écrite à l'encre avec des particules d'or, Sigismond Auguste l'appelait « l'Infante du Royaume de Pologne, marquise de Brandebourg » (Illvstrissimæ Principi dominæ Heduigi, Dei gratia Infanti Regni Poloniæ Marchionisæ Brandemburgensi ...). Dans son dernier portrait connu, elle est très obèse, un peu plus que son mari, probablement à cause de la difficulté à marcher. Il a été créé en 1562 par le peintre italien Giovanni Battista Perini (Parine) en contrepartie du portrait de Joachim II (Musée de la ville de Berlin, VII 60/642x), cependant, il est connu d'une copie ultérieure réalisée en 1620 par Heinrich Bollandt (Palais de Berlin, Berliner Schloss), qui a été perdu pendant la Seconde Guerre mondiale. Quant aux épouses du double mariage de 1545, Sophie de Legnica décède quelques jours après la naissance de son fils Joachim Frédéric (1546-1608), successeur de son père comme électeur de Brandebourg. Barbara devint duchesse de Brzeg en 1547. Elle donna à son mari sept enfants, cinq filles et deux fils, et lorsque Georges II mourut en 1586, après quarante et un ans de mariage, il laissa le duché de Brzeg à sa femme comme douaire avec la pleine souveraineté sur cette terre jusqu'à sa propre mort. La fascination de Georges II pour la cour à l'italienne des Jagellons se reflète dans l'architecture du « Wawel silésien » - le château de Piast à Brzeg. La cour à arcades du château a été construite entre 1547 et 1560 par Giovanni Battista de Pario et son fils Francesco, tandis que la porte principale était ornée d'effigies de Piasts silésiens. Les sculpteurs Andreas Walther et Jakob Warter ont créé des bustes des ancêtres de Georges II et les armoiries du Royaume de Pologne qui couronnent la porte - bien que Georges II ait été un vassal des Habsbourg, il s'est opposé à leur politique absolutiste en Silésie. Ils ont également sculpté les effigies en pied du duc et de sa femme au-dessus du portail (1551-1553). Les tapisseries que Georges et Barbara ont commandées entre 1567 et 1586 ressemblent aux célèbres tapisseries jagellonnes (arras du Wawel) et indiquent que dans le domaine des arts et du mécénat, presque tout à Brzeg était comme à Cracovie. Dans le pavillon de chasse Grunewald à Berlin se trouve un grand tableau de l'atelier Lucas Cranach l'Ancien ou Lucas Cranach le Jeune, représentant le Jugement de Pâris (huile sur panneau, 209,5 x 107,2 cm, GK I 1185). Il est similaire aux portraits allégoriques des ducs de Legnica-Brzeg, Ziębice-Oleśnica et Lubin dans la scène du Jugement de Pâris des années 1520, identifié par moi, cependant, il a été créé beaucoup plus tard - daté de manière variable entre 1540-1545. Le tableau est l'un des quatre panneaux, qui appartenaient à l'électeur Joachim II et se trouvaient en 1793 au palais de Berlin. La femme au centre de la composition est la déesse Vénus, la plus belle des déesses que Pâris jugera. Elle regarde le spectateur. Il s'agit sans aucun doute d'un « portrait déguisé » d'une femme, qui, très probablement, a commandé ce tableau. Elle sait parfaitement qui va gagner ce concours, cependant elle met la main sur l'armure d'un homme dépeint comme Pâris comme pour dire stop, tu devrais suivre ton cœur et choisir quelqu'un d'autre. Le vieil homme derrière elle représente Mercure, un messager des dieux. Il lève son bâton avec lequel il frappe Pâris sur la poitrine, l'avertissant de la séduction féminine par un grand cri et l'exhortant à prendre une décision prudente. Cupidon, dieu de l'affection et du désir, pointe sa flèche vers la jeune femme près de Mercure. Vénus dans ce tableau a les traits de l'électrice Hedwige Jagellon, comme dans le tableau de Hans Krell de la même collection ou dans de nombreux tableaux de Lucas Cranach l'Ancien et de son atelier. Par conséquent, Mercure est le duc Frédéric II de Legnica-Brzeg, qui dans les peintures antérieures était représenté comme Pâris, la deuxième déesse est sa fille Sophie de Legnica et Pâris est son mari Jean-Georges de Brandebourg - ses traits correspondent à son effigie par Lucas Cranach le Jeune à Dresde (Gemäldegalerie Alte Meister, numéro d'inventaire 1949). La troisième déesse est Barbara de Brandebourg, la sœur de Jean-Georges et future duchesse de Brzeg. Ce tableau est donc une commémoration du double mariage et de l'alliance avec les Piast de Silésie. Jugement de Pâris similaire par suiveur de Lucas Cranach l'Ancien se trouvait également à Berlin (huile sur panneau, 50,5 x 34 cm, collection privée avant 2009), cependant, seule Hedwige est identifiable à droite. Les autres personnes sont différents. Pâris regarde Vénus-Hedwige et une autre femme tient sa main sur son bras et pointe vers son cœur, tandis que Cupidon pointe sa flèche vers son cœur. Il s'agit donc très probablement du mari d'Hedwige, l'électeur Joachim II et de sa nouvelle maîtresse et le tableau a été commandé pour sanctionner cette nouvelle relation. La troisième femme de la scène est très probablement Sophie de Legnica, car une effigie très similaire peut être vue dans un autre grand panneau de la série mentionnée du palais de Berlin. Elle tient les chaussures de Bethsabée dans la scène de Bethsabée au bain (huile sur panneau, 208 x 106 cm, GK I 1186), semblable au tableau de Cranach de 1526, très probablement de la dot d'Hedwige, représentant son père Sigismond I, sa femme Bona et sa maîtresse Katarzyna Telniczanka dans la même scène (Gemäldegalerie à Berlin). Bethsabée pourrait donc être un portrait de la maîtresse de Joachim - Anna Sydow, alors qu'il était dépeint comme le roi biblique David. Barbara de Brandebourg a également été représentée dans un autre tableau de Cranach. Lucrèce de la collection de Hans Grisebach à Berlin, attribuée à Lucas Cranach l'Ancien ou à son fils Cranach le Jeune, a ses traits, semblables au tableau du palais de Berlin et à sa statue du château de Brzeg. Le tableau a été inspiré par l'image iconique de Bona Sforza, reine de Pologne créée une décennie plus tôt, qui a été saluée par Andrzej Krzycki (1482-1537), archevêque de Gniezno dans son épigramme « Sur Lucrèce représentée plus lascivement » (In Lucretiam lascivius depictam). Aussi dans le domaine du portrait, les ducs de Legnica-Brzeg s'inspirent fortement de la cour royale polonaise. Le protestantisme s'opposait à une telle « lascivité », donc très probablement dans la seconde moitié du XVIe siècle, comme l'indique le style, elle était habillée. Cette surpeinture (robe) a été retirée après 1974.
Jugement de Pâris avec des portraits d'Hedwige Jagellon (1513-1573), Sophie de Legnica (1525-1546), Barbara de Brandebourg (1527-1595), Frédéric II de Legnica-Brzeg (1480-1547) et Jean-Georges de Brandebourg (1525 -1598) par l'atelier Lucas Cranach l'Ancien ou Lucas Cranach le Jeune, vers 1545, pavillon de chasse de Grunewald.
Jugement de Pâris avec des portraits d'Hedwige Jagellon (1513-1573) et des membres de sa famille par un suiveur de Lucas Cranach l'Ancien, vers 1545-1550, collection particulière.
Bethsabée au bain avec des portraits de Sophie de Legnica (1525-1546), Joachim II Hector (1505-1571) et, très probablement, Anna Sydow par l'atelier de Lucas Cranach l'Ancien ou Lucas Cranach le Jeune, vers 1545-1550, pavillon de chasse de Grunewald.
Portrait de Barbara de Brandebourg (1527-1595), duchesse de Brzeg en Lucrèce par l'atelier Lucas Cranach l'Ancien ou Lucas Cranach le Jeune, vers 1545-1550, collection particulière.
Portrait de l'électrice Hedwige Jagellon (1513-1573) par Heinrich Bollandt d'après Giovanni Battista Perini, 1620 d'après l'original de 1562, palais de Berlin, perdu pendant la Seconde Guerre mondiale. Reconstitution virtuelle, © Marcin Latka
Portrait de Stanisław Orzechowski par Giovanni Cariani
« Ma patrie est la Ruthénie, située sur le fleuve Tyras, que les habitants de la zone côtière appellent le Dniestr, au pied des montagnes des Carpates, dont la chaîne sépare la Sarmatie de la Hongrie », commence son autobiographie Stanisław Orzechowski ou Stanislaus Orichovius (1513-1566), un noble des armoiries d'Oksza. Il écrivit ces paroles en 1564 à la demande de Giovanni Francesco Commendone (1523-1584), évêque vénitien et légat du pape en Pologne (lettre du 10 décembre 1564 de Radymno). Dans une lettre du 15 août 1549 de Przemyśl (Datae Premisliae, oppido Russiae, die Assumptionis beatae Virginis, anno Christi Dei nostri 1549) à Paolo Ramusio (Paulus Rhamnusius), secrétaire du Conseil des Dix à Venise, il ajoute que « mon pays, dur et grossier, qui a toujours adoré Mars, mais n'a commencé que récemment à adorer Minerve. Car la Ruthénie auparavant ne différait pas beaucoup par la lignée et les coutumes des Scythes avec lesquels elle borde, cependant, ayant des relations avec les Grecs, dont elle a adopté la confession et la foi, elle a abandonné sa dureté et sa sauvagerie scythe, et maintenant elle est douce, calme et fertile, elle aime beaucoup la littérature latine et grecque » (d'après « Orichoviana ... » de Józef Korzeniowski, tome 1, pages 281, 587).
Formé aux universités de Cracovie (1526), Vienne (1527), Wittenberg (1529), Padoue (1532), Bologne (1540) et poursuivant ses études à Rome et Venise, Orzechowski était un représentant typique de la diversité polono-lituanienne. Il est né le 11 novembre 1513 à Przemyśl ou à proximité d'Orzechowce. Stanisław était très fier de ses origines ruthènes et se décrivait comme gente Roxolani, natione vero Poloni (d'origine ruthène/roxolanienne, nationalité polonaise), cependant, il écrivait principalement en latin. Le 5 juillet 1525, à l'âge de 12 ans, il est ordonné prêtre catholique et devient chanoine de Przemyśl. En 1543, peu de temps après son retour en Pologne, il fut excommunié par l'évêque Stanisław Tarło pour avoir de nombreux bénéfices incompatibles et pour son absence au synode diocésain. Quelques années plus tard, en 1547, le nouvel évêque de Przemyśl, Jan Dziaduski, accuse Orzechowski, qui a eu une progéniture avec sa concubine Anna Zaparcianka (Anuchna z Brzozowa), de mener une vie scandaleuse. En 1550, Stanisław organisa un mariage pour un prêtre catholique Marcin Krowicki et Magdalena Pobiedzińska à Urzejowice. Un an plus tard, en 1551, il se maria lui-même à Lścin avec une noble de 16 ans, Magdalena Chełmska, pour laquelle l'évêque Dziaduski excommunia Orzechowski. Il correspondait fréquemment avec le roi Sigismond Auguste, Nicolas « le Noir » Radziwill, Jan Amor Tarnowski et son fils Jan Krzysztof, Piotr Kmita, Jakub Uchański et écrivit des lettres au cardinal Alessandro Farnese (lettres datées du 1er mai 1549 et du 15 janvier 1566 de Przemyśl), le pape Jules III (lettre du 11 mai 1551 de Przemyśl) et le roi Ferdinand (lettre du 7 septembre 1553 de Cracovie). Le discours d'Orzechowski aux funérailles du roi Sigismond I fut publié à Cracovie en 1548 (Funebris oratio: habita a Stanislao Orichovio ...) puis la même année à Venise avec les armoiries de la reine Bona Sforza sur la page de titre (Stanilai Orichouii Rhuteni Ornata et copiosa oratio ...), imprimé par Paolo Ramusio et réédité en 1559 également à Venise, dans la collection Orationes clarorum virorum. Dans une lettre de Venise de 1548, Ramusio demanda à Orzechowski de lui envoyer ses autres œuvres par l'intermédiaire du secrétaire de Bona, Vitto Paschalis (Reverendi Domini Vitti Paschalis Serenissimae Reginae Bonae a secretis). Aucune effigie d'Orzechowski réalisée de son vivant n'est connue. Le portrait publié dans Starożytności Galicyjskie à Lviv en 1840 (lithographie de Teofil Żychowicz) représente un homme en costume du milieu du XVIIe siècle, donc près d'un siècle après sa mort (1566). En 2022 un portrait d'un homme barbu tenant sa main droite sur un casque et la main gauche sur une épée, attribué au cercle de Titien, a été vendu à Paris (huile sur toile, 94 x 75 cm, Hôtel Drouot, 17 juin 2022, lot 18). Le tableau provient de la collection d'Achille Chiesa à Milan (vendu aux American Art Galleries de New York, 22-23 novembre 1927, lot 117, comme le portrait d'un guerrier) et déjà en 1927 il n'était pas en très bon état de conservation. En haut à droite se trouve le nom du personnage représenté par le portrait, mais malheureusement plus lisible. Son visage a été légèrement modifié lors de la restauration, cependant, le style du portrait, en particulier la façon dont les mains ont été peintes, permet d'attribuer le tableau à Giovanni Cariani (décédé en 1547), également connu sous le nom de Giovanni Busi ou Il Cariani, actif à Venise et à Bergame près de Milan. D'après les dates latines visibles sur certaines reproductions anciennes, l'homme avait 32 ans en 1545 (ÆTAT SVÆ ANNO / XXXII / MD.XLV), exactement comme Stanisław Orzechowski, qui un an plus tôt, en 1544, publiait à Cracovie ses deux importantes œuvres - le « Baptême des Ruthènes. Bulle sur le non-rebaptême des Ruthènes » (Baptismus Ruthenorum. Bulla de non rebaptisandis Ruthenis) et Ad Sigismundum Poloniae Regem Turcica Secunda appelant à la solidarité de l'Europe chrétienne contre l'Empire ottoman. En 1545, Orzechowski a été accusé d'avoir battu à mort un sujet de l'évêque Dziaduski de Przysieczna et le noble du tableau a une pose comme s'il était prêt à se défendre par tous les moyens. Son casque, bien que ressemblant généralement à certains burgonets de la Renaissance, est très inhabituel, et l'analogie la plus proche peut être trouvée avec les casques découverts dans les tumulus scythes (comparer « The Scythians 700–300 BC » par E.V. Cernenko). L'homme le tient car il a probablement été trouvé près de son lieu d'origine, c'est donc un précieux souvenir des anciens habitants de cette terre et un symbole important.
Portrait de Stanisław Orzechowski (1513-1566), âgé de 32 ans par Giovanni Cariani, 1545, Collection particulière.
Portrait de Stanisław Karnkowski par Jacopo Tintoretto
Stanisław Karnkowski des armoiries de Junosza est né le 10 mai 1520 à Karnkowo près de Włocławek, en tant que fils de Tadeusz vel Dadźbog, héritier de Karnków et Elżbieta Olszewska de Kanigów. Jeune homme, il quitta la maison familiale et se rendit chez son oncle, l'évêque de Włocławek, Jan Karnkowski (1472-1537). C'est à lui qui doit Karnkowski sa première éducation.
En 1539, il entreprend des études à l'Académie de Cracovie. Après avoir obtenu son diplôme, en 1545, il se rendit en Italie pour poursuivre ses études - d'abord à Pérouse, puis à Padoue, où il termina ses études avec un doctorat utriusque iuris. Il a également étudié à Wittenberg, où il s'est familiarisé avec les enseignements de Luther. De retour des études en 1550, il devient secrétaire de l'évêque de Chełmno puis de Jan Drohojowski, évêque de Włocławek. En 1555, il devint secrétaire du roi Sigismond Auguste, à partir de 1558, il fut grand référendaire de la couronne et en 1563, il devint grand secrétaire, puis évêque de Cujavie à partir de 1567, archevêque de Gniezno et primat de Pologne à partir de 1581. Il servit comme régent de la République polono-lituanienne (Interrex) en 1586-1587, après la mort du roi Étienne Bathory. Karnkowski a constitué l'une des bibliothèques polonaises les plus riches à la fin du XVIe et au début du XVIIe siècle, comprenant selon certaines estimations 322 livres, dont certains acquis au cours de ses études à l'étranger, comme Consilia Ludouici Romani de Lodovico Pontano, publié en 1545 (Archives de l'archidiocèse de Gniezno). Le portrait d'un jeune homme en costume noir boutonné à un col haut et tenant son avant-bras droit sur une base de colonne, a été enregistré pour la première fois dans le Grand Cabinet du palais de Kensington en 1720 comme une oeuvre de Titien. On pense maintenant qu'il s'agit de la première œuvre datée du Tintoret. Selon une inscription en latin sur un socle de colonne, l'homme avait 25 ans en 1545 (AN XXV / 1545), exactement comme Stanisław Karnkowski, lorsqu'il commença ses études en Italie. Il ressemble beaucoup à Karnkowski de son portrait comme évêque de Włocławek, réalisé entre 1567-1570 par un peintre inconnu (Séminaire supérieur de Włocławek), et comme le primat de Pologne en soutane verte (Palais de l'archevêque de Gniezno), peint en 1600 par le monogrammiste I.S. Dans une collection privée en Suisse, il existe une copie réduite de cette effigie également attribuée à Jacopo Tintoretto.
Portrait de Stanisław Karnkowski (1520-1603), âgé de 25 ans par Jacopo Tintoretto, 1545, Kensington Palace.
Portrait de Stanisław Karnkowski (1520-1603), âgé de 25 ans par Jacopo Tintoretto, vers 1545, Collection privée.
Portraits de Stanisław Spytek Tarnowski par le Tintoret
« Stanislas comte de Tarnów, homme des plus parfaits dons d'esprit, de corps et de fortune, né dans la première famille noble, ayant parcouru la Hongrie, la Mésie, la Macédoine, la Grèce, la Syrie, la Judée, l'Arabie, l'Égypte, l'Italie et l'Allemagne dans sa jeunesse, et ayant reçu les insignes du saint service du Pontife et de l'Empereur et les excellents honneurs des princes chrétiens et turcs, il rentra chez lui et il fut décoré des plus hautes distinctions par le roi Sigismond » (Stanislao Comiti a Tarnow viri animi corporis et fortunae dotibus absolutissimo, qui primaria ortus familia, adolescens Hungaria, Moesia, Macedonia, Graecia, Syria, Judaea, Arabia, Aegypto, Italia, Germania peragratis, ac utriusque sanctae militiae insignis a Pontifice et Imperatore acceptis praeclarisque honorariis Principibus tam Christianis quam Turcicis onustus domum rediens, a rego Sigismundo summis honoribus est exornatus) est un fragment d'une inscription latine, qui se trouvait dans la partie supérieure du monument funéraire de Stanisław Spytek Tarnowski (1514-1568), voïvode de Sandomierz dans l'église de Chroberz entre Cracovie et Kielce.
Ce magnifique monument, considéré comme l'un des meilleurs de Pologne, a été fondé en 1569 par l'épouse de Stanisław, Barbara Drzewicka (Barbara de Drzewicza), nièce du primat Maciej Drzewicki (1467-1535). L'inscription en bas commémore la fondation et informe que Stanisław vécut 53 ans et près de sept mois et mourut au château de Krzeszów nad Sanem le 6 avril 1568, troisième heure de la nuit suivante (Vixit annos LIII menses fere septem obyt in arce Krzessow [...] MDLXVIII sexta aprilis hora tertia noctis seqventis). Le défunt était représenté dans la « pose de Sansovino » à la mode, dormant au-dessus du sarcophage dans une armure Renaissance richement décorée. Derrière la figure du voïvode, le centre de l'arcade est rempli d'un cartouche avec ses armoiries comprenant la croix des Chevaliers du Saint-Sépulcre et les attributs de sainte Catherine d'Alexandrie, commémorant son pèlerinage en Terre Sainte et le monastère de sainte Catherine sur le mont Sinaï. De part et d'autre de l'arcade, il y a des panoplies (armures, cuirasses, casques, pistolets, lances, timbales), et au-dessus des niches avec des sculptures de saint Michel archange et Samson déchirant la gueule du lion. Cette dernière statue est la plus inhabituelle parmi de nombreuses sculptures de ce monument et elle est également identifiée à Benaja, fils de Joïada, capitaine de la garde du roi David, qui a soutenu Salomon et est devenu le commandant de son armée (d'après « Nagrobki w Chrobrzu ... » par Witold Kieszkowski, p. 123). Son costume romain avec armure anatomique (lorica musculata) de centurion, le rapproche également d'Hercule terrassant le lion de Némée. Le monument est attribué au sculpteur le plus éminent de la Renaissance polonaise - Jan Michałowicz d'Urzędów ou son atelier. Stanisław était le fils de Jan Spytek Tarnowski et de Barbara Szydłowiecka, nièce de Krzysztof, grand chancelier de la Couronne. Dans les années 1530, peut-être avec son père, il entreprit un pèlerinage en Terre Sainte. En 1537, il est nommé porte-épée de la couronne, staroste de Sieradz et châtelain de Zawichost en 1547. Il devient grand trésorier de la Couronne en 1555 et en 1561 voïvode de Sandomierz. Avant 1538, il épousa Barbara et ils ont sept enfants - six filles et un fils. Vers 1552, il achète Chroberz et Kozubów pour 70 000 florins à la famille Tęczyński et fonde l'église de Chroberz. Les riches châteaux médiévaux de Chroberz et Krzeszów, qu'il a sans aucun doute reconstruits dans le style Renaissance, comme tous les magnats similaires de l'époque, ont tous deux été détruits. En 2017, lors de la 7e Biennale internationale d'art de Pékin au Musée national d'art de Chine, un « Commandant en armure ancienne » du Tintoret - Jacopo Tintoretto (huile sur toile, 220 x 120 cm) provenant d'une collection privée a été exposé. Auparavant, en 2015, il faisait également partie de l'exposition « Images d'un génie. Le visage de Léonard » au Huashan Creative Park à Taipei, Taiwan. A cette époque la disposition de son pied gauche a été modifiée par les restaurateurs. L'homme porte une riche armure de style romain, la cuirasse anatomique héroïque, conçue pour imiter un physique humain masculin idéalisé, et des sandales caligae. Son casque cassis doré est orné de riches reliefs. Son épée n'est cependant pas un gladius typique d'un soldat romain, c'est plus un sabre oriental, il est donc plus un guerrier oriental, comme les Sarmates, les légendaires envahisseurs des terres slaves dans l'Antiquité et les ancêtres présumés des nobles de la République polono-lituanienne. Ce portrait est daté de 1545 dans les catalogues et selon l'inscription latine le modèle avait 31 ans lorsqu'il a été peint (ÆTATIS SVÆ / AÑ XXXI), exactement comme Stanisław Spytek Tarnowski, qui selon certaines sources serait né en octobre 1514 (après « Hetman Jan Tarnowski ... » de Włodzimierz Dworzaczek, p. 375). Pèlerin en Terre Sainte, comme beaucoup d'autres pèlerins de Pologne-Lituanie, il embarqua sans doute sur un navire à Venise. Il est possible qu'il ait visité la ville en 1545, mais il est plus probable qu'il ait commandé son portrait dans la République de Venise sur la base de dessins d'étude envoyés de Pologne. Le même homme est également représenté dans un autre portrait du Tintoret, en buste, dans un manteau noir doublé de fourrure (huile sur toile, 50,2 x 35 cm). Il a été vendu en 2002 (Christie's New York, 25 janvier 2002, lot 27) et provient de la collection du Prince Adam Jerzy Czartoryski (1770-1861) à Paris. Les collections de la famille Czartoryski, dispersées après l'insurrection de 1830, sont secrètement transportées à Paris, où la femme d'Adam, Zofia Anna Sapieha, achète l'hôtel Lambert en 1843. Il figure également dans un autre portrait du Tintoret, aujourd'hui au Kunsthistorisches Museum de Vienne (huile sur toile, 73 x 65 cm, GG 11). Ce tableau est daté d'environ 1547/1548 et est identifiable dans la collection impériale de Vienne en 1816. Après les partages de la Pologne (1772-1795), lorsque Vienne devint la nouvelle capitale des nobles du sud de la Pologne, beaucoup y déplacèrent leurs collections d'art. Il est également possible que le portrait ait été envoyé à Vienne déjà au XVIe siècle - en 1547, Stanisław Spytek devint châtelain de Zawichost près de Sandomierz et son parent, Jan Amor Tarnowski (1488-1561), obtint de l'empereur le titre de comte lié à la possession dans le sud de la Pologne. Malgré les énormes pertes subies par les collections d'art polonais en raison des guerres, des invasions et de l'appauvrissement du pays qui a suivi, certaines œuvres de peintres vénitiens, dont le Tintoret, ont survécu à la destruction, aux confiscations et aux évacuations. L'un de ces tableaux est Narcisse du Tintoret d'environ 1560, acquis en 2017 par le Musée national de Wrocław auprès d'un collectionneur privé. Au XIXème siècle, c'était une propriété d'Otto Hausner (1827-1890) à Lviv. Si le collectionneur d'art galicien a pu acquérir ce tableau lors de ses voyages en Europe occidentale et notamment en Italie, il l'a plutôt acheté en Pologne ou en Ukraine. Lviv, la capitale de la voïvodie ruthène, était un centre économique important de la République polono-lituanienne, avec des influences et une communauté italiennes importantes et des nobles et patriciens riches commandaient et achetaient fréquemment de telles peintures à l'étranger. En ce qui concerne le portrait, l'art profane et maîtres anciens européens, de nombreux historiens de l'art veulent voir la Pologne d'avant le XIXe siècle comme un désert artistique, mais les inventaires et autres documents des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles prouvent que ce n'était pas le cas.
Portrait de Stanisław Spytek Tarnowski (1514-1568), 31 ans, en armure antique par le Tintoret, 1545, Collection particulière.
Portrait de Stanisław Spytek Tarnowski (1514-1568) de la collection Czartoryski par le Tintoret, vers 1545, Collection particulière.
Portrait de Stanisław Spytek Tarnowski (1514-1568) par le Tintoret, 1547/1548, Kunsthistorisches Museum de Vienne.
Narcisse de la collection Hausner à Lviv par le Tintoret, vers 1560, Musée national de Wrocław.
Portraits d'Erazm Kretkowski par Lucas Cranach le Jeune et Giovanni Cariani
« Ici repose Kretkowski, où le destin t'a conduit, Quand tu as exploré toutes les terres et toutes les mers autour de toi, Sans fatiguer tes membres par le labeur, Tu as traversé le Gange rapide et les vagues glacées de Borysthène [le fleuve Dniepr], Le Tage et le Rhin, l'Istrie à deux bras Et les sept portes jumelles du Nil. Maintenant tu verras le grand Olympe Et les maisons éthérées, où, mêlées aux dieux, tu ris Des soucis et des espoirs et des lamentations des hommes » (HIC TE CRETCOVI MORS ET TVA FATA MANEBANT / CVM TERRAS OMNES ET CVM MARIA OMNIA CIRCVM / LVSTRARES NVLLO DEFESSVS MEMBRA LABORE / TE RAPIDVS GANGES GELIDÆQ. BORISTENSIS VNDÆ / TE TAGVS ET RHÆNVS TE RIPA BINOMINIS ISTRI / ET SEPTAGEMINI NOVERVNT OSTIA NILI / NVNC CONCESSISTI MAGNVM VISVRVS OLYMPVM / ÆTHEREASQ. DOMOS VBI DIIS IMMISTVS INANES / ET CVRAS ET SPES HOMINVM LAMENTAQ. RIDES.), lit le soi-disant Epitaphium Cretcovii dans la basilique Saint-Antoine de Padoue - épitaphe latine écrite par le poète Jan Kochanowski et dédiée à Erazm Kretkowski (1508-1558). C'est l'un des premiers textes poétiques connus du poète qui, au printemps 1558, voyagea pour la troisième fois en Italie.
Kretkowski, châtelain de Gniezno, est mort à Padoue dans la République de Venise le 16 mai 1558 à l'âge de 50 ans, selon la première partie de l'inscription sur son épitaphe (ANN. ÆTAT. SVÆ QVINQVAG. OBIIT PATAV. DIE MAII XVI M D L VIII), au début d'un autre voyage plus long. Sa belle épitaphe avec buste en bronze a probablement été réalisée par Francesco Segala (vers 1535-1592), un sculpteur actif à Venise et à Padoue, qui a servi la cour de Guillaume Gonzague à Mantoue, ou Agostino Zoppo (d. 1572), actif à Padoue et Venise. Elle a été créée avant 1560 et probablement fondée par son cousin, Jerzy Rokitnicki. Son buste représente un homme relativement jeune, âgé d'environ 30 ou 40 ans, il était donc basé sur une effigie antérieure, miniature, dessin, portrait ou moins probablement une statue également d'un artiste vénitien, car en 1538, à l'âge de 30 ans, Kretkowski était un émissaire polono-lituanien auprès de l'Empire ottoman et il a sans aucun doute visité Venise. En 1538, il devint également châtelain de Brześć Kujawski et sa coiffure est typique de la fin des années 1530 - par ex. portrait d'un jeune marié de la famille Rava par Lucas Cranach l'Ancien, daté « 1539 » (Museu de Arte de São Paulo). En plus d'être un voyageur et un explorateur, comme le mentionne son épitaphe, Erazm, fils de Mikołaj Kretkowski, voïvode d'Inowrocław, et d'Anna Pampowska, fille d'Ambroży, voïvode de Sieradz, était comme son père courtisan à la cour royale de Sigismond I et Bona Sforza. En 1534, il fut fiancé à la dame d'honneur de la reine Bona, Zuzanna Myszkowska, fille de Marcin, châtelain de Wieluń. Cependant, l'accord prénuptial a été rompu par les parents de la mariée et Kretkowski est resté célibataire jusqu'à la fin de sa vie. Grâce au soutien de la reine Bona, Kretkowski a reçu des charges et des dignités lucratives du roi. En 1545, il fut nommé pour le voïvode de Brześć Kujawski, cependant, cette nomination fut annulée et à partir de 1546, il fut le staroste de Pyzdry. Il était le supérieur des douanes de la Grande Pologne (1547) et à partir de 1551 il occupa la charge de châtelain de Gniezno. Bientôt, cependant, Kretkowski se trouva en opposition avec la reine Bona, car avec un groupe de magnats, il soutint le mariage du jeune roi Sigismond Auguste avec sa maîtresse Barbara Radziwill (d'après « Pomnik Erazma Kretkowskiego ... » de Jerzy Kowalczyk, p. 56). En 1551, il fut l'un des commissaires du Congrès de Głogów pour rencontrer les commissaires du roi Ferdinand d'Autriche et en 1555, avec Jan Drohojowski, évêque de Włocławek, il fut envoyé à Henri V, duc de Brunswick-Lunebourg, concernant son mariage avec la princesse Sophie Jagellon. Il avait donc de bonnes relations et de contacts en Allemagne. On ne sait pas exactement quand il a visité l'Inde, l'Égypte ou l'Istrie dans la République vénitienne, cependant, il a dû commencer son voyage en embarquant sur un bateau à Venise. Au Musée national de Varsovie se trouve un portrait d'un homme barbu en manteau gris-noir, attribué à Lucas Cranach le Jeune (huile sur panneau, 64,5 x 49 cm, M.Ob.836). Il provient de la collection de Carl Daniel Friedrich Bach (1756-1829), peintre, dessinateur et professeur d'art allemand, qui a légué le tableau à la Société silésienne pour la culture patriotique de Wrocław. Après 1945, le tableau a été transféré à Varsovie du dépôt d'art du Troisième Reich à Kamenz (Kamieniec Ząbkowicki) et plus tôt, il se trouvait au Musée des beaux-arts de Silésie à Wrocław (numéro d'inventaire 1284). On ne sait pas où et comment Bach a acquis le tableau, mais à partir de 1780, il était peintre au service du comte Józef Maksymilian Ossoliński, riche propriétaire terrien, homme politique et historien, à Varsovie. En 1784, il accompagna le comte Jan Potocki, explorateur, historien, romancier et diplomate, lors de son voyage aux Pays-Bas, en France et en Italie et entre 1786 et 1792, aux frais de Potocki, il étudia, d'abord à Rome puis à Portici. Il séjourna à Paris, Venise, Vienne et Berlin. Selon l'inscription latine dans le coin supérieur gauche du tableau, l'homme du portrait avait 38 ans en 1546, lorsque le tableau a été créé (1546 / ANNO ÆTATIS SVÆ. XXXVIII), exactement comme Kretkowski lorsqu'il est devenu le staroste de Pyzdry. Il a célébré des événements importants de sa vie avec le portrait, comme en témoigne le prototype de son buste en bronze. Cependant, dans un tel portrait à usage privé ou pour sa famille ou ses amis proches, il n'a pas besoin de rappeler qu'il était un noble des armoiries Dołęga et staroste de Pyzdry, comme dans l'épitaphe pour le grand public. Le rappel de la date de création et de son âge était suffisant. L'homme du portrait ressemble beaucoup aux traits représentés sur son buste. Un dessin d'étude pour le portrait du staroste de Pyzdry se trouve au Musée des Beaux-Arts de Reims (détrempe sur papier, 36,5 x 24,7 cm, 795.1.276). Il fut acquis en 1752 par la Ville de Reims, en même temps qu'un ensemble d'autres dessins d'étude de Cranach et de son atelier, dont l'effigie de Philippe Ier, duc de Poméranie, peint vers 1541 (795.1.266). L'homme a la même expression sur ses lèvres, bien que sa barbe soit plus courte. Le même homme, avec une barbe plus longue et coiffé d'un bonnet noir était représenté dans un autre tableau, vendu en 2012 à Boston (huile sur toile, 75,5 x 63,5 cm, vendu chez Bonhams Skinner, le 18 mai 2012, lot 202), comme par l'école italienne. Le tableau a été acheté chez Harris & Holt Antiques, West Yorkshire en Angleterre et était auparavant attribué à Titien ou à son entourage. Le style du tableau est le plus proche de celui de Giovanni Busi il Cariani, mort à Venise en 1547. L'homme porte un manteau gris-noir similaire, comme dans la peinture de Cranach, mais dans cette version, il est doublé de fourrure chère. S'il est probable que Kretkowski ait visité les deux ateliers, à Wittenberg et à Venise, il est plus probable que, comme la reine Bona, il ait été peint par un membre de l'atelier envoyé en Pologne pour préparer des dessins d'étude.
Dessin préparatoire pour un portrait d'Erazm Kretkowski (1508-1558), staroste de Pyzdry par Lucas Cranach le Jeune ou atelier, vers 1546, Musée des Beaux-Arts de Reims.
Portrait d'Erazm Kretkowski (1508-1558), staroste de Pyzdry, âgé de 38 ans par Lucas Cranach le Jeune, 1546, Musée national de Varsovie.
Portrait d'Erazm Kretkowski (1508-1558), staroste de Pyzdry par Giovanni Cariani, vers 1546, Collection privée.
Portrait de Barbara Radziwill en robe bleue, dite La Bella de Titien
En mai 1543, le roi Sigismond Auguste, âgé de 22 ans, épousa sa cousine Elizabeth d'Autriche, âgée de 16 ans. Lors de l'entrée à Cracovie pour son couronnement, les seigneurs et chevaliers du royaume étaient vêtus de toutes sortes de costumes, notamment italiens, français et vénitiens. La jeune reine est décédée deux ans plus tard, sans avoir laissé d'héritier mâle à son époux. Sigismond Auguste a commandé pour elle un magnifique monument funéraire en marbre au sculpteur padouan formé à Venise, Giovanni Maria Mosca dit Padovano. Le roi espérait que sa maîtresse, Barbara Radziwill, qu'il avait l'intention d'épouser, lui donnerait un enfant.
Le portrait d'une dame en robe bleue du Titien, dite La Bella, ressemble beaucoup aux effigies de Barbara Radziwill, notamment son portrait à Washington. Les boucles dorées de sa robe en forme d'arcs décoratifs, bien que peintes avec moins de diligence, sont presque identiques. Ses vêtements incarnent le luxe du XVIe siècle - une robe de velours vénitien teint en bleu indigo coûteux, brodée de fil d'or et doublée de zibeline, dont la Pologne-Lituanie était l'un des principaux exportateurs à cette époque. Elle tient son épaisse chaîne en or et pointe vers la peau de belette, un zibellino, également connu sous le nom de nom de martre subelline, subeline, et même sublime, sur sa main, un accessoire populaire pour les mariées comme talisman pour la fertilité. Les bestiaires contemporains indiquent que la belette femelle conçut par l'oreille et accoucha par la bouche. Cette méthode de conception « miraculeuse » était censée être parallèle à l'Annonciation du Christ, qui a été conçu lorsque l'ange de Dieu a chuchoté à l'oreille de la Vierge Marie (d'après « Sexy weasels in Renaissance art » de Chelsea Nichols). L'inclusion du zibellino représente l'espoir que la femme serait dotée d'une bonne fertilité et donnerait à son mari de nombreux enfants en bonne santé. Ce symbolisme exclut la possibilité que le portrait représente une courtisane vénitienne (« femme portant la robe bleue »), secrètement peinte par Titien pour François Marie Ier della Rovere, duc d'Urbino, qui était déjà marié et avait trois filles et deux fils, vers 1535. Dès 1545, le pape Paul III voulait marier sa petite-fille Victoire Farnèse au veuf Sigismond Auguste, qui épousa cependant en secret sa maîtresse entre 1545 et 1547 (selon certaines sources, ils étaient mariés depuis le 25 novembre 1545). Victoire épousa finalement le 29 juin 1547, Guidobaldo II della Rovere, duc d'Urbino (fils de François Marie), alors au service de la République de Venise. Il est fort probable que le duc ou Victoire ait reçu un portrait de la maîtresse royale, qui a ensuite été transféré à Florence. Une copie du portrait de l'atelier de Titan, très probablement par Lambert Sustris, peint avec des pigments moins chers et sans très coûteux pigment d'outremer, est une preuve que, comme dans le cas des portraits de l'impératrice Isabelle de Portugal, le modèle n'était pas dans l'atelier du peintre et le portrait était un d'une série. Il y avait aussi des erreurs et des insuffisances, ses boucles d'or ont été remplacées par de simples rubans rouges. La comparaison avec les portraits de l'impératrice Isabelle confirme que Titien aimait les proportions et la beauté classique. Juste en rendant les yeux légèrement plus grands et plus visibles et en harmonisant leurs traits, il a atteint ce que ses clients attendaient de lui, être beau dans leurs portraits, proche des dieux de leurs statues grecques et romaines, c'était la Renaissance. La miniature du miniaturiste inconnu Krause, probablement un amateur, de la fin du XVIIIe ou du début du XIXe siècle dans le château royal de Varsovie, indique qu'une version du tableau se trouvait également en Pologne, peut-être dans la collection du roi Stanislas Auguste Poniatowski. À partir de 1545, le jeune roi Sigismond Auguste n'épargna pas d'argent pour sa maîtresse. Les marchands juifs et florentins Abraham Czech, Symon Lippi et Kasper Gucci (ou Guzzi) livraient à la cour royale d'énormes quantités de tissus et de fourrures coûteux. Entre 1544 et 1546, le jeune roi employa de nombreux nouveaux bijoutiers à sa cour de Cracovie et de Vilnius, comme Antonio Gatti de Venise, Vincenzo Palumbo (Vincentius Palumba), Bartolo Battista, italien Christophorus, Giovanni Evangelista de Florence, Hannus (Hans) Gunthe, allemand Erazm Prettner et Hannus Czigan, Franciszek et Stanisław Merlicz, Stanisław Wojt - Gostyński, Marcin Sibenburg de Transylvanie, etc. Sans oublier Giovanni Jacopo Caraglio, qui vers 1550 a créé un camée avec le profil divinement beau de Barbara. En un an seulement, 1545, le roi acheta jusqu'à 15 bagues en or avec des pierres précieuses aux orfèvres de Vilnius et de Cracovie. En 1547, Girolamo Mazzola Bedoli, un peintre lombard, a créé une peinture d'Adoration des Mages pour la Certosa Sancta Maria Schola Dei à Parme, aujourd'hui à la Galleria nazionale di Parma (numéro d'inventaire GN145). Un homme représenté comme l'un des mages a un costume clairement inspiré du costume d'un noble polono-lituanien. Son sabre oriental et ses couleurs - cramoisi et blanc, les couleurs nationales de la Pologne, indiquent également qu'il s'agit d'un homme originaire de Pologne-Lituanie, très probablement inspiré par la présence accrue de leurs envoyés dans les milieux artistiques en Italie à cette époque. Selon des sources, Barbara était une beauté, d'où le titre en italien, La Bella, est pleinement mérité. « La composition de son corps et de son visage la rendait si belle que les gens par jalousie dénigraient son innocence », elle était « glorieusement merveilleuse, comme une seconde Hélène [Hélène de Troie] » comme il était écrit dans un panégyrique, elle avait la peau blanche d'albâtre, « les yeux doux, douceur de la parole, lenteur des mouvements ».
Portrait de Barbara Radziwill en robe bleue, dite La Bella du Titien, 1545-1547, Palais Pitti à Florence.
Portrait de Barbara Radziwill, dite La Bella par l'atelier du Titien, très probablement Lambert Sustris, 1545-1547, collection particulière.
Portrait de Barbara Radziwill en costume français
Le 15 juin 1545 mourut Elisabeth d'Autriche, première épouse de Sigismond II Auguste, qui poursuivit sa liaison avec sa maîtresse Barbara Radziwill, qu'il rencontra en 1543. Déjà en septembre 1546, des rumeurs circulaient à Cracovie selon lesquelles Sigismond allait épouser « une femme privée de la plus mauvaise opinion ». Pour éviter cela et renforcer l'alliance pro-turque (la fille aînée de Bona, Isabelle Jagellon, a été établie par le sultan Suleiman comme régente de Hongrie au nom de son fils), il a été décidé de marier Sigismond à Anne d'Este (1531-1607), fille du duc de Ferrare et liée à la maison régnante française.
La miniature d'une dame en costume italien, dite Bona Sforza d'Aragona des années 1540, qui se trouvait dans la collection Czartoryski, ne peut pas représenter Bona car la femme est beaucoup plus jeune et les traits sont différents, elle est cependant très similaire aux effigies de Barbara Radziwill. Les traits de cette dame, d'autre part, sont très similaires à ceux visibles dans un portrait d'une dame tenant un calice et un livre au Musée national de Varsovie, une fois dans la collection du marchand d'art Victor Modrzewski à Amsterdam, donc le plus probablement provenant d'une collection en Pologne. Ce dernier tableau est attribué à l'entourage du Maître des demi-figures féminines, un peintre flamande ou de la cour française qui a souvent représenté des dames sous les traits de leurs saints patrons et qui a également travaillé pour d'autres cours européennes (par exemple, portrait d'Isabelle de Portugal à Lisbonne). La femme est vêtue selon la mode française, très semblable à la tenue dans le portrait de Catherine de Médicis, reine de France d'environ 1547 aux Offices (Inv. 1890 : inv. 2448). Elle tient un livre de prières et un calice, un attribut de sainte Barbe, invoquée centre la mort subite et violente (la scène sur le calice montre un homme tuant un autre homme) et patronne des femmes enceintes (avec sainte Marguerite d'Antioche). Les deux peintures sont très probablement des copies d'atelier d'une grande commission de portraits d'État, mais la ressemblance est toujours visible.
Portrait de Barbara Radziwill en costume français par l'entourage de Maître des demi-figures féminines, vers 1546-1547, Musée national de Varsovie.
Miniature de Barbara Radziwill par l'entourage de Jan van Calcar, vers 1546-1547, Musée Czartoryski (?), publié dans « Jagiellonki polskie » d'Aleksander Przeździecki (1868).
Miniature de Bona Sforza d'Aragona par Jan van Calcar, vers 1546, Galerie des Offices à Florence.
Portrait de Thomas Howard, duc de Norfolk par Giovanni Cariani ou Bernardino Licinio
En février 1546 arriva à Londres l'envoyé de Pologne-Lituanie Stanisław Lasota (Stanislaus Lassota) des armoiries de Rawicz (vers 1515-1561), courtisan de la reine Bona Sforza (aulicus Bonae Reginae), valet, agent diplomatique et secrétaire royal. Il présenta à Henri VIII des propositions alléchantes de coopération avec la Pologne et assura au monarque anglais que la Pologne n'avait pas l'intention de cesser de fournir des céréales à l'Angleterre qui à l'époque était en guerre avec la France et avait besoin d'un approvisionnement constant en céréales du pays et le front de guerre.
Lasota, digne de confiance de la famille royale, était utilisé pour des missions discrètes. Il a également présenté un projet (sans autorisation officielle) de marier Sigismond Auguste à la princesse Marie Tudor (1516-1558). Henri VIII a récompensé Lasota avec une chaîne en or et l'a nommé chevalier d'or (eques auratus) devant toute la cour. Il y a même un document dans les dossiers du Conseil privé, qui montre que le Conseil a payé « Aprilis 1546. À Cornelys, l'orfèvre, pour avoir fabriqué un collier de livrée pour le gentilhomme de Polonia ». Lasota partit de Vilnius en 1545 et avant d'atteindre l'Angleterre, il se rendit également à Vienne, Munich et en Espagne. En mars 1546, Stanisław quitte Londres et arrive à Paris, où, à son tour, il propose le mariage de Sigismond Auguste avec la princesse Marguerite de Valois (1523-1574), fille du roi François Ier. Un an plus tard, Lasota retourna en Angleterre avec une ambassade officielle (d'après « Polska w oczach Anglików XIV-XVI w. » de Henryk Zins, p. 70-71). Les cadeaux précieux faisaient partie de la diplomatie à cette époque et Lasota a sans aucun doute également apporté de nombreux cadeaux précieux. En 1546, Sigismond I offrit à Hercule II d'Este, duc de Ferrare, une chaîne en or d'une valeur de 150 florins d'or hongrois. Son épouse la reine Bona, comme son fils plus tard, avait une affinité particulière pour les bijoux. En 1543, elle donna à son fils 40 coupes en argent, de nombreuses chaînes en or et d'autres objets de valeur. Des bijoux exquis étaient commandés par la reine ou pour elle auprès des meilleurs orfèvres de Pologne-Lituanie et de l'étranger. Au début de 1526, une chaîne en or fut commandée à Nuremberg pour Bona et en 1546 Seweryn Boner paya 300 florins à l'orfèvre de Nuremberg Nicolaus Nonarth pour la fabrication de colliers pour ses filles. Des perles ont été achetées pour des sommes énormes à Venise et à Gdańsk et des pierres précieuses toutes faites ont été achetées à Nuremberg et en Turquie (d'après « Klejnoty w Polsce ... » d'Ewa Letkiewicz, p. 57). En 1545, le brodeur de la cour Sebald Linck reçut de l'or vénitien et un autre type d'or, qui dans les factures est décrit comme aurum panniculare, pour orner la robe de cérémonie de Sigismond Ier. En 1554, l'envoyé de la reine acheta à Anvers « des travaux d'orfèvrerie pour un montant de 6 000, à donner à la reine d'Angleterre », comme le rapporta l'ambassadeur vénitien à la cour impériale Marc'Antonio Damula et deux ans plus tard Pietro Vanni (souvent anglicisé sous le nom de Peter Vannes), secrétaire latin du roi Henri VIII, décrivant le départ de Bona de Pologne et son séjour à Venise, écrivit qu' « elle a transporté hors du pays, par diverses voies secrètes, une quantité infinie de trésors et de bijoux » (au Conseil, 7 mars 1556, à Venise). Les portraits faisaient également partie intégrante de la diplomatie. Les dirigeants ont échangé leurs portraits, des portraits d'épouses potentielles, des membres de la famille, des personnalités importantes et des personnes célèbres. En juin 1529, un portrait du duc de Mantoue, Frédéric II de Gonzague (1500-1540), fut apporté à Bona par son émissaire et en 1530, un diplomate au service de Sigismund et Bona Jan Dantyszek envoya à Krzysztof Szydłowiecki, grand chancelier de la Couronne, le portrait du conquistador espagnol Hernán Cortés. A Varsovie conservé l'un des meilleurs portraits d'Henri VIII par l'entourage de Hans Holbein le Jeune, très probablement peint par Lucas Horenbout (Musée national de Varsovie, huile sur bois de chêne, 106 x 79 cm, numéro d'inventaire 128165). Le portrait est une version de l'effigie du roi créée par Holbein le Jeune en 1537 dans une peinture murale au palais de Whitehall. Il figurait plus tôt dans la collection de Jakub Ksawery Aleksander Potocki (1863-1934) et Léon Sapieha (inscription au verso : L. Sapieha) et en 1831 « Henri VIII d'Angleterre par Holbeyn sur bois dans un cadre doré » est mentionné dans un registre de peintures de Ludwik Michał Pac par Antoni Blank (1er février 1831, Ossolineum, Wrocław). Un autre catalogue de Blank, de la collection Radziwill à Nieborów près de Łódź, publié en 1835, répertorie cinq tableaux de Holbein (pièces 426, 427, 458, 503, 505). Le portrait du marchand de Gdańsk Georg Gisze (1497-1562), anobli par le roi polonais Sigismond Ier en 1519, a été créé par Hans Holbein le Jeune en 1532 à Londres pour être envoyé à son frère Tiedemann Giese, secrétaire du roi de Pologne (aujourd'hui à la Gemäldegalerie de Berlin). Dans la collection privée de Hambourg, en Allemagne, se trouve le portrait d'un riche noble. Ses traits du visage et son costume sont étonnamment similaires à ceux des effigies de Thomas Howard (1473-1554), troisième duc de Norfolk, comte-maréchal et le lord grand trésorier, oncle de deux des épouses du roi Henri VIII, Anne Boleyn et Catherine Howard, et l'un des nobles les plus puissants du pays. Hans Holbein le Jeune et son atelier ont créé une série de portraits du duc de Norfolk (château de Windsor, château Howard et collection privée) âgé de 66 ans, donc créés à l'apogée de sa puissance en 1539. Bien que favorisé par Henri VIII pendant la majeure partie de sa vie, sa position devint instable après l'exécution de sa nièce Catherine Howard en 1542 et de nouveau en 1546 lorsque lui et son fils furent arrêtés pour trahison (12 décembre). Ce politicien catholique de premier plan sous Henri VIII et Marie Tudor a été décrit par l'ambassadeur vénitien Ludovico Falieri en 1531 : « [il] a une très grande expérience dans le gouvernement politique, discute admirablement des affaires du monde, aspire à une plus grande élévation et il est hostile aux étrangers, en particulier à notre nation vénitienne. Il a cinquante-huit ans, petit et maigre en personne ». Le portrait mentionné à Hambourg montre un homme âgé de 60 ou 70 ans dans un costume des années 1540. La forme de ses boucles de manche en or rappelle une rose Tudor et il tient sa main droite sur le casque fermé de son armure de style italien/français. En juin 1543, Howard déclara la guerre à la France au nom du roi pendant la guerre d'Italie de 1542-1546. Il est nommé lieutenant-général de l'armée et commande les troupes anglaises lors du siège infructueux de Montreuil. Le 7 juin 1546, le traité d'Ardres est signé avec la France. Tout indique qu'il s'agit d'un portrait d'Howard, à l'exception de la chaîne en or autour de son cou. Dans tous les portraits de Holbein et de l'atelier, il porte l'Ordre de la Jarretière, un important ordre de chevalerie lié à la couronne anglaise. Si l'on considère le portrait comme effigie du duc de Norfolk, cette chaîne différente s'inscrivait donc dans le cadre des efforts diplomatiques du commandant, qui se plaignait du ravitaillement insuffisant de son armée pendant la campagne en France. C'est donc comme un message à quelqu'un, « J'aime ton cadeau, nous pourrions être des alliés ». Une autre chose intrigante à propos de ce portrait est son auteur. Le tableau a été créé par un peintre italien dans le style proche de Giovanni Cariani et Bernardino Licinio. Federico Zeri a attribué l'œuvre en 1982 à Cariani, mort à Venise en 1547, ou à l'école du XVIe siècle de Ferrare. En 1546, la reine Bona a commandé une série de peintures pour la cathédrale de Cracovie à Venise et les contacts avec Ferrare ont été augmentés en raison du mariage prévu de Sigismond Auguste avec Anne d'Este (le portrait de la mariée aurait été envoyé via Venise par Carlo Foresta, l'un des agents du marchand de Cracovie Gaspare Gucci). En conclusion, le portrait de Hambourg a été commandé à Venise pour ou par la cour polono-lituanienne, sur la base d'un dessin ou d'une miniature envoyé d'Angleterre. Malgré leur grande richesse, le mariage avec une lointaine monarchie élective de Pologne-Lituanie n'était pas considéré comme avantageux pour les rois héréditaires d'Angleterre, surtout lorsque la guerre avec la France était terminée et qu'ils n'avaient pas besoin d'un approvisionnement accru en céréales et Sigismond Auguste a décidé d'épouser sa maîtresse Barbara Radziwill.
Portrait de Georg Gisze (1497-1562), marchand de Gdańsk par Hans Holbein le Jeune, 1532, Gemäldegalerie à Berlin.
Portrait d'Henri VIII d'Angleterre par l'entourage de Hans Holbein le Jeune, très probablement Lucas Horenbout, 1537-1546, Musée national de Varsovie.
Portrait de Thomas Howard (1473-1554), troisième duc de Norfolk par Giovanni Cariani ou Bernardino Licinio, 1542-1546, collection privée.
Portrait de Catherine Willoughby, duchesse de Suffolk par l'atelier de Hans Holbein le Jeune
On dit que Catherine Willoughby (1519-1580) fut considérée comme candidate pour épouser Sigismond Auguste après que l'ambassadeur polonais n'ait pas réussi à obtenir la main de la princesse Marie Tudor en 1546, et entre 1557 et 1559, elle et son mari furent « placés honorablement dans le comté dudit roi de Pologne, à Sanogelia [Samogitie en Lituanie], dit Crozen [Kražiai] » (d'après « Chronicles of the House of Willoughby de Eresby », p. 98). Catherine était une fille et héritière de William Willoughby, 11e baron Willoughby de Eresby, par sa seconde épouse, María de Salinas, demoiselle de compagnie de la reine Catherine d'Aragon. Elle et son deuxième mari Richard Bertie (1516-1582) étaient de confession protestante et en 1555, ils ont été forcés de fuir l'Angleterre en raison du règne catholique de la reine Marie Ire et ne sont retournés en Angleterre que sous la reine protestante Élisabeth Ire.
Son premier mari était Charles Brandon, 1er duc de Suffolk, qu'elle épousa le 7 septembre 1533, à l'âge de 14 ans. Ils eurent deux fils, tous deux décédés jeunes en 1551 - Henri (né en 1535) et Charles (né en 1537). Au Metropolitan Museum of Art, il y a un portrait d'une jeune fille âgée de 17 ans (latin : ANNO ETATIS·SVÆ XVII) par l'atelier de Hans Holbein le Jeune, également identifiée comme l'effigie de Catherine Howard, reine d'Angleterre de 1540 à 1542, donc datée vers 1540 (huile sur panneau, 28,3 x 23,2 cm, numéro d'inventaire 49.7.30). Le tableau se trouvait au début du XIXe siècle dans la collection du prince Józef Antoni Poniatowski (1763-1813), neveu du roi Stanislas Auguste, qui a hérité de nombreux tableaux de sa collection et par conséquent aussi des collections royales historiques. La principale caractéristique de son visage est une lèvre supérieure caractéristique, également visible sur la photo du tableau avant restauration lorsque les retouches ont été supprimées. Une lèvre similaire est vue dans des portraits identifiés comme représentant des enfants de Catherine Willoughby - Henry Brandon, 2e duc de Suffolk (1535-1551) par Hans Holbein le Jeune (Royal Collection, RCIN 422294) et Susan Bertie (née en 1554) par un peintre inconnu (Beaney House of Art and Knowledge). Son visage et sa pose ressemblent également à ceux du portrait dessiné de la duchesse de Suffolk par Hans Holbein le Jeune, créé entre 1532 et 1543 (Windsor Castle, RCIN 912194). La ressemblance d'une femme de la peinture à l'image ultérieure de la fille de Catherine est surprenante. Une broche camée sur son buste à deux têtes pourrait être Castor et Pollux, les Gémeaux astronomiques, interprétés par les mythographes de la Renaissance en termes d'immortalité partagée et de lien qui unit deux personnes même après la mort (d'après « Castor and Pollux », Cengage, Encyclopedia.com).
Portrait de Catherine Willoughby (1519-1580), duchesse de Suffolk, âgée de 17 ans par l'atelier de Hans Holbein le Jeune, vers 1536, Metropolitan Museum of Art.
Portrait de Zofia Firlejowa en Vénus par l'atelier de Giovanni Cariani
En 1546 ou au début de 1547, Jan Firlej (1521-1574) des armoiries de Lewart, plus tard grand maréchal de la Couronne, voïvode de Cracovie et chef du camp calviniste, épousa l'incroyablement riche Zofia Bonerówna, fille du banquier du roi Seweryn Boner (1486-1549), recevant une énorme dot de 47 000 florins et la propriété de Boner près du château d'Ogrodzieniec. Jan était le fils aîné de Piotr Firlej (décédé en 1553), voïvode de Ruthénie à partir de 1545 et conseiller de confiance de la reine Bona Sforza et du roi Sigismond Auguste, et de Katarzyna Tęczyńska. Conclu à l'initiative de son père, qui a utilisé l'argent de la dot de la femme de Jan pour rembourser ses dettes, ce mariage s'est avéré très bénéfique du point de vue des intérêts de la famille.
Piotr était un mécène des arts, il agrandit son château à Janowiec et construit un palais Renaissance à Lubartów. A ses frais, une belle pierre tombale a été créée vers 1553 par Giovanni Maria Mosca, appelé il Padovano dans l'église dominicaine de Lublin. Dans ses grands domaines de Dąbrowica, un village à un mile de Lublin, il possédait un magnifique palais, dont les escaliers sculptés dans le marbre étaient admirés par le poète Jan Kochanowski. Les parents de Zofia étaient également des mécènes renommés des arts. La sculpture funéraire en bronze de Seweryn et de sa femme Zofia née Bethman a été créée entre 1532 et 1538 par Hans Vischer à Nuremberg et transportée à Cracovie. Entre 1530 et 1547, Seweryn a reconstruit et agrandi le château d'Ogrodzieniec, transformant la forteresse médiévale en un château de la Renaissance - il s'appelait « le petit Wawel ». Les Boner l'ont meublé de beaux meubles, de tapisseries et d'autres objets de grande valeur importés de l'étranger. En 1655, le château fut partiellement incendié par l'armée suédoise qui y stationna près de deux ans, détruisant une grande partie des bâtiments. Semblable à la cour royale, de nombreux objets de ce type ont également été commandés ou acquis à Venise. En 1546, un vénitien Aloisio reçut un manteau de fourrure et plusieurs dizaines de thalers pour un montant total de 78 zlotys 10 groszy pour divers instruments qu'il apporta de Venise à Cracovie sur ordre du roi. En tant que gouverneur des domaines royaux, le père de Zofia, Seweryn, qui tenait les livres de compte de la cour, a négocié de nombreux achats de ce type. En 1553, deux juifs de Kazimierz, Jonasz, l'aîné de la communauté de Kazimierz, et Izak, le fils du deuxième doyen de cette communauté et fournisseur royal Izrael Niger, participèrent à une mission commerciale envoyée par le roi à Vienne et Venise pour acheter marchandises pour la cour royale, recevant un paiement anticipé de 840 florins hongrois en or. Quelques mois plus tard (11 avril 1553) Izak Izraelowicz Niger (Schwarz) fut renvoyé à Venise afin d'acheter des cadeaux de mariage pour la troisième épouse de Sigismond Auguste, Catherine d'Autriche, recevant 400 florins hongrois en or (d'après « Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego », numéros 153-160, p. 7). Les habitants de la ville royale de Cracovie étaient des connaisseurs d'art et possédaient d'importantes collections de peintures et de portraits. En 1540, Katarzyna, veuve de Paul Kaufman, un marchand de Cracovie, résidant au couvent de Saint-André, a laissé ses portraits dans son testament au couvent (Omes imagines suas dat, donat se defuncta, Conventui huic s. Andrere, ad Ecclesiam et etiam sororibus monialibus) et en 1542 dans la liste des peintures de feu Melchior Czyżowski, vice-procureur du château de Cracovie (Viceprocuratori Castri Cracoviensis), il y avait deux de ses portraits (Duæ imagines Dni Melchioris C ...), une peinture d'Hérodias (Tabula pieta, Herodiadis), peut-être par l'atelier de Cranach, la femme adultère (Figura de muliere deprehensa in adulterio), peut-être par le peintre vénitien, les douze travaux d'Hercule (Duodecem labores Herculis), une vue de Venise (Cortena in qua depicta est Venetia), un tableau de Judith et Hérodias, peint des deux côtés (Tabula Judith et Herodiadis, ex utraque parte depicta), tableau de Thisbe et un autre de Judith (Figura Thisbe, Fig. Judith), Nativité du Christ (Nativitatis Christi) et Marie-Madeleine (Mariæ Magdalenæ), probablement de l'école vénitienne, et d'autres peintures religieuses. Plus d'un demi-siècle plus tard, vers 1607, un autre représentant de la famille, Hieronim Czyżowski, enregistré dans les livres de la nation polonaise 15 ans plus tôt, en 1592, commanda un tableau du peintre vénitien Pietro Malombra avec son portrait comme donateur (Résurrection de chevalier Piotrawin par saint Stanislas) pour l'autel de la nation polonaise dans la Basilique de saint Antoine à Padoue. À la galerie nationale d'Écosse, il existe une étude préparatoire pour ce tableau (numéro d'inventaire RSA 221), dans laquelle cependant le donateur n'est pas présent dans la composition, indiquant que son portrait a été ajouté plus tard, éventuellement basé sur un dessin envoyé de Pologne. Bonerówna a épousé Jan Firlej peu de temps avant ou après son retour de mission diplomatique à la cour de Ferdinand Ier d'Autriche et très probablement à la cour de Ferrare. Elle lui donna deux filles Jadwiga et Zofia et quatre fils Mikołaj, Andrzej, Jan et Piotr. Zofia est décédée en 1563 ou après et Jan a ensuite épousé Zofia Dzikówna (décédée après 1566) et plus tard Barbara Mniszech (décédée en 1580). Le couple eut probablement une autre fille, Elżbieta, mais elle mourut jeune en 1580. Sa pierre tombale derrière l'autel principal de l'église de Bejsce près de Cracovie fut fondée par son frère Mikołaj Firlej (décédé en 1600), voïvode de Cracovie, qui a une magnifique chapelle funéraire dans la même église, sur le modèle de la chapelle Sigismond. Ce monument à la vierge polonaise, selon l'inscription latine (ELIZABETHAE / IOAN(NIS) FIRLEII A DAMBROWICA PALAT(INI) ET CAPIT(ANEI) CRACOVIEN(SIS) / ATQVE MARSALCI REGNI F(ILIAE) / VIRGINI NATALIB(VS) ILLVSTRI. FORMA INSIGNI AETATE FLORE(N)TI / VITA PVDICISSIMAE [...] NICOL(AVS) FIRLEIVS A DAMBROWICA IO(ANNES) F(IRLEIVS) - CASTELL(ANVS) BIECEN(SIS) / SORORI INCOMPARABILI E DOLORIS ET AMORIS FRATERNI / MOERENS POS(VIT) / OBIIT AN(N)O D(OMI)NI : M.D.LXXX), est considérée comme une rareté et attribué à l'atelier de Girolamo Canavesi. Elżbieta était représentée endormie, à moitié allongée, dans une pose rappelant la Naissance de Vénus, une fresque romaine de la Maison de Vénus à Pompéi, créée au Ier siècle après JC, ou Vénus de cassone avec des scènes de la bataille des Grecs et Amazones devant les murs de Troie par l'atelier de Paolo Uccello, peint vers 1460 (Yale University Art Gallery, New Haven). La pierre tombale d'Elżbieta est couronnée des armoiries des Firlej - Lewart, un léopard rampant. En 2014, une peinture non encadrée de Vénus et Cupidon couchés par l'atelier de Giovanni Cariani (décédé en 1547) a été vendue à Londres (huile sur toile, 102 x 172,2 cm, Bonhams, 9 juillet 2014, lot 35). Cupidon pointe sa flèche au cœur de la femme allongée, symbolisant l'amour. Dans le coin droit de la toile, sur l'arbre, il y a un bouclier avec des armoiries montrant un léopard rampant sur fond rouge, très similaire à celui visible dans le monument à Elżbieta Firlejówna à Bejsce, ainsi que de nombreuses autres représentations de armoiries de la famille Firlej. En arrière-plan, il y a une cathédrale gothique, très similaire à la vue de la cathédrale Saint-Étienne dans le Panorama de Vienne (Vienna, Citta Capitale dell' Austria), créée par un graveur italien vers 1618 (Wien Museum, numéro d'inventaire 34786). Le tableau rappelle les plaques érotiques de placard-cabinet de Peter Flötner ou Wenzel Jamnitzer du domaine Zamoyski à Varsovie (perdu pendant la Seconde Guerre mondiale). Le cabinet était orné de 26 plaques de bronze représentant des figures féminines nues allongées. Il a très probablement été créé à Augsbourg ou à Nuremberg et pourrait provenir d'une commission royale ou d'un magnat. Flötner a créé plusieurs objets exquis pour Sigismond Ier dans les années 1530, notamment un autel en argent pour la chapelle de Sigismond et un coffret d'Hedwige Jagiellon (Saint-Pétersbourg). Si ce tableau de l'épouse de Jan Firlej en Vénus a été peint par l'atelier de Cariani peu avant la mort de l'artiste, cela expliquerait pourquoi Firlej a décidé de commander son portrait au jeune Jacopo Tintoretto en 1547 (Musée Kröller-Müller). Un manuscrit de l'Ossolineum (numéro 2232) des années 1650 répertorie un grand nombre de bijoux, de meubles, de peintures, de livres, de vêtements, de tissus aux armoiries de Lewart et de reliques des domaines des Firlej à Dąbrowica, Ogrodzieniec et Bejsce. Il comprend également de nombreux biens importés et des portraits, comme des « éventails étrangers », « des tableaux d'ancêtres décédés et de nombreux arts divers, très coûteux et élaborés », « grands tapis persans et faits maison », « deux tableaux : un en costume français, l'autre en polonais, et le troisième commencé, à la française », « de nombreuses vieilles images d'Ogrodziniec et de Dąbrowica, l'une avec un nain avec un grand fils ; des images coûteuses et pieuses sur cuivre, beaucoup sur toile », « du verre coûteux, enterré dans une cave à Dąbrowica de l'ennemi, Jarosz Kossowski l'a creusé », probablement du verre vénitien sauvé pendant le déluge (1655-1660), « le calice Bonarowski, trois timbres d'or, pliés en un, par un travail élaboré », probablement de dot de Zofia Bonerówna, « divers lunettes étrangers de cuivre, jetons étrangers » et autres objets.
Portrait de Zofia Firlejowa née Bonerówna (décédée en 1563) en Vénus et Cupidon avec les armoiries de Lewart par l'atelier de Giovanni Cariani, 1546-1547, Collection privée.
Portrait de Jan Firlej par le Tintoret
Grâce aux efforts de son père, Jan Firlej (1521-1574) a reçu une éducation au plus haut niveau. Il a étudié à l'Université de Leipzig pendant deux ans, puis a poursuivi ses études à l'Université de Padoue pendant les deux années suivantes. De là, avec son parent le comte Stanisław Gabriel Tęczyński (1514-1561), chambellan de Sandomierz, et Stanisław Czerny, staroste de Dobczyce, il se rendit en Terre Sainte, visita l'Égypte et la Palestine. Ils partirent de Venise dans la seconde moitié de 1541 - le 16 juin de cette année-là, il participa à la procession solennelle à Venise, en tant que seigneur de Dąbrowica (dominus de Dambrouicza) parmi le groupe de pèlerins de Jérusalem (peregrinorum Hierosolimitanorum). Il a également voyagé à Rome. Vers 1543, il retourne en Pologne, et en 1545, il entre au service du roi Sigismond Ier. La même année, il est envoyé en mission auprès de l'empereur Charles Quint à la Diète du Saint Empire romain germanique à Worms. Selon Stanisław Hozjusz (Hosius, Op. I, 459) en 1547, en tant qu'envoyé, il participa à des activités diplomatiques à la cour de Ferdinand Ier d'Autriche, concernant peut-être le mariage du roi avec Barbara Radziwill ou les projets de le marier à Anne d'Este (1531-1607), fille du duc de Ferrare.
En janvier 1546, Giovanni Andrea Valentino (de Valentinis), médecin de la cour de Sigismond l'Ancien et de la reine Bona, fut envoyé de Cracovie avec une mission confidentielle auprès de Sigismond Auguste résidant en Lituanie, concernant le mariage avec Anne d'Este. À cette époque, une lettre séparée a été envoyée par l'envoyé du duc de Ferrare, Antonio Valentino, séjournant en Pologne du 30 août 1545 à septembre 1546, à Bartolomeo Prospero, le secrétaire du duc Ercole II, pour accélérer la livraison du portrait de la mariée. « Il recommanda que le colis soit exporté à Venise non par la poste royale, mais par une voie privée entre les mains de Carlo Foresta, l'un des agents de Gaspare Gucci de Florence, marchand à Cracovie » (d'après le « Działalność Włochów w Polsce w I połowie XVI wieku » de Danuta Quirini-Popławska, p. 87). Il est possible que le portrait mentionné dans la lettre ait été créé à Venise, car les ducs de Ferrare y ont également commandé leurs effigies, par ex. portrait d'Alphonse II d'Este (1533-1597) par Titien ou atelier du château d'Arolsen, identifié par moi (Marcin Latka). En 1909, dans la collection du prince Andrzej Lubomirski à Przeworsk, il y avait une petite peinture (huile sur plaque d'étain, 26 x 35 cm) attribuée à l'école vénitienne du XVIe siècle représentant « Vierge à l'Enfant entourée de personnes qui, selon la tradition, représentent la famille des princes d'Este ; la femme aux cheveux d'or représente probablement la célèbre Éléonore d'Este » (d'après « Katalog wystawy obrazów malarzy dawnych i współczesnych urządzonej staraniem Andrzejowej Księżny Lubomirskiej » de Mieczysław Treter, point 36, p. 11). En 1547, un peintre Pietro Veneziano (Petrus Venetus), a créé une peinture pour l'autel principal de la cathédrale de Wawel et Titien a été convoqué pour peindre Charles V et d'autres à Augsbourg. Le tableau du musée Kröller-Müller d'Otterlo attribué à Jacopo Tintoretto montre un noble riche vêtu d'un manteau noir doublé d'une fourrure de lynx extrêmement chère. Sa pose fière et ses gants indiquent également sa position sociale. Ce tableau a été acquis par Helene Kröller-Müller en 1921 et auparavant, il se trouvait dans la collection du comte de Balbi à Venise et peut-être dans la collection Giustinian-Lolin à Venise. Selon l'inscription dans le coin inférieur gauche, l'homme avait 26 ans en 1547 (ANN·XXVI·MEN·VI·/·MD·XL·VII·), exactement comme Jan Firlej, lorsqu'il fut envoyé en mission en Autriche et peut-être à Venise et à Ferrare.
Portrait de Jan Firlej (1521-1574) âgé de 26 ans par Jacopo Tintoretto, 1547, Musée Kröller-Müller.
Portrait de Nicolas « le Rouge » Radziwill par l'atelier de Giovanni Cariani
En 1547, Nicolas III Radziwill (1512-1584), grand échanson royal de Lituanie, fils du grand hetman de Lituanie Georges « Hercule » Radziwill et Barbara Kolanka, reçut le titre de prince de l'Empire romain à Birzai et Dubingiai de l'empereur Charles V. Il l'a reçu avec son cousin Nicolas (1515-1565), alors grand maréchal de Lituanie, devenu prince à Niasvij et Olyka. Afin de ne pas le confondre avec son homonyme, les cousins reçoivent des surnoms en raison de la couleur de leurs cheveux. Nicolas III est plus connu sous le nom de « le Rouge » et son cousin sous le nom de « le Noir ».
Vers la même année, le roi Sigismond II Auguste épousa secrètement la sœur cadette de Nicolas, Barbara, pensant qu'elle était enceinte. Nicolas « le Rouge » était désormais beau-frère et confident du roi. Grâce à la protection du roi, il devint maître de la chasse de Lituanie en 1545 et à partir de 1550, il fut voïvode de Trakai. Nicolas était un célèbre chef militaire, il a participé à la guerre avec la Moscovie entre 1534-1537, y compris au siège de Starodub en 1535. Le portrait d'un membre de la famille Radziwill, dit Jean Radziwill (mort en 1522), surnommé « le Barbu », père de Nicolas « le Noir », au Musée national d'art de Biélorussie à Minsk, provient de la galerie de portraits au château de Radziwill à Niasvij. En raison du style du costume et de la technique, cette œuvre est généralement datée du début du XVIIe siècle. Il est cependant stylistiquement très proche d'un autre portrait de la même collection, le portrait du prince Nicolas II Radziwill (1470-1521) par Giovanni Cariani, réalisé vers 1520. Le visage du modèle a été créé dans le style de Cariani, très probablement par le maître lui-même, le reste, moins élaboré, fut sans doute complété par l'élève du peintre. Cariani, bien qu'il travailla souvent à Bergame près de Milan, mourut à Venise. La date de la mort de l'artiste n'est pas connue, sa dernière présence est documentée le 26 novembre 1547 dans le testament de sa fille Pierina, faisant coïncider sa mort l'année suivante. La pose et l'écharpe de l'homme sont très similaires à l'effigie de Nicolas III Radziwill au Musée de l'Ermitage (ОР-45840) signée en polonais/latin : « Nicolas Prince à Birzai, voïvode de Vilnius, chancelier et hetman / évangélique, appelé le rouge » (Mikołay Xże na Birżach, Wda Wilenski, Kanclerz y Hetman / Evangelik, cognomento Rufus), de la première moitié du XVIIe siècle. L'homme tient un bâton militaire. Son armure noire est presque identique à l'armure noire de Nicolas III Radziwill au Kunsthistorisches Museum de Vienne. Cette armure, créée par un atelier italien vers 1545, fut offerte à Ferdinand II (1529-1595), archiduc d'Autriche, fils d'Anna Jagellon, en 1580 par Nicolas lui-même. L'épée à sa ceinture est semblable à la rapière dorée de l'archiduc Maximilien, le fils aîné d'Anna Jagellon, créée par Antonio Piccinino à Milan et par un atelier espagnol vers 1550 (Kunsthistorisches Museum de Vienne). L'homme ressemble enfin à l'effigie de la mère de Nicolas Barbara Kolanka par Cranach (Wartburg-Stiftung à Eisenach) et de sa sœur Barbara-La Bella par Titien (Palais Pitti à Florence).
Portrait de Nicolas « le Rouge » Radziwill (1512-1584) par l'atelier de Giovanni Cariani, vers 1547, Musée national d'art de Biélorussie à Minsk.
Portraits des membres de la famille Radziwill par Giampietro Silvio et Paris Bordone
Jean Radziwill (1516-1551), avec son frère aîné Nicolas « le Noir » Radziwill (1515-1565), a grandi à la cour du roi Sigismond l'Ancien. En tant que courtisan royal, muni de lettres de recommandation du roi Sigismond Ier et de la reine Bona, il se rendit en Italie en 1542 - il visita certainement Ferrare, Padoue et Venise. Tant pendant le voyage en Italie qu'au retour, il s'arrêta à Vienne à la cour de Ferdinand, roi de Bohême et de Hongrie. Il retourna à Cracovie en septembre 1542. C'est probablement au cours de ce voyage que Jean fit la connaissance de la Réforme et revint au pays en tant que luthérien (d'après « Archiva temporum testes ... » de Grzegorz Bujak, Tomasz Nowicki, Piotr Siwicki, p. 218).
Il fut le premier Radziwill à mourir dans la foi évangélique, comme en témoignent les discours funéraires de Venceslas Agrippa et Philippe Melanchthon - Oratio Fvnebris de Illvstrissimi Principis et Domini Domini Iohannis Radzivili ..., publiés à Wittenberg en 1553. En 1544, il devint le grand pannetier lituanien (krajczy, incisor Lithuaniae). Il était aussi le staroste de Tykocin. Il correspondait avec le duc Albert de Prusse, comme l'ont conservé plusieurs lettres du duc à Jean datant de 1546. Le 24 décembre 1547, grâce aux efforts de son frère aîné, il reçut le titre de prince du Saint-Empire romain germanique et cette année-là, il épousa probablement Elżbieta Herburt de Felsztyn. Il mourut sans enfant le 27 septembre 1551. C'est très probablement Jean, cousin de Barbara et confident du jeune roi, qui a facilité leur rencontre (d'après « Przeglad polski ... » de Stanisław Koźmian, tomes 9-12, p. 7). Il a participé à de splendides fêtes et mascarades à Vilnius, au cours desquelles « seulement les salopes ou les veuves connues pour leur prostitution et leur flirt, avant toutes les autres femmes respectables, sont accueillies. Chacune, parce que les richesses n'ont de valeur que dans notre pays, se considère tout à fait honnête lorsqu'elle voyage dans une magnifique calèche tirée par de nombreux chevaux, ou lorsqu'elle est parée d'or, d'écarlate [tissus] et de perles, et se présente aux yeux des gens sur toutes les places de marché et carrefours », a déploré le théologien calviniste Andrzej Wolan (Andreas Volanus), secrétaire royal (texte publié en 1569). Au cours d'une de ces fêtes, Jean Radziwill est devenu obsédé par une femme et a quitté sa femme (d'après « Najsłynniejsze miłości królów polskich » de Jerzy Besala, p. 111-114). « Auguste tomba amoureux de Barbara Radziwill, une femme d'une famille célèbre de Lituanie [...] qui accorda toujours plus d'attention à d'autres choses que la gloire [c'est-à-dire la bonne opinion]. Ayant perdu sa virginité avec beaucoup, le roi, trompé par eux, glorifiant la forme et le corps et la débauche facile, lui furent d'abord emmené » - a écrit le secrétaire du nonce papal, Antonio Maria Graziani (Gratiani). Ils se connaissaient probablement depuis l'enfance, car Sigismond Auguste passait souvent du temps en Lituanie avec ses parents et le manoir de Radziwill était adjacent au château grand-ducal de Vilnius. Peut-être que la prochaine réunion eut lieu à Hieraniony (Gieranony) en Biélorussie en octobre 1543. Peu de temps après la mort de la première épouse de Sigismond Auguste, de nombreuses personnes parlaient d'un éventuel mariage. Bientôt, des commentaires très désagréables commencèrent à circuler à propos de la favorite du roi. Le chanoine Stanisław Górski (mort en 1572), secrétaire de la reine Bona entre 1535 et 1548, dénombra trente-huit de ses amants, l'appelait « une grande pute » (wiborna kurwa) ou magna meretrix et affirmait qu'elle ne montrait aucun chagrin suite à la perte de son premier mari et qu'elle ne portait pas non plus le deuil de veuve. Stanisław Orzechowski (1513-1566), chanoine de Przemyśl, opposant au célibat, écrivait en 1548 : « Lorsqu'elle grandit et fut donnée à son précédent mari, elle se conduisit de telle manière qu'elle a égalé ou dépassé sa mère en disgrâce, et a été marquée par de nombreuses taches de luxure et d'impudeur ». Il écrit aussi : « Il y a des gens ici et là qui se roulaient lascivement avec cette Thaïs [une courtisane repentante] ». Plus tard, même son cousin Nicolas « le Noir » parla d'elle en termes défavorables : « Après tout, elle était mariée à Gostautas, et dans cette maison ex usu et natura crescebat illa diabolica symulatio [la simulation diabolique est née de la pratique et de la nature] », et qu'elle « s'est livrée à des pratiques diaboliques par nécessité et par nature ». De telles rumeurs étaient probablement alimentées par la reine Bona, car le mariage avec un sujet n'était pas favorisé dans la majorité des pays hautement hiérarchiques d'Europe occidentale, y compris son Italie natale (en Pologne-Lituanie, le monarque était élu et il n'y avait pas de titres héréditaires en dehors de ceux accordés par l'empereur, cherchant ainsi des partisans). Elle exprima ses inquiétudes dans une lettre adressée au maire de Gdańsk, Johann von Werden (1495-1554). De nombreux auteurs renommés furent impliqués dans cette campagne visant à déshonorer la maîtresse du roi, il est donc difficile aujourd'hui de déterminer dans quelle mesure cela était vrai. Le frère de Barbara, Nicolas « le Rouge », et son cousin Nicolas « le Noir », après avoir consulté sa mère Barbara Kolanka, ont demandé au roi de cesser de visiter leur maison car ses relations avec Barbara faisaient honte à toute la famille. Peu de temps après, le roi épousa secrètement sa maîtresse. Lorsque Barbara devint reine, son frère Nicolas « le Rouge » était le supérieur de la garde entourant la reine en Lituanie. Le roi lui envoie de nombreuses lettres (conservées à la Bibliothèque impériale de Saint-Pétersbourg). Sigismond Auguste avait peur que Barbara ne soit empoisonnée. Il y a des avertissements détaillés sur la façon dont la reine doit boire et qui doit préparer sa boisson et il préfère que les hommes, et non les femmes, lui donnent à boire. La reine voudrait également se conformer en tout aux souhaits de son mari. Une fois, elle demande quels vêtements porter pour le saluer. Le roi répond qu'elle devrait porter « une robe noire en tissu italien » (d'après « Biblioteka warszawska », tome 4, p. 631). Au Kunsthistorisches Museum de Vienne se trouve le portrait d'un homme tenant une lettre (huile sur toile, 82 x 66 cm, GG 1537). Le tableau provient de la collection de l'archiduc Léopold Guillaume d'Autriche et a été enregistré au Theatrum Pictorium (numéro 54), avant deux tableaux représentant Andrzej Frycz Modrzewski et le roi Sigismond Ier (numéros 56, 57), identifiés par moi. Selon une inscription au Theatrum Pictorium, le tableau original a été peint par Titien (I. Titian p.), tandis que la toile de Vienne est signée par un autre peintre vénitien Giampietro Silvio (1495-1552), ce qui indique que la signature n'était probablement pas connue auparavant. Le portrait s'inspire clairement de certaines effigies de Martin Luther et Philippe Mélanchthon réalisées par Lucas Cranach et studio et l'homme ressemble à un prédicateur protestant. Cependant, son manteau noir de soie brillante et sa riche bague à son doigt indiquent qu'il est plutôt un aristocrate. D'après la signature mentionnée du peintre à droite au-dessus de son épaule, le tableau a été réalisé en 1542 (Jo.pe.S. 1542), lorsque Jean Radziwill visita la République de Venise et de Vienne. Le même homme est représenté dans un autre tableau de Silvio, aujourd'hui conservé à la Gemäldegalerie de Berlin (huile sur toile, 102 x 144 cm, numéro d'inventaire 196). Le tableau fut acheté en 1815 à Paris dans la collection Giustiniani par Frédéric-Guillaume III (1770-1840), roi de Prusse, avec près de 160 autres œuvres et transféré à Berlin. La collection a été transférée à Paris en 1807 depuis Rome, où elle était conservée dans le palais Giustiniani construit au début du XVIIe siècle et correspond probablement au tableau mentionné dans l'inventaire de la collection de 1638 avec attribution à Giorgione. L'homme porte un manteau rouge de staroste ou semblable au żupan cramoisi de la noblesse polono-lituanienne, le tableau a donc été créé après 1544. La scène représente le Christ et la femme adultère (La femme adultère amenée devant le Christ), illustrant le passage du Nouveau Testament dans lequel un groupe de scribes et de pharisiens affrontent Jésus, interrompant son enseignement. Ils amènent une femme, l'accusant d'avoir commis un adultère. Ils disent à Jésus que la punition pour quelqu'un comme elle devrait être la lapidation, comme le prescrit la loi mosaïque. Il leur dit: « Que celui d'entre vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle ». On pense que l'effigie de la femme adultère est un portrait déguisé d'une célèbre et « magnifique courtisane » (somtuosa meretrize) Julia Lombardo, qui possédait un tel tableau avant sa mort en 1542 à Venise. On ne sait pas comment le tableau est arrivé à Rome dans la collection du banquier génois Vincenzo Giustiniani (1564-1637). Très probablement, il a été envoyé dans la Ville éternelle peu de temps après sa création. La femme ressemble à l'effigie de la reine Barbara réalisée par l'atelier de Paris Bordone à Knole House, Kent (NT 129951) et à d'autres portraits de la reine, tandis que le visage du Christ ressemble beaucoup à l'effigie du frère de Barbara, Nicolas « le Rouge », par atelier de Giovanni Cariani au Musée national d'art de Biélorussie à Minsk. Il a les cheveux foncés car le Christ ne pouvait pas avoir les cheveux roux, selon l'iconographie connue. Une autre version de ce tableau se trouve à Vilnius. Il provient de la collection du Dr Pranas Kiznis exposée au Palais des Grands-Ducs de Lituanie. La collection comprend le portrait du pape Léon X par Jacopino del Conte et Suzanne et les vieillards par Palma il Giovane. La provenance exacte n'est pas précisée, même si le tableau a été acquis en Italie, où il a probablement également été réalisé, cela n'exclut pas l'identification des mêmes protagonistes comme des portraits déguisés de Barbara Radziwill et de son frère. Ce tableau avait une signification politique importante et pouvait donc être destiné à la famille ou aux amis en Italie. On sait très peu de choses sur Silvio, décédé à Venise en 1551, probablement né sur le territoire vénitien vers 1495 et qui signa certaines de ses œuvres Joannes Petrus Silvius Venetus, se définissant ainsi comme Vénitien. Peut-être que son séjour en Pologne-Lituanie reste à découvrir. De telles représentations dans la scène du Christ et de la femme adultère étaient populaires dans l'Europe du XVIe siècle, notamment dans ce contexte d'« adultère » bien connu. Le tableau de Georg Vischer de la Galerie électorale de Munich (Alte Pinakothek, numéro d'inventaire 1411), daté de 1637, est très probablement une copie d'un original perdu d'Albrecht Dürer datant d'environ 1520. Dürer s'est représenté comme le Christ et la femme adultère porte les traits de une maîtresse d'Alphonse d'Este (1476-1534), duc de Ferrare (parent de la reine Bona Sforza) - Laura Dianti (décédée en 1573), appelée Eustochia. Laura était fréquemment représentée sous de nombreux déguisements bibliques, comme la Vierge à l'Enfant avec l'enfant saint Jean-Baptiste (Galerie des Offices à Florence et Musée Fesch à Ajaccio), sainte Marie-Madeleine (collection privée), Salomé (collection privée), tous par Titien et suiveurs et aussi dans la scène de Jésus prêchant à Laura Dianti et son arrière-petit-fils Alphonse III d'Este, duc de Modène et Reggio par cercle de Sante Peranda (Château de Chenonceau). Semblable au tableau berlinois où Jean Radziwill était représenté dans le coin supérieur gauche en tant que donateur, une telle effigie se retrouve également dans le tableau de Vischer (un homme avec une casquette verte regardant le spectateur). En 1642, dans un conflit avec la famille d'Este, les avocats du Saint-Siège ont même évoqué la façon dont la grand-mère du duc François Ier était représentée dans un portrait d'il y a de nombreuses années (un portrait de Laura représentée comme une courtisane exotique par Titien). L'absence d'insignes et la libre convention d'une femme « indécente » étaient, à leur avis, la preuve que le dirigeant était né hors mariage (d'après « Prawna ochrona królewskich wizerunków » de Jacek Żukowski). C'est pourquoi de nombreuses effigies « indécentes » furent détruites lors de la Contre-Réforme, dont très probablement l'original de Dürer. Une autre scène similaire avec des portraits se trouve au château de Johannisburg à Aschaffenburg (numéro d'inventaire 6246). Il provient de la galerie de Zweibrücken et se trouvait peut-être autrefois dans la cathédrale de Halle, remaniée vers 1520 par le cardinal Albert de Brandebourg (1490-1545). Dans ce tableau, attribué à l'atelier ou au cercle de Lucas Cranach l'Ancien (peut-être Hans Abel), Albert était représenté sous les traits du Christ et de sa concubine Elisabeth (Leys) Schütz (décédée en 1527) comme la femme adultère. Le cardinal était également fréquemment représenté sous d'autres déguisements religieux, tels que saint Jérôme, saint Érasme et saint Martin et sa concubine en sainte Ursule. La même femme et le même homme étaient également représentés ensemble dans un autre tableau. Ce portrait est attribué à Paris Bordone, mais son style révèle de grandes similitudes avec certaines œuvres de Giovanni Cariani, comme l'effigie évoquée de Nicolas « le Rouge » à Minsk. Bordone a probablement copié un tableau de Cariani et s'est inspiré de son style. Le tableau se trouve maintenant au musée Nivaagaard à Nivå, au Danemark (huile sur toile, 84,5 x 71 cm, 0009NMK) et a été acheté le 11 septembre 1906 de Lesser, Londres par l'homme d'affaires danois Johannes Hage (1842-1923). La tenue d'une jeune femme est très similaire à celle que l'on voit dans un Portrait de jeune femme de Bordone à la National Gallery de Londres, daté vers 1545 (NG674) ou dans un Portrait de dame du palais Pitti de Florence, daté entre 1545 et 1555 (Palatina 109, 1912) ou Femmes à leurs toilettes vers 1545 dans les National Galleries Scotland (NG 10). La femme pose la main sur son ventre comme pour dire qu'elle reste chaste et les rumeurs sont fausses. L'homme qui se tient derrière elle lui ressemble et il tient ses mains sur ses bras en signe de soutien, c'est évidemment son frère. Le même homme est représenté dans un autre tableau de Bordone dans lequel sa pose et ses traits ressemblent également à ceux de son cousin Jean Radziwill de tableau de Silvio à Berlin. Il tient une lettre et le tableau peut être comparé au portrait du joaillier royal Giovanni Jacopo Caraglio au château royal de Wawel datant entre 1547 et 1553. Ce tableau provient de la collection du comte von Galen à Haus Assen à Lippborg dans le nord de l'Allemagne. Depuis le début du XVIIe siècle, la famille Radziwill avait des relations et des propriétés importantes en Allemagne. Le portrait a été vendu en 2004 à Londres (huile sur toile, 92,4 x 74 cm, Sotheby's, 8 juillet 2004, lot 300). Parmi les tableaux appartenant au « Roi victorieux » Jean III Sobieski (1629-1696), qui pourraient provenir de collections royales antérieures et mentionnés dans l'inventaire du palais de Wilanów de 1696, on trouve « Un tableau de mulieris in adulterio a Iudaeis deprehensae [une femme surprise en adultère par les Juifs] dans des cadres dorés et sculptés » (Obraz mulieris in adulterio a Iudaeis deprehensae wramach złocistych rzniętych, n° 70). En plus d'un cadre coûteux, ce tableau était accroché dans un intérieur représentatif de l'Antichambre du roi, à côté d' « Un tableau du Christ Seigneur avec les Pharisiens [Le Christ parmi les docteurs] dans un cadre doré de Raphaël » (Obraz Chrystusa Pana z Farazeuszami wramach złocistych Rafaela, n° 69). L'inventaire des tableaux de la collection de la princesse Louise Charlotte Radziwill (1667-1695), ayant survécu au déluge (1655-1660), dressé en 1671, outre les portraits de la reine Barbara et de son époux, recense les portraits suivants des membres de la famille : Nicolaus Radziwił Dux in Ołyka et Nieśwież Palatinus Vilnen. (10), Joanes Radziwil Dux in Muszniki Archicamer. M.D.L. (15), Joanes Radziwił Dux in Olika et Nieśwież Etatis Sue 35 (17), Nicolaus Radziwił Dux Birzarum et Dubincorum, Palaitinus Vilnen. Gnalis Dux Exercitum M.D.L. (21) et bien d'autres portraits indéterminés comme « Une personne en costume noir à l'allemande, cheveux jaunes » (271). L'inventaire comprend également des tableaux tels que « Lucifer avec des diables, peinture sur tôle » (579).
Portrait de Jean Radziwill (1516-1551) tenant une lettre par Giampietro Silvio, 1542, Kunsthistorisches Museum de Vienne.
Portrait de Jean Radziwill (1516-1551) du Theatrum Pictorium (54) par Jan van Troyen, 1660, Bibliothèque de la Cour princière Waldeck.
Le Christ et la femme adultère avec des portraits de Barbara Radziwill (1520/23-1551), de son frère Nicolas « le Rouge » Radziwill (1512-1584) et de son cousin Jean Radziwill (1516-1551) par Giampietro Silvio, vers 1545-1547, Gemäldegalerie à Berlin.
Le Christ et la femme adultère avec des portraits de Barbara Radziwill (1520/23-1551) et de son frère Nicolas « le Rouge » Radziwill (1512-1584) par Giampietro Silvio, vers 1545-1547, Palais des Grands-Ducs de Lituanie à Vilnius.
Portrait de Barbara Radziwill (1520/23-1551) et de son frère Nicolas « le Rouge » Radziwill (1512-1584) par Paris Bordone, vers 1545-1547, Musée Nivaagaard à Nivå.
Portrait de Nicolas « le Rouge » Radziwill (1512-1584) tenant une lettre par Paris Bordone, vers 1550, Collection privée.
Portraits de Barbara Radziwill enceinte
Dans une lettre du 26 novembre 1547, Stanisław Andrejewicz Dowojno (décédé en 1566) rapporta au roi Sigismond Auguste la fausse couche de Barbara Radziwill, que le roi avait épousé en secret en 1547. Ayant un grand nombre de maîtresses avant, pendant et après son mariage, le roi est resté sans enfant. À un moment donné, le parlement a voulu légitimer et reconnaître comme son successeur tout héritier mâle qui pourrait lui être né.
Le portrait d'une dame avec une servante de Jan van Calcar de la collection du prince Léon Sapieha, vendu en 1904 à Paris, représenterait Barbara Radziwill enceinte (peut-être perdue pendant la Seconde Guerre mondiale). Il montre une femme en robe rouge à l'italienne avec pendentif en émeraude sur la poitrine accompagnée d'une sage-femme. La facture d'un brodeur royal, qui a facturé au trésor « une robe de velours rouge » qu'il a brodée en 1549 pour la reine Barbara avec des perles et du fil d'or pour 100 florins, confirme que des robes similaires étaient en sa possession. Le portrait de Calcar est très similaire dans sa composition au portrait connu comme l'effigie de Sidonia von Borcke (Sidonia la Sorcière) (1548-1620) et attribué à l'atelier de Lucas Cranach l'Ancien. Ce portrait se trouvait avant la Seconde Guerre mondiale dans le palais Von Borcke à Starogard (détruit), propriété d'une riche famille poméranienne d'origine slave, avec l'effigie de Sophie Jagellon (1522-1575) et de son mari. Le costume du modèle est de style allemand et similaire au costume de la parente de Sigismond Auguste, Anna de Brunswick-Lunebourg (1502-1568) (en tant qu'épouse de Barnim XI de Poméranie) d'environ 1545 ou un portrait d'Agnes von Hayn de 1543, tous deux par Cranach ou son atelier, il ne peut donc s'agir de Sidonia, née en 1548. La femme du tableau tient un calice, allusion à sa patronne, sainte Barbe, comme dans un triptyque de Cranach de 1506 à Dresde (la main est presque identique). La page de titre de « L'inscription sur la tombe de la noble reine Barbara Radziwill » (Napis nad grobem zacney Krolowey Barbary Radziwiłowny), un chant funèbre (chant de deuil) louant l'épouse bien-aimée du roi, publié à Cracovie en 1558, est ornée d'une belle gravure sur bois représentant sainte Barbe avec les tours du château en arrière-plan. Les deux peintures, par Calcar et de l'atelier de Cranach, faisaient sans doute alors partie de la propagande jagellonne pour légitimer la maîtresse royale en tant que reine de Pologne.
Portrait de Barbara Radziwill enceinte avec une sage-femme par l'atelier de Lucas Cranach l'Ancien, 1546-1547, Palais Von Borcke à Starogard, très probablement détruit pendant la Seconde Guerre mondiale.
Portrait de Barbara Radziwill enceinte avec une sage-femme par Jan van Calcar ou l'entourage, 1546-1547, collection du Prince Leon Sapieha, vendu en 1904 à Paris, peut-être perdu pendant la Seconde Guerre mondiale.
Portrait de Barbara Radziwill par Moretto da Brescia ou Jan van Calcar
Le portrait de la dame inconnue en blanc à la National Gallery of Art de Washington (huile sur toile, 106,4 x 87,6 cm, 1939.1.230), attribué à Moretto da Brescia, peintre de la République de Venise qui aurait fait son apprentissage chez Titien, peut être comparé à un portrait par Jan Stephan van Calcar, élève de Titien, de la collection Sapieha à Paris. Ce dernier tableau, très probablement perdu pendant la Seconde Guerre mondiale, représenterait la deuxième épouse de Sigismond Auguste enceinte, Barbara Radziwill. Les caractéristiques du visage ainsi que le style et les détails du costume sont très similaires. La robe dans la peinture de Moretto est également très similaire à celle visible sur une miniature d'une dame au collier de perles, qui peut être identifiée comme l'effigie de Bona Sforza d'Aragona, reine de Pologne, de la seconde moitié des années 1540 (Uffizi, Inv. 1890, 9005).
La facture d'un brodeur royal de Sigismond Auguste, qui chargea le trésor pour « une robe de tabinet blanc » qu'il broda en 1549 pour la reine Barbara « d'un large rang de drap d'or et de velours vert » pour 15 florins, confirme que des robes similaires étaient en sa possession. Le tailleur de la reine était un Italien Francesco, qui fut admis à son service à Vilnius le 2 mai 1548 avec un salaire annuel de gr. 30 fl. 30. En mai 1543, lors de l'entrée à Cracovie pour le couronnement d'Elisabeth d'Autriche, les seigneurs et chevaliers du Royaume étaient vêtus de toutes sortes de costumes, notamment italiens, français et espagnols, tandis que le jeune roi Sigismond Auguste était habillé à l'allemande, probablement par courtoisie pour Elizabeth. L'inventaire de la dot de la sœur de Sigismond Auguste, Catherine Jagellon, de 1562 comprend 13 robes françaises et espagnoles. Le tableau de Washington provient de la collection du comte Alessandro Contini Bonacossi (1878-1955) à Rome et à Florence, qui possédait également le portrait de Sigismond Auguste par Francesco Salviati (Mint Museum of Art, 39.1) et des portraits du roi et de son troisième épouse du Tintoret ou du Titien (Galerie des Offices et Musée national de Serbie), vendue en 1936 à la Fondation Samuel H. Kress. Un portrait de la reine Barbara (pièce 19) est mentionné parmi les peintures italiennes de la collection du prince Boguslas Radziwill (1620-1669) en 1657 (Archives centrales des documents historiques de Varsovie - AGAD, 1/354/0/26/79.2).
Portrait de Barbara Radziwill (1520/23-1551) en blanc par Moretto da Brescia ou Jan van Calcar, vers 1546-1548, National Gallery of Art, Washington.
Portraits de Sigismond II Auguste par Jan van Calcar ou Moretto da Brescia
En 1547, malgré la désapprobation de sa mère et l'animosité de la noblesse, Sigismond Auguste, roi de Pologne et grand-duc de Lituanie, épousa secrètement sa maîtresse Barbara Radziwill, une noble lituanienne qu'il rencontra en 1543.
Le portrait attribué à Jan van Calcar (huile sur toile, 125,5 x 92 cm, vendue au Dorotheum de Vienne, 14 avril 2005, lot 12), montre un jeune homme (Sigismond Auguste avait 26 ans en 1546). Il se tient contre des bâtiments anciens similaires à une reconstruction du mausolée de l'empereur Auguste à Rome publiée en 1575 (le roi né le 1er août a été nommé d'après le premier romain L'empereur Gaius Octavius Augustus) et le castrum doloris du roi à Rome en 1572 ou l'obélisque visible dans le portrait du joaillier royal Giovanni Jacopo Caraglio d'environ 1553. Le tableau provient de la collection de John Rushout, 2e baron Northwick (1770-1859), collectionneur passionné d'œuvres d'art, d'antiquités et de pièces de monnaie, très probablement acquises en Italie en 1790. Dans le « Catalogue of the pictures, works of art, &c. at Northwick Park » de 1864, il a été répertorié avec attribution à Parmigianino comme « Portrait de Cosme de Médicis » (Portrait of Cosmo de Medici, n° 34). L'auteur présumé Jan van Calcar, élève de Titien à Venise, s'installa à Naples vers 1543, où il mourut avant 1550. La mère de Sigismond, Bona Sforza, était une petite-fille d'Alphonse II, roi de Naples et à partir de 1524, elle était duchesse de la ville voisine Bari et Rossano. Selon les registres de Sigismond Auguste par un courtisan Stanisław Wlossek de 1545 à 1548, le roi avait « des robes doublées de lynx, courtes italiennes », des robes de velours noir et des bas de « soie ermestno noire », des chaussures en daim noir, etc. Le registre de ses vêtements de 1572 comprend des robes italiennes, allemandes et persanes évaluées à 5351 zloty. Le portrait pourrait être un pendant à un portrait de Barbara Radziwill de dimensions similaires attribué à Moretto da Brescia (National Gallery of Art, 1939.1.230), qui pourrait également être attribué à Calcar, tout comme auparavant le portrait de l'homme décrit ici était attribué à Moretto da Brescia, et inversement. L'homme tient dans sa main droite une fleur d'oeillet rouge, symbole de passion, d'amour, d'affection et de fiançailles. Le même modèle est également représenté dans le portrait à Vienne (Kunsthistorisches Museum, huile sur toile, 86,5 x 59 cm, numéro d'inventaire GG 79), signé par Calcar (. eapolis f. / Stephanus / Calcarius), et dans le tableau attribué à Francesco Salviati, qui séjourna brièvement à Venise, au Mint Museum (huile sur panneau, 109,2 x 82,9 cm, 39.1). Selon l'inscription, le tableau de Vienne a été peint à Naples et a été exposé à la Galerie impériale en 1772, il s'agissait donc probablement d'un cadeau aux Habsbourg. Tandis que le tableau de Salviati provient de la collection du comte Alessandro Contini Bonacossi (1878-1955) à Rome et à Florence, qui possédait également le portrait mentionné de la seconde épouse du roi Barbara Radziwill et des portraits de Sigismond Auguste et de sa troisième épouse par le Tintoret ou le Titien (Galerie des Offices et Musée national de Serbie), vendu à Samuel Henry Kress le 1er septembre 1939. La médaille d'or de Sigismond II Auguste à l'occasion de l'anniversaire et du couronnement avec le buste et les armoiries du jeune roi a été réalisée par le médailleur moins connu Domenico Veneziano (Dominicus Venetus, Dominique de Venise) en 1548 - inscription « Sigismond Auguste, roi de Pologne, grand-duc de Lituanie, 29 ans » (SIGIS[mundus] AVG[ustus] REX POLO[niae] MG[magnus] DVX LIT[huaniae] AET[atis] S[uae] XXIX), aujourd'hui à l'Ossolineum de Wrocław (numéro d'inventaire G 1611). Il a signé son ouvrage au revers autour de l'Aigle polonais : « Domenico Veneziano [me] fit l'an de grâce 1548 » (ANO D[omini] NRI[nostri] M.D.XLVIII. DOMINICVS VENETVS FECIT.).
Portrait de Sigismond II Auguste (1520-1572) par Jan van Calcar ou Moretto da Brescia, vers 1546-1548, collection particulière.
Portrait de Sigismond II Auguste (1520-1572) avec des gants par Jan van Calcar, années 1540, Kunsthistorisches Museum de Vienne.
Portrait de Sigismond II Auguste (1520-1572) avec des gants, attribué à Francesco Salviati, années 1540, Mint Museum of Art, Charlotte.
Portraits de Sigismond Auguste et du joaillier royal Giovanni Jacopo Caraglio par Paris Bordone et atelier
En 1972, le portrait du joaillier royal Giovanni Jacopo Caraglio a été offert au château royal de Wawel à Cracovie par Julian Godlewski. Après 1795, lorsque la Pologne perdit son indépendance, le château, qui fut consumé par un incendie destructeur en 1702 et saccagé à plusieurs reprises par différents envahisseurs, fut transformé en caserne et en hôpital militaire et presque aucune trace de l'ancienne splendeur royale n'y a été conservée. Avant 1664, le tableau se trouvait dans la collection Muselli à Vérone.
Caraglio est né à Vérone dans la République de Venise vers 1500 ou 1505. Il était actif dans sa ville natale, ainsi qu'à Rome et à Venise. En Italie, il était surtout connu comme graveur sur cuivre et médailleur. Il est venu à Cracovie vers 1538 en tant qu'artiste reconnu. Après son arrivée à la cour jagellonne, il se sépare probablement de l'art graphique et se consacre exclusivement à l'orfèvrerie et à la joaillerie, fabriquant principalement des pierres précieuses avec des images de membres de la famille royale. En reconnaissance de ses mérites, Sigismond Auguste l'a anobli en 1552. Caraglio était également citoyen de la capitale Cracovie, et avec sa femme, Katarzyna, née là-bas, il a vécu dans une maison qu'il a achetée à l'extérieur des murs de la ville - à Czarna Wies. Il avait un fils Ludwik et une fille Katarzyna. Durant son long séjour en Pologne, l'artiste a certainement fait de nombreux voyages en Italie. En témoigne, entre autres, l'assez bonne connaissance que Vasari a de sa vie et de son œuvre. Nous apprenons l'un de ses voyages en Italie - probablement pour affaires - grâce aux récits préparés par Justus Decius. La facture d'avril 1553, outre la liste des dépenses pour les minerais par Caraglio, contient entre autres, l'inscription le concernant : pro viatico itineris in Italiam (approvisionnement pour le voyage en Italie) (d'après « Caraglio w Polsce » de Jerzy Wojciechowski , p. 29). Le portrait de Caraglio était au XVIIème siècle attribué à Titien et plus tard à Bordone, qui a vécu à Venise à partir d'octobre 1552 et plus tôt à Milan entre 1548-1552. Caraglio reçoit ou offre humblement un médaillon à l'effigie du roi (probablement réalisé par lui-même) à l'aigle royal polonais avec le monogramme SA de Sigismond Auguste sur sa poitrine. L'aigle est debout sur un casque d'or parmi d'autres ouvrages et ustensiles nécessaires à l'orfèvre. En 1552, Caraglio se rendit à Vilnius pour fabriquer un bouclier doré pour le roi entouré de roses d'or avec une croix en émail rouge et trois autres boucliers d'argent décorés d'un ornement de têtes d'aigles (Exposita pro ornandis scutis S.M.R. per Ioannem Iacobum Caralium Italum 1553), ainsi que trois autres orfèvres Gaspare da Castiglione, Grzegorz de Stradom et Łukasz Susski. En arrière-plan, il y a un obélisque et un amphithéâtre romain, identifié comme symbole de Vérone - Arena di Verona. D'après l'inscription en latin sur le socle de la colonne, il avait 47 ans (ATATIS / SVAE / ANN[O] / ХХХХ / VII) au moment de la création du tableau, cependant son visage semble beaucoup plus jeune. Sur la base de cette inscription, on pense généralement que le tableau a été peint entre 1547 et 1553, peut-être lors de son séjour confirmé en Italie en 1553, néanmoins, on ne peut exclure qu'il soit basé sur un dessin ou une miniature envoyé de Pologne. Caraglio a probablement donné ce portrait à sa sœur Margherita, qui vivait à Vérone. Dans les environs de Parme, dans la ville de Sancti Buseti, l'artiste a acheté une maison avec des terres et des vignes. Caraglio avait l'intention de quitter la cour de Sigismond Auguste dans sa vieillesse et de retourner en Italie. Cependant, il ne remplit pas ses intentions, il mourut à Cracovie vers le 26 août 1565 et fut enterré dans l'église carmélite de la Visitation, qui fut en grande partie détruite lors du déluge (1655-1660). Il lègue la maison de Vérone à Elisabetta, la petite-fille de sa sœur. L'épouse de l'artiste, Katarzyna, s'est remariée avec un cordonnier italien, Scipio de Grandis. Le même homme que dans le tableau de Wawel était représenté dans l'œuvre vendue à Vienne en 2012 (Dorotheum, 13.12.2012, Lot 12, huile sur toile, 61,5 x 53 cm). Il porte un costume similaire, il y a une colonne similaire derrière lui et le tissu en arrière-plan et le style de la peinture entière est très proche de Paris Bordone et de son atelier, comparable au portrait d'homme du Louvre, identifié comme effigie de Thomas Stahel , daté de « 1540 ». Le portrait a été vendu en Autriche, tandis que Caraglio s'est rendu en Slovaquie voisine en 1557, où il a séjourné à la cour d'Olbracht Łaski (1536-1604), un noble polonais, alchimiste et courtisan, à Kežmarok. À l'âge de douze ans, Łaski est envoyé à la cour de l'empereur Charles V, qui le recommande à son frère Ferdinand d'Autriche. Il retourna en Pologne en 1551 et en 1553 il se rendit à Vienne, où il devint le secrétaire de Catherine d'Autriche, qui devint la troisième épouse du roi Sigismond Auguste. En 1556, il visita à nouveau la Pologne, où il rencontra la riche veuve Katarzyna Seredy née Buczyńska. Leur mariage a eu lieu en 1558 à Kežmarok. Il est possible que Łaski ou les Habsbourg aient reçu un portrait du célèbre bijoutier du roi de Pologne. Caraglio a sans aucun doute également servi d'intermédiaire dans les commandes d'effigies de son patron le roi Sigismond Auguste. En 2011, un petit portrait d'homme barbu de la collection du château de Gourdon près de Nice dans le sud de la France a été vendu aux enchères à Paris (huile sur toile, 39,8 x 31,5 cm, Christie's, 30 mars 2011, lot 487). Il a été initialement attribué au suiveur de Moretto da Brescia et plus tard à Paris Bordone et daté des années 1550. Sa provenance antérieure n'est pas connue. Les collections du château médiéval de Gourdon ont été épargnées pendant la Révolution française. Agrandi par les Lombards au XVIIe siècle, le château fut légué par Jean Paul II de Lombard à son neveu le marquis de Villeneuve-Bargemon, dont les héritiers vendirent la demeure en 1918 à une Américaine, Miss Noris, qui ouvrit un musée en 1938. Occupé pendant la Seconde Guerre mondiale par les Allemands, puis restauré par la comtesse Zalewska, il fut ensuite acquis par l'homme d'affaires français Laurent Negro (1929-1996). Il est donc possible que le tableau ait été envoyé de Venise en France déjà au XVIe siècle ou apporté de Pologne par la comtesse Zalewska ou ses ancêtres. Bordone a peint une deuxième version légèrement plus grande de ce portrait (huile sur toile, 57,2 × 41,9 cm) qui se trouvait dans la collection du marquis d'Ailesbury en Angleterre et plus tard à la Hallsborough Gallery de Londres. « La robe des deux personnages est sobre mais clairement luxueuse, et transmet l'importance des modèles sans avoir besoin d'opulence » (d'après l'entrée du catalogue Sphinx Fine Art). Les traits du visage de l'homme, la barbe rousse et les cheveux foncés correspondent parfaitement aux autres effigies du roi Sigismond Auguste par Bordone, Moretto da Brescia ou Jan van Calcar, Francesco Salviati et Tintoret, identifiées par moi. Comme dans le cas du portrait d'Anna de Brunswick-Lunebourg (1502-1568), épouse de Barnim XI de Poméranie par Lucas Cranach l'Ancien et du portrait de Jean III Sobieski avec l'Ordre du Saint-Esprit par Prosper Henricus Lankrink, l'artiste n'a peut-être pas du tout vu le modèle, mais avec des dessins détaillés avec des descriptions de couleurs et de tissus, il a pu produire une œuvre avec beaucoup de savoir-faire et de ressemblance.
Portrait de Sigismond II Auguste (1520-1572), du Château de Gourdon, par Paris Bordone, 1547-1553, Collection particulière.
Portrait de Sigismond II Auguste (1520-1572), de la collection Ailesbury, par Paris Bordone, 1547-1553, Collection particulière.
Portrait du joaillier royal Giovanni Jacopo Caraglio (1500/1505-1565) par l'atelier de Paris Bordone, 1547-1553, Collection particulière.
Portraits de Barbara Radziwill et Sigismond Auguste par l'entourage de Titien
Au XVIIIème siècle, avec la popularité croissante de l'histoire de Marie Stuart, reine d'Écosse, le portrait d'une femme inconnue, soi-disant Portrait de Carleton en Chatsworth House, a été identifié comme son effigie en raison d'une grande similitude avec une estampe de Hieronymus Cock d'environ 1556 et l'histoire de Chatsworth House. De nombreuses estampes et copies de ce portrait ont été réalisées. Aujourd'hui, cependant, les chercheurs rejettent cette identification.
Le style de la peinture est proche du cercle de Titien et du portrait de Venise ainsi que de la composition avec une chaise (« chaise Savonarole »), une fenêtre et de riches tissus, velours vénitien et drap d'or. Le costume cependant, un mélange de motifs français, italiens, espagnols et allemands des années 1540 n'est pas typique de Venise. De plus, le modèle n'est pas une « beauté vénitienne » typique, un peu grassouillette. En 1572, le brodeur royal chargea le trésor royal des robes qu'il brodait pour la reine Barbara en 1549 dont une, la plus chère, pour laquelle il facture 100 florins : « J'ai brodé une robe de velours rouge, corsage, manches et trois rangs en bas de perles et d'or ». Des manches bouffantes similaires aux épaules sont visibles dans les portraits de Barbara par Moretto da Brescia (Washington), Jan van Calcar (Paris, perdu) et par le cercle de Lucas Cranach le Jeune (Cracovie). En février 1548, une longue bataille commença pour reconnaître Barbara comme l'épouse de Sigismund Augustus et la couronner comme reine de Pologne. Presque depuis son mariage en 1547, la santé de Barbara a commencé à décliner. Sigismond Auguste s'est personnellement occupé de sa femme malade. Il pourrait également demander l'aide du seul allié possible - Edouard VI d'Angleterre, un roi enfant, qui comme Sigismond a été couronné à l'âge de 10 ans et fils d'Henri VIII, qui a rompu avec l'Église catholique pour épouser sa maîtresse Anne Boleyn. En 1545, pour guérir sa première épouse Elisabeth d'Autriche de l'épilepsie, Sigismond voulait obtenir un anneau de couronnement du roi d'Angleterre, censé être un antidote efficace. En 1549, arrive à Londres Jan Łaski (Jean de Lasco), un réformateur calviniste polonais, secrétaire du roi Sigismond Ier et ami des Radziwll (le frère de Barbara s'est converti au calvinisme en 1564) pour devenir surintendant de l'église des étrangers. Il a assurément servi d'intermédiaire avec le roi d'Angleterre dans les affaires personnelles de Sigismond Auguste et a peut-être apporté en Angleterre un portrait de sa femme. La tour octogonale du portrait est très similaire au principal monument de Vilnius du XVIe siècle, le clocher médiéval de la cathédrale, reconstruit dans le style Renaissance sous le règne de Sigismond Auguste après 1544 (et plus tard en raison d'incendies et d'invasions) et proche de la résidence de Barbara, le Palais des Grands Ducs de Lituanie. La femme tient deux roses, blanche et rouge - les roses blanches sont devenues des symboles de pureté, les roses rouges du sang rédempteur, et les deux couleurs, ainsi que le vert de leurs feuilles, représentaient également les trois vertus cardinales foi, espoir et amour » (d'après « The Routledge Companion to Medieval Iconography » de Colum Hourihane, 2016, p. 459). Le portrait d'un homme assis près d'une fenêtre avec « une ville du Nord au-delà » est très similaire aux autres effigies de Sigismond Auguste, tandis que le paysage derrière lui est presque identique à celui visible dans le portrait de Carleton. C'est presque comme si le roi était assis sur la même chaise dans la pièce du château de Vilnius à côté de sa femme bien-aimée. Ce portrait provient d'une collection privée à Londres et a été vendu en 1997 avec attribution à Jacopo Robusti, dit Tintoret (huile sur toile, 103,5 x 86,5 cm, vendue chez Christie's Londres, 18 avril 1997, vente aux enchères en direct 5778, lot 159). Dans cette représentation, le nez du monarque est plus crochu que dans d'autres portraits de peintres vénitiens identifiés par moi, cependant dans deux gravures sur bois avec le portrait de Sigismond Auguste, publiées à Cracovie en 1570 dans les « Statuts et privilèges de la Couronne traduits du latin en polonais » (Statuta y przywileie koronne z łacińskiego ięzyka na polskie przełożone) de Jan Herburt, son nez est différent sur les deux. L'apparence étrange et peu naturelle de son doigt indique également que le portrait est très probablement une copie d'une autre effigie ou basé uniquement sur des dessins d'étude. Le portrait d'un général par Titien à la Gemäldegalerie Alte Meister à Kassel est identifié par Iryna Lavrovskaya comme l'effigie du cousin influent de Barbara Radziwill, Nicholas Radziwill, dit « le Noir » (Heritage, N. 2, 1993. pp. 82-84). L'implantation de la galerie de portraits à Niasvij est associée à Radziwill « le Noir », qui commandait des images à l'étranger, notamment à Strasbourg (d'après « Monumenta variis Radivillorum... » de Tadeusz Bernatowicz, p. 20). Semblable au roi Sigismond II Auguste - armures à l'armurerie royale de Stockholm, au musée du Kremlin et au musée de l'armée polonaise à Varsovie, il a commandé une armure et sa barde de cheval complémentaire à Kunz Lochner à Nuremberg (Kunsthistorisches Museum, certains éléments se trouvent au Metropolitan Museum of Art). Dans l'une des lettres, le père nostalgique a demandé à son fils Nicolas Christophe « l'Orphelin », qui étudiait à l'étranger, de commander un portrait et de l'envoyer en Lituanie. Le portrait, envoyé de Strasbourg, suscite des mécontentements et en même temps des remarques cinglantes sur les vêtements de son fils. Le voïvode ordonna de faire un nouveau portrait grandeur nature de son fils afin qu'il puisse voir sa taille. Il a également ordonné qu'une chaîne avec l'image du roi soit peinte sur la poitrine de son fils (d'après « Tylem się w Strazburku nauczył ... » de Zdzisław Pietrzyk, p. 164).
Portrait de Barbara Radziwill (1520/23-1551) par l'entourage de Titien, vers 1549, Chatsworth House.
Portrait de Sigismond II Auguste (1520-1572) par l'entourage de Titien, vers 1547-1549, collection particulière.
Portrait de Nicholas Radziwill, dit « le Noir » (1515-1565) par Titien, 1550-1552, Gemäldegalerie Alte Meister à Kassel.
Portraits de Barbara Radziwill par des peintres flamands
L'effigie, précédemment identifiée comme Anne de Pisseleu, duchesse d'Etampes (les chercheurs modernes rejettent aujourd'hui cette identification), est très similaire dans les traits du visage et le style de costume au portrait dit de Carleton à Chatsworth et au portrait de Barbara Radziwill par Moretto da Brescia à Washington. Il n'est connu que par des copies du XIXe siècle, car l'original d'environ 1550 (ou 1549) de la collection royale française, très probablement d'un peintre flamand, est considéré comme perdu.
Anne de Pisseleu, était une maîtresse de François Ier, roi de France et une fervente calviniste, qui a conseillé François sur la tolérance envers les huguenots. Même après sa déposition, après la mort de François en mars 1547, elle était l'une des protestantes les plus influentes et les plus riches de France. Il ne peut être exclu que Sigismond Auguste et les Radziwill l'aient approchée avec leur cause - le couronnement de Barbara en tant que reine et sa reconnaissance internationale, et que la copie de l'effigie de Barbara qui lui a été offerte ait été après la Révolution française confondue avec son portrait. Vers l'année 1548 ou 1549, Sigismond Auguste a commandé aux Pays-Bas espagnols (Flandre) le premier ensemble de nouvelles tapisseries pour ses résidences (connues sous le nom de tapisseries jagellonnes ou les arras du Wawel). Il est fort probable qu'à l'instar de son père en 1536, il y ait également commandé quelques tableaux. Les détails des vêtements du modèle trouvent également leur confirmation dans la facture du brodeur royal qui a chargé le trésor royal des vêtements qu'il a brodés pour la reine Barbara en 1549: « J'ai brodé un béret de velours rouge avec des perles; j'en ai gagné fl. 6 ». Le portrait d'une dame en costume à l'espagnole, dit Anne Boleyn du musée Condé et réalisé vers 1550, ressemble étonnamment à la série de portraits de la sœur célibataire aînée de Sigismond Auguste à cette époque, Sophie Jagellon. C'est presque comme un pendant au portrait de Sophie, le costume est très similaire et les portraits ont sans doute été créés dans le même atelier. C'est largement idéalisé, comme certains portraits de Marguerite de Parme d'après l'original d'Antonio Moro, néanmoins la ressemblance avec l'apparence de Barbara est forte. Par l'intermédiaire de sa mère, Bona Sforza d'Aragona, le mari de Barbara avait des prétentions sur le royaume de Naples et le duché de Milan, tous deux faisant partie de l'empire espagnol. De même que le portrait précédent, les robes noires sont également incluses dans la même facture du brodeur royal pour 1549: « une robe de teletta noire, j'ai brodé un corsage et des manches avec des perles; j'ai gagné de cette robe fl. 40. » ou « J'ai brodé une robe de velours noir, deux rangées de perles dans le bas; j'en ai gagné 60 fl. » . Le portrait d'une femme mystérieuse de la Picker Art Gallery à Hamilton a sans aucun doute été peint par un maître néerlandais et est très proche du style un peu caricatural de Joos van Cleve et de son fils Cornelis (par exemple, les portraits d'Henri VIII d'Angleterre). La femme porte cependant un costume italien des années 1540, semblable au portrait d'une dame avec un livre de musique du Getty Center. Le bijou de son collier a également une signification symbolique adéquate, le rubis est un symbole à la fois de la royauté et de l'amour, le saphir un symbole de pureté et du Royaume de Dieu et une perle était un symbole de fidélité. A part la ressemblance avec d'autres portraits de Barbara, dont le mari aimait beaucoup la mode italienne, et son tailleur était italien, c'est un autre indice qu'il s'agit aussi de son portrait.
Portrait de Barbara Radziwill dans un béret de perles, gravure de 1849 d'après l'original perdu du peintre flamand d'environ 1549, collection particulière.
Portrait de Barbara Radziwill dans un béret de perles, XIXe siècle d'après l'original perdu du peintre flamand d'environ 1549, Victoria and Albert Museum.
Portrait de Barbara Radziwill en costume espagnol par un peintre flamand, vers 1550, Musée Condé.
Portrait de Barbara Radziwill en costume italien par un peintre flamand, peut-être Cornelis van Cleve, 1545-1550, Picker Art Gallery à Hamilton.
Portrait de la reine Bona Sforza par Lucas Cranach le Jeune
Le portrait d'une vieille femme par Lucas Cranach le Jeune du Musée des beaux-arts de Boston présente une forte similitude avec les effigies contemporaines de Bona Sforza, reine de Pologne. La reine a commencé à porter sa tenue distinctive de dame aînée veuve vers 1548, après la mort de Sigismond Ier.
Quant à la couleur des yeux et aux caractéristiques, la comparaison avec les portraits de l'empereur Charles Quint, ses portraits par Bernardino Licinio et de sa fille, preuves que différents ateliers interprétaient différemment les effigies royales et autant plus que l'outremer naturel (couleur bleu foncé) était un pigment coûteux au XVIe siècle, des pigments moins chers ont été utilisés pour faire une copie (couleur des yeux). Dans une lettre du 31 août 1538, Bona Sforza parle de deux portraits de sa fille Isabelle, et se plaint que ses traits dans le portrait qu'elle a ne sont pas très précis. Comme les peintres vénitiens, pour répondre à la forte demande pour ses œuvres, Cranach a développé un grand atelier et « un style de peinture qui dépendait de solutions de raccourci et d'une utilisation intensive de motifs facilement copiés et de méthodes par cœur pour produire des détails décoratifs qui pourraient être reproduits avec succès par les assistants ». Une épithète « le peintre le plus rapide » (pictor celerrimus), peut encore être lue sur sa tombe dans l'église de la ville de Weimar (d'après « German Paintings in the Metropolitan Museum of Art, 1350-1600 », p. 77). Malgré d'énormes pertes au cours de nombreuses guerres et invasions, le nom de Cranach ou des peintures de son style apparaissent dans de nombreux livres et inventaires concernant les collections historiques de peintures en Pologne-Lituanie. Avant son accession au trône en tant que souverain unique, Sigismond Auguste, par l'intermédiaire de son cousin le duc Albert de Prusse, tente d'obtenir des portraits de princes allemands peints par Lucas Cranach l'Ancien (d'après « Malarstwo polskie : Gotyk, renesans, wczesny manieryzm » de Michał Walicki, p. 36). Des peintures furent envoyées en février 1547 par l'intermédiaire de Piotr Wojanowski, locataire de Grudziądz et furent accrochées dans la galerie royale en cours de création à Vilnius (d'après « Zygmunt August : Wielki Książę Litwy do roku 1548 » de Ludwik Kolankowski, p. 329). La peinture de la Vierge à l'Enfant avec deux anges contre le paysage par un suiveur de Lucas Cranach l'Ancien, a probablement été offerte à l'église Corpus Christi de Cracovie par le roi Sigismond II Auguste. La première mention du tableau remonte à 1571 et fut rapportée plus tard par le chroniqueur du monastère, Stefan Ranotowicz (1617-1694) dans son Casimiriae civitatis, urbi Cracoviensi confrontatae, origo. Ranotowicz déclare que « nous avons une peinture allemande dans le pallatium de la donation royale représentant Beatae Mariae Virginis » (d'après « Madonna z Dzieciątkiem w krakowskim klasztorze kanoników regularnych ... » de Zbigniew Jakubowski, p. 130). Nicolas « le Noir » Radziwill, cousin de la deuxième épouse du roi Barbara, avait une tapisserie allemande basée sur la peinture de Cranach et en 1535, un Poméranien, Antoni Wida, probablement un élève de Cranach, réside à Cracovie et en 1557 il est enregistré comme un peintre de la cour de Sigismond Auguste à Vilnius (en partie d'après « Dwa nieznane obrazy Łukasza Cranacha Starszego » de Wanda Drecka, p. 625). Des inventaires dressés en 1671 à Königsberg répertorient l'immense fortune héritée par la princesse Louise Charlotte Radziwill (1667-1695) de son père Boguslas Radziwill (1620-1669), dont les domaines étaient comparés par les contemporains à « Mantoue, Modène et d'autres états plus petits en Italie ». Parmi plus de 900 peintures de l'inventaire, il y avait des portraits, des scènes mythologiques et bibliques de Lucas Cranach (24 pièces) ainsi que « Le visage de Jésus d'Albert Duer », c'est-à-dire Albrecht Dürer, et une « peinture de Pawel Caliaro », c'est-à-dire Paolo Caliari dit Véronèse, environ 25 peintures italiennes, plusieurs portraits de dames et messieurs inconnus italiens, allemands et français, des peintures avec des femmes « nues » et « à moitié nues », des icônes ruthènes et russes, un autel grec et une « Fantaisie espagnole ». Portraits de membres de la famille Radziwill, rois polonais depuis Jean Ier Albert (1459-1501), plus de 20 effigies des Vasa et de leurs familles, empereurs allemands, rois de Suède, de France, d'Angleterre et d'Espagne et de diverses personnalités étrangères, rassemblés sur plusieurs générations, constituaient la partie dominante de plus de 300 pièces de l'inventaire (d'après « Galerie obrazów i "Gabinety Sztuki" Radziwiłłów w XVII w. » de Teresa Sulerzyska, p. 90). L'inventaire recense également de nombreuses peintures qui peuvent être de Cranach l'Ancien et de son fils ou de peintres vénitiens ou néerlandais du XVIe siècle : Une dame en robe blanche, avec des bijoux, une couronne sur la tête (71), Une dame en manteau de lynx en noir, un chien à ses côtés (72), Une dame en czamara, une couronne de diamants sur la tête avec des perles, tenant des gants (73), Une belle dame en tenue de perles et une robe brodée de perles (80), Une femme qui s'est poignardée avec un couteau (292), Une femme, image semi-circulaire en haut (293), Un homme de cette forme, peut-être le mari de cette femme (294), Dido qui s'est poignardée avec un couteau (417), Une grande image de Venise (472), Lucrèce qui s'est poignardée, cadres dorés (690), Une femme nue qui s'est poignardée, cadres dorés (691), Une dame bien habillée avec un enfant, sur panneau (692) , Une dame en robe rouge qui s'est poignardée (693), Petite image : un Allemand avec une femme nue (embrassant, des garçons nus servent) (737), Une personne avec une longue barbe, en noir, inscription An° 1553 etatis 47 (753), Une dame sous la tente montrait sa poitrine (840), Vénus avec Cupidon piqué par les abeilles (763), deux portraits de Barbara Radziwill, reine de Pologne (79 et 115) et un portrait du roi Sigismond Auguste de Pologne, sur panneau (595) (d'après « Inwentarz galerii obrazów Radziwiłłów z XVII w. » par Teresa Sulerzyska). L'inventaire comprend également plusieurs peintures de nus et érotiques et ce n'est qu'une partie des splendides collections des Radziwll qui ont survécu au déluge (1655-1660). Peut-être les tableaux appartenant à un citoyen de Cracovie Melchior Czyżewski (décédé en 1542) : Tabula Judith et Herodiadis ex utraque parte depicta et par le conseiller de Cracovie Jan Pavioli en 1655 : « bain de Bethsabée », « Judith », « portrait de Christian, roi de Danemark », « le duc de Saxe », avait quelque chose en commun avec l'atelier de Wittenberg. Dans la collection du roi Jean II Casimir Vasa, petit-fils de Bona Sforza, vendue aux enchères à Paris en 1672, il y avait la Vierge à l'Enfant de Cranach (Une Vierge avec un petit Christ, peint sur bois. Original de Lucas Cronus), portant peut-être des traits de sa célèbre grand-mère. Le roi Stanislas Auguste (1732-1798), possédait 6 tableaux de Cranach et de son atelier, l'un de saint Jérôme, les cinq autres sur des sujets mythologiques : Vénus et l'Amour sur bois (n° 941), Pyrame et Thisbé (n° 912), Venus Couchée (n° 913), Venus surprise avec Mars (n° 914), Venus et Mars (n° 915). De nombreuses peintures vénitiennes, italiennes et allemandes ont été exposées à Varsovie au Palais Bruhl en 1880, certaines d'entre elles faisant peut-être partie à l'origine de la collection royale : Lucas Cranach - Vieil homme avec une jeune fille (35, Musée), Jacopo Bassano - Vulcain forgeant les flèches (43, Musée), Moretto da Brescia - Vierge avec saint Roch et sainte Anne (51, Musée), Gentile Bellini - Le Christ descendu de la croix, entouré de saints (66, Musée), Le Tintoret - Baptême de Christ (71, 81, Musée), école de Paolo Veronese - Tentation de Saint Antoine (84, Musée), Jacopo Bassano - Adoration des Bergers, propriété de la Comtesse Kossakowska (4, salle D), école de Titien - Baptême du Christ, propriété de la comtesse Maria Łubieńska (6, salle D), Giovanni Bellini - Madone, propriété du comte Stanisław Plater-Zyberk (75, salle D), Bernardo Luini - Christ et saint Jean, propriété de Mme Chrapowicka (76, salle D), Bassano - scène biblique, propriété de Mme Rusiecka (19, salle E), école vénitienne - Objet historique : Fête des Rois, propriété de Jan Sulatycki (2, salle F), Lucas Cranach - Nymphe couchée, propriété de Jan Sulatycki (35, salle F) (d'après « Katalog obrazów starożytnych …» de Józef Unger). D'autres peintures importantes de Cranach et de son atelier liées à la Pologne et très probablement à la cour royale incluent la stigmatisation de saint François, créée vers 1502-1503, aujourd'hui au Belvédère de Vienne (numéro d'inventaire 1273), en Pologne, probablement déjà au XVIème siècle et au XIXe siècle dans la collection de la famille Szembek à Zawada près de Myślenice, comparables aux peintures des maîtres italiens Gentile da Fabriano (Fondation Magnani-Rocca) ou Lorenzo di Credi (Musée Fesch), le Massacre des Innocents au Musée national de Varsovie (M.Ob.587), qui était vers 1850 dans la collection Regulski à Varsovie, portrait de la princesse Sibylle de Clèves (1512-1554) en mariée de la collection Skórzewski, signé avec l'insigne de l'artiste et daté « 1526 » (Musée national de Poznań, perdu), portrait de George le Barbu, duc de Saxe, époux de Barbara Jagellon (Académie polonaise de l'apprentissage à Cracovie, perdu), portrait présumé d'Henri IV le Pieux, duc de Saxe (collection Frąckiewicz, perdu), portrait en miniature de Katharina von Bora « la luthérienne » (collection de Leandro Marconi à Varsovie, détruit en 1944) (partiellement d'après « Polskie Cranachiana » de Wanda Drecka).
Portrait de la reine Bona Sforza par Lucas Cranach le Jeune, 1549, Museum of Fine Arts, Boston.
Portrait de Sigismond Auguste avec la construction d'un pont à Varsovie par le Tintoret
« Sigismond Auguste a construit un pont en bois sur la Vistule, long de 1150 pieds, qui était presque inégalé en termes de longueur et de magnificence dans toute l'Europe, provoquant l'admiration universelle », déclare Georg Braun, dans son ouvrage Theatri praecipuarum totius mundi urbium (Revue des grandes villes du monde) publiée à Cologne en 1617.
En 1549, pour faciliter la communication avec le Grand-Duché de Lituanie, où résidait Barbara, Sigismond Auguste décida de financer la construction d'un pont permanent à Varsovie. En 1549, il acheta à Stanisław Jeżowski, un écrivain foncier de Varsovie, le privilège héréditaire du transport à travers la Vistule, lui donnant en retour « deux villages, un moulin et demi d'un deuxième moulin, 40 voloks forestiers et 200 florins ». Le portrait d'un homme avec un « paysage du Nord » montrant une construction d'un pont en bois à la National Gallery of Art de Washington, créé par Jacopo Tintoretto, est très similaire à d'autres effigies de Sigismond Auguste. Il fut acheté en 1839 à Bologne par William Buchanan. La ville de Bologne était célèbre pour son université, ses architectes et ses ingénieurs, comme Giacomo da Vignola (1507-1573), qui y commença sa carrière d'architecte et où en 1548 il construisit trois écluses ou Sebastiano Serlio (1475-1554), un remarquable architecte et théoricien de l'architecture né à Bologne. En 1547, la reine Bona voulait impliquer Serlio, marié à sa dame d'honneur Francesca Palladia, à sa cour. Comme Serlio avait déjà un poste en France, il proposa à Bona ses élèves. Dans une lettre à Ercole d'Este, Bona demanda un bâtisseur capable de construire tout et en 1549 la reine s'installa à Varsovie. À partir de 1548, le médecin de la cour du roi était Piotr de Poznań, qui obtint son doctorat à Bologne et en 1549, un Espagnol formé à Bologne, Pedro Ruiz de Moros (Piotr Roizjusz), devint courtisan de Sigismond Auguste et conseiller juridique de la cour (iuris consultus), grâce à la recommandation de son collègue des études à Bologne, secrétaire royal Marcin Kromer. Du 4 juin au 24 septembre 1547, le maître charpentier Maciej, appelé Mathias Molendinator, avec ses aides, dirigea la construction d'un pont en bois sur des supports en brique recouverts d'un toit en bardeaux, qui traversait la rivière Vilnia à Vilnius du palais royal aux écuries royales. On ne sait pas si la construction a réellement commencé en 1549 ou si le portrait n'était qu'un élément d'une série de matériaux destinés à des fins de propagande, confirmant la créativité et l'innovation de l'État jagellonien. Il est possible qu'en raison de problèmes pour trouver un ingénieur apte à aider à la construction du plus grand pont d'Europe du XVIe siècle, le projet a été reporté. Ce n'est qu'après 19 ans, le 25 juin 1568, dix ans après le début de la poste polonaise régulière (Cracovie - Venise), que le tapotement de la première pile fut lancé. Le pont a été ouvert au public le 5 avril 1573, quelques mois après la mort de son fondateur, accomplie par sa sœur Anna Jagiellon, qui a également construit la tour du pont en 1582 pour protéger la construction. Le pont de 500 mètres de long était le premier passage permanent sur la Vistule à Varsovie, le plus long passage en bois d'Europe à l'époque et une nouveauté technique. Il était fait de bois de chêne et de fer et équipé d'un système de suspension. Le pont a été construit par « Erasmus Cziotko, fabrikator pontis Varszoviensis » (Erazm z Zakroczymia), qui selon certains chercheurs était un Italien et son vrai nom était Giotto, un nom de famille porté par une famille de constructeurs florentins.
Portrait de Sigismond Auguste avec la construction d'un pont à Varsovie par le Tintoret, vers 1549, National Gallery of Art, Washington.
Portrait de Sigismond Auguste par le Tintoret ou atelier, années 1540, collection particulière.
Portraits de Sigismond Auguste en armure et au chapeau noir par Le Tintoret
Au début de 1549, Barbara Radziwill est arrivée de Vilnius via la ville royale de Radom (septembre 1548) à Nowy Korczyn près de Cracovie pour son couronnement et son entrée cérémonielle dans la ville en tant que nouvelle reine. Huit fois par an, de grandes foires aux céréales avaient lieu dans la ville de Nowy Korczyn. Le grain acheté là-bas était acheminé sur la Vistule jusqu'à Gdańsk dans de grandes péniches, semblables à des galères, comme visible dans la Vue de Varsovie d'environ 1625. Les seigneurs du Royaume arrivèrent pour saluer Barbara à Korczyn et le 12 février 1549, elle embarqua sur un voyage vers la capitale.
Le trajet fluvial depuis ou vers Korczyn serait le plus facile, mais les sources ne le confirment pas. Les récits de 1535 renseignent néanmoins sur les bateaux appartenant à Sigismond Ier et à son fils Sigismond Auguste. La statue sur le navire, visible sur le tableau, est clairement Saint Christophe, un saint patron des voyageurs, il ne s'agit donc probablement pas d'un navire de guerre. L'effigie est à Vienne et les Habsbourg autrichiens étaient des parents de Sigismond Auguste par l'intermédiaire d'Anne Jagellon (1503-1547), deux de ses épouses étaient ses filles et des portraits étaient souvent commandés pour être envoyés à des parents éloignés. Le portrait qui pourrait être daté de 1550, bien qu'idéalisé, ressemble à d'autres effigies du roi par Le Tintoret et porte une inscription ANOR XXX (an 30) sur la base de la colonne. Sigismond Auguste a atteint son 30e anniversaire le 1er août 1550 et sa femme bien-aimée a été couronnée le 7 décembre 1550. Enfin, sa mère a été décrite comme une jolie blonde claire, « quand (curieusement) ses cils et ses sourcils sont complètement noirs », alors l'anomalie de la couleur des cheveux a-t-elle été héritée d'elle ? Le même modèle a également été représenté portant un chapeau noir dans un portrait de collection privée par Le Tintoret et une copie d'atelier de celui-ci au Musée des Beaux-Arts de Rouen.
Portrait de Sigismond II Auguste (1520-1572) avec une galère royale par Le Tintoret, vers 1550, Kunsthistorisches Museum de Vienne.
Portrait de Sigismond II Auguste (1520-1572) en armure par l'entourage du Tintoret, vers 1550, collection particulière.
Portrait de Sigismond Auguste au chapeau noir par Le Tintoret, 1545-1550, collection particulière.
Sigismond Auguste et Barbara Radziwill comme Jupiter et Io par Paris Bordone
Dans les « Métamorphoses » d'Ovide, Jupiter, le roi des dieux a remarqué Io, une mortelle et une prêtresse de sa femme Junon, reine des dieux. Il la convoitait et la séduisait. Le tableau de Paris Bordone à Göteborg montre le moment où le dieu découvre que sa femme jalouse approche et il lève son manteau vert pour cacher sa maîtresse. Le mythe correspond parfaitement à l'histoire d'amour de Sigismond Auguste et de sa maîtresse Barbara Radziwill, une noble lituanienne qu'il rencontra en 1543, alors qu'il était marié à Elisabeth d'Autriche (1526-1545), et qu'il épousa en secret malgré la désapprobation de sa mère, la puissante reine Bona.
Selon Vasari, Bordone a créé deux versions de la composition. L'une pour le cardinal Jean de Lorraine (1498-1550) en 1538, lorsqu'il se rendit à la cour de François Ier de France à Fontainebleau, et l'autre « Jupiter et une nymphe » pour le roi de Pologne. Les chercheurs ont souligné que stylistiquement, la toile devrait être datée des années 1550, il ne peut donc pas s'agir de la peinture créée pour le cardinal de Lorraine. Le tableau aurait été apporté en Suède par Louis Masreliez (1748-1810), un peintre français, il ne peut donc être exclu qu'il ait été emmené en France par Jean Casimir Vasa, arrière-petit-fils de Bona, après son abdiction en 1668, que Masreliez acquis en Italie une copie de tableau préparé pour le roi de Pologne, peut-être un modello ou un ricordo, ou qu'il fut capturé par l'armée suédoise pendant le Déluge (1655-1660) et acheté par Masreliez en Suède. L'effigie d'Io n'est pas si « statuesque » que d'autres effigies des déesses par Bordone, pourrait être une courtisane, mais pourrait surtout être la maîtresse royale et peut être comparée aux effigies de Barbara, tandis que Jupiter à celles de Sigismond Auguste. La peinture pourrait alors être considérée comme faisant partie de la propagande jagellonne pour légitimer la maîtresse royale en tant que reine de Pologne.
Sigismond Auguste et Barbara Radziwill comme Jupiter et Io par Paris Bordone, années 1550, Musée des Beaux-Arts de Göteborg.
Sigismond Auguste en Christ comme la lumière du monde par Paris Bordone
Le goût particulier de la reine Bona pour les peintures la représentant en Vierge Marie et son fils en Jésus, en personnages bibliques et les saints est confirmé par ses effigies de Francesco Bissolo et Lucas Cranach. Ce type de portraits était populaire dans toute l'Europe depuis le Moyen Âge.
Les exemples incluent l'effigie d'Agnès Sorel, maîtresse du roi Charles VII de France, comme Vierge allaitante par Jean Fouquet des années 1450, Giulia Farnese, maîtresse du pape Alexandre VI comme la Vierge Marie (« la signora Giulia Farnese nel volto d'una Nostra Donna » selon Vasari) et sa fille Lucrèce Borgia en sainte Catherine par Pinturicchio des années 1490, Marie de Bourgogne sous les traits de Marie Madeleine créée vers 1500, François Ier de France en saint Jean Baptiste par Jean Clouet d'environ 1518, Catherine d'Autriche, reine du Portugal en sainte Catherine par Domingo Carvalho d'environ 1530, les autoportraits d'Albrecht Dürer sous les traits du Sauveur ou le Salvator Mundi de Léonard, peut-être un autoportrait ou des effigies de son amant Salaì en saint Jean-Baptiste et de nombreux autres. Tondos en marbre décorant la chapelle de Sigismond à la cathédrale de Wawel, créée par Bartolommeo Berrecci entre 1519-1533 comme chapelle funéraire pour les derniers membres de la dynastie Jagellonne, montre le roi Sigismond Ier l'Ancien sous les traits du roi biblique Salomon et le roi David (ou son banquier Jan Boner). L'estampe publiée dans « Le grand théâtre historique, ou nouvelle histoire universelle » de Nicolas Gueudeville à Leyde en 1703, d'après un dessin original de 1548, représente le roi Sigismond Ier l'Ancien sur son lit de mort bénissant son successeur Sigismond Auguste aux cheveux longs. En février 1556, Bona quitta la Pologne pour son Italie natale en passant par Venise avec les trésors qu'elle avait accumulés pendant 38 ans chargés sur 12 chariots tirés par six chevaux. Elle a sans doute emporté avec elle des tableaux religieux, des portraits de membres de la famille royale et de son fils bien-aimé Auguste. Elle s'installe à Bari près de Naples, héritée de sa mère, où elle arrive le 13 mai 1556. Bona mourut un an plus tard, le 19 novembre 1557, à l'âge de 63 ans. Elle fut empoisonnée par son courtisan Gian Lorenzo Pappacoda, qui falsifia ses dernières volontés et lui vola ses trésors. La peinture montrant le Christ comme la lumière du monde (Lux mundi) à la National Gallery de Londres (une copie à l'Accademia Carrara de Bergame) ressemble fortement aux effigies connues de Sigismond Auguste. Le tableau a été donné à la National Gallery en 1901 par les héritiers du chirurgien, qui à leur tour se sont vu offrir par un membre de l'Ambassade du Royaume des Deux-Siciles, formée lors de la fusion du Royaume de Sicile avec le Royaume de Naples en 1816, en remerciement pour sa gentillesse envers une dame sicilienne en 1819. Selon la description du musée, « des peintures de ce type étaient conservées dans les maisons, en particulier dans les chambres à coucher », Bona l'a-t-elle donc eue sur son lit de mort à Bari ? Cette convention du portrait historié était sans doute bien connue de la reine à travers les portraits de Laurent de Médicis (1492-1519), duc d'Urbino par des peintres vénitiens, dépeint comme le Christ rédempteur du monde (Salvator Mundi). Certaines images sacrées en Pologne-Lituanie sont également considérées comme des effigies des monarques, comme Notre-Dame de la Porte de l'Aurore à Vilnius, représentant prétendument Barbara Radziwill, maîtresse et plus tard épouse de Sigismond Auguste, ou le portrait de la reine Marie Casimire Sobieska (1641-1716) en sainte Barbe dans la cathédrale de Bydgoszcz. On pense que la peinture de Vilnius a été commandée comme l'une des deux peintures, l'une représentant le Christ Sauveur (Salvator Mundi) et l'autre la Vierge Marie. D'autres versions et copies d'atelier du tableau à Londres se trouvent aujourd'hui à l'Accademia Carrara de Bergame (offerte en 1908), héritage de la comtesse Maria Ricotti Caleppio, veuve du patricien d'Ancône Raimondo Ricotti décédé dans sa villa de Rome, à l'abbaye de San Benedetto à Polirone près de Mantoue, peut-être de la collection Gonzaga, et au Musée Rolin à Autun en France, transféré du Louvre, très probablement de la collection royale française. Une autre variante réduite (61 x 50,5 cm) de collection privée a été vendue à New York (Sotheby's, 2 novembre 2000, lot 68). Il est donc fort probable que des effigies du roi de Pologne déguisé en Sauveur aient été envoyées à différentes cours royales et princières d'Europe peu après leur création dans l'atelier vénitien de Paris Bordone, à Rome, à Mantoue et en France, entre autres. Dans l'un des autels latéraux de l'église de l'Assomption à Kraśnik, il y a une peinture de Salvator Mundi par l'atelier de Paris Bordone du milieu du XVIe siècle. Il est possible qu'elle ait été offerte au temple par Stanisław Gabriel Tęczyński (1514-1561) ou son fils Jan Baptysta Tęczyński (1540-1563), propriétaires de Kraśnik, et qu'elle ait été initialement donnée à l'un d'eux par le roi.
Sigismond Auguste en Christ comme la lumière du monde par Paris Bordone, 1548-1550, National Gallery de Londres.
Sigismond Auguste en Christ comme la lumière du monde par Paris Bordone, 1548-1550, Accademia Carrara à Bergame.
Sigismond Auguste en Christ comme la lumière du monde par l'atelier de Paris Bordone, 1548-1550, Abbaye de San Benedetto in Polirone.
Sigismond Auguste en Christ Sauveur (Salvator Mundi) par l'atelier de Paris Bordone, 1548-1550, Collection particulière.
Le Christ rédempteur du monde (Salvator Mundi) par l'atelier de Paris Bordone, milieu du XVIe siècle, église de l'Assomption à Kraśnik.
Portraits de la reine Barbara Radziwill par Cornelis van Cleve
Dans la Pologne de l'entre-deux-guerres, l'attention a été attirée sur la similitude du visage de la Madone de la Porte de l'Aurore, l'éminente icône chrétienne de la Vierge Marie vénérée à Vilnius, en Lituanie, avec les effigies de la noble dame lituanienne Barbara Radziwill, devenue reine de Pologne. Cette hypothèse a été présentée par Zbigniew Kuchowicz dans son livre « Images de femmes inhabituelles de la vieille Pologne aux XVIe-XVIIIe siècles » (Wizerunki niepospolitych niewiast staropolskich XVI-XVIII wieku), où il affirmait que le fait de la similitude de la Madone de Vilnius avec la reine a été remarquée par les historiens polonais des milieux catholiques. Juliusz Kłos, professeur à l'Université de Vilnius, a écrit dans un guide de Vilnius que ce tableau pouvait être classé comme appartenant à l'école italienne du milieu du XVIe siècle, et il a également vu une similitude frappante entre le visage de la Vierge Marie et les portraits de Barbara Radziwill. La ressemblance a également été soulignée par le prêtre Piotr Śledziewski, selon qui « le type de la Madone de la Porte de l'Aurore ressemble étonnamment au portrait de la reine Barbara Radziwill [...] Le même nez, le même menton et la même bouche, les mêmes yeux et bords des yeux, la même structure corporelle ». En fin de compte, il a été établi que le tableau n’a pas été créé à l’époque où vivait Barbara, mais bien plus tard. Cependant, cela n'exclut pas que son créateur ait pu s'inspirer d'un des portraits de la reine (d'après « Duchy Kresów Wschodnich » d'Alicja Łukawska, p. 35).
Le tableau de Notre-Dame de la Porte de l'Aurore a probablement été peint à Vilnius dans les années 1620 par un peintre inconnu. Avant l'apparition de la chapelle en 1671, ce grand tableau (200 x 165 cm), peint sur des planches de chêne, était accroché dans une petite niche à l'intérieur de la porte de la ville. Dans la niche du mur extérieur de la porte, en paire avec l'image de la Madone, était accrochée une image du Christ Rédempteur (Salvator Mundi), également peinte sur des planches de chêne, aujourd'hui conservée au Musée du patrimoine de l'Église de Vilnius (repeinte en XVIIIe et fin du XIXe siècle). Le culte de l'image de Notre-Dame a commencé après le déluge désastreux, après 1655. Selon certains auteurs, les originaux seraient des œuvres du peintre flamand Maerten de Vos de la fin du XVIe siècle, cependant, compte tenu de l'identification des traits de la Vierge, la peinture originale utilisée pour peindre son visage a été réalisée vers le milieu du XVIe siècle. Le même visage a été utilisé dans un autre tableau de la Madone, aujourd'hui conservé au couvent des Clarisses à Cracovie. Ce petit tableau a été fondé par le père Adam Opatowiusz (Opatowczyk ou Opatovius, 1574-1647), chanoine de Cracovie et sept fois recteur de l'Académie de Cracovie, docteur en philosophie (1598) et en théologie (1619), formé à Padoue et à Rome. Il est représenté comme un donateur tenant le pied de l'Enfant dans la partie inférieure du tableau, avec saint François d'Assise à gauche, dont l'effigie, selon Michał Walicki, a été inspirée par les œuvres des peintres italiens du XIIIe siècle Margaritone d'Arezzo ou Bonaventura Berlinghieri (d'après « Zloty widnokrąg », p. 107). Le portrait d'Opatowiusz avec un Crucifix se trouve également dans le même couvent, de sorte que l'effigie de saint François a probablement été calquée sur une peinture italienne médiévale importée. L'image de la Vierge à l'Enfant endormi d'Opatowiusz est directement inspirée d'un tableau aujourd'hui conservé au château royal de Blois (huile sur panneau, 81,2 x 64,8 cm, numéro d'inventaire 869.2.20, antérieur IP 57). Ce tableau, daté par les experts vers 1550, provient de la collection de Pauline Fourès, née Marguerite-Pauline Bellisle, Madame de Ranchoup - la Comtesse de Ranchoup, comme elle aimait l'appeler, amante de Napoléon Bonaparte, offerte en 1869. Il a été attribué à l'origine à Lambert Lombard et maintenant à Cornelis van Cleve, qui a très probablement peint le portrait de la reine Barbara en robe rouge (Picker Art Gallery à Hamilton). De nombreuses copies de ce tableau existent. Des versions de bonne qualité peuvent être trouvées au Musée Magnin de Dijon (huile sur panneau, 81,5 x 66,6 cm, 1938E183) et à la Gemäldegalerie de Berlin (huile sur panneau, 80 x 65 cm, 653). Deux autres versions issues de collections privées ont été vendues en 2012 (huile sur panneau, 84 x 70 cm, Bonhams Londres, 5 décembre 2012, lot 86) et en 2020 (huile sur panneau, 95 x 76 cm, Sotheby's Londres, 23 septembre 2020, lot 33). Dans ce dernier tableau, attribué à un suiveur de Cornelis van Cleve, une colonne de marbre a été ajoutée à l'arrière-plan. Le style de ce tableau se rapproche le plus du portrait de la reine Barbara nue conservé au Musée national de Varsovie (M.Ob.2158 MNW), attribué à l'entourage de Michiel Coxie. Le visage de la Madone ressemble étonnamment aux effigies de Barbara Radziwill par Paris Bordone (Musée Nivaagaard à Nivå) et par Giampietro Silvio (Palais des Grands-Ducs de Lituanie à Vilnius), identifiées par moi. La Madone d'Opatowiusz possède également une couronne, histoire de souligner son statut royal. Une Madone similaire peut également être vue dans une composition représentant l'Adoration des Mages de Cornelis van Cleve. De nombreuses compositions de ce type ont été créées par le peintre et son atelier, mais l'une d'entre elles, conservée au Kunsthistorisches Museum de Vienne (huile sur panneau, 125,1 x 96,1 cm, GG 1703), est très spécifique. Ce tableau a été peint à la manière de Cornelis van Cleve et signé du monogramme CAVB. Très jeune âge de saint Joseph, qui était habituellement représenté comme un vieillard, et grande similitude de l'effigie de saint Melchior agenouillé, le plus âgé des mages, avec l'effigie du roi Sigismond Ier dans une scène similaire de Joos van Cleve (Gemäldegalerie à Berlin), ainsi que d'autres portraits du roi, notamment en donateur par atelier de Michel Sittow (collection particulière) et Hans von Kulmbach (Château de Gołuchów), indiquent qu'il s'agit plus d'une allégorie politique que d'une scène religieuse. Bien que le vieux roi, décédé en 1548, avant le couronnement de Barbara, ait condamné dans quelques lettres le mariage de son fils avec sa maîtresse, on considère généralement qu'il traitait bien sa belle-fille, c'est pourquoi la reine Bona, qui a affirmé plus tard que le scandale avait contribué à la mort de son mari, aurait pu être l'instigatrice des lettres mentionnées. Les trois hommes entourant Madone-Barbara doivent donc être identifiés comme son frère Nicolas « le Rouge » en saint Joseph et son cousin Nicolas « le Noir » en saint Gaspard et le roi Sigismond Ier, portant l'Ordre de la Toison d'Or, en saint Melchior et elle est comparable à la scène similaire avec le portrait déguisé de l'empereur Frédéric III par Joos van Cleve (Musée national de Poznań et Gemäldegalerie Alte Meister de Dresde). Le tableau a été exposé dans la galerie en 1783, il pourrait donc s'agir d'un cadeau des Radziwill à l'empereur pour sanctionner le mariage de Sigismond Auguste.
Portrait de la reine Barbara Radziwill en Madone à l'Enfant endormi par Cornelis van Cleve, vers 1550, Château royal de Blois.
Portrait de la reine Barbara Radziwill en Madone à l'Enfant endormi par Cornelis van Cleve, vers 1550, Musée Magnin à Dijon.
Portrait de la reine Barbara Radziwill en Madone à l'Enfant endormi par Cornelis van Cleve, vers 1550, Collection privée.
Portrait de la reine Barbara Radziwill en Madone à l'Enfant endormi par Cornelis van Cleve, vers 1550, Gemäldegalerie à Berlin.
Portrait de la reine Barbara Radziwill en Madone à l'Enfant endormi par le cercle de Michiel Coxie, vers 1550, Collection privée.
Vierge à l'Enfant endormi avec saint François d'Assise et le père Adam Opatowiusz, peintre inconnu, deuxième quart du XVIIe siècle, Couvent des Clarisses à Cracovie.
Adoration des Mages avec des portraits de Sigismond Ier, Barbara Radziwill, Nicolas « le Noir » et Nicolas « le Rouge » Radziwill par Cornelis van Cleve, vers 1550, Kunsthistorisches Museum de Vienne.
Portraits de Franciszek Krasiński et Piotr Dunin-Wolski par Lambert Sustris ou atelier
Franciszek Krasiński, un noble des armoiries de Ślepowron, est né le 10 avril 1525, probablement dans le village de Krasne en Mazovie, au nord de Varsovie, dans la famille de Jan Andrzej Krasiński, panetier de Ciechanów, et Katarzyna Mrokowska. Il a fait ses études primaires au gymnase protestant de Zgorzelec en Silésie (partie de la Bohême), puis a étudié sous Philip Melanchthon à l'Université de Wittenberg, d'où, sur les conseils de l'évêque Mikołaj Dzierzgowski, il a démissionné. En 1541, il entra à l'Université de Cracovie, puis se rendit en Italie, où il étudia à l'Université de Bologne, et le 4 juin 1551, à l'Université de Rome, il devint docteur des deux lois (utriusque iuris). Après son retour en Pologne, il fut très probablement ordonné prêtre et devint secrétaire de son parent éloigné, le primat Mikołaj Dzieżgowski, qui l'aida à obtenir plusieurs avantages ecclésiastiques : l'archidiaconé de Kalisz et le chanoine de Łuck, Łowicz et Cracovie. En 1560, Franciszek devint le secrétaire du roi Sigismond Auguste sous le patronage du primat Jan Przerębski. Il exerça des fonctions diplomatiques, notamment à Vienne, où il fut ambassadeur à la cour impériale entre 1565-1568. Il fut plus tard vice-chancelier de la couronne entre 1569-1574 et évêque de Cracovie entre 1572-1577. Atteint de tuberculose, il séjourne souvent au château des évêques de Cracovie à Bodzentyn. Il y mourut le 16 mars 1577 et selon son testament, il fut enterré dans l'église locale, où son monument funéraire en marbre fut créé par l'atelier de Girolamo Canavesi à Cracovie.
Les traits du visage d'un homme portant un pourpoint richement brodé et une cape noire bordée de fourrure dans un portrait attribué à Lambert Sustris sont très similaires aux effigies connues de Franciszek Krasiński, en particulier à son portrait par un peintre anonyme qui était avant la Seconde Guerre mondiale dans la collection de Ludwika Czartoryska née Krasińska à Krasne, perdue. De plus, la pose est très similaire. La peinture de Krasne était datée dans le coin supérieur droit « Ao 1576 », cependant, il pourrait s'agir d'un ajout ultérieur car sur ce portrait, il est beaucoup plus jeune que sur d'autres effigies connues (par exemple, portrait du monastère franciscain de Cracovie d'environ 1572). Le tableau attribué à Sustris a été vendu à New York en 1989 et a été peint sur panneau. Selon l'inscription en latin dans le coin inférieur droit, l'homme avait 25 ans en 1550 (.ET TATIS SVE../.ANNVS./.XXV./.P./MDL), exactement comme Franciszek Krasiński, lorsqu'il étudia à Bologne et Rome. À la galerie Colonna de Rome, il y a un portrait d'un homme tenant des gants (huile sur toile, 88 x 65 cm, numéro d'inventaire Fid. n. 1477), qui ressemble également beaucoup à Franciszek Krasiński du portrait de Krasne et décrit l'effigie attribuée à Sustris. Il était auparavant attribué à Lorenzo Lotto, Nicolas Neufchatel ou Dirck Barendsz (attributions rejetées) et maintenant à un peintre anonyme du sud des Pays-Bas. Les attributions précédentes et le style de ce tableau correspondent parfaitement aux peintures de Sustris, un peintre hollandais qui a travaillé dans l'atelier de Titien et a incorporé des éléments de la Renaissance italienne dans son travail. Le costume de l'homme et le style sont également très proches du tableau daté de 1550. La date à laquelle Krasiński a été ordonné prêtre est inconnue. Il était chanoine de Gniezno à partir de 1556, cependant, comme Copernic ou Jan Dantyszek, il n'aurait peut-être pas été ordonné prêtre. Le costume et la pose du modèle peuvent être comparés aux effigies d'Antoine Perrenot de Granvelle (1517-1586), l'un des principaux ministres des Habsbourg espagnols, devenu chanoine de Besançon et protonotaire apostolique en 1529, alors qu'il n'avait que 12 ans, plus tard, en novembre 1538, âgé de seulement vingt et un ans, il est nommé évêque d'Arras et est ordonné prêtre deux ans plus tard (d'après « Les Granvelle et les anciens Pays-Bas » de Krista de Jonge, Gustaaf Janssens, p. 20). Granvelle devint aussi archevêque de Malines (1560) et cardinal (1561), pourtant dans la majorité de ses portraits, comme celui réalisé par Frans Floris vers 1541, aux yeux bleus, par Titien en 1548, par Antonis Mor en 1549 et vers 1560, par Lambertus Suavius en 1556, tous aux yeux sombres, il n'y a aucune référence explicite à son sacerdoce. Un certain nombre de portraits conservés de « princes de l'Église » polono-lituaniens sont des effigies officielles dédiées aux églises, où le patron était représenté en vêtements pontificaux. Dans les images privées, ils pouvaient se permettre, comme Granvelle, d'être représentés dans des tenues moins formelles, plus typiques d'un noble que d'un prêtre. Selon l'inscription latine en haut à gauche, l'homme avait 37 ans en 1562 (A° 1562 / AETATIS. 37), exactement comme secrétaire royal Franciszek Krasiński. Il aurait pu commander cette peinture à Venise puis l'envoyer à Rome, bien qu'il soit également possible qu'en 1562 il se soit trouvé en Italie. Un autre portrait attribué à Lambert Sustris ou à son atelier montre un homme barbu en costume noir avec un chapeau noir, tenant un livre et assis sur une chaise. Ce tableau a été vendu à Londres en 2005. Il porte l'inscription et la date Roma Ano 1564 Etatis Mae 33 (Rome Année 1564 de mon âge 33) au-dessus de la tête de l'homme, ainsi que trois autres inscriptions en grec (ou arménien), hébreu et italien. L'inscription en italien Non ognuno che mi dice signor / Signore entrata nel regno de cieli: / ma colui che fa la volunta del / padre mio che e ne' cieli (Ce ne sont pas tous ceux qui me disent: “Seigneur, Seigneur”, qui entreront dans le Royaume des cieux, mais seulement ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux) sont des versets du septième chapitre de l'Évangile de Matthieu dans le Nouveau Testament, une partie du Sermon sur la montagne, sur les vrais et les faux disciples. L'âge d'un homme correspond parfaitement à l'âge de Piotr Dunin-Wolski (1531-1590), le fils de Paweł Dunin-Wolski, grand chancelier de la Couronne, et de Dorota Wiewiecka des armoiries de Jastrzębiec, qui après ses premières études à l'Académie Lubrański à Poznań est allé à Bologne et à Padoue pour terminer ses études. A Bologne en 1554, il est mentionné comme élève de Sebastiano Corrado (Sebastianus Corradus), professeur de grec et de latin, qui traduisit Platon en latin. Il était chanoine de Poznań depuis 1545 et après son retour d'Italie, il séjourna à la cour du roi Sigismond Auguste, où il se révéla être un homme particulièrement doué pour les langues étrangères et la diplomatie. Il fut alors envoyé à Madrid en Espagne en 1560 où il resta plus de 10 ans, essayant de récupérer les soi-disant sommes napolitaines pour le roi. Son séjour à Rome en 1564 n'est pas mentionné dans les sources, cependant ses lettres de Barcelone du 4 mars au cardinal Stanisław Hozjusz et de Madrid du 23 septembre à l'évêque Marcin Kromer pourraient indiquer un tel voyage. Il retourna en Pologne en 1573. Il était collectionneur d'antiquités et rassembla une grande bibliothèque, dont il fit don à l'Académie de Cracovie (environ 1000 volumes) et à la bibliothèque du chapitre de Płock (130 livres). Dunin-Wolski mourut à Płock le 20 août 1590 et fut enterré dans l'église cathédrale, où sa pierre tombale est conservée à ce jour ainsi qu'un portrait. Cette effigie, réalisée après sa mort au XVIIe ou XVIIIe siècle par un peintre local, a indéniablement été copiée d'une autre effigie de l'évêque de Płock (depuis 1577), et elle est étonnamment similaire au tableau décrit, peint par Sustris ou son atelier.
Portrait de Franciszek Krasiński (1525-1577), âgé de 25 ans, en pourpoint brodé par Lambert Sustris, 1550, Collection particulière.
Portrait du secrétaire royal Franciszek Krasiński (1525-1577), âgé de 37 ans, tenant des gants de Lambert Sustris, 1562, Galerie Colonna à Rome.
Portrait du chanoine Piotr Dunin-Wolski (1531-1590), âgé de 33 ans par Lambert Sustris ou atelier, 1564, Collection particulière.
Portraits de la reine Barbara Radziwill et de son père par l'atelier de Paris Bordone
« On dit que la reine Bona, qui auparavant se souciait peu des choses divines, commence à être attirée par les innovations religieuses. Parce qu'elle lit des livres italiens d'un certain Bernardino Ochino, autrefois moine en Italie et fondateur de la nouvelle congrégation des Capucins, mais qui a changé de foi et enseigne désormais en Angleterre. Ils assurent qu'elle aimerait faire venir un type similaire d'enseignants, c'est-à-dire des prédicateurs. Un changement d'esprit étrange dans l'esprit de cette femme! Elle s'est également réconciliée avec la reine Barbara. Par son envoyé et son confesseur, Franciszek Lismaninus de Corcyre [Francesco Lismanini de Corfou], Bona appelait Barbara sa belle-fille la plus aimée, se recommandait elle-même et ses filles dans les termes les plus flatteurs et lui envoyait de petits cadeaux. Beaucoup prétendent qu'elle l'a fait de manière trompeuse, non pas pour le bien de Barbara, mais pour asservir le roi son fils, qui est tellement attaché à sa femme qu'il déteste ceux qui la persécutent avec haine, et que cela était d'autant plus facile pour elle qu'elle savait que la reine Barbara ne vivra pas longtemps. Le confesseur de la reine Bona lui-même, que j'ai cité plus haut, m'a assuré solennellement que ce consentement était réel et qu'il s'agissait d'un décret divin. Et c'est un changement de mentalité remarquable », rapporte dans une lettre du 9 mars 1551 le docteur Johannes Lang, envoyé du roi Ferdinand Ier d'Autriche.
Cette lettre illustre non seulement les relations familiales au sein de la dynastie Jagellonne vers le milieu du XVIe siècle, mais aussi la popularité de la culture italienne et les nouvelles idées et tendances à la cour royale. Dans une lettre antérieure datée du 4 janvier 1551 de Świdnica (Swidniciae) au roi, le docteur Lang ajoute à propos des réformes religieuses en Pologne-Lituanie : « J'ai déjà écrit à Votre Majesté Royale au sujet d'un mariage conclu par un prêtre à Pinczów, une ville à quatorze milles de Cracovie. Maintenant on me dit qu'une nouvelle liturgie y a été introduite après l'expulsion des moines ; ils chantent la messe en polonais et condamnent la communion sous une seule espèce dans l'Eucharistie. D'étranges foules de nobles y viennent, piétinant effrontément sur les anciens rites de l'église. Autant que je puisse le prédire, je vois que, malgré l'opposition de certains hommes, la Pologne obtiendra de force le mariage sacerdotal et la communion sous les deux espèces. Il y aura un étrange changement dans les choses de l'église là-bas » (d'après « Jagellonki polskie ... » par Aleksander Przezdziecki, tome 5, p. LXVIII-LXX). À Knole House, Kent en Angleterre, il y a un autre portrait d'une dame inconnue, appelée Marie, reine d'Écosse, de trois quarts (huile sur toile, 107 x 89 cm, NT 129951), semblable au portrait dit de Carleton à Chatsworth House. La jeune femme porte une robe ivoire brodée d'or avec des sous-manches bleues. Ses cheveux sont ornés de perles et de fleurs d'œillets rouges, symboles d'amour et de passion. En raison d'une identification antérieure, le portrait est attribué à l'école française ou flamande. Aux XVIIIe et XIXe siècles, la légende romantique et la mort tragique de la reine d'Écosse ont contribué à ce phénomène et même la fille de l'adversaire de Marie - Sir Francis Walsingham (mort en 1590), Frances Walsingham (1567-1633), Lady Sidney est devenue Marie, reine d'Écosse. Il est possible qu'au XIXe siècle, l'inscription sur la petite étiquette en trompe-l'œil, ou cartellino, visible dans le coin supérieur gauche, dans un beau portrait de Frances attribué à Robert Peake (Fine Arts Museums of San Francisco, 1954.75), ait été modifiée en latin : MARIA REGINA SCOTIAE. Grâce à une nouvelle technologie, les restaurateurs ont découvert le lettrage original : The Ladie Sidney daughter to Secretarye Walsingham (d'après « Who's That Lady ?… » d'Elise Effmann Clifford). Il en a été de même pour le portrait de la princesse Sophie Jagellon (1522-1575) en costume espagnol (Musée Czartoryski, MNK XII-296) ou du portrait du cardinal Jean Albert Vasa (1612-1634) de l'école vénitienne (très probablement Tommaso Dolabella, Palais de Wilanów à Varsovie, Wil.1240), qui, selon une inscription ultérieure, représente le cardinal André Bathory (1562-1599). Les traits de la dame ressemblent à ceux du portrait de Carleton et de la miniature de la reine Barbara réalisés par l'atelier de Lucas Cranach le Jeune (Musée Czartoryski, MNK IV-V-1433), ainsi que d'autres portraits de la reine. Le style de ce tableau ressemble à l'effigie en pied du père de la reine Barbara - Georges Radziwill (1480-1541), surnommé « Hercule » au Musée national d'art de Biélorussie à Minsk (huile sur toile, 210 x 122 cm). Il peut être comparé aux portraits de Sigismond Auguste sous les traits du Christ lumière du monde réalisés par l'atelier de Paris Bordone (Académie Carrara de Bergame et Abbaye de San Benedetto de Polirone) ainsi qu'au double portrait, attribué à Bordone (Musée Nivaagaard, 0009NMK) et portrait d'homme à Paris (Louvre, INV 126 ; MR 74). D'après l'inscription latine dans le coin supérieur gauche, Georges Radziwill a été peint en 1541 à l'âge de 55 ans (GEORGIVS RADZIWIL CASTELLANVS VILENSIS [...] AÑO DNI. M.D.XXXXI. ÆTATIS VERO SVÆ LV.). L'inventaire des peintures de la collection de la princesse Louise Charlotte Radziwill (1667-1695), dressé en 1671, recense quelques-unes des effigies ayant survécu au déluge (1655-1660). Parmi ces portraits, beaucoup ont été réalisés en 1550, comme Nicolaus Radziwil Cognomento, 2dus Dux in Gonidz Palatinus Vilne[n]sis Cancelarius M.D.L. (1), Georius Radziwił Castelanus Vilnens. Gnalis dux Exercitum M.D.L. (9), Joanes Radziwił Dux in Muszniki Archicamer. M.D.L. (15) et Nicolaus Radziwił Dux Birzarum et Dubincorum, Palaitinus Vilnen. Gnalis Dux Exercitum M.D.L. (21). La création d'une telle galerie d'ancêtres et d'autres membres de la famille était probablement liée au couronnement de la reine Barbara le 7 décembre 1550.
Portrait de la reine Barbara Radziwill par l'atelier de Paris Bordone, vers 1549-1551, Knole House.
Portrait de Georges « Hercule » Radziwill, châtelain de Vilnius par l'atelier de Paris Bordone, vers 1549-1551, Musée national d'art de Biélorussie à Minsk.
Comments are closed.
|
Artinpl est un projet éducatif individuel pour partager des connaissances sur les œuvres d'art aujourd'hui et dans le passé en Pologne.
Si vous aimez ce projet, veuillez le soutenir avec n'importe quel montant afin qu'il puisse se développer. © Marcin Latka Catégories
All
Archives
April 2023
|