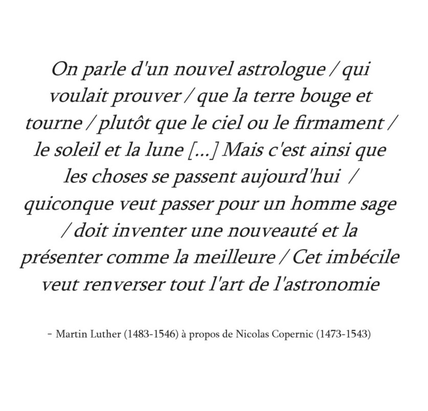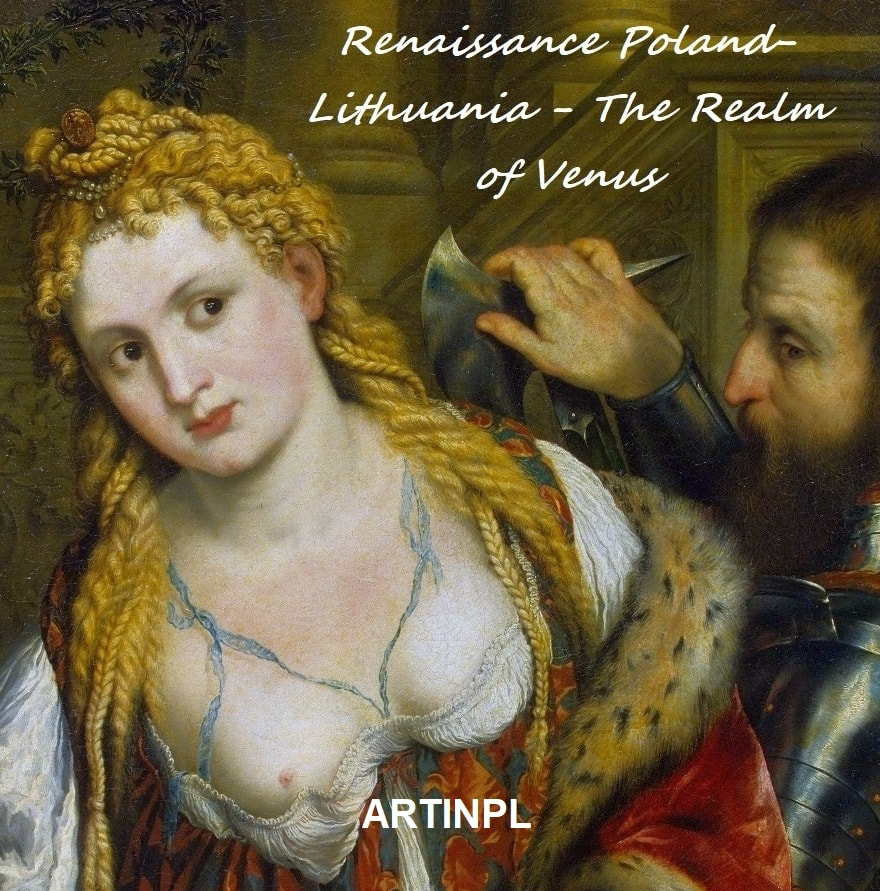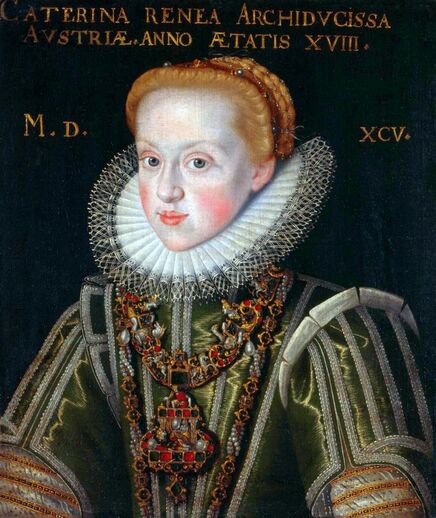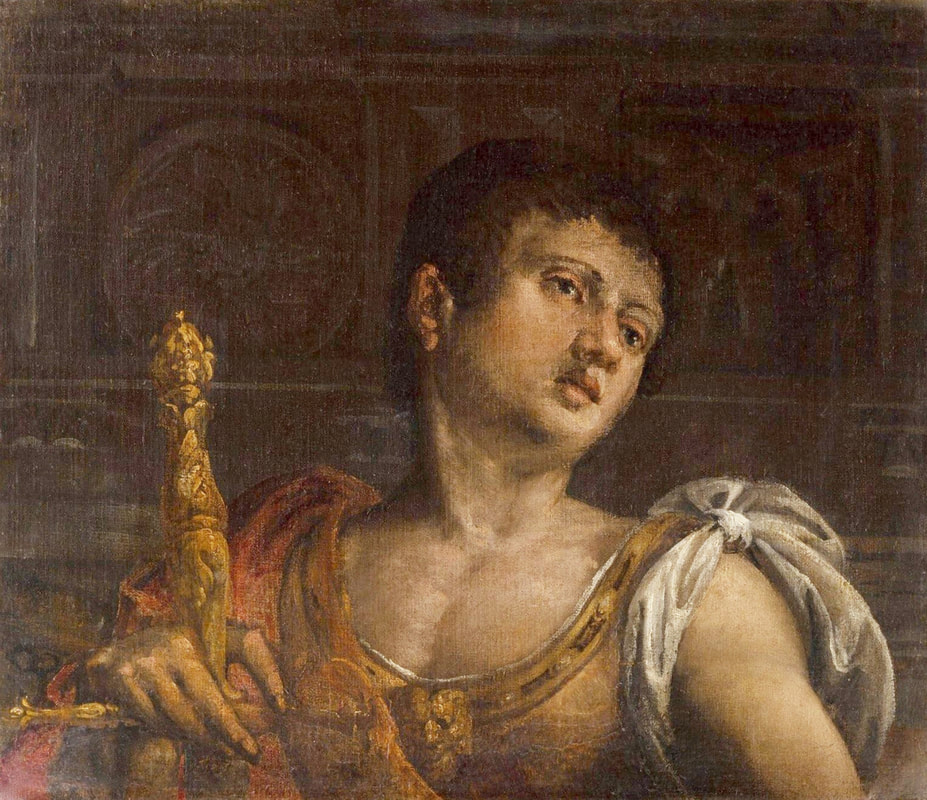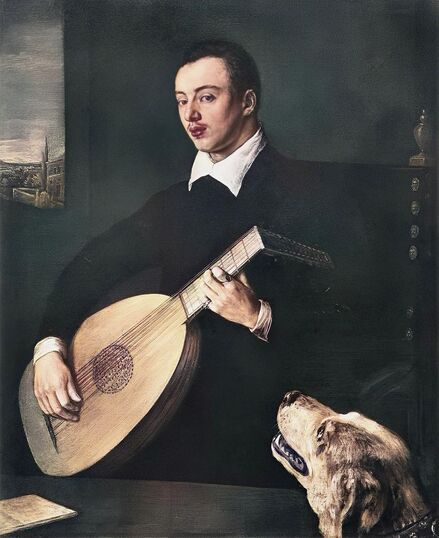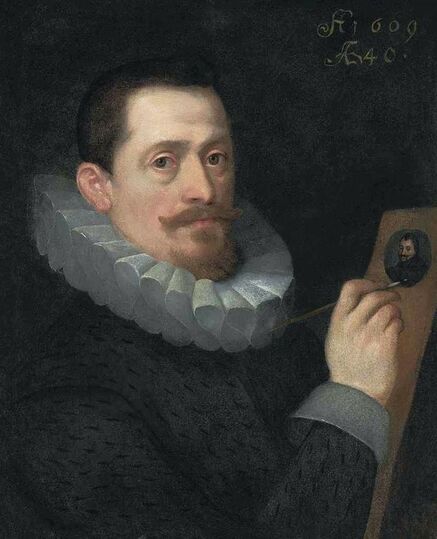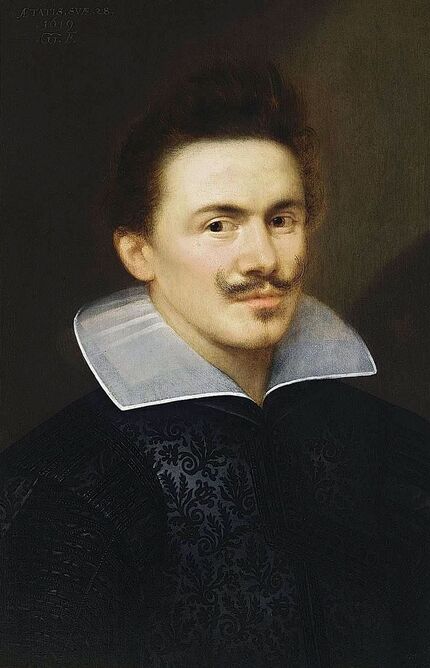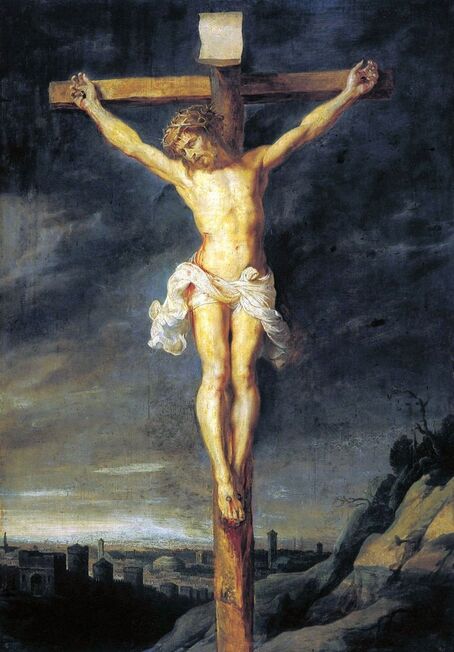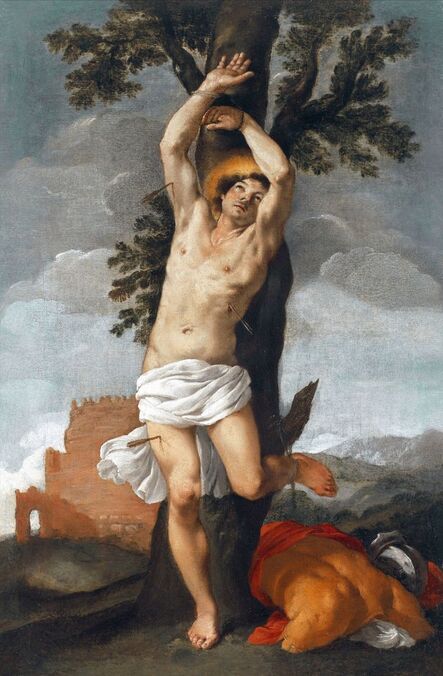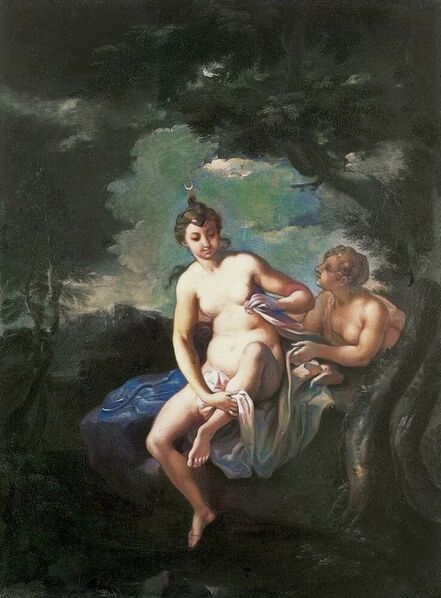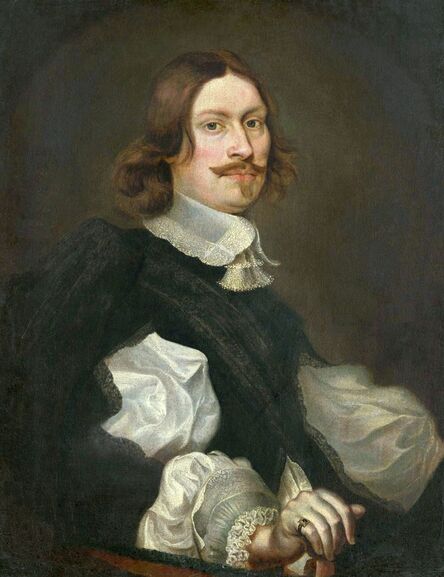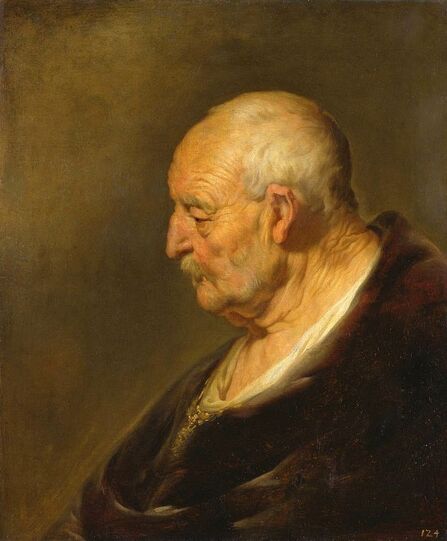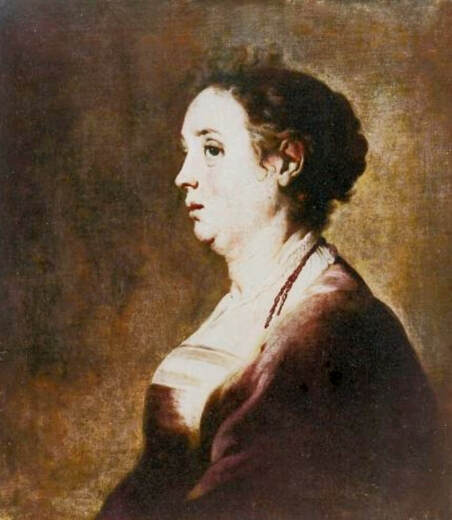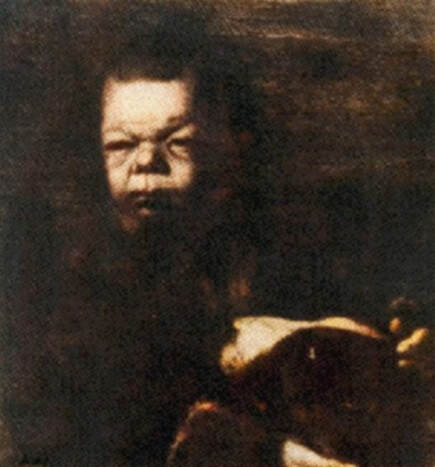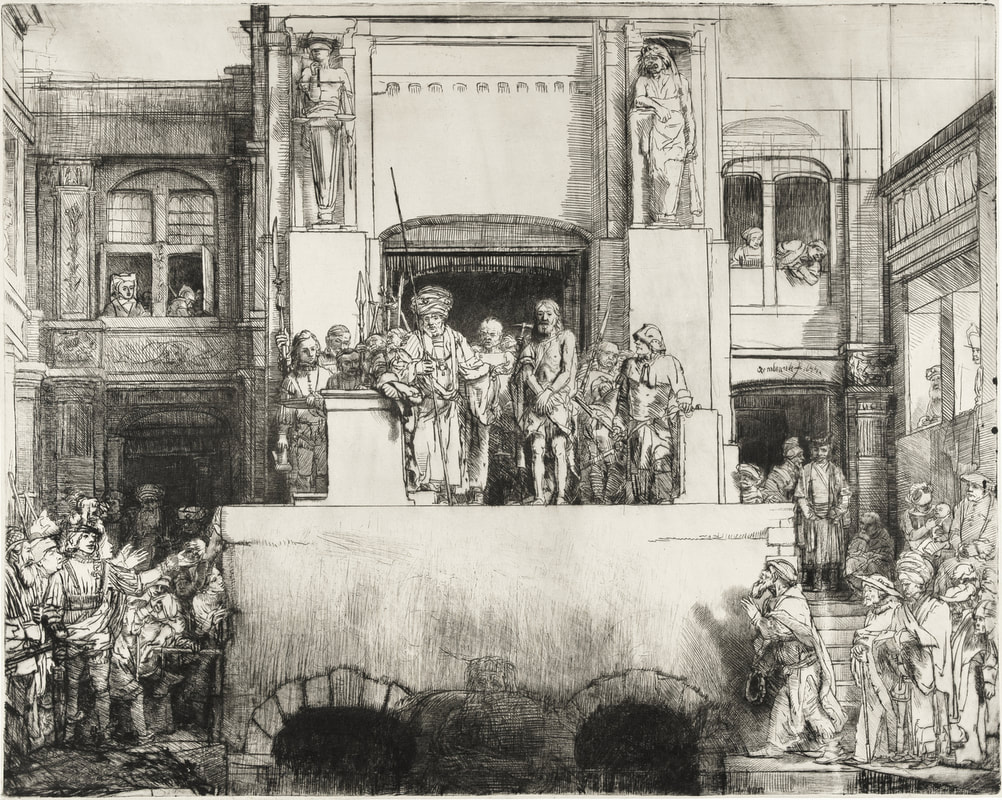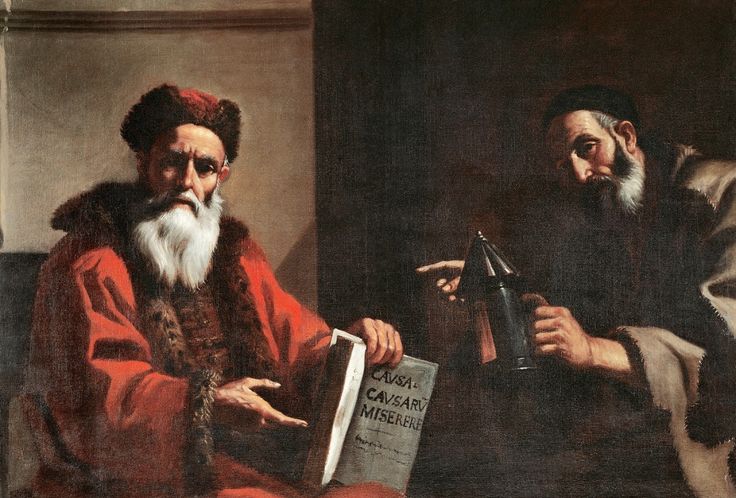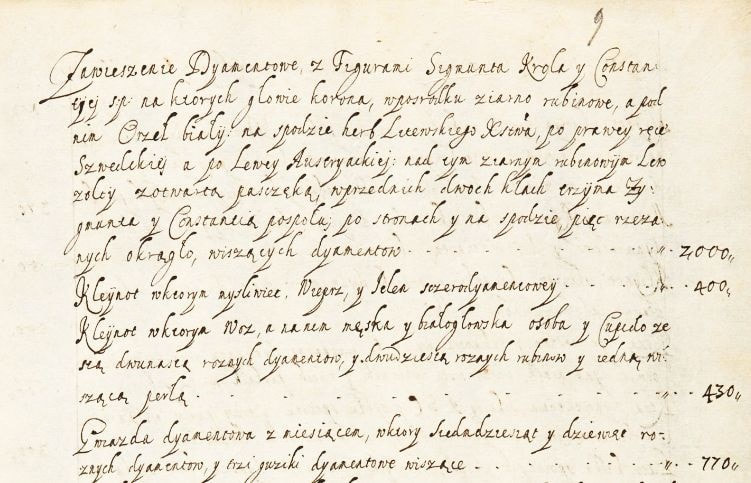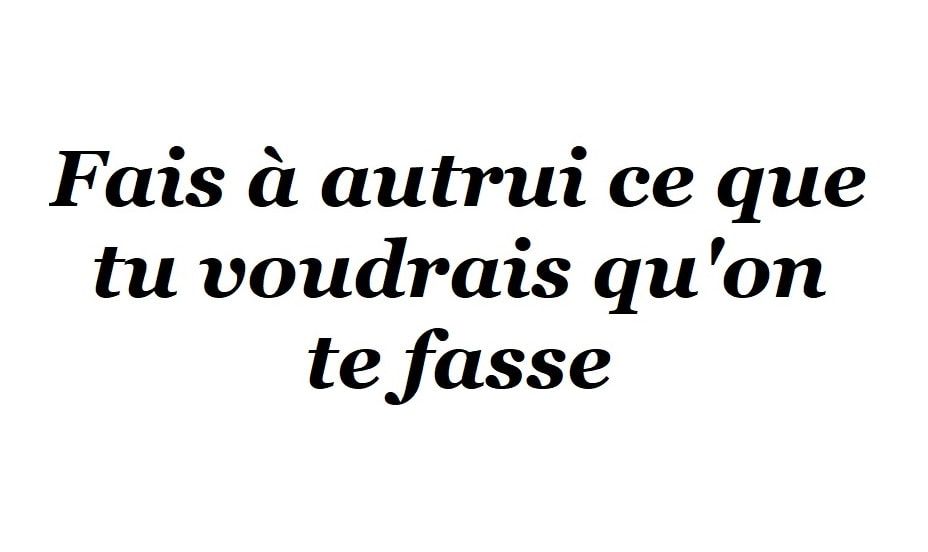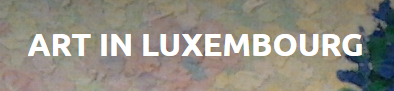|
Pologne-Lituanie de la Renaissance - Le royaume de Vénus, déesse de l'amour, détruite par Mars, dieu de la guerre. Découvrez ses « Portraits oubliés », ses souverains et sa culture unique ...
Portraits oubliés - Introduction - partie A Portraits oubliés des Jagellon - partie I (1470-1505) Portraits oubliés des Jagellon - partie II (1506-1529) Portraits oubliés des Jagellon - partie III (1530-1540) Portraits oubliés des Jagellon - partie IV (1541-1551) Portraits oubliés des Jagellon - partie V (1552-1572) Portraits oubliés des Jagellon - partie VI (1573-1596) Portraits oubliés - Introduction - partie B Portraits oubliés des Vasa polonais - partie I (1587-1623) Portraits oubliés des Vasa polonais - partie II (1624-1636) Portraits oubliés des Vasa polonais - partie III (1637-1648) Portraits oubliés des Vasa polonais - partie IV (1649-1668) Portraits oubliés des « rois compatriotes » (1669-1696)
« Avant le déluge », c'est un ancien titre d'un tableau aujourd'hui identifié pour représenter la Fête du fils prodigue. Il a été peint par Cornelis van Haarlem, un peintre des Pays-Bas protestants, surtout connu pour ses œuvres très stylisées avec des nus à l'italienne, en 1615, lorsque le monarque élu de la République polono-lituanienne était un descendant des Jagellons - Sigismond III Vasa. Malgré d'énormes pertes dans les collections de peintures, l'œuvre de Cornelis van Haarlem est représentée de manière significative dans l'un des plus grands musées de Pologne - le Musée national de Varsovie, dont la majorité provient d'anciennes collections polonaises (trois de la collection de Wojciech Kolasiński : Adam et Eve, Mars et Vénus en amants, Vanitas et la Fête du fils prodigue de la collection de Tomasz Zieliński à Kielce).
Malheureusement, son histoire antérieure est inconnue, il ne peut donc pas être associée sans équivoque à l'âge d'or de la Pologne-Lituanie, qui, presque comme dans la Bible, s'est terminée par le déluge (1655-1660), une punition pour les péchés, comme certains pourraient le croire, ou comme l'ouverture de la boîte de Pandore déchaînant le mal sur le monde. « Les Suédois et les Allemands notoires, pour qui le meurtre est un jeu, la violation de la foi est une plaisanterie, le pillage un plaisir, l'incendie volontaire, le viol des femmes et tous les crimes une joie, notre ville, détruite par de nombreuses contributions, ils ont détruit par le feu, ne laissant que la banlieue de Koźmin non brûlée », décrit les atrocités dans la ville de Krotoszyn, incendiée le 5 juillet 1656, un témoin oculaire - un auteliste, frère Bartłomiej Gorczyński (d'après « Lebenserinnerungen » de Bar Loebel Monasch, Rafał Witkowski, p. 16). Les descriptions de Vilnius détruite après le retrait des armées russes et cosaques, et d'autres villes de la République sérénissime, sont tout aussi terrifiantes. Les troupes polonaises ont répondu avec une impitoyabilité similaire, parfois aussi envers leurs propres propres citoyens, qui ont collaboré avec les envahisseurs ou ont été accusées de collaboration. L'invasion s'est accompagnée d'épidémies liées aux marches de diverses armées, de la destruction de l'économie, exacerbation des conflits et des divisions sociales et ethniques. Une apocalypse inimaginable, envoyée non par Dieu mais par la cupidité humaine. La guerre devrait être une relique oubliée du passé, mais malheureusement ce n'est toujours pas le cas. Un autre tableau conservé au Musée national de Varsovie rappelle ces événements. Ce petit tableau (huile sur cuivre, 29,6 x 37,4 cm, numéro d'inventaire 34174) a très probablement été réalisé par Christian Melich, peintre de la cour des Vasa polono-lituaniens, actif à Vilnius entre 1604 et 1655 (de style similaire à la Reddition de Mikhaïl Chéine au Musée National de Cracovie, MNK I-12) ou autre peintre flamand. On pensait initialement qu'il représentait le roi Jean II Casimir Vasa après la bataille de Berestetchko en 1651, mais les traits distinctifs d'un homme à cheval ont permis de l'identifier avec une grande certitude comme étant Charles X Gustave le « brigand de l'Europe », comme on l'appelait dans la République polono-lituanienne, « qui était capable de déclencher des horreurs de guerre dans n'importe quelle partie du vieux continent » (d'après « Acta Universitatis Lodziensis : Folia historica », 2007, p. 56), et le sujet comme son triomphe sur le pays. Des personnifications féminines de la République, très probablement la Pologne, la Lituanie et la Ruthénie (ou la Prusse) comme trois déesses du Jugement de Pâris, rendent hommage au « brigand de l'Europe » soutenu par Mars et Minerve et piétinant les ennemis polonais en costumes nationaux. Une des femmes (Vénus-Pologne) offre la couronne et un putto ou Cupidon offre le symbole de la Pologne, l'Aigle blanc. Mars, l'épée dégainée, regarde l'humble femme. Les événements dramatiques changent non seulement les individus mais aussi des nations entières.
Mars et Vénus amoureux (Mars désarmé par Vénus) par Cornelis van Haarlem, 1609, Musée national de Varsovie.
Fête du fils prodigue (Avant le déluge) par Cornelis van Haarlem, 1615, Musée national de Varsovie.
Triomphe de Charles X Gustave le « brigand de l'Europe » sur la République polono-lituanienne par le peintre flamand, très probablement Christian Melich, vers 1655, Musée national de Varsovie.
Bibliographie et mentions légales. La majorité des faits historiques dans les « Portraits oubliés » et les informations sur les œuvres d'art sont facilement vérifiables sur des sources fiables disponibles sur Internet, sinon je vous invite à visiter les Bibliothèques nationales de Pologne - personnellement ou virtuellement (Polona). La majorité des traductions, si elles ne sont pas spécifiquement attribuées à quelqu'un d'autre dans le texte ou les sources citées, sont ma création. Les peintures originales reproduites dans « Portraits oubliés » sont considérées comme étant dans le domaine public (reproduction photographique fidèle d'une œuvre d'art originale en deux dimensions, droit d'auteur d'une durée de vie de 100 ans ou moins après la mort de l'auteur) conformément à la loi internationale sur le droit d'auteur (photos de photothèques accessibles au public, sites web d'institutions concernées, mes propres photos et scans de diverses publications avec crédit au propriétaire), cependant, tous ont été retouchés et améliorés sans interférence significative avec la qualité de l'œuvre originale, si possible (Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions 3.0 non transposé, CC BY-SA 3.0). Toutes les interprétations, identifications et attributions, non spécifiquement attribuées à d'autres auteurs dans le texte ou les sources citées, doivent être considérées comme ma paternité - Marcin Latka (Artinpl).
Les successeurs des Jagellon, les Vasa, ont déplacé l'accent du mécénat artistique vers le nord, soutenant les peintres flamands et hollandais et acquérant des produits de luxe et de l'art aux Pays-Bas, mais les influences italiennes étaient encore fortes. « La nation italienne, dont nous avons reçu la religion, la littérature, les beaux arts et l'équipement de la vie plus élégante des Sarmates, est la plus méritée » (Natio Jtalica optime de nobis merita est, a qua religionem, literas, bonas artes, ac elegatioris vitae apparatum Sarmatae accepimus), écrit dans une lettre de 1601 le grand chancelier Jan Sariusz Zamoyski (1542-1605) au pape Clément VIII.
Les grandes influences des Italiens et de la culture italienne en Pologne-Lituanie ont conduit à un intérêt accru pour les élections royales polono-lituaniennes dans la péninsule italienne, qui est désormais largement oubliée. En 1573, Alphonse II d'Este, duc de Ferrare envoya le célèbre poète Giovanni Battista Guarini en Pologne-Lituanie, pour pérorer sa cause devant la Diète (Sejm). Guarini échoua dans sa mission et à son retour à Ferrare fut critiqué pour son ineptie diplomatique (d'après « Politics and Diplomacy in Early Modern Italy ...» de Daniela Frigo, p. 167). Parmi les autres candidats italiens importants à la première élection libre de 1573 figuraient également Alexandre Farnèse, duc de Parme et Plaisance et François Ier de Médicis, grand-duc de Toscane. Ce dernier a également été considéré lors de la troisième élection libre de 1587, lorsque le fils de Catherine Jagellon Sigismond Vasa a été élu, et il avait un fort soutien. Simone Gengi d'Urbino, architecte et ingénieur militaire au service de feu roi Étienne Bathory, estimait que parmi les nombreux candidats présentés, il avait de bonnes chances de succès (...et quanto ella per parere de più principali potessi più d'ogn'altro aspirare a questa corona), comme il le déclare dans une lettre datée du 7 janvier 1587 de Riga (dal nuovo forte di fiume Dvina), adressée au grand-duc et à son ambassadeur à la cour impériale de Prague Orazio Urbani. Il demanda au directeur de la poste royale de Pologne-Lituanie Sebastiano Montelupi de n'épargner aucun effort ni argent pour que le courrier chargé des lettres au grand-duc parvienne à Vienne le plus tôt possible. C'est Montelupi qui, dans une lettre du 18 décembre 1586, informe la cour de Ferrare de la mort de Bathory. Il a recommandé d'embaucher un messager spécial vêtu de vêtements allemands et parlant couramment l'allemand. De Vienne, par l'intermédiaire de l'ambassadeur de Toscane, les lettres devaient être envoyées à Florence. La candidature du souverain florentin a été soutenue, entre autres, par Stanisław Karnkowski, archevêque de Gniezno, Olbracht Łaski, voïvode de Sieradz et par le chancelier Jan Zamoyski. Au début de février 1587, ils envoyèrent une ambassade à Florence, qui comprenait, entre autres, le beau-frère du voïvode de Sieradz, Wincenty de Seve, prévôt de Łask, qui reçut l'ordre d'inviter le grand-duc à participer aux prochaines élections. Sa candidature aurait été présentée dans la voïvodie de Sandomierz par le chancelier Zamoyski lui-même, qui, selon Urbani, favorisait sincèrement François. Selon le diplomate toscan, les ducs de Ferrare et de Parme avaient peu de chance lors des prochaines élections en tant que dirigeants mesquins et insignifiants. Le fait que le milieu florentin de Cracovie ait également été vivement intéressé par l'élection à venir est attesté par une lettre du 7 janvier 1587, de Filippo Talducci, adressée à Marco Argimoni à Florence, dans laquelle, énumérant les candidats à la Couronne polonaise, il a mentionné le grand-duc de Toscane, qui, s'il voulait mobiliser les ressources financières appropriées, aurait une chance d'être élu (il figliuolo del Re di Svetia, il Cardinale Batori, il Duca di Ferrara et il nostro Serenissimo Gran Duca, il quale se volessi attendere con li mezzi sapete, sarebbe cosa riuscibile. Dio lasci seguire il meglio). Les aspirations à la couronne polonaise des ducs de Ferrare, de Parme et même de Savoie sont mentionnées dans la correspondance des ambassadeurs de Toscane à Madrid, Bongianni Gianfighacci et Vincenzo Alamanni (lettres du 21 février, 27 mars et 4 avril 1587) (d'après « Dwór medycejski i Habsburgowie ... » par Danuta Quirini-Popławska, p. 123-126). Le portrait du grand-duc, aujourd'hui conservé au palais de Wilanów (Wil.1494), pourrait faire référence à cette candidature. Il provient très probablement d'une série de petits portraits similaires provenant de Ros près de Grodno en Biélorussie, attribués à l'école italienne du XVIIIe siècle. Ce « portrait d'homme » est considéré comme une copie d'Angelo Bronzino, mais il ressemble beaucoup aux portraits de Francesco réalisés par son peintre de cour Alessandro Allori (1535-1607). Les arcs de triomphe pour les cérémonies d'entrée du roi Sigismond III Vasa à Cracovie en 1587 devaient être habillés d'images des Jagellon en tant qu'ancêtres du nouveau roi. Comme leurs visages étaient presque totalement inconnus en raison de leur ancienneté (Effigies enim eorum, cum plerisque fere vetustate ignotae essent), le dit chancelier Zamoyski les fit extraire des monuments les plus anciens (ex antiquissimis quibuscumque monumentis eruerat) et les munit des inscriptions appropriées. Ces inscriptions ont été imprimées séparément et certaines sont citées par David Chytraeus dans son Chronicon Saxoniae ..., publié à Leipzig en 1593 (d'après « Listy Annibala z Kapui ... » d'Aleksander Przezdziecki, p. 107). C'est grâce aux efforts des générations suivantes que l'identité de nombreuses personnalités importantes a été préservée. Ils ajoutent des inscriptions aux peintures, créent des copies ou les publient sous forme de gravures. Dans les anciens territoires de la République, cette continuité a été dramatiquement interrompue par les guerres et les invasions. Les costumes italiens, la nourriture, les jardins, la musique, la langue et les livres, les peintures, l'artisanat et les danses étaient les plus populaires dans la République polono-lituanienne, même les heures étaient encore comptées à l'italienne sous le règne du monarque élu Sigismond III Vasa - 24 heures du coucher du soleil un jour au coucher du soleil le lendemain. Dans deux lettres, probablement de 1614 et 1615, Sigismond III exprime sa gratitude au nonce Claudio Rangoni pour les tableaux qu'il envoie d'Italie. Deux ans plus tard, en 1617 et l'année suivante, Rangoni envoya de nouveau deux tableaux et « quelques [autres] tableaux » (alcuni quadri) au roi, puis à la reine. Selon le nonce, le roi aimait les peintures et achetait volontiers les œuvres des meilleurs maîtres et démontrait une passion pour les bijoux et les tapisseries coûteuses. Le roi n’était pas seulement un amateur d’art, mais aussi un artiste amateur. Ce qui est très significatif, c'est que lors de la rébellion de Zebrzydowski en 1606, ses adversaires se sont moqués de lui en le qualifiant de « vénitien » (wenecysta), qui préfère « monter avec les Italiens en gondole, payant richement leur folie, au lieu de monter un cheval en armure » (d'après « Odrodzenie w Polsce ... », Volume 5, éd. Bogusław Leśnodorski, p. 358). Dans ses « Sermons de diète » (Kazania sejmowe), publiés en 1597 à Cracovie, Piotr Skarga, le prédicateur de la cour de Sigismond III, appelait métaphoriquement le parlement à ne pas restreindre davantage le pouvoir du roi en faveur d'un absolutisme plus habsbourgeois : « Messieurs ! Ne faites pas le royaume de Pologne une ville [libre] du Reich allemand, ne faites pas un roi peint comme à Venise. Parce que vous n'avez pas l'esprit vénitien et que vous ne vivez pas dans une seule ville » (Sermon 6). Il a également grondé la grande richesse et la vie luxueuse de la noblesse, leurs vêtements coûteux de velours et de soie, les caves pleines de vin, les voitures dorées: « Voyez quelle abondance et richesse et vie joyeuse cette mère vous a apportée, et comment elle vous a doré et accordé tant que vous avez assez d'argent, de la nourriture en abondance, des vêtements si chers, de telles foules de serviteurs, de chevaux, de chariots ; tant d'argent et de revenus multipliés partout » (Sermon 2), et négligeant la défense de la République : « Personne vivant dans l'abondance comme ça surveille les châteaux et les murs de la ville » (Sermon 8). Comme à l'époque précédente, au XVIIe siècle, les costumes étrangers étaient encore très populaires parmi la noblesse. Franciszek Siarczyński dans son « L'image du règne de Sigismond III ... », publiée à Poznań en 1843, affirme qu'il a « vu des peintures à Cracovie dans lesquelles Zebrzydowski ressemblait à un sultan, Zborowski à un chevalier romain, à Krosno Stanisław Oświęcim, a tous les vêtements d'un Suédois, Tarnowski d'un Grec armé, etc. Niesiecki a décrit le portrait à Topolno de Krzysztof Konarski, de 1589, sous les traits d'un chevalier allemand ». Un noble en tenue de parade espagnole, qui participa à l'expédition du prince Ladislas Vasa à Moscou en 1612, fut ridiculisé par d'autres soldats : « [retournez] à Salamanque, à Compostelle, monsieur l'Espagnol » (d'après « Obraz wieku panowania Zygmunta III ... », p. 73-74). Les membres des différents groupes ethniques de Sarmatie se sont rendus dans différents pays d'Europe occidentale, principalement pour faire des affaires, car le pays était un fournisseur majeur de nombreux biens importants, mais aussi pour poursuivre leurs études, pour un meilleur climat ou pour la santé, pour faire un pèlerinage ou simplement pour visiter d'autres pays. Après avoir terminé ses études à l'Académie de Cracovie ou de Vilnius ou dans d'autres écoles importantes de la République polono-lituanienne, il était d'usage de poursuivre ses études à l'étranger, à Padoue, Bologne, Louvain, Leiden ou Ingolstadt, entre autres. À l'étranger, les Sarmates ont fréquemment adopté des costumes locaux, ce qui est confirmé par de nombreuses sources, mais certains ont décidé de voyager dans leurs costumes traditionnels - généralement un żupan cramoisi, un manteau delia et un chapeau kolpak. Ces costumes ont été fréquemment repris dans leurs œuvres par différents artistes d'Italie, de Flandre, des Pays-Bas et de France. Certains étrangers étaient également représentés en costumes sarmates, comme le peintre Martin Ryckaert dans son magnifique portrait peint vers 1631 par Antoine van Dyck (Musée du Prado à Madrid). Nicolas Lagneau (Bibliothèque nationale de France), Stefano della Bella, Guercino (Nationalmuseum de Stockholm) et Rembrandt ont laissé de nombreux dessins et gravures représentant des personnages vêtus de costumes typiques sarmates. De tels costumes peuvent également être vus dans les peintures de Mattia Preti (Musées du Capitole à Rome), Giuseppe Maria Galeppini (collection privée en Suède) et David Teniers le Jeune (Louvre et Galerie d'État de Neubourg). Johann Heinrich Schönfeld a peint vers 1653 ses « Sarmates au tombeau d'Ovide » (Musée des Beaux-Arts de Budapest et Royal Collection), qui pourrait être une illustration de l'un des nombreux récits de la Renaissance sur les expéditions de recherche de la tombe du poète, comme celle décrite par Stanisław Sarnicki en 1587 (Annales, sive de origine et rebus gestis Polonorum et Lituanorum, p. 73), et Philips Wouwerman réalisent entre 1656 et 1668 un tableau représentant la cavalerie polono-lituanienne combattant l'armée du « brigand de l'Europe » lors du déluge (National Gallery, Londres). La poésie préservée, créée avant le déluge, confirme l'image d'une République riche, préoccupé par divers problèmes sociaux, et non d'un pays ravagé par des guerres constantes et des invasions de voisins, luttant pour son indépendance. Le recueil de manuscrits de poètes polonais, principalement membres de la communauté des frères polonais (ariens), compilé en 1675 par Jakub Teodor Trembecki (1643-1719/1720), publié en 1910-1911 par Aleksander Brückner (« Jakuba Teodora Trembeckiego wirydarz poetycki », tome I), comprend les poèmes suivants de poètes inconnus : 27. Sur une fête italienne, 28. La prospérité polonaise, 29. L'espièglerie polonaise, 165. Sur les costumes étrangers en Pologne (« De nos jours, on reconnaît à peine les Polonais, il y a des Italiens, des Français, en grand nombre à la cour »); de Jan Gawiński de Wielomowic (vers 1622 - vers 1684) : 215. Sur Vénus (« Vénus mécontente ne rend personne riche ; elle a un fils nu ; contente, quand tu la payes »), 262. Une fille sans honte (« Et votre belle nature et vos sens merveilleux, ma Dame, ont été gâtés par ces bizarreries de vos costumes »), 263. Les épouses d'aujourd'hui (« Chez les païens, les femmes mouraient pour leurs maris, et aujourd'hui elles dansaient sur sa tombe »), 325. Le concept d'un peintre ruthène sous le tableau de Judith décapitant Holopherne; par Hieronim Morsztyn (vers 1581 - vers 1622) : 368. Maladie de cour (« La syphilis, les ulcères, les bubons, furent amenés de France et ils furent hébergés dans un lupanar »), par Jan Andrzej Morsztyn (1621-1693): 471. À l'Italien (« Toi, Italien, vends des produits vénitiens et tu en profites grandement ») et de Daniel Naborowski (1573-1640) : 617. À un hermaphrodite (« Tu as une forme féminine mais tu as une bite, donc tu es tous les deux [femme et homme] »), 643. Sur des images de nus dans les bains (« C'est décent de se laver nu dans les bains »). Pour son épigramme obscène sur les seins féminins, Hieronim Morsztyn s'est très probablement inspiré d'un modèle italien : « Cazzo [un vulgarisme italien pour phallus], coincé dans l'entrejambe, ne pouvait pas faire son travail » (Cazzo w kroku pojmane nie mogło się sprawić) (d'après « Poeta i piersi » de Radosław Grześkowiak, p. 18). La reine d'origine française Marie-Louise de Gonzague est généralement considérée comme ayant introduit en Pologne des costumes féminins plus audacieux, pour ne pas dire inappropriés, principalement en raison du contraste marqué entre les effigies de la reine et les portraits de ses prédécesseurs de la dynastie des Habsbourg - Cécile-Renée d'Autriche, Constance d'Autriche et Anna d'Autriche. Cependant, de nombreux auteurs semblent oublier que ces reines préféraient la mode de la cour impériale ou espagnole qui n'autorisait pas les seins nus décrits par Wacław Potocki (1621-1696). La popularité des costumes audacieux français, vénitiens et florentins a été confirmée bien plus tôt par Piotr Zbylitowski dans sa « Réprimande de la tenue extravagante des femmes » (Przygana wymyślnym strojom białogłowskim), publiée à Cracovie en 1600, et la mode italienne dominait à la cour des Jagellon. Même si en fait la mode introduite par Marie-Louise « révélée » davantage au regard du public. Dans une lettre de Gdańsk du 15 février 1646 adressée au cardinal Jules Mazarin (1602-1661), la reine écrit que « les dames polonaises sont habillées comme on s'habillait en France il y a quinze ans : des robes cousues à la hâte, à taille très courte et des manches très larges. Elles se précipitent toutes à toute vitesse pour imiter nos vêtements. Leurs matériaux sont extrêmement chers et recouverts de pierres précieuses. La belle-fille du grand chancelier de la couronne [Katarzyna Ossolińska née Działyńska] change de tenue tous les jours ». Le courtisan français Jean Le Laboureur (1621-1675) rapporte également que de nombreux membres de la noblesse s'habillaient à la française pour la réception de la reine. Szymon Starowolski (1588-1656) dans sa « Réforme des habitudes polonaises » (Reformacya Obyczaiow Polskich), publiée avant 1653, déplore que « presque toute la Pologne est devenue française, et probablement toute a été frappée par la maladie française [syphilis] » (wszytka już prawie Polska sfrancuziała, a podobno sfrancowaciała) et Krzysztof Opaliński (1609-1655) ne put s'empêcher de ridiculiser les costumes exagérés et l'utilisation excessive de produits cosmétiques par les dames dans son Liryki (lait d'ânesse pour éclaircir le teint, amandes grillées pour assombrir les sourcils, coraux écrasés avec de l'écume de mer-sépiolite comme poudre pour les joues). « Les dames riches d'ici aiment beaucoup les vêtements somptueux, elles commandent donc aux religieuses diverses œuvres délicates et les paient bien », écrit une des religieuses françaises de la Visitation de la Vierge Marie, qui visita la Pologne en 1654. Elle ajoute également qu'elle vit dans plusieurs monastères de merveilleuses broderies d'argent, d'or et de soie, parfaitement finies, ornées de bijoux d'une grande splendeur, parfois même de luxe. La reine Marie-Louise, qui venait de quitter Paris, écrivait dans la lettre mentionnée au cardinal Mazarin que : « La splendeur est extraordinaire [...] Bref, je n'en avais aucune idée, malgré les meilleures pensées que je m'étais créées pour reprendre courage pendant le voyage. Tout a dépassé mes attentes, vous n'aurez donc aucun doute que je suis très satisfaite » (d'après « Studya historyczne » de Wiktor Czermak, p. 75-76, 98-99, 101-102, 123-125, 127). Parfois, les dames étrangères adoptaient aussi quelque chose de la mode polonaise. Une française et dame d'honneur de la reine, Marie Casimire de La Grange d'Arquien, confiait dans une de ses lettres à Jan Sobieski qu'elle en avait déjà marre du soutien-gorge qu'elle portait jusqu'à présent, et elle en commandait un nouveau : « il est un peu criméen, boutonné à l'envers » (il est un peu z krymska zapięty na bakier) avec des mots polonais dans une lettre française. Bien que son nouveau vêtement n'était pas purement polonais, car le mot « criméen » indique également le motif tatar original. Ladislas IV acheta et commanda de nombreux tissus de luxe auprès de marchands italiens pour lui et la reine. En 1637, la somme de 11 281 zlotys fut versée au marchand de Cracovie Wincenty Barsotti pour la soie et le linge de lit destinés au mariage du roi et un an plus tard, en septembre 1638, Ladislas acheta, par l'intermédiaire de Hieronim Pinocci en Italie, « cinq pièces de drap d'or » pour un montant de 7 265 zlotys, et quelques années plus tard, en novembre 1645, il devait à nouveau 4 000 thalers à Pinocci pour des tissus apportés de Venise et de Vienne. Selon la lettre du roi à son trésorier en date du 7 décembre 1634, lorsque l'envoyé de la République polono-lituanienne se rendit à Moscou, il y avait dans son entourage un courtisan avec une commission royale pour acheter des « fourrures diverses et fines » pour 20 000 zlotys. Selon les registres de 1652-1653, Jean Casimir achetait du satin, du velours, de la soie fine, de la dentelle d'or, des rubans, etc., ainsi que des fourrures de lynx, d'hermine, de zibeline et de loir, principalement auprès des Juifs. En 1667, Mademoiselle Ruffini, apparemment italienne ou d'origine italienne comme l'indique son nom de famille, était payée entre 2 318 et 2 528 zlotys par mois pour les besoins de la cuisine de la reine. Alors que selon la liste des dettes de Ladislas IV, il devait 39.412 zlotys pour des vins italiens, français et hongrois importés de Vienne dans les années 1636-1639, et 90.000 zlotys à un bijoutier et Jean Casimir a payé à l'horloger environ 17.500 zlotys entre 1652-1653, environ 13.000 zlotys pour ses vêtements et 74.726 zlotys au total pour les beaux vêtements de ses domestiques, l'achat et l'exécution de plusieurs tableaux (à Salomon Schindler pour les tableaux, au Père Karwat pour les tableaux peints à Rome, à un peintre d'Elbląg) entraîna une dépense de seulement 2 026 zlotys entre 1652 et 1653. Cette valeur inférieure ne signifie pas qu’il ne s’agissait pas de peintures splendides. Rappelons que les « maîtres anciens » sont devenus tels bien plus tard et que d'éminents peintres pour lesquels certains sont aujourd'hui prêts à payer une fortune, ont parfois eu du mal à vendre leurs œuvres de leur vivant ou leurs tableaux ont été sous-évalués, comme dans le cas d'El Greco, éminent peintre gréco-espagnol formé à Venise. Le Greco n'a reçu que 350 ducats pour Le Dépouillement du Christ (El Expolio), achevé au printemps 1579 pour l'autel de la sacristie de la cathédrale de Tolède, bien que son propre expert l'avait évalué à 950 et le Martyre de saint Maurice, peint pour l'Escurial en 1580, ne satisfit pas le roi Philippe II. Le seul chef-d'œuvre du Greco en Pologne, probablement issu de la collection Lubomirski, a été découvert par hasard en 1964 dans l'église paroissiale de Kosów Lacki, à l'est de Varsovie, et a donc été oublié pendant plusieurs siècles. On ne peut exclure que son style « vénitien » ait été reconnu par le jeune Jerzy Sebastian Lubomirski (1616-1667) et qu'il ait été acheté lors de sa visite en Espagne en 1634. Le nonce Mario Filonardi (1594-1644) dans une lettre du 11 juillet 1637 au cardinal Bartolini mentionne que pour décorer son palais d'Ujazdów, Ladislas IV importa de Florence un grand nombre de statues en bronze, de tables en marbre et de statuettes. Ces sculptures devaient coûter 7 000 thalers, et leur installation fut réalisée par l'architecte Agostino Locci, formé à Rome. Le nom de l'auteur n'est pas mentionné, mais le principal sculpteur actif à cette époque à Florence était Pietro Tacca (1577-1640), qui travailla pour les cousins de Ladislas de la famille Médicis et créa des statues équestres en bronze de l'oncle du roi, le roi Philippe III de Espagne et son fils Philippe IV, tous deux à Madrid. En 1625, lors de sa visite à Florence ou à Livourne, d'où le prince devait s'embarquer pour Gênes, Ladislas eut également l'occasion de rencontrer personnellement le sculpteur. Il n'y a aucune trace de ces statues nulle part, ce qui indique qu'elles ont probablement été fondues par les envahisseurs pour fabriquer des canons. Outre les grandes résidences en briques bien connues de Varsovie, Cracovie, Vilnius et d'autres grandes villes, les Vasa polono-lituaniens possédaient plusieurs grands palais en bois dont rien ne subsiste aujourd'hui. Le plus important était Nieporęt, près de Varsovie. Le palais a été construit par Sigismond III et appartenait plus tard à Jean Casimir. Il avait une grande cour, un beau jardin et une magnifique chapelle. Le Laboureur vante le splendide travail de menuiserie du bâtiment et écrit qu'il comportait un grand nombre de pièces confortables, toutes très belles et qu'il ne laisse rien à désirer sinon qu'il soit fait d'un matériau plus durable. Il y avait aussi plusieurs demeures en bois construites à Varsovie et dans d'autres villes pour différents membres de la famille et plusieurs palais de chasse, comme celui de la forêt de Białowieża, construit avant 1639 selon les plans de Giovanni Battista Gisleni. La poésie baroque faisait également référence à la position des femmes dans la société et à la valeur des peintures. « S'il y avait davantage de telles [femmes] en Pologne, on ferait bien plus ! » (O gdyby takich w Polszcze było siła, Daleko by się więcej dokazało!), commente Wacław Potocki dans son poème « Judith » (Judyta) après la défaite des forces de la République à la bataille de Pyliavtsi en septembre 1648, louant la sagesse, la force et le courage des femmes et critiquant l'ineptie des dirigeants masculins. « Pourquoi refuses-tu une chose aussi triviale ? » (Czemuż mi rzeczy tak lichej żałujesz?), demande le poète, très probablement Jan Andrzej Morsztyn (1621-1693), dans son « De l'image refusée » (Na obraz odmowiony), en commentant le refus de sa bien-aimée de lui offrir son portrait. Ce passage confirme que les effigies peintes étaient populaires et peu coûteuses. Une anecdote du début du XVIIe siècle provenant d'une auberge de Gdańsk fait référence à des effigies peintes commandées par des nobles - un certain noble envoya un peintre chez son ami pour faire un portrait de sa femme, célèbre pour sa beauté, mais le mari chassa le peintre en disant que si le noble aimait le portrait, il voudrait aussi voir l'original tous les jours (d'après « Mówią wieki », tome 19, 1976, p. 13). Les inventaires des collections royales des Jagellon et des Vasa de Pologne-Lituanie n'ont pas été conservés dans leur intégralité, mais les informations conservées dans les testaments des citadins, ainsi que dans les inventaires de leurs biens, et le mécénat de leurs successeurs donnent une impression de qualité de leurs collections, alors que le pays était l'un des premiers pays d'Europe à la renaissance et au début du baroque. La Pologne-Lituanie était aussi l'une des plus riches du continent. Même les couches inférieures de la noblesse de la République possédaient les plus beaux objets fabriqués dans les meilleurs ateliers locaux et étrangers - comme le lavabo en argent aux armoiries Rogala de Jan Loka, staroste de Borzechowo, créé à Augsbourg par Balthasar Grill, caché dans le sol pendant le déluge (1655-1660). L'attitude envers l'art dans le Brandebourg, qui fut l'un des envahisseurs lors du déluge, et à la cour royale de Pologne-Lituanie est mieux illustrée par le rapport d'Andrzej Köhne-Jaski, un marchand d'ambre calviniste de Gdańsk, également actif dans la diplomatie comme envoyé de Sigismond III et des électeurs de Brandebourg. Vers 1616, Jaski commentait la destruction de tableaux dans le Brandebourg : « Je n'y ai pas prêté beaucoup d'attention cet été, mais je me souviens des magnifiques tableaux d'Albrecht Dürer et de Lucas [Cranach] accrochés dans les églises. J'aimerais que SM [Sa Majesté] ait de telles [peintures] » (Ich habe dießen sommer so genaue achtung nicht darauf gegeben, aber erinnere mich, das noch schöne bilder von Albrecht Dührer und Lucas vorhanden und in der kirchen hengen. Wolte wünschen, das EM solche hätten) (d'après « Das Leben am Hof ... » de Walter Leitsch, p. 2358). A cette époque, l’art italien et flamand, et non allemand, dominait la cour royale. Les patriciens de la ville royale de Cracovie, dont beaucoup étaient d'origine italienne comme leurs noms l'indiquent, possédaient de nombreux tableaux, parfois d'excellents maîtres étrangers, comme en témoigne l'extrait du testament de Jan Paviola (Joannes Benedictus Savioly, décédé en 1653), conseiller de Cracovie. La liste et l'estimation des peintures, expertisées par les anciens de la guilde des peintres Marcin Klossowski et Marcin Blechowski, peintres de Cracovie, comprennent de nombreux portraits et peintures qui pourraient provenir des écoles italienne, vénitienne, flamande, hollandaise et allemande, mais l'auteur et le l'origine n'a pas été indiquée. Le mot paysage - lanczaft en vieux polonais, était utilisé sous une forme très similaire à Landschaft en allemand et landschap en néerlandais, ce qui pourrait indiquer que ces peintures étaient hollandaises/flamandes ou allemandes. « Image de feu le roi Ladislas IV ; la reine Son Altesse Louise Marie ; Image du fils impérial ; sa sœur ; feu le seigneur de Cracovie Koniecpolski ; [Image] dans laquelle une femme couronnée donne une chope à un soldat ; Quatre images, représentant le quatre parties du monde avec des gens ; quatre représentant le jour et la nuit, une endommagée ; trois représentant une partie du monde ; Paysage avec pêche ; Image de Bethsabée : se baignant ; [Image] représentant la destruction de la ville, avec l'armée en dessous combats ; quatre tableaux de l'histoire de Joseph, très abîmés, dont un entier ; paysage avec des bandits ; tableau de Judith, cassé ; une cuisinière avec du gibier ; 12 images d'empereurs romains; deux sur lesquelles des poissons sont peints, sans cadres ; Image du roi Ladislas IV en peau d'élan ; Judicium Parisis [Jugement de Pâris] avec trois déesses ; quatre images représentant les parties de l'année avec des jeunes filles ; Portrait de Sa Majesté le roi Ladislas IV dans un manteau rouge ; la reine Son Altesse Cécile [Renée] ; le roi Son Altesse Sigismond III ; Frédéric-Henri, prince d'Auraniae [Orange] ; le roi Christian du Danemark ; duc de Saxe; l'Empereur Son Altesse Ferdinand III ; Sa femme l'impératrice; Léopold; la vieille impératrice; Une image d'un homme avec une tasse et un crâne ; des cavaliers jouant aux cartes avec une dame ; Orphée avec des animaux ; Paysage avec des gens mangeant en été ; voleurs, sur cuivre, dans un cadre ; sur cuivre, sans figures, avec une colonne ou un pilier ; Peinture sur cuivre, trois rois [Adoration des mages] ; lavant les pieds des apôtres; Image d'un jardin, sur cuivre; Judith, sur cuivre ; Esther, sur cuivre ; sur du cuivre, Melchisédech offrant du pain et du vin à Daniel ; Saint Pierre sortant de la prison avec l'ange ; le Samaritain sur cuivre ; Saint François; Cinq tableaux avec écume de mer sur gumi, réalisés avec des peintures sur parchemin ; Image sur panneau, un crâne ». Cette longue et riche liste de peintures a été réalisée le 15 février 1655. Quelques mois plus tard, en juillet 1655, deux armées suédoises entrèrent dans la Grande Pologne, l'une des provinces les plus riches et les plus développées de la République, qui pendant des siècles n'avait été affectée par aucun conflit militaire. Ils furent bientôt suivis par d'autres pays et les envahisseurs n'étaient pas aussi sensibles à l'art que les patriciens de la République, les matières précieuses, le cuivre, l'argent et surtout l'or étaient les plus importantes. Paul Würtz (1612-1676), gouverneur de Cracovie pendant l'occupation suédo-transylvaine de la ville entre 1655 et 1657, ordonna d'arracher des barres de fer forgé, des marbres, des boiseries précieuses et des sols, ainsi que le sarcophage en argent de saint Stanislas, créé à Augsbourg en 1630 (fondé par Sigismond III), autel en argent de saint Stanislas, créé à Nuremberg en 1512 (fondé par Sigismond I), et des statues et chandeliers de la cathédrale de Wawel à fondre (d'après « Elity polityczne Rzeczypospolitej ... » par Marceli Kosman, p. 323). La véritable origine des objets pillés était souvent dissimulée ou effacée comme des armoiries sur les lions de marbre devant le palais de Drottningholm près de Stockholm. « Avant-hier, il nous vint nouvelle qu'ils avaient saccagé toutes les églises de Cracovie, et qu'on n'en avait pu sauver qu'un calice dont quelques religieux disaient la messe en secret », rapporte dans une lettre du 4 décembre 1655 de Głogów Pierre des Noyers, secrétaire de la reine Marie Louise de Gonzague (d'après « Lettres de Pierre Des Noyers secrétaire de la reine de Pologne ... », publiées en 1859, p. 22). La situation était similaire dans d'autres villes de la République, notamment à Vilnius et Varsovie, où lors de la deuxième occupation les résidences royales ont été soumises à un pillage systématique par les forces suédoises et brandebourgeoises. « Les habitants de Varsovie ont dû aider à transporter les objets pillés à la banque de la Vistule, sous peine de confiscation de leurs propres biens. [...] Le 11 août, le commandant de la capitale, le général von Bülow [Barthold Hartwig von Bülow ( 1611-1667)], a reçu l'ordre de transporter tous les objets de valeur et les œuvres d'art du château. À cette époque, plus de 200 peintures ont été emportées, y compris les plafonds de cinq salles du château, l'argenterie royale, les meubles et 33 tapisseries. Les Suédois avaient déjà commis de véritables actes de barbarie, grattant l'or des boiseries et des plafonds dorés, « dont ils ne peuvent avoir tiré plus de trois ou quatre ducats, et ont fait un dommage de plus de 30,000 francs » [selon la lettre citée de des Noyers]. Tout ce qui avait de la valeur était transporté par voie d'eau vers Toruń et Königsberg, par exemple colonnes de jaspe du jardin royal » (d'après « Warszawa 1656 » de Mirosław Nagielski, p. 262). « Ils ont généralement tout tué à Vilna [Vilnius], tant hommes que femmes, hormis les jeunes et les enfants, qu'ils ont envoyés en Moscovie, et ont mis des Moscovites pour habiter cette ville-là. [...] A Vilna, les Moscovites ont ruiné la belle et somptueuse chapelle de saint Casimir, qui coûtait plus de trois millions; et dans la grande église, ils y ont mis leurs chevaux; elle leur sert d'écurie », ajoute des Noyers dans des lettres du 8 novembre et du 28 décembre 1655 (d'après « Lettres ... », p. 10, 40). Le prochain inventaire important de peintures d'un conseiller de Cracovie, Gerhard Priami, réalisé le 21 juillet 1671, si peu d'années après le déluge (1655-1660) destructeur, n'est pas si impressionnant : « Portraits du roi Sigismond III avec la reine [ ...]; Image de la flagellation [du Christ] [...]; Salomon, vers le haut [...]; Saint Joseph sur panneau, à l'ancienne [...]; Quatre paysages [...]; Paysage avec une foire [...] ; Image de Loth [et de ses filles] [...] ; Deux paysages à hauteur de coude ; Image de Judith [...] ; Trois images de l'histoire de Tobias ; Image de la sainte Vierge en roses ; Saint Jean-Baptiste ; Jésus tombant [sous la croix] ; Image de la sainte Vierge majoris ; Deux portraits de Monseigneur Ossoliński, le second de Monseigneur Lubomirski ; blasons, impériaux et royaux ; Deux courtisanes, l'un plus grand l'autre plus petit; Portrait de feu Priami, qui reste chez M. Jerzy Priami ». Selon le testament de Jan Pernus, conseiller de Cracovie, de 1672, il possédait un grand tableau de Præsentationis (Présentation), prétendument de Rubens. Il collabora avec les Suédois lors de l'invasion dans les années 1655-1657 et participa au pillage honteux du palais royal de Łobzów et de la cathédrale de Wawel par les occupants. Pernus a pillé des marbres précieux du palais de Łobzów, et il est possible qu'il ait pris les peintures décorant la résidence royale (d'après « Galeria rajcy Pernusa » de Michał Rożek). « Deux tableaux de travail romain sur cuivre, qui se trouvent dans ma chambre, l'un de la Nativité du Christ, l'autre de l'Assomption de la Vierge Marie de taille égale ; je veux que mon neveu (Franciszek Pernus, héritier) les offre à Sa Majesté le Roi, le Seigneur miséricordieux, de ma part, le sujet le plus bas [...] À M. Reyneker, conseiller de Cracovie, mon gendre, [...] Je lui marque une image de saint Jean de Kenty, peint sur une plaque de métal, du digne maître Strobel [Bartholomeus Strobel], lui demandant d'accepter ce petit cadeau en signe de mon amour et en souvenir. [...] Vivant en grande amitié avec le prêtre Adam Sarnowski, chanoine de Varsovie et Łowicz, scribe privé de Son Altesse, je lui donne en souvenir un tableau de la Vierge Marie, d'un éminent artisan romain. Ce tableau se trouve dans la chambre du jardin, avec saint Joseph et saint Jean, en plus quatre tableaux sur toile, avec des fleurs, d'environ trois quarts de coudée de large, avec des cadres dorés ». Au monastère de Bielany il a donné quatre tableaux avec des fleurs de travail romain et des portraits de lui-même et de sa femme à la chapelle Pernus de la basilique Sainte-Marie de Cracovie (d'après « Skarbniczka naszej archeologji ... » d'Ambroży Grabowski, pp. 61- 68). Le mentionné Adam Sarnowski a pris des dispositions pour ses biens et peintures dans son testament signé à Frombork le 15 avril 1693, quatre mois avant sa mort. Il a laissé à la reine Marie Casimire Sobieska (de La Grange d'Arquien) un tableau : « A la reine Sa Majesté, Ma Dame, l'original des Trois Rois [Adoration des Mages] de Rembrandt, dans des cadres noirs, qui est à l'étage dans la salle, et une autre belle M. Locci choisira » (d'après « Testament Adama Sarnowskiego... » d'Irena Makarczyk, p. 167). Jadwiga Martini Kacki, plus tard Popiołkowa, dans son testament de 1696 dit: « Aux Pères Carmélites na Piasku, veuillez donner deux peintures peintes à la grecque sur toile, et la troisième par Salwator ». La liste des propriétés de 1696 de Kazimierz Bonifacy Kantelli (Bonifacius Casimirus Cantelli) de Carpineti en Campanie, apothicaire et secrétaire royal, venu à Cracovie depuis Krosno et obtenant les droits de la ville en 1625, comprend un grand nombre de peintures, principalement religieuses ; mais il y a aussi des portraits de personnages notables, tels que le roi Jean III Sobieski, Ladislas IV Vasa, la reine Marie Louise de Gonzague, la reine Cécile-Renée d'Autriche, le roi Jean Casimir, le roi Michel Korybut, le chancelier Ossoliński et bien d'autres. Parfois, il y a aussi d'autres objets d'art dans les inventaires, comme « l'effigie d'ambre du roi Sigismond III », mentionnée dans le testament de Wolfowicowa, épouse du conseiller de Cracovie en 1679. En 1647, une veuve Anna Zajdlicowa née Pernus, dans son dernier testament a déclaré : « À M. Filip Huttini, secrétaire et scribe des décrets du Roi Sa Majesté, conseiller de Cracovie, je donne et lègue ma tapisserie en cuir doré [cuir de Cordoue], avec des images de rois polonais ». Il y avait aussi de nombreuses peintures avec des thèmes mythologiques. Dans le registre de propriété du conseiller Kasper Gutteter (1616) il y avait des peintures représentant Vénus, Hercule et le labyrinthe mythique. L'image de Mercure avec Vénus se trouvait dans la maison de Wojciech Borowski (1652). Rozalia Sorgierowa (1663) avait une peinture d'Andromède et la liste des propriétés d'Oktawian Bestici de 1665 contenait: « Satyre sur toile », « Vénus allongée nue » et « Trois Dianes ». Dans la collection d'Andrzej Kortyn (Andrea Cortini), il y avait six peintures mythologiques, dont Vénus et Cupidon (d'après « Mecenat artystyczny mieszczaństwa krakowskiego ... » de Michał Rożek, p. 177). Selon le riche inventaire du 10 mai 1635, le scribe municipal de Poznań Wojciech Rochowicz possédait un tableau de Pallas Athéna, Vénus et Junon, ainsi que 5 petits tableaux dans des cadres peints sur des planches de chêne représentant le « peuple romain ». Plusieurs peintures érotiques ont été mentionnées dans la très riche galerie du bourgeois de Poznań Piotr Chudzic, mort en 1626, comme une « image nue pour l'appétit », « 3 peintures de courtisanes » et « une toute petite image vénitienne ronde sur étain d'une courtisane » (d'après « Odzież i wne̜trza domów ... » de Magdalena Bartkiewicz, p. 68 et « Inwentarze mieszczańskie Poznania », p. 407). Rochowicz à Poznań avait une image d'une courtisane et une d'une wenetka (courtisane vénitienne), Krzysztof Głuszkiewicz à Lviv avait six peintures de courtisanes et à Cracovie des peintures de courtisanes appartenaient à: Franciszek Delpacy (1630), Anna Telani (1647), Oktawian Bestici (1655), Andrzej Cieski (1659), Gerard Priami (1671) et Stanisław Kłosowicz (1673), qui avaient quatre tableaux de courtisanes (d'après « Sztuka a erotyka », éd. Teresa Hrankowska, p. 197). Hieronim Morsztyn (1581-1623), auteur du « Plaisir mondain » (1606) et de nombreux poèmes érotiques, dans son ouvrage « Actéon. (Aux courtisanes polonaises) » écrivait qu'elles seraient heureuses de « courir nues ». Tableaux nus et érotiques, tels que « Un tableau rond dans un cadre doré, qui représente les 3 Grâces avec le portrait de Sa Majesté le Roi » (62), « Un tableau dans un cadre doré et sculpté, représentant les 3 Grâces, donnant les Livres de l'Éternité avec le portrait de Sa Majesté le Roi » (63) et « Un tableau représentant une femme nue avec un homme, enlacé" (65), sont mentionnés dans l'inventaire du pavillon de bains du roi Jean III Sobieski à Jovkva en 1690 (Regestr opisania łaźni w zamku żółkiewskim po odjeździe Króla Jmci na sejm do Warszawy in anno 1690 die 5 Januarii). Les Vasa polonais, descendants des Jagellon du côté maternel (par l'intermédiaire de Catherine Jagellon), étaient des mécènes renommés qui ont commandé de nombreuses belles peintures et autres objets localement et à l'étranger dans les meilleurs ateliers, comme par exemple une série de 6 tapisseries avec l'histoire de Diane, achetée vers 1611-1615 par Sigismond III Vasa dans l'atelier de François Spierincx à Delft. En 1624, Pierre Paul Rubens peint le prince Ladislas Sigismond Vasa (futur Ladislas IV) lors de sa visite à Bruxelles. Selon les sources disponibles, Rubens et le père de Ladislas Sigismond, le roi Sigismond III, ne se sont jamais rencontrés en personne, mais le beau portrait du roi est sans doute de sa main (attribution à Rubens par Ludwig Burchard, collection de Heinz Kisters à Kreuzlingen). Bien que non confirmée dans les lettres ou inventaires conservés, cette effigie du roi a sans aucun doute été créée à partir de dessins d'étude ou miniatures envoyés de Varsovie. Le roi élu Jean III Sobieski (à partir de 1674) organisa consciemment l'opinion européenne, commandant des œuvres appropriées, peintures et gravures en Pologne et à l'étranger, aux Pays-Bas, en Flandre, à Paris et en Italie (œuvres de Romeyn de Hooghe, Reinier de la Haye, Caspar Netscher, Prosper Henricus Lankrink, Ferdinand van Kessel, Adam Frans van der Meulen, Jan Frans van Douven, ateliers de Pierre Mignard et Henri Gascar, Jacques Blondeau, Simon Thomassin, Giovanni Giacomo de Rossi, Domenico Martinelli). Des sculptures exquises ont également été commandées à l'étranger, comme des statues des sculpteurs flamands Artus Quellinus II et de son fils Thomas II et Bartholomeus Eggers (Palais Wilanów et jardin d'été à Saint-Pétersbourg, pris à Varsovie en 1707), des bijoux à Paris (diamant Sobieski) et de l'argenterie à Augsbourg (œuvres d'Abraham II Drentwett, Albrecht Biller, Lorenz Biller II et Christoph Schmidt). La construction de sa résidence de banlieue, inspirée de la Villa Doria Pamphili à Rome, Sobieski a confié à Augustyn Wincenty Locci, fils de l'architecte italien Agostino Locci. Les meilleurs artistes, architectes et scientifiques locaux et étrangers ont participé à la décoration de la résidence et à la glorification du monarque, de sa femme et de la République. L'inventaire de la galerie d'images du palais Radziwill à Biała Podlaska, appelée Radziwiłłowska (Alba Radziviliana), du 18 novembre 1760, donne un aperçu intéressant de la qualité et de la diversité des collections de peinture dans la République polono-lituanienne. Le palais a été construit par Alexandre Louis Radziwill (1594-1654), grand maréchal de Lituanie après 1622 sur le site d'anciennes demeures en bois. L'inventaire répertorie 609 positions de peintures principalement religieuses et mythologiques dont rien n'est conservé à Biała : (52) Peinture de Diane, peinte sur étain avec deux flèches sans cadres, (53) Image d'Adonis dormant avec la déesse Héra [Vénus et Adonis], peint sur verre dans des cadres dorés, (84) Peinture de la chasse de Diane, peinte sur un panneau dans un cadre doré, (113) Vénus endormie allongée sur un lit, sans cadres, (117) Visage de Pallas [Athéna], peint sur toile sans cadre, (128) Vénus debout dans l'eau [Naissance de Vénus], peinte sur cuivre dans des cadres dorés, (157) Portrait du roi Sigismond Jagellon et grand-duc de Lituanie [Sigismond I] sur étain sans cadre, (158) Portrait du roi Sigismond de Pologne et de Suède [Sigismond III Vasa], [...], peint sur étain, sans cadre, (165) Portrait d'Henri Helesius [Henri de Valois], roi de Gaule et de Pologne, grand-duc de Lituanie, peint sur cuivre dans des cadres, (166) Portrait du roi Étienne Bathory, peint sur étain dans des cadres noirs, (181) Diane tenant une trompette, peinte sur toile dans de vieux cadres dorés, (192) Histoire de Vulcain et Vénus, peinte sur toile, sans cadres, (193) Deuxième histoire, également de Vénus, également avec Vénus et Vulcain, grande peinture sur toile, sans cadres, (206) Portrait d'homme, peinture de Rubens, sur toile dans des cadres noirs, (210) Peinture de Baceba [Bethsabée] au bain, peinte sur toile sans cadre, (213) Peinture de Lucrèce, expressive, avec un poignard, une belle peinture peinte sur toile, sans cadre, (217) Peinture d'Hérodianna [Hérodiade] avec la tête de saint Jean, peint sur toile sans cadres, (224) Image d'Hercule, peinte sur toile sans cadre, (233) Peinture de Vénus descendant des nuages, une grande peinture sur toile, sans cadres, (234) Image de Lucrèce percée d'un poignard, peint sur toile, sans cadres, (235) Peinture de Vénus nue couchée avec Cupidon, peinte sur toile, sans cadre, (258) Histoire de Vénus avec Adonis, grande peinture sur toile, sans cadre, (259) Portrait de un chevalier, en pied, Rabefso [Rubens?], sur toile sans cadre, (283) Peinture de Bacchus, peinte sur toile sans cadre, (284) Peinture de Judith, peinte sur toile, sans cadre, (296) Image de Lucrèce, peinte sur panneau, sans cadre, (302) Personne à moitié nue, peinte sur toile, sans cadre, (303) Lucrèce méditante, peinte sur toile, sans cadre, (335) Paysage avec nains et fruits, peint sur toile, (336) Paysage avec Diane mourante et les nymphes, sur toile, (348) Peinture de Vénus endormie nue, peinte sur toile, sans cadre, (349) Peinture d'Adonis avec Vénus jouissant, peinte sur toile, sans cadre, (376) Peinture de Vénus avec Cupidon et Zefiriusz avec Hetka [probablement Zéphyr et Hyacinthe homoérotique], deux pièces de mesure et de N° similaires, peintes sur toile, sans cadres, (390) Histoire de Dyanna sur laquelle tombe une pluie dorée [Danaé et la pluie d'or, peut-être par Titien ou atelier], peint sur toile sans cadres, (391) Vénus endormie, peinte sur toile, sans cadres, (535) Portraits de divers seigneurs ... trente-six de tailles différentes, peints sur toile, sans cadres, (536) Portraits de divers seigneurs et rois de taille inégale, peints sur toile, (544) Différents portraits sous un même numéro, dix-neuf pièces, peints sur toile, (577) Portrait d'Étienne Bathory, roi de Pologne, peint sur toile dans des cadres noirs, (596) Histoire de Judith avec Holopherne, peinte sur toile dans des cadres noirs, (597) Vénus endormie à la chasse, peinte sur toile, (604) Histoire de sainte Suzanne avec deux anciens, peinte sur panneau en cadres dorés noirs, (607) Rois de Pologne, cinquante et un sur parchemin et (608) Une dame avec un chien, peinte sur un panneau, sans cadre (d'après « Zamek w Białej Podlaskiej ... » d'Euzebiusz Łopaciński, pp. 37-47). Avec une collection aussi importante, il était difficile de décrire pleinement l'identité de chaque effigie. Le chaos de la guerre a également contribué à l'oubli des noms des modèles et des peintres. De nombreuses œuvres d'art de valeur en Pologne-Lituanie ont été pillées ou détruites lors des invasions du pays aux XVIIe, XVIIIe, XIXe et XXe siècles. Le pays s'est considérablement appauvri en raison des guerres, de sorte que des œuvres d'art précieuses et mobiles, en particulier celles dont l'histoire a été perdue, ont été vendues. À la fin du XVIIIe siècle, comme le pays lui-même, la Pologne-Lituanie avait presque complètement disparu de l'histoire de l'art européen. Les collections d'art ont été confisquées pendant les partages de la Pologne - après l'effondrement du soulèvement de Kościuszko en 1794 (en particulier les joyaux de la couronne polonaise), le soulèvement de novembre en 1830-1831 et le soulèvement de janvier en 1863-1864. Pour sécuriser leurs biens, de nombreux aristocrates déplacent leurs collections à l'étranger, notamment en France. Lorsque la Seconde Guerre mondiale a éclaté en 1939, les tapisseries jagellonnes commandées en Flandre par le roi Sigismond II Auguste et récupérées de l'Union soviétique entre 1922 et 1924, ont été transportées à travers la Roumanie, la France et l'Angleterre jusqu'au Canada et sont retournées en Pologne en 1961. Le système électif de la République polono-lituanienne a également favorisé la sortie d'œuvres d'art du pays. Les peintures et autres objets de valeur de la collection royale qui ont survécu au déluge (1655-1660) ont été transportés en France par le roi Jean II Casimir Vasa (1609-1672), qui a abdiqué en 1668 et s'est installé à Paris. De nombreux objets de valeur ont été hérités par Anne de Gonzague (1616-1684), princesse palatine, décédée à Paris. La reine Bona Sforza (1494-1557) a déménagé ses biens à Bari en Italie, la reine Catherine d'Autriche (1533-1572) à Linz en Autriche et la reine Eleonora Wiśniowiecka (1653-1697) à Vienne. La reine française Marie Casimire Sobieska et ses fils ont transporté leurs collections à Rome et en France et les monarques électifs de la dynastie saxonne au XVIIIe siècle ont déplacé de nombreux objets à Dresde. Le dernier monarque de la République, Stanislas II Auguste, abdique en novembre 1795 et déplace une partie de sa collection à Saint-Pétersbourg. Il convient également de noter que lorsque les trésors de la Sérénissime République (Serenissima Respublica Coronae Regni Poloniae Magnique Ducatus Lithuaniae) ont été pillés par différents envahisseurs, en 1683, l'armée de la République sous la direction du monarque élu Jean III Sobieski a sauvé les opulents trésors impériaux d'un destin similaire aux portes de Vienne (Délivrance de Vienne ou Bataille de Vienne). Un siècle plus tard, entre 1772 et 1795, l'Autriche était l'un des pays qui divisa la République (partages de la Pologne) et la Pologne disparut des cartes de l'Europe pendant 123 ans.
Collection d'art du prince Ladislas Sigismond Vasa, attribuée à Étienne de La Hire, 1626, Château Royal de Varsovie.
Portraits de Sigismund III Vasa et Stanisław Radziejowski par Daniël van den Queborn ou suiveur de Frans Pourbus le Jeune
Au musée Czartoryski à Cracovie se trouve un portrait du roi Sigismond III Vasa attribué à l'école hollandaise (huile sur panneau, 93 x 68 cm, numéro d'inventaire MNK XII-352). Le tableau a été acheté en 1875, avec d'autres portraits et miniatures, à Mikołaj Wisłocki de Pogorzela. Il a été initialement attribué à Bartholomeus van der Helst (1613-1670) et selon l'autocollant imprimé au dos du tableau, il a été acheté à Podbela en Biélorussie, près de la forêt de Białowieża et accroché pendant longtemps dans l'ancienne chapelle de mélèze à Białowieża (Zygmunt 3o Król - na drzewie ma być roboty fan der Helsta malarza Holenderskiego - nabyty w Podbiałey, pod puszczą Białowieską - wisiał bardzo długo w Starey Modrzewiowej Kaplicy w Białowieży (gub. Grodzieńska:)).
Le manoir de chasse jagellonien situé à Stara Białowieża a probablement été utilisé dès 1409, et vers 1594, sous le règne de Sigismond III Vasa, il a été déplacé au centre de la Białowieża moderne, où un moulin a également été construit. Moins d'un an après son élection, en 1588, face à la peste à Cracovie, le jeune roi quitte la capitale et chasse dans la forêt de Białowieża. « Le manoir de Białowieża construit pour Son Altesse Royale pour le passage et la chasse » est mentionné en 1639 et il a été détruit pendant le déluge (1655-1660) ou peu après et a été mentionné pour la dernière fois en 1663. En 1597, Sigismond III ordonne au trésorier de la cour du Grand-Duché de Lituanie, Dymitr Chalecki (décédé en 1598), d'annuler les charges retenues contre les serfs employés à creuser « Notre étang de Białowieża » et de « relâcher les lourdes charges des travaux » (d'après « Dwór łowiecki Wazów w Białowieży ... » de Tomasz Samojlik et autres, pp. 74, 76-77, 80, 84). En 1651, le fils de Sigismond, Jean II Casimir, employa un architecte et ingénieur néerlandais Peeter Willer (ou Willert) pour des travaux similaires à Nieporęt près de Varsovie et Henri IV de France (1553-1610) amena les meilleurs ingénieurs néerlandais pour assécher, drainer, construire des polders avec leurs canaux, écluses, prairies et fermes basses tout le long de la côte de France (d'après « The French Peasantry ... » de Pierre Goubert, p. 2). Il est tout à fait possible que Sigismond ait également employé des spécialistes des Pays-Bas, également ceux déjà actifs en Prusse polonaise, pour créer des étangs et fournir des plantes et des poissons. Le peintre n'a probablement jamais vu le roi en personne, la ressemblance n'est donc pas frappante, notamment avec les portraits de Martin Kober, ce qui a conduit certains auteurs à suggérer qu'il s'agissait à l'origine d'un portrait de quelqu'un d'autre transformé à l'effigie du roi. Probablement au XVIIe siècle, comme le style le suggère, une inscription latine (SIGISMVNDVS III / DEI GRA: REX POLONIÆ) et une couronne ont été ajoutées, mais compte tenu de la provenance de la Białowieża royale, de la tradition, de la ressemblance générale et des inscriptions, il n'y a pas raison de prétendre qu'il ne s'agit pas d'un portrait original du roi commandé aux Pays-Bas. Une effigie similaire de Sigismond avec une longue moustache et des cheveux blonds a été incluse dans la carte colorée à la main de la République polono-lituanienne (Poloniae Amplissimi Regni Typvs Geographicvs) du Speculum Orbis Terrarum de Gerard de Jode, publié à Anvers en 1593. Le portrait du roi est l'une des rares effigies de cette publication, ce qui pourrait indiquer que la cour polonaise l'a influencé sur cette carte particulière ou qu'elle s'est inspirée de l'augmentation des commandes d'effigies aux Pays-Bas à cette époque. Le style de la peinture de Białowieża rappelle les deux portraits unanimement attribués à Frans Pourbus le Jeune (1569-1622), peintre flamand d'Anvers (dès 1592 environ actif à Bruxelles), dans la Galleria nazionale di Parma, identifié comme Luigi Carafa et sa femme Isabella Gonzaga (numéro d'inventaire 297, 303), cependant, il ressemble encore plus à deux tableaux attribués à un autre peintre d'Anvers - Daniël van den Queborn, tous deux au Rijksmuseum d'Amsterdam. L'un représente un enfant de 18 mois en 1604, peut-être Louis de Nassau, fils illégitime du prince Maurice d'Orange (SK-A-956) et l'autre, daté « 1601 », Francisco de Mendoza, amiral d'Aragon et marquis de Guadalest, qui était mayordomo mayor (grand intendant) dans la maison d'Albert VII, archiduc d'Autriche et a participé à différentes missions diplomatiques en Pologne, en Hongrie, en Styrie et dans le Saint Empire romain germanique (SK-A-3912). En 1579, Daniël rejoint la guilde de Middelburg et en 1594, il devient peintre de la cour du prince Maurice à La Haye. Le style du costume et de la collerette du roi est très similaire à celui des portraits de Gortzius Geldorp des années 1590 - portrait de Jean Fourmenois, daté « 1590 » (Rijksmuseum à Amsterdam, SK-A-912) et portrait de Gottfried Houtappel, daté « 1597 » (Musée de l'Ermitage, ГЭ-2438). Portrait de Joachim Ernst (1583-1625), margrave de Brandebourg-Ansbach (vendu chez Christie's, 27 octobre 2004, lot 46) des années 1610, comme son costume l'indique, est attribué à un suiveur de Frans Pourbus le Jeune. En 1609, Pourbus s'installe à Paris et le séjour de Joachim Ernst en France à cette époque n'est pas confirmé dans les sources. Le 14 août 1593, Sigismond III arriva à Gdańsk avec sa femme Anna d'Autriche, sa sœur Anna Vasa et toute la cour. La ville était un port majeur de la République où les influences néerlandaises devinrent prédominantes à cette époque dans presque tous les aspects de la vie (commerce, art, architecture et mode). La croisière fluviale de Varsovie à Gdańsk a duré 12 jours et la cérémonie d'accueil a eu lieu à la Porte Verte. Le 15 août 1593, la cour participa à la procession à l'église dominicaine. La cérémonie a été présidée par l'évêque de Cujavie, Hieronim Rozdrażewski, qui aurait commandé un dessin illustrant l'événement (peut-être une étude pour un tableau), attribué à Anton Möller l'Ancien (Château royal de Wawel). Le roi se rend ensuite avec la cour à Wisłoujście, d'où le 16 septembre, sur 56 ou 57 navires, il embarque avec les personnes qui l'accompagnent et un détachement de l'armée polono-lituanienne vers la Suède. Le roi embarqua sur un navire fourni par la ville d'Amsterdam (d'après « Polacy na szlakach morskich świata » de Jerzy Pertek, p. 56). Il est possible que parmi les courtisans accompagnant le roi figurait également le jeune noble Stanisław Radziejowski (1575-1637). Il était courtisan à la cour de la reine veuve Anna Jagellon à Varsovie, où il reçut le titre d'intendant de la cour et après sa mort en 1596, il passa à la cour de Sigismond Vasa, où il servit à nouveau principalement la reine Anna d'Autriche et son fils Ladislas Sigismond. Plus tard, il n'occupera aucune fonction à la cour, mais il participera à des missions confidentielles à l'étranger et dans la République (d'après « Radziejowice: fakty i zagadki » de Maria Barbasiewicz, p. 41). Stanisław a étudié à l'étranger, à Würzburg en 1590. En 1598, il fut envoyé comme délégué de la paix à Moscou, il devint le staroste de Sochaczew en 1599 et il accompagna le roi lors de ses voyages (par exemple en 1634 à Gdańsk). Radziejowski a souvent eu l'occasion d'héberger toute la cour royale sous son toit dans son domaine de Radziejowice près de Varsovie. Il n'y avait pas d'envoyé étranger, pas de nonce apostolique qui ne connut son hospitalité et la reine Constance d'Autriche, seconde épouse de Sigismond, prit volontiers un bain à Radziejowice. Aucune effigie de Stanisław conservée en Pologne, mais en tant que courtisan si proche de la reine qui voyageait à l'étranger, il s'habillait sans doute principalement à la mode d'Europe occidentale. Le tableau du Musée national de Cracovie (numéro d'inventaire MNK I-20) représentant l'Adoration du Crucifix avec le roi Sigismond III Vasa et ses courtisans masculins, peint par Wojciech Maliskiewic en 1622, montre clairement la disposition de la mode à la cour royale. Seul un quart des courtisans sont habillés en costume national, les autres portent des collerettes et des hauts-de-chausses à la mode. En 1583, Balthasar Bathory de Somlyo, neveu du roi Étienne Bathory élevé à sa cour à Cracovie, est portraituré par Hendrick Goltzius en costume français lors de sa visite aux Pays-Bas avec son ami Stanisław Sobocki. Le trésorier (Jan Firlej, grand trésorier de la Couronne) des « Statuts et registres des privilèges de la Couronne » de Stanisław Sarnicki, publiés à Cracovie en 1594, porte également une tenue occidentale, ainsi que fils infâme de Stanisław, Hieronim (1612-1667), qui a été représenté habillé selon la mode de l'Europe occidentale dans une estampe de Jeremias Falck Polonus, créée en 1652. En 2022, un portrait d'un jeune homme peint dans un style similaire au portrait de Białowieża a été vendu au Dorotheum de Vienne (huile sur toile, 65,5 x 55 cm, 11.05.2022, lot 25). Ce tableau est attribué à Frans Pourbus le Jeune et provient d'une collection privée en Uruguay (depuis les années 1920). La provenance exacte est inconnue, il est donc possible qu'elle ait été associée à l'immigration polonaise en Uruguay où les premiers Polonais sont arrivés au XIXe siècle en tant que réfugiés politiques qui ont fui après l'insurrection de Janvier (la première organisation polonaise à Montevideo a été créée en 1921). Le jeune homme porte un pourpoint brodé à la mode et une collerette en dentelle. Selon l'inscription latine dans la partie supérieure du tableau, il a été créé à Anvers et le modèle avait 18 ans en 1593 (ANTVE'[rpiae] ANo SAL.. / 1593 / ÆTA' SVÆ.18..), exactement comme Radziejowski, lorsqu'il peut avoir terminé ses études et peut monter à bord d'un navire à Anvers pour Gdańsk ou simplement le commander de Gdańsk à Anvers, comme son petit-fils le cardinal Michał Stefan Radziejowski, qui a commandé son portrait à Paris (attribué au peintre anversois Jacob Ferdinand Voet, Musée Czartoryski, MK XII-377). L'air de famille est frappant avec le portrait de Michał Stefan au Musée de Varsovie (MHW 15948), et l'effigie mentionnée du fils de Stanisław, la forme du nez, les poches sous les yeux et une fossette au menton étant particulièrement similaires chez ces membres de la famille. Un tableau attribué à Frans Pourbus le Jeune, qui pourrait provenir de la collection de Sigismond III et éventuellement lié à l'activité diplomatique de Radziejowski, se trouve au Musée national d'art de Lituanie à Vilnius (huile sur toile, 56 x 44 cm, LNDM T 4019). Ce « Portrait de femme au ruban rouge » est daté en haut à droite « 1604 » et appartenait à la même galerie que « Portrait de femme au diadème », daté « 1614 » (LNDM T 4018), qui est une effigie de Marie de Médicis (1575-1642), reine de France par Alessandro Maganza, identifiée et attribuée par mes soins. Le costume de la femme est également similaire à celui visible dans une autre effigie de la reine de France, créée par Thomas de Leu ou cercle vers 1605 (Bibliothèque nationale autrichienne), tandis que ses traits du visage ressemblent à ceux de Christine de Lorraine (1565-1637), grande-duchesse de Toscane (épouse de l'oncle de Marie), d'après une estampe de Thomas de Leu, réalisée entre 1587-1590 (The Royal Collection, RCIN 615750). Ses traits ressemblent également à ceux des autres portraits de Christine, comme celui du peintre français, peut-être François Quesnel, de 1588 (Galerie des Offices à Florence, Inv. 1890, n. 4338) ou une copie du peintre italien, peinte après 1589 (vendu chez Sotheby's à New York, le 26 mai 2023, lot 314). Vers 1604, Frans Pourbus peint la future belle-fille de Christine, l'archiduchesse Marie-Madeleine d'Autriche (1587-1631), en robe jaune (Kunsthistorisches Museum, GG 3385) et sa sœur aînée Constance (GG 3306). Plusieurs portraits des Vasa polono-lituniens conservés à Florence, comme le portrait en pied de Sigismond III (Inv. 1890, n. 2270) datant d'environ 1610. Les monarques de la République possédaient sans doute aussi de nombreuses effigies des souverains de Toscane. Il est possible que certains d'entre eux aient également été apportés par Radziejowski, qui était à Florence en 1616 et qui, en 1615, offrit à la grande-duchesse Marie-Madeleine un miroir dans un cadre en ambre.
Portrait du roi Sigismond III Vasa (1566-1632) par Daniël van den Queborn ou suiveur de Frans Pourbus le Jeune, années 1590, Musée Czartoryski de Cracovie.
Portrait du courtisan Stanisław Radziejowski (1575-1637), âgé de 18 ans par Daniël van den Queborn ou suiveur de Frans Pourbus le Jeune, 1593, Collection particulière.
Portrait de Christine de Lorraine (1565-1637), grande-duchesse de Toscane en costume français par atelier de Frans Pourbus le Jeune, 1604, Musée national d'art de Lituanie à Vilnius.
Portrait de la reine Anna d'Autriche par Jacopo Tintoretto
Les peintres italiens, fidèles à la tradition romaine antique, idéalisent fréquemment leurs modèles. En revanche, les peintres des écoles nordiques, néerlandaises et allemandes préféraient un naturalisme parfois grotesque. Cela se voit mieux dans les portraits de l'empereur Charles Quint. Dans les tableaux de Marco Cardisco, Parmigianino, Titien, Giorgio Vasari et Francesco Terzi, c'est un très bel homme avec des traits harmonieux et de grands yeux, tandis que dans les tableaux de Lucas Cranach, Jakob Seisenegger, Jan Cornelisz Vermeyen et peintres flamands, il ressemble parfois plus à un bouffon qu'à un souverain de l'un des plus grands empires de l'histoire.
C'était également une forte tradition des Habsbourg de collectionner les effigies de différents dirigeants d'Europe, en particulier des membres de leur propre famille. Les effigies des femmes des Habsbourg devenues reines de Bohême, de Hongrie, du Portugal, de France, du Danemark, duchesses de Toscane, de Mantoue, de Savoie, de Parme, de Bavière ou encore princesses de Transylvanie sont richement représentées dans leurs collections à Madrid et à Vienne. Il est donc tout à fait inhabituel que les reines polonaises de la maison d'Autriche ne soient quasiment pas représentées dans les collections connues aujourd'hui. Certains inventaires conservés prouvent que les effigies des monarques polonais se trouvaient dans les collections des Habsbourg à Madrid et à Vienne. Par exemple, l'inventaire de certains biens de la reine Marguerite d'Autriche, belle-sœur du roi Sigismond III Vasa, soumis à son gardien des bijoux (guardajoyas) Hernando Rojas, d'octobre 1611, répertorie un portrait en miniature (naipe) du fils du roi de Pologne (Un retrato del hijo del rey de Polonia en un naipe, article 146) et treize « portraits en miniatures de membres de la maison de la reine, notre-dame » (Trece retratos de naipe de personajes de la cassa de la reyna, nuestra señora, article 151) (d'après « Inventare aus dem Archivo del Palacio zu Madrid » de Rudolf Beer, p. CLXXV). Pour la première épouse de Sigismond, Anna d'Autriche (1573-1598), les portraits de sa famille laissés à Graz et perdus lors de l'incendie du Wawel en 1595 étaient évidemment d'une grande importance. Après l'incendie, de nouveaux portraits de la famille ont dû être peints à Graz. La mère, l'archiduchesse Marie-Anne de Bavière, a rapidement envoyé un portrait d'elle-même, mais Anna a déclaré que l'image ne ressemblait en rien à sa mère. « Je suis désolé que VA [Votre Altesse] n'ait pas encore de peintre. Mon mari m'a donné la permission que son peintre l'envoie peindre tout le monde quand il en a le temps, ainsi il aura beaucoup de travail à faire » (Es ist mir ye gar laid, das ED [Eure Durchlaucht] jez kain maler hat. Mein gemahel hat mir sein maler bewilligt, wan es wider ED nit wer, denselben hinauszuschigken und alle abzemalen, wann er ainmal zeit hat, dann er hat jez gar vil ze arbaiten), écrit-elle à sa mère dans une lettre du 6 avril 1595 très probablement à propos du peintre de la cour Martin Kober (d'après « Das Leben am Hof ... » de Walter Leitsch, p. 371, 1267-1269, 1280 , 1284, 2376, 2378-2379, 2562). Quelques informations conservées en Autriche sur les portraits échangés en préparation du premier mariage du roi. Les débuts de la négociation remontent à une époque où tous deux étaient encore enfants, la mariée n’avait pas encore huit ans et le marié quatorze ans et demi. Il est possible qu'un portrait d'une fillette de huit ans ait été envoyé par les Habsbourg. Lorsque l'affaire est revenue neuf ans plus tard, il fallut à nouveau envoyer un portrait. « Je voudrais affirmer que le roi, dès qu'il reçut l'effigie de l'archiduchesse Anna, en tomba profondément amoureux, l'ouvrit dans sa chambre et, après s'être longtemps tenu devant elle, envoya également un retrato [espagnol pour le portrait] d'elle à son père, le roi de Suède, qui était également heureux d'accepter de telles choses » (wol affirmiren, das der könig, alsbald er dero erzherzogin Anna contrafee bekomben, sich stark darein verliebt, dasselbe in seiner camer aufgemacht und villmallen ein guette lange weil darvor gestanden seye, auch seinem herrn vattern, dem könig in Schweden, ein retrato darvon geschickt habe, der im solches gleichsfalls gar wol gefallen lassen), écrivit Sebastian Westernacher à l'archiduchesse Marie-Anne de Bavière le 19 mai 1591. L'effigie d'Anna, seize ans, était accrochée dans la chambre du roi et elle était représentée portant « une robe brodée, blanche et argentée» (in einem weiß silbernen gewirkten rock abconterfeyet), selon un journal de Cracovie à propos du mariage de mai/juin 1592. Les contemporains savaient certainement que ces portraits étaient souvent largement embellis, de sorte que le marié n'avait que deux options s'il voulait éviter de s'exposer à l'inconnu : envoyer des espions de beauté ou faire confiance aux peintures. Avant son premier mariage, Sigismond envoyait de tels espions, mais il faisait probablement aussi confiance aux effigies. Un émissaire du roi a remis au maître de cour (Hofmeister) de la mère d'Anna son portrait, le représentant portant un bijou avec le monogramme SA, très probablement de son oncle Sigismond Auguste ou des mariés (Sigismond et Anna), a raconté l'archiduchesse Marie-Anne à l'empereur Rodolphe II, dans une lettre de Graz, datée du 8 juillet 1591 (seines künigs contrafet in ainem tafelein von ebano, darbey auch ain gemaldes glainot an einer klainen gulden kettl an des künigs hals hangend, und darinnen dise zwen puechstaben SA zu sehen). Selon certaines sources, la première épouse de Sigismond n'aimait pas beaucoup le luxe. Son confesseur, Fabian Quadrantinus (1549-1605) de Starogard Gdański, éduqué à Rome, affirmait que : « On ne voyait sur elle ni or, ni bijoux, ni pierres précieuses. Elle était principalement vêtue de noir ». D'autres documents prouvent qu'elle possédait de nombreux objets de luxe. Selon un inventaire, la reine possédait plus d'une centaine de vêtements, et selon un deuxième inventaire, plus de deux cents. Elle commandait des marchandises à Florence et achetait des produits de luxe à Gdańsk. Elle mangeait toujours avec une cuillère en or et portait des bijoux, régulièrement une bague en rubis et émeraude, ainsi qu'un collier avec un saphir. Urszula Meyerin, dans une lettre datée du 3 avril 1598, affirmait que même lorsqu'elle était jeune, Anna « n'avait jamais respecté la volupté, la splendeur, les joies ou les convoitises du monde, mais les méprisait et les rejetait » (nimmermehr der welt üppigkeit, pracht, freuden oder wollusten geachtet, sondern vielmehr verachtet und verworfen). Jan Bojanowski écrit cependant peu après son arrivée qu'elle est loin d'être mélancolique (krolowa pani nasza is iest pani od melancholiei daleka) et qu'elle est toujours joyeuse, mais avec une dignité gracieuse (lettre du 22 juin 1592). Lorsque le roi voulut aller au combat contre les Tatars, la reine exprima le souhait de rester près de lui, « si nécessaire, elle voulait aussi devenir mercenaire et porter une armure » (wan's sein müeste, wolt sie auch ein landsknechtin aren und das fäleisen nachtragen, lettre d'Ernhofer à l'archiduchesse Marie-Anne, 5 avril 1595). Lorsqu'on lui envoie un nouveau portrait de son frère devenu gros, elle écrit à sa mère : « C'est pour ça qu'il me semble qu'il en était à son 10ème mois [de grossesse] » (Darum es dunkt mich auch, ehr sei ihn 10. monat gwesen, lettre du 1er février 1597). Dans une autre lettre à sa mère, elle commentait « que le bon vieux roi d'Espagne est vraiment drôle et qu'on peut vraiment l'apprécier » (das der guett alt kinig von Hispania erlich paufellig ist und das man sein auch schier gnueg hatt, lettre de mai 3, 1597). La reine était également aventureuse et sortait à plusieurs reprises incognito pour voir quelque chose, comme la procession du 27 janvier 1595. Avec Anna Radziwiłłowa née Kettler (1567-1617), elle sortait dans un traîneau « habillée comme une dame patricienne » (wie burgerin geklaidet). Elles n'étaient pas reconnues par les femmes polonaises et lorsque l'une d'elles tenta de se frayer un chemin devant la reine, Radziwiłłowa commença à se disputer avec elle (lettre d'Ernhofer à l'archiduchesse Marie-Anne, 6 mars 1595). Semblable à d'autres dames polono-lituaniennes qui ont expérimenté la mode, la jeune reine portait sans doute aussi des robes vénitiennes, françaises, florentines ou flamandes, comme le décrit Piotr Zbylitowski dans sa « Réprimande de la tenue extravagante des femmes » (Przygana wymyślnym strojom białogłowskim), publiée à Cracovie en 1600. Même si la reine était très pieuse, elle n’était pas obstinément zélée comme sa mère. D'août 1592 à août 1593, la jeune reine vécut près de la cour italienne de la vieille reine Anna Jagellon, envoyant des lettres depuis les résidences d'Ujazdów et de Łobzów. Les relations entre les deux reines étaient probablement un peu difficiles pour plusieurs raisons. Surtout, ils n'avaient pas de langue commune, car la jeune reine ne parlait que l'allemand et l'espagnol et comprenait le latin et le polonais - selon Giovanni Paolo Mucante (Intende, come dicono, la lingua latina, la spagnola, la todesca et anco la polacca, ma non parla se non todesca et spagnola, lettre du 25 septembre 1596). Anna Jagellon parlait latin, polonais et italien. Au début, il y avait aussi quelques difficultés avec la priorité. Durant les six derniers mois de sa vie, la vieille reine vécut à nouveau sous le même toit que la jeune reine. Anna d'Autriche envoya un jour à sa mère les cadeaux qu'elle avait reçus d'Anna Jagellon (lettre du 22 novembre 1593). La jeune Anna prenait également soin de la vieille reine malade. La relation entre les deux était si bonne que l'archiduchesse Marie-Anne devint vraiment jalouse (lettre de Salome von Thurn à l'archiduchesse Marie-Anne, 5 mai 1594). Au musée du Prado de Madrid se trouve le portrait d'une jeune femme en robe verte assise sur une chaise (huile sur toile, 114 x 100 cm, numéro d'inventaire P000484). Le tableau provient de la collection royale espagnole (n° 597) et a été initialement attribué à Paolo Veronese (1528-1588) et maintenant à Jacopo Tintoretto (1518-1594). La femme a des fleurs dans les cheveux et son costume indiquent que le tableau a été réalisé dans les années 1590. Une robe similaire peut être vue dans un portrait de femme de la Gemäldegalerie Alte Meister de Dresde (numéro d'inventaire Gal.-Nr. 249), daté d'environ 1590 et que l'on pensait auparavant représenter Marie de Médicis, reine de France. Comparaison avec deux gravures sur bois de Habiti Antichi Et Moderni di tutto il Mondo ... de Cesare Vecellio (Bibliothèque Czartoryski, 2434 I Cim), livre publié à Venise en 1598 et rassemblant la mode contemporaine du monde entier - Gentildonne ne'Regiment (p. 104) et Donne per casa (p. 108), indique qu'elle porte le costume d'une noble vénitienne à la maison. Dans ce livre, l'effigie du roi Sigismond III (Rè di Polonia / Poloniæ Rex, p. 346) a été publiée avec quelques costumes typiques de la République polono-lituanienne. Sa lèvre inférieure saillante et la provenance du tableau indiquent qu'elle est une Habsbourg. Le peintre a embelli l'effigie en réduisant le nez et les lèvres, cependant la ressemblance avec d'autres effigies de la reine de Pologne est notable, notamment le portrait du château royal de Varsovie (FC ZKW 1370), son effigie dans la scène de la Naissance de la Vierge de Juan Pantoja de la Cruz au Musée du Prado (P001038) et son portrait par Martin Kober à la Galerie des Offices (2392 / 1890). L'idéalisation était courante à cette époque. Le portrait du roi Sigismond III Vasa dans un grand chapeau par l'atelier de Philipp Holbein II, qui se trouvait avant 1939 dans la collection de Jan Perłowski à Varsovie (perdu pendant la Seconde Guerre mondiale), est le meilleur exemple de cette pratique, peut-être initiée par le peintre, qui souhaitait que le modèle soit davantage conforme à ses standards de beauté. La femme de ce portrait ressemble également beaucoup à la sœur cadette de la reine, Constance, qui deviendra dix ans plus tard la seconde épouse de Sigismond III, dans son portrait idéalisé au château royal de Wawel (numéro d'inventaire 1783). Selon les inventaires des vêtements de la reine Anna conservés aux Archives nationales de Suède à Stockholm (Riksarkivet, Extranea 85), probablement réalisés vers 1595, la reine possédait également une robe semblable à celle représentée dans le tableau : « Une jupe en damassé vert avec des bords dorés » (Ain grien damasten rock mit golt gebrämbt, 92).
Portrait de la reine Anna d'Autriche (1573-1598) dans une robe damassée vénitienne par Jacopo Tintoretto, vers 1592-1594, Musée du Prado à Madrid.
Portrait du roi Sigismond III Vasa dans un grand chapeau par l'atelier de Philipp Holbein II, années 1610, perdu pendant la Seconde Guerre mondiale.
Portrait du Prince Jerzy Zbaraski en saint Georges par Paolo Fiammingo
En 1591, après de premières études dans le pays, les jeunes frères Zbaraski Jerzy (George) ou Iouri (1574-1631) et Krzysztof (Christophe) (1579-1627), descendants du prince ruthène Fédor Nesvitsky (décédé avant 1442), fait un long voyage à l'étranger. Ils ont visité l'Allemagne, l'Italie et la France. Ils étudient à Padoue (1592-1593) et visitent Venise, Rome et Naples. En France, ils sont allés à Lyon, Bordeaux et Paris. Pendant leurs études à l'étranger, les frères se sont convertis du calvinisme au catholicisme, cependant, ils étaient partisans de la tolérance religieuse et opposants à l'énorme influence de l'Ordre des Jésuites.
Ils revinrent au pays au tournant de 1594 et 1595. L'année suivante (1596) ils participèrent à l'expédition de Hongrie, à l'expédition de Moldavie et au siège de Suceava. En 1598, Jerzy faisait partie de la suite qui accompagnait le roi Sigismond III Vasa en Suède. Probablement au tournant de 1600 et 1601, les deux frères Zbaraski sont allés aux Pays-Bas, où Jerzy a étudié le grec et l'histoire sous Justus Lipsius à Louvain. Entre 1602 et 1605, Krzysztof séjourne à nouveau en Italie, où il maîtrise les sciences mathématiques sous la direction de Galilée. En 1616, Jerzy retourna également à Padoue où il s'inscrivit à l'université. En 1620, après la mort de Janusz Ostrogski, Jerzy Zbaraski est nommé châtelain de Cracovie. Comme son jeune frère Krzysztof, il n'était pas marié et n'avait pas d'enfants. Les frères Zbaraski étaient les héritiers de l'énorme fortune de leur père, en plus des domaines de leur mère, la duchesse Anna Chetvertynska (Czetwertyńska), membre de la famille princière ruthène, qui selon Józef Wolff étaient des descendants de Iaroslav le Sage, Grand Prince de Kiev. Au XVIème siècle, la famille Chetvertynski possédait de grands domaines en Ukraine et en Biélorussie et, comme la famille Zbaraski, ils avaient la pogonie ruthène, affichant saint Georges battant le dragon, dans leurs armoiries. Déjà en juin 1589, dans la suite de l'évêque Radziwill et du voïvode Mikołaj Firlej, Jerzy visita la cour impériale de Prague, où il eut l'occasion d'admirer des collections d'art exquises de l'empereur Rodolphe II. De Venise, Jerzy, grand connaisseur et amateur d'art, a apporté le tableau de Notre-Dame de Myślenice, plus tard célèbre pour ses miracles. Selon « L'Histoire du tableau miraculeux de Notre-Dame à Myślenice », publié en 1642 à Cracovie, le tableau original appartenait au pape Sixte V, qui l'a laissé dans son testament à la petite-fille de sa sœur, qui est devenue l'abbesse d'un couvent de Venise. Lorsque le prince Jerzy Zbaraski l'a vu au couvent, il a voulu l'avoir, mais l'abbesse n'a pas voulu lui donner l'original, mais a accepté d'en faire une copie. Lors de la peste de Cracovie en 1624, le tableau devait être brûlé comme « infecté », mais a été épargné de la destruction. En 1633, le tableau fut transféré à l'église paroissiale de Myślenice. L'image de la Vierge Marie est peinte sur un panneau de bois (50,3 x 67,8 cm) et en raison de certaines similitudes de style, elle est attribuée à l'école de Prague du début du XVIIe siècle. Le visage et la pose de la Vierge sont cependant presque identiques comme dans le tableau représentant Bethsabée au bain (vendu chez Cambi Casa d'Aste à Gênes le 30 juin 2020, lot 100), réalisé par Paolo Fiammingo (Paul le Flamand, vers 1540-1596). Fiammingo, né Pauwels Franck, était un peintre flamand qui, après une formation à Anvers, a été actif à Venise pendant la majeure partie de sa vie. Il a peut-être aussi travaillé à Florence. Vers 1573, il s'installe définitivement à Venise, où il devient l'élève de Jacopo Tintoretto (le Tintoret). Il a ouvert un studio à succès, qui a reçu des commandes de toute l'Europe. L'un de ses clients les plus importants était l'empereur Rodolphe II et Hans Fugger, héritier d'une dynastie bancaire allemande, qui lui commanda en 1580 plusieurs tableaux pour décorer l'Escorial souabe - château de Kirchheim près d'Augsbourg. Le style de la main de Marie dans la peinture de Myślenice est similaire à celui visible dans la Dame révélant son sein (Une honnête courtisane) de Domenico Tintoretto, daté des années 1580 (Musée du Prado à Madrid, numéro d'inventaire P000382). Le portrait d'homme en saint Georges de collection privée, attribué à l'école italienne ou vénitienne, s'apparente également au style du Tintoret. Ce petit tableau (28,7 x 21,7 cm) a été peint sur cuivre et le style de peinture ressemble plus précisément à l'image intitulée Profession d'armes de la Résidence de Munich, attribuée à Fiammingo et créée dans les années 1590 (Alte Pinakothek à Munich). Le prince Jerzy Zbaraski était le fondateur d'au moins deux églises dédiées à son saint patron, saint Georges. L'un dans le siège principal du prince et de son frère, Zbaraj en Volhynie, était le lieu de sépulture d'une partie de la famille Zbaraski. L'église en bois et le monastère fortifié des Bernardins ont été fondés en 1606, et à partir de 1627, la nouvelle église en brique a été construite, très probablement conçue par l'architecte et ingénieur de Son Altesse le roi Sigismond III Vasa, Andrea ou Andrzej dell'Aqua de Venise, enfonçant près de 1 600 pieux dans la zone marécageuse. Cette église fut détruite en 1648. En 1630, Zbaraski fonda également l'église Saint-Georges à Pilica. Entre 1611-1612, Krzysztof commande à Vincenzo Scamozzi à Venise, un projet de palais fortifié destiné à Zbaraj. Dans un commentaire de sa conception, publié en 1615 dans son « L'Idea Della Architettura Universale », Scamozzi rappelle de nombreuses rencontres et discussions sur l'architecture militaire avec le savant aristocrate ruthène. C'est cependant une conception de l'ingénieur militaire flamand Hendrik van Peene et du vénitien Andrea dell'Aqua qui a été utilisée pour construire la nouvelle forteresse de Zbaraj entre 1626-1631. Son traité sur l'artillerie « Praxis ręczna działa » de 1630 (manuscrit à la bibliothèque de Kórnik), dell'Aqua dédié au prince Jerzy Zbaraski. En 1627, Jerzy fonda la chapelle Zbaraski à l'église dominicaine gothique de Cracovie, comme mausolée pour lui et son frère. La chapelle a été construite par les maçons et sculpteurs Andrea et Antonio Castelli, probablement selon les plans de l'architecte royal Constantino Tencalla. Dans la chapelle baroque, il y a des monuments à deux frères sculptés en marbre noir de Dębnik et en albâtre blanc. Jerzy est représenté endormi en armure et dans une pose presque identique à celle du monument funéraire du roi Sigismond Ier l'Ancien dans la chapelle de Sigismond (1529-1531). Sa coiffure est typique d'un magnat polono-lituanien de cette époque et il tient sa masse comme s'il tenait ses organes génitaux, allusion moins subtile à sa virilité ou sa promiscuité. Il est possible que certaines des œuvres hautement érotiques de Fiammingo aient été commandées par le prince Zbaraski. L'homme représenté comme saint Georges ressemble à Jerzy Zbaraski de sa sculpture funéraire, son portrait peint dans les années 1780 d'après l'original des années 1620 (Palais Wilanów à Varsovie) et les effigies de son frère Krzysztof (Musée national de l'histoire de l'Ukraine et Galerie nationale d'art de Lviv). Jerzy a été accusé d'un style de vie dissolu et lorsqu'il a décidé de mettre fin aux contrefacteurs de pièces avec lesquels il s'apprêtait à coopérer, ils « ont persuadé une dame qui rendait visite au prince de lui donner un poison » (d'après « Niepokorni książęta » d'Arkadiusz Bednarczyk, Andrzej Włusek). Bien qu'il n'ait pas d'enfants, la mémoire du dernier prince Zbaraski a été conservée dans les œuvres d'art exquises qu'il a commandées.
Portrait du Prince Jerzy Zbaraski (1574-1631) en saint Georges par Paolo Fiammingo, 1592-1594, Collection privée.
Notre-Dame de Myślenice par Paolo Fiammingo, 1592-1594, église Sainte-Marie de Myślenice.
Portrait du courtisan royal Sebastian Sobieski par Leandro Bassano
Vers le 16 octobre 1593, le roi Sigismond III Vasa départ de Gdańsk pour son couronnement en tant que roi héréditaire de Suède. Il était accompagné de ses courtisans, dont Sebastian Sobieski (vers 1552-1614), troisième fils du capitaine Jan Sobieski (vers 1518-1564) et Katarzyna Gdeszyńska. Plus tôt cette année-là, en février, Sebastian a été envoyé par le roi comme son envoyé au sejmik (assemblée régionale) de Lublin. C'est la première fonction importante confirmée de ce courtisan royal. « Les instructions pour le sejmik de Lublin données par Sa Majesté à Sebastian Sobieski, un courtisan royal à Varsovie le 16 février 1593 », se trouvent à la Bibliothèque Czartoryski à Cracovie (BCz 390).
Sobieski a très probablement étudié à l'école calviniste de Bychawa près de Lublin. Le 17 décembre 1576, probablement grâce à l'intercession du vice-chancelier de la Couronne Jan Zamoyski, il est admis, comme page, à la cour du roi Étienne Bathory. Puis, comme ses frères, en raison de l'influence croissante du mouvement de la Contre-Réforme à la cour royale, il se convertit au catholicisme romain. Le 1er mai 1584, il est transféré au groupe des salatariati saeculares (bénéficiaires laïcs) dans lequel il se trouve jusqu'à la mort du roi. Il devint un partisan de Zamoyski, soutint l'élection du roi Sigismond III et, apparemment, il participa à la défense de Cracovie contre l'attaque des troupes de l'archiduc Maximilien II en 1587 et la bataille de Byczyna en 1588. À partir de mai 1596, il occupa le poste de porte-étendard de la Couronne et en tant que tel, il a été représenté dans l' « Entrée du cortège nuptial de Sigismond III Vasa à Cracovie en 1605 » (Château Royal de Varsovie). Portrait d'un homme barbu en costume oriental de collection privée en France, en raison d'une certaine similitude dans le style et, éventuellement, les dates de sa vie est attribué à Hans von Aachen (1552-1615), un peintre allemand formé en Italie. En 1592, alors qu'il travaillait encore à Munich, von Aachen fut nommé peintre de la cour de Rodolphe II, empereur romain germanique et s'installa à Prague en 1596. D'après l'inscription en latin dans le coin supérieur droit l'homme avait 41 ans en 1593 (ANNO 1593 / ÆTATIS 41), exactement comme Hans von Aachen, mais aussi Sebastian Sobieski, né vers 1552. Le portrait n'est évidemment pas un autoportrait du peintre de la cour impériale et ce riche noble était représenté dans un żupan de soie cramoisi boutonné de boutons d'or, très semblable aux boutons de żupan de Stanisław Piwo, échanson de Płock, du deuxième quart du XVIIe siècle (Trésor de Skrwilno, Musée régional de Toruń). Son manteau noir garni de fourrure de lynx est presque identique à celui montré dans le portrait de Jan Opaliński (1546-1598), créé en 1591 (Musée national de Poznań), ou dans Douze types polonais et hongrois par Abraham de Bruyn, créé vers 1581 (Rijksmuseum Amsterdam). Son col en dentelle est très similaire à celui à l'effigie du Maréchal (Stanisław Przyjemski avec un bâton de maréchal) des « Statuts et registres des privilèges de la couronne » de Stanisław Sarnicki par Jörg Brückner à Cracovie, créé en 1594 (Bibliothèque Czartoryski). Les lettres sur la table sont des documents très importants, très probablement des instructions d'envoyé données par le roi. Le style de peinture est identique au portrait du Doge Marino Grimani (1532-1605), réalisé vers 1595 par Leandro Bassano, signé : LEANDER A PONTE BASS [ANO] EQVES F. (Princeton University Art Museum). L'homme ressemble aux effigies du frère de Sebastian Sobieski, Marek Sobieski (vers 1550-1605), voïvode de Lublin (gravure sur bois de 1862 d'après un portrait perdu de la collection Zamoyski) et de descendant du frère (petit-fils de Marek), le roi Jean III Sobieski (portrait des années 1670 au château de Kórnik). Le portrait mentionné de Jan Opaliński à Poznań, une copie d'un tableau détruit pendant la Première Guerre mondiale (du manoir incendié de Rogów près d'Opatowiec), est considéré par Michał Walicki comme une manifestation très précise de la tradition vénitienne « se référant aux portraits des Bassano » (d'après « Malarstwo polskie : Gotyk, renesans, wczesny manieryzm », p. 33). Stilistiquement très similaire était la peinture qui était avant la Seconde Guerre mondiale à l'hôpital Saint Lazare à Varsovie portant l'inscription en latin : R. P. PETRVS SKARGA SOCIETATIS IESV. Il représentait le prédicateur de la cour du roi Sigismond III Vasa, Piotr Skarga (1536-1612), qui devint le premier prêtre à le détenir. L'hôpital a été créé en 1591 à son initiative pour les pauvres et les lépreux et le fondateur était représenté assis dans son bureau devant une table recouverte d'un tapis oriental.
Portrait du courtisan royal Sebastian Sobieski (vers 1552-1614) âgé de 41 ans par Leandro Bassano, 1593, Collection privée.
Portrait de Jan Opaliński (1546-1598) âgé de 45 ans par un suiveur des Bassano, 1591, Musée national de Poznań.
Portrait du prédicateur Piotr Skarga (1536-1612) par un suiveur des Bassano, après 1591, Hôpital Saint Lazare à Varsovie, perdu.
Portraits de la reine Anna d'Autriche et de ses sœurs par Martin Kober et des peintres espagnols
Les inventaires des vêtements de la reine Anna conservés aux Archives nationales de Suède à Stockholm (Riksarkivet, Extranea 85) ont probablement été réalisés vers 1595 car ils comprennent de nombreux objets créés alors qu'elle était déjà reine, comme des oreillers brodés des armoiries de Pologne et de Lituanie. La jeune reine s'habillait principalement de saya espagnole noire dans la version d'Europe centrale, comme le montre son portrait officiel réalisé par Martin Kober. Elle avait également des « vêtements polonais » (Volgen IM polnische klaider, articles 205-212) et des robes espagnoles plus courtes (Spänische kurze jänger). En privé, elle porte de nombreux vêtements colorés : marron, violet, leibfarb (couleur de peau), jaune, rouge, blanc, tyrkroth (rouge turc), aschenfarb (gris), bleu et autres. Elle portait également au moins trois robes vertes : « Une robe en tissu d'or vert » (Ain grien gulden stuck, 72), « Une jupe en satin vert avec des bords dorés » (Ain grien atleser rock mit gulden porten, 87) et « Une jupe en damassé vert avec des bords dorés » (Ain grien damasten rock mit golt gebrämbt, 92) (d'après « Das Leben am Hof ... » de Walter Leitsch, p. 1282, 2381, 2555-2562, 2569, 2571).
La « jupe » de satin vert (87), couleur symbolique de la fertilité, mentionnée dans l'inventaire pourrait être la même robe qui était représentée dans un portrait de l'archiduchesse Anna à l'âge de 18 ans, daté « 1592 » (ANNA ARCHIDVCISSA AVSTRIÆ. / ANNO ÆTATIS / XVIII. / MD / LXXXXII.) de Collection de peintures de l'État de Bavière (en prêt permanent au Germanisches Nationalmuseum de Nuremberg, huile sur toile, 60,5 x 50,9 cm, Gm661 / 6846). Ce portrait, ainsi que d'autres portraits similaires de sa mère et de ses frères et sœurs, proviennent du château de Neubourg. Il faisait donc très probablement partie à l'origine de la dot de Constance d'Autriche (car son portrait est absent de cette série) et plus tard de la dot de sa fille Anna Catherine Constance Vasa. Son grand pendentif en or représente Jupiter et Danaé. La jeune archiduchesse a donc été peinte peu avant son mariage avec Sigismond et le style de ce tableau est proche de celui de Martin Kober, qui a également travaillé pour les Habsbourg - notamment similaire au portrait de la fille d'Anna, Anna Maria Vasa (1593-1600) au couvent de Las Descalzas Reales à Madrid et portrait de Stanisław Lubomirski (1583-1649) et de sa sœur Katarzyna (décédée en 1612) au Kunsthistorisches Museum de Vienne. Toutes les sœurs d'Anna étaient représentées dans des robes similaires. Pour cette raison et le fort air de famille de toutes les sœurs, il est parfois difficile de déterminer le modèle dans d'autres séries, comme celle de la dot de l'archiduchesse Marie-Madeleine d'Autriche, aujourd'hui à la Villa del Poggio Imperiale à Florence. Cette série est attribuée à Giacomo de Monte (Jakob de Monte), bien que le style soit également proche de Kober. Dans la série du Kunsthistorisches Museum de Vienne, probablement du château de Graz, le portrait de Marie-Christine d'Autriche (1574-1621) est identifié comme représentant Anna (numéro d'inventaire GG 3238). Cette effigie est attribuée à de Monte, qui a utilisé le même ensemble de dessins d'étude que Kober pour créer le portrait du château de Neubourg peint en 1595, lorsque l'archiduchesse avait 21 ans (MARIA CRISTIERNA ARCHIDVCISSA AVSTRIÆ. / ANNO ÆTATIS XXI. / M.D. / XCV., Alte Pinakothek à Munich, huile sur toile, 60,5 x 52 cm, 6845). Dans la série du couvent des Descalzas Reales à Madrid, également attribuée à Giacomo de Monte, les quatre sœurs ont été transformées en saintes chrétiennes - Anna était représentée comme sainte Dorothée, Marie-Christine comme sainte Lucie, Catherine-Renée comme sainte Catherine et Élisabeth comme sainte Agnès. Parmi les portraits des membres de la famille de Marguerite d'Autriche, reine d'Espagne, qui se trouvaient dans la Galerie de la Reine de l'Alcazar royal de Madrid en 1636, il y avait sans doute aussi un portrait de la reine de Pologne. Ces portraits étaient décrits comme : « Parents et frères de la reine Doña Margarita. Treize portraits en pied des parents et frères de la reine Doña Margarita, sans cadres (?), et réalisés par Bartholome Gonçalez pour El Pardo » (Padres y hermanos de la Señora Reina Doña Margarita. Treçe retratos de medio cuerpo arriba de los Padres y hermanos de la Señora Reina Doña Margarita, sin molduras, y los hiço Bartholome Gonçalez para el Pardo, Inventaire de l'Alcázar de 1636, p. 185-188). Sept portraits de la série, réalisés par le peintre de cour Bartolomé González y Serrano (1564-1627) avant 1627, furent déposés en 1918 à l'ambassade d'Espagne à Lisbonne et furent détruits lors de l'incendie de 1975. L'un d'eux fut reproduit en 1968 dans l'Antemurale XII (Institutum Historicum Polonicum Romae) comme le portrait d'Anna d'Autriche (Anna Regina Poloniae, Museo del Prado). A cette effigie, elle porte une saya typiquement espagnole de la fin du XVIe siècle. Selon un article de Gloria Martínez Leiva (« El incendio de la Embajada española en Lisboa de 1975 », 16 janvier 2018), il ne s'agit pas d'une effigie d'Anna, mais de sa sœur l'archiduchesse Catherine-Renée d'Autriche (1576-1599). La jeune fille ressemble en réalité davantage à l'effigie de Catherine-Renée en 1595, lorsque l'archiduchesse avait 18 ans (CATERINA RENEA ARCHIDVCISSA / AVSTRIÆ. ANNO ÆTATIS XVIII. / M.D. / XCV., Germanisches Nationalmuseum, huile sur toile, 60,6 x 50,9 cm, Gm665 / 6847) par Kober, qu'au portrait de sa sœur aînée de la même série. Les effigies posthumes de l'archiduchesse Marie-Anne et de son époux Charles II d'Autriche (1540-1590) par González, peintes après 1608 (Musée du Prado, P002434, P002433), faisaient très probablement partie de la série de Lisbonne. Concernant la série de Kober, dans laquelle certaines effigies portent des dates différentes (1590, 1592 et 1595), le peintre les a probablement réalisées en même temps mais elles montrent les modèles à des âges et des dates différents. Il a très probablement copié plusieurs effigies de la famille de Constance alors qu'il travaillait sur des peintures pour sa dot (ou celle de l'une de ses sœurs) en 1595 à Graz. La fille aînée de l'archiduchesse Marie-Anne a également été représentée avec ses sœurs et sa mère dans la scène de la Naissance de la Vierge de Juan Pantoja de la Cruz au musée du Prado (huile sur toile, 260 x 172 cm, P001038). Ce tableau, commandé par la reine Marguerite d'Autriche pour son oratoire privé dans le palais de Valladolid, a été réalisé en 1603 (signé et daté : Juº Pantoja Dela .+. Faciebat. / 1603). Il commémore probablement la naissance et la mort de l'infante Marie d'Espagne, décédée en bas âge au cours de son premier mois (1er mars 1603). Sa grand-mère, l'archiduchesse Marie-Anne, est représentée comme une sage-femme divine accompagnée de ses filles déjà décédées - Anna, reine de Pologne et archiduchesse Catherine-Renée d'Autriche, décédée à l'âge de vingt-trois ans avant son mariage avec Ranuce Ier Farnèse, duc de Parme. C'est pourquoi toutes deux portent davantage de robes italiennes, car en Pologne-Lituanie, la mode italienne était populaire. Tous trois regardent le spectateur. La jeune fille près du lit de sainte Anne regarde également le spectateur. Ses traits des Habsbourg lui permettent d'être identifiée comme Constance d'Autriche, qui en 1602, avec sa sœur cadette Marie-Madeleine, fut considérée à la cour de Madrid comme candidate pour épouser Ferdinand Ier, grand-duc de Toscane, mais qui épousa finalement Sigismond III en 1605. Bien que Pantoja ait accompagné la famille royale lors de voyages à Valladolid, Burgos, Lerma et El Escorial, il n'a probablement jamais quitté l'Espagne. L'archiduchesse Marie-Anne s'est rendue en Espagne pour le mariage de sa fille Marguerite, mais c'était en 1599. Toutes les effigies ont donc été créées par le peintre espagnol à partir d'autres portraits de membres de la famille de la reine ou de dessins d'étude, comme les peintures mentionnées de Bartolomé González. Le grand attachement de l'archiduchesse Marie-Anne à sa fille aînée est démontré par le fait que lorsque l'archiduchesse tomba en panique à cause de l'avancée ottomane, elle voulut fuir en Pologne pour être avec sa fille, et non à Munich, Prague, Bruxelles ou Madrid. Dans une lettre datée du 18 septembre 1594 de Poznań, la reine assure à sa mère qu'elle pourrait venir à Cracovie (solang mein gmahel und ich waß haben, so sol ED auch allezeit unverlassen sein).
Portrait de l'archiduchesse Anna d'Autriche (1573-1598), âgée de 18 ans en 1592, par Martin Kober, vers 1595, Germanisches Nationalmuseum.
Portrait de l'archiduchesse Marie-Christine d'Autriche (1574-1621), âgée de 21 ans, par Martin Kober, 1595, Alte Pinakothek de Munich.
Portrait de l'archiduchesse Catherine-Renée d'Autriche (1576-1599), âgée de 18 ans, par Martin Kober, 1595, Germanisches Nationalmuseum.
Naissance de la Vierge avec portraits de l'archiduchesse Marie-Anne et de ses filles par Juan Pantoja de la Cruz, 1603, Musée du Prado à Madrid.
Portrait de la reine Anna d'Autriche (1573-1598) et de sa sœur l'archiduchesse Catherine-Renée d'Autriche (1576-1599) dans la scène de la Naissance de la Vierge de Juan Pantoja de la Cruz, 1603, Musée du Prado à Madrid.
Portrait de l'archiduchesse Catherine-Renée d'Autriche (1576-1599) en costume espagnol par Bartolomé González y Serrano, après 1608, Musée du Prado à Madrid, détruit.
Portraits de la reine Anna d'Autriche nue (Vénus endormie) par Dirck de Quade van Ravesteyn
La reine Anna d'Autriche, première épouse de Sigismond III, échangeait fréquemment des effigies avec des membres de sa famille en Autriche. Ses portraits (conterfet, conterfeit), généralement de petites miniatures (Meiner klein conterfet schick ich ED), sont fréquemment mentionnés dans ses lettres à sa mère. En janvier 1595, le frère d'Anna, Ferdinand d'Autriche (1578-1637), s'apprêtait à envoyer deux tableaux, l'un pour sa mère, « l'autre pour ta sœur, la reine » (das ander für dein schwester die kinigin), selon une lettre de l'archiduchesse Marie-Anne datée du 3 janvier 1595 de Graz (d'après « Das Leben am Hof ...» de Walter Leitsch, p. 1278, 2380, 2569).
« La reine régnante a 19 ans, elle est mince, mais avec un joli visage, agréable et polie », écrit l'envoyé vénitien Pietro Duodo dans son rapport de 1592 au Sénat vénitien (d'après « Zbiór pamiętników ... » de Julian Ursyn Niemcewicz, p.76). À en juger par les portraits officiels de la reine réalisés par Kober, on ne peut rien dire sur sa silhouette, car elle est entièrement recouverte par sa robe espagnole et seul son visage est clairement visible. Alors Duodo était-il autorisé à voir la reine nue ou à admirer son effigie nue ? Dans une lettre du 19 mai 1591 à l'archiduchesse Marie-Anne, à propos du portrait d'Anna reçu par Sigismond, Sebastian Westernacher rapporte que le roi « l'ouvrit dans sa chambre » (in seiner camer aufgemacht). Le fait que le roi l'admirât dans sa chambre privée indique que le portrait était nu ou érotique car de telles effigies étaient fréquemment couvertes. Par exemple, l'inventaire des peintures de la collection de la princesse Louise Charlotte Radziwill (1667-1695), dressé en 1671, mentionne « Un tableau sale fermé » (Obraz plugawy zamykany, article 685 / 56) (d'après « Inwentarz galerii obrazów Radziwiłłów z XVII w." de Teresa Sulerzyska, p. 279). Concernant l'un de ses portraits, envoyé de Cracovie à Vienne, la reine déclara dans une lettre qu'elle préférait qu'il soit détruit plutôt que de tomber entre de mauvaises mains (d'après « Sztuka i polityka ... » de Juliusz Chrościcki, p. 33-34). Une telle déclaration indique clairement que l’effigie devait être de nature très intime. La même déclaration concerne les effigies de sa famille qui ont été perdues dans l'incendie du château de Wawel en 1595. Certains effets personnels de la reine, notamment des bijoux, ont été jetés par les fenêtres dans le jardin et tous les objets n'ont pas été retrouvés, certains ont été volé, y compris le coffre avec « les portraits de Son Altesse Ducale et de tous les jeunes princes et princesses » (comterfett von ir f[irstlich] d[urchlaucht] und der ganzen jungen herschaft), selon une lettre d'Urszula Mayerin du 7 avril, 1595. « Je préférerais qu'ils soient brûlés plutôt que volés » (Es wer mir lieber, sie weren verbrunnen, ais das mans gestolen hat), dit la reine, ce qui indique également que certains d'entre eux pourraient être de nature érotique. À bien des égards, la jeune reine a tenté d'imiter ou de rivaliser avec la vieille reine Anna Jagellon. Après l'incendie, elle regrette d'avoir perdu tous ses diadèmes : « J'ai perdu tous mes diadèmes, dont une des 53 très grosses perles, presque aussi grosses que celles du collier de perles de la vieille reine, et diverses petites choses » (Ich hab alle meine krenl verloren, darunder ainẞ [mit] 53 gar grosse perl, schier so groẞ alẞ der alten kinigin grosse sch[n]uer und allerlay kleine sachen) (d'après « Der Brand im Wawel ... » de Walter Leitsch, p. 248, 251). Le mariage de toutes les petites-filles d'Anna Jagellon (1503-1547) était une affaire hautement politique, c'est pourquoi leur cousin, l'empereur Rodolphe II, contrôlait de nombreux aspects des modalités du mariage. Des galeries entières de portraits de mariée furent réalisées pour l'empereur au cours de ces années et Anne de Tyrol (1585-1618) et Constance de Stiria (1588-1631), la sœur de la reine Anna d'Autriche, furent également peintes pour Sigismond après la mort de sa première femme. Fin 1603, l'empereur envoie le peintre Hans von Aachen à Innsbruck. Le peintre part ensuite pour la Bavière, la Savoie et Modène, lorsque Rodolphe change d'avis et fait échouer les négociations avec Sigismond III concernant le mariage avec Anne de Tyrol. On soupçonnait même que le peintre « ne peindrait pas bien » (nichz guttz mallen) pour empêcher le mariage. L'effigie de la sœur aînée d'Anne de Tyrol, l'archiduchesse Marie d'Autriche (1584-1649) par Hans von Aachen, aujourd'hui conservée à la Galerie nationale d'art de Lviv (numéro d'inventaire 3857), a très probablement été créée pour Sigismond en 1604 (datée en haut à gauche). Le naturalisme de cette effigie ainsi que de celui de Constance (Kunsthistorisches Museum, GG 9452) est presque grotesque, plus proche des peintures du cabinet de curiosités impérial (Wunderkammer) que des effigies de proches de l'empereur. Les effigies de la jeune reine Anna d'Autriche envoyées aux Médicis conservées à Florence (un portrait de trois quarts et une miniature - Galerie des Offices, 2392 / 1890, Inventario Palatina, n. 624) et à Munich, offertes à la famille Wittelsbach (portrait en pied - Alte Pinakothek de Munich, 6992 et une miniature - Musée national bavarois, R. 1459). Comme c'était l'usage à l'époque, l'empereur devait recevoir des images de sa cousine, la reine de Pologne, mais aucun portrait d'Anna envoyé à sa famille à Vienne, Graz ou Innsbruck n'est connu. Au Kunsthistorisches Museum de Vienne se trouve un tableau représentant une femme nue allongée (« Vénus endormie » ou « Vénus au repos ») (huile sur panneau, 80 x 152 cm, GG 1104). Le tableau provient probablement de la collection de Rodolphe II, mais il est clairement identifiable dans la galerie en 1783 (d'après « Joseph Heintz ... » de Jürgen Zimmer, p. 101). On pensait que le tableau était identique au tableau mentionné dans l'inventaire de la collection de Vienne entre 1610-1619 : « Item une dame nue, peinte par Joseph Hainzen » (Item ein nackhets weib von Joseph Hainzen untermahlt, n° 83) et qu'il représentait une courtisane à la cour de Rodolphe II à Prague ou sa maîtresse, comme Kateřina Stradová également connue sous le nom de Catherina Strada (vers 1568-1629), fille du peintre Ottavio Strada l'Ancien, avec qui il eut six enfants. Cependant, aucune preuve claire n’a jamais été établie. De telles effigies privées et intimes n'étaient pas destinées au grand public, comme aujourd'hui où on peut facilement les voir dans les musées et différentes expositions, mais à un cercle restreint de spectateurs, de sorte que nous ne trouverions probablement jamais de confirmation écrite claire de qui était représenté. Le tableau est désormais attribué à Dirck de Quade van Ravesteyn, peintre hollandais qui, entre 1589 et 1608, fut peintre à la cour de Rodolphe II à Prague, où travaillaient alors plusieurs peintres des Pays-Bas et de Flandre. Il fut admis en juin 1589 comme portraitiste. En 1598, il est prouvé qu'il possédait une maison à Malá Strana à Prague et qu'il prêtait même de grosses sommes d'argent à d'autres personnes, notamment à des artistes. Il s'inspire des œuvres d'autres peintres, dont deux peintres flamands « errants » Hans Vredeman de Vries et son fils Paul, venus de Gdańsk à Prague en 1596. Au Musée des Beaux-Arts de Dijon, il existe un pendant (pièce d'accompagnement) à ce tableau (huile sur panneau, 90 x 164 cm, CA 134). Il provenait également très probablement de la collection impériale de Vienne et, avant 1809, il se trouvait dans la galerie du palais du Belvédère d'où il fut récupéré par Napoléon. Il existe quelques différences entre les deux tableaux, comme la couleur de l'oreiller, cependant, les deux tableaux représentent la même femme, vue sous un angle différent. Une restauration récente a révélé la présence de pièces d'or au sommet du tableau, donc à l'origine la composition était destinée à représenter le modèle dans la scène mythologique de Danaé, séduite par Jupiter transformé en pluie d'or. Un grand pendentif en or avec la scène de Jupiter et Danaé peut être vu dans le portrait de l'archiduchesse Anna à l'âge de 18 ans (Germanisches Nationalmuseum, Gm661). La version viennoise était découpée à gauche et indiquait également la présence, en haut de la composition, de pièces d'or. Les deux tableaux ont été exposés ensemble au Kunsthistorisches Museum de Vienne lors de l'exposition temporaire « Baselitz - Naked Masters » du 7 mars au 25 juin 2023. Des oreillers brodés aussi élaborés que ceux représentés dans les peintures étaient mentionnés dans l'inventaire des possessions de la reine (Riksarkivet à Stockholm, Extranea 85) - « un oreiller avec les armoiries lituaniennes brodées en argent, or et soie » (Ain kyß mit dem litauischen wapen mit silber, golt und seyden gestickt, 213), « un oreiller brodé d'argent, d'or et de soie avec les armoiries polonaises » (Mer ain gewirkts kyß von silber, golt und seyden mit dem polnischen wapen, 214) ou « un oreiller brodé d'argent, d'or et de soie avec les armoiries de la famille Tęczyński » (Mer ain gewirkt kiß von silber, golt und seyden mit dem tentschinischen wapen, 215). Une œuvre de la première période de travail de de Quade van Ravesteyn, datant d'environ 1590, représentant le mariage mystique de sainte Catherine, se trouve au Musée national de Varsovie (huile sur panneau, 29,5 x 21,5 cm, M.Ob.108, antérieur 235). Il provient de la collection de Piotr Fiorentini à Varsovie, léguée à l'École des Beaux-Arts en 1858. Il est possible qu'il ait fait partie de la collection royale qui a survécu au déluge (1655-1660) et que le peintre a visité la cour royale polono-lituanienne dans les années 1590. Deux portraits de Sigismond III sont également proches du style de de Quade van Ravesteyn - une miniature du Musée Czartoryski de Cracovie représentant le roi à l'âge de 30 ans, ainsi créée en 1596 (inscription : SIGISMVND[US] POLONIÆ ET / SVECIÆ REX M[AGNUS] DVX LITH[UANIÆ] / ET FINLANDIÆ ANNO ÆTA / TIS XXX, huile sur cuivre, 17,2 x 14,2 cm, MNK XII-144) et un portrait au Musée national de Varsovie (inscription : SIGISMVNDT. D.G. REX POLONIÆ, huile sur panneau, 27 x 20 cm, MP 188 MNW). Au tournant des XVIe et XVIIe siècles, de nombreux tableaux furent commandés et achetés à Prague par la cour royale polono-lituanienne auprès des artistes de la cour impériale de Rodolphe II. Certains d’entre eux ou leurs agents arrivèrent également dans la République. Le meilleur exemple d'une telle œuvre, réalisée à Prague, Augsbourg ou à Cracovie, est le portrait signé du roi Sigismond III Vasa par Joseph Heintz l'Ancien (J. Heintzen F. / SIGISMVNDVS ... / REX POLONIAE / & SVECIAE ...) à l'Alte Pinakothek de Munich (numéro d'inventaire 11885). Un autre exemple est une composition inspirée de la fresque de Pomarancio à Santo Stefano Rotondo à Rome - Lapidation de saint Etienne, attribuée à Hans von Aachen. Il a été créé ou acquis pour l'église Saint-Étienne de Cracovie (démolie en 1801, aujourd'hui dans la nouvelle église Saint-Étienne). En 1601, Andrzej Opaliński (1575-1623) acquiert à Prague un portrait de Michel le Brave (1558-1601), prince de Valachie, pour le roi, peut-être de Bartholomeus Spranger et une œuvre signée de Spranger (B. SPRANGERS. ANT .F.) de la même époque, représentant Vanitas (Putto avec un crâne), se trouve au Château royal de Wawel (numéro d'inventaire 935, de la collection Miączyński-Dzieduszycki). L'une de ces premières importations dans la République pourrait également être la sainte Ursule avec des femmes martyres de Spranger conservées au Musée national d'art de Lituanie (LNDM T 3995), offerte à la Société des amis de la science de Vilnius avant 1937. Au Musée National de Varsovie se trouvent également l'Allégorie de la Fortune du cercle de Spranger (M.Ob.763 MNW) et son dessin signé représentant le Péché originel (B(?) Spranger in., Rys.Ob.d.701, de la Société d'encouragement des beaux-arts de Varsovie), ainsi que le portrait d'Alphonse II d'Este, duc de Ferrare proche du style de Hans von Aachen (M.Ob.1913, de la collection de Jan Popławski) et Martyre de saint Sébastien, d'après l'estampe de Jan Harmensz. Muller, peint par von Aachen ou cercle (M.Ob.812, du dépôt d'art d'après-Seconde Guerre mondiale à Cracovie). Les deux tableaux font clairement référence aux nus Jagellonne du Titien, en particulier le portrait de la princesse Isabelle Jagellon (Vénus d'Urbino) et le portrait d'Anna Jagellon en Vénus avec un organiste et un chien, dont des copies figuraient sans doute également dans la collection royale avant le déluge. La femme ressemble beaucoup à Anna d'Autriche d'après ses portraits de Sofonisba Anguissola (collection privée) et du Tintoret (Musée du Prado, P000484), identifiés par mes soins. Il faut donc en conclure qu'à travers ces tableaux, la jeune reine de Pologne a voulu montrer à son cousin l'empereur, qu'elle n'est pas un spécimen de son cabinet de curiosités, mais une belle souveraine du Royaume de Vénus.
Mariage mystique de sainte Catherine par Dirck de Quade van Ravesteyn, vers 1590, Musée national de Varsovie.
Portrait de la reine Anna d'Autriche (1573-1598) nue (Vénus endormie) par Dirck de Quade van Ravesteyn, vers 1595, Kunsthistorisches Museum de Vienne.
Portrait de la reine Anna d'Autriche (1573-1598) nue (Vénus endormie) par Dirck de Quade van Ravesteyn, vers 1595, Musée des Beaux-Arts de Dijon.
Portrait en miniature du roi Sigismond III Vasa, âgé de 30 ans par l'atelier de Dirck de Quade van Ravesteyn, vers 1596, Musée Czartoryski.
Portrait du roi Sigismond III Vasa par l'atelier de Dirck de Quade van Ravesteyn, après 1596, Musée national de Varsovie.
Portrait de l'archiduchesse Marie d'Autriche (1584-1649) par Hans von Aachen, 1604, Galerie nationale d'art de Lviv.
Portraits de Stanisław Lubomirski et Bianca Cappello par Alessandro Maganza
Le jour de l'an 1595, à l'âge d'environ 11 ans, Stanisław Lubomirski (1583-1649), le fils aîné du comte Sebastian Lubomirski (décédé en 1613), avec son frère Joachim (1588-1610), quitta Wola Justowska près de Cracovie pour poursuivre ses études au collège jésuite de Munich. Il a été pris en charge par les serviteurs de confiance de son père, Piotr Szczepanowski, et Jan Gębczyński, diplômé de l'Université de Cracovie, qui ont tenu des registres de toutes les dépenses encourues à cette époque. Lubomirski séjourna à Munich jusqu'en mai 1597. Ce séjour fut interrompu par des difficultés financières et le mariage de la sœur aînée Katarzyna qui épousait le prince Janusz Ostrogski. Les frais d'études au collège et les dépenses engagées pendant le séjour de plus de deux ans à Munich étaient assez importants, s'élevant à 4 921 thalers. De retour en Pologne, le 21 juillet 1597, son père lui cède - avec l'accord du roi - la starostie de Nowy Sącz (d'après « Stanisław Lubomirski (1583-1649) ... » du prêtre Andrzej Bruździński, p. 93).
À la fin de 1598 ou au début de l'année suivante, accompagné du poète Piotr Kochanowski (1566-1620) et du susmentionné Jan Gębczyński, il partit à nouveau à l'étranger, cette fois vers le sud – en Italie. En 1599, il s'inscrit à l'Université de Padoue et se rend également en France et aux Pays-Bas. Il revint en 1601 et l'année suivante il fut admis à la cour royale. Le roi Étienne Bathory était le parrain de Stanisław. En tant que żupnik de Cracovie entre 1581 et 1592, son père a construit sa fortune principalement à partir de « sel » ainsi que de prêts usuraires, qui ont été évalués négativement dans la République. En 1597, même les joyaux de la couronne ont été mis en gage avec Lubomirski et en 1595, Sebastian est devenu le comte de Wiśnicz de la nomination impériale. Vers cette époque les « effets de voyage » des magnats et des nobles étaient transportés sur des « charrettes à trésors » et dans des « chars de chambre » recouverts de cuir dans des coffres, souvent de fabrication française, très sophistiqués et étanches, destinés à un type d'objets précis , comme « une boite en étain pour les tableaux », selon l'inventaire de la famille Radziwill (d'après « Mieszkańcy Rzeczypospolitej w podróży ... » d'Urszula Augustyniak, p. 375). Stanisław, qui deviendra plus tard le mécène d'un éminent architecte italien, Matteo Trapola, a également acquis et commandé des œuvres d'art à l'étranger. Une de ces dépenses ambiguës pour une rencontre avec un peintre a été enregistrée par Gębczyński lors de son séjour à Munich - « Pour la copie de Stach et avec le peintre » (Za kopią Stach i z malarzem), 5 zlotys 21 grosz. « Tout ne peut être confié au papier », écrit dans une lettre du 8 juillet 1588 de Venise, le diplomate Stanisław Reszka et les questions qui ne peuvent pas être discutées directement sont transmises oralement par un messager de confiance et authentifié, qui remplace parfois une lettre, simplement faute de temps pour l'écrire (d'après « W podróży po Europie » de Wojciech Tygielski, Anna Kalinowska, p. 14). Dans le palais de Wilanów à Varsovie, il y a un portrait d'un élégant jeune homme de 14 ans sur fond d'une colonne et d'un rideau de l'école vénitienne (huile sur toile, 176 x 115 cm, numéro d'inventaire Wil.1150). Il provient du château de Wiśnicz et a été déplacé à Varsovie avant 1821. Le château de Wiśnicz a été acheté par Sebastian Lubomirski en 1593 et entre 1615 et 1621 Trapola l'a agrandi et reconstruit pour son fils Stanisław. L'inscription originale en latin : Aetatis 14, au-dessus de sa tête confirme l'âge du modèle, tandis que l'inscription ultérieure identifiant le modèle comme Sebastian Lubomirski (Sobestian Lubomirski Wielkorządca Kr.: W: Woryniecki zmarły R. 1613) a été transférée à l'arrière de la toile doublée. Sur la base de ces informations, le tableau est daté d'environ 1560 (Sebastian est né vers 1546) et attribué à Giovanni del Monte ou de Monte, peintre actif à cette époque à la cour royale de Pologne-Lituanie (il partit pour Venise en 1557). Cependant, comme le note Wanda Drecka (« Portrety Sebastiana Lubomirskiego ... », p. 92), la coupe de ses hauts-de-chausses ou pantalon ne peut être comparée qu'aux costumes des gardes dans l'entrée du cortège nuptial de Sigismond III Vasa à Cracovie en 1605 (Château Royal de Varsovie), soi-disant « rouleau de Stockholm » parce qu'il a été emmené en Suède pendant le déluge (1655-1660) et retourné en Pologne en 1974. Les chaussures du garçon sont très similaires à celles représentées dans le portrait de l'homme d'État suédois Mauritz Stensson Leijonhufvud, daté « 1596 » (ANNO DOMINO 1596, château de Skokloster) et la pose et le costume peuvent être comparés au portrait de Sir Walter Raleigh et de son fils, daté « 1602 » (National Portrait Gallery de Londres). Des pantalons et des chaussures similaires peuvent également être vus dans un double portrait de deux enfants en costumes verts assortis, maintenant au Kunsthistorisches Museum de Vienne (huile sur toile, 116 x 91 cm, GG 3299). Le portrait est identifié pour représenter éventuellement des membres de la famille royale polonaise et attribué à l'école allemande ou polonaise. C'est principalement parce que le costume et la pose de la jeune fille sont très similaires à ceux de la sœur de Stanisław, très probablement Krystyna dans son portrait au Musée national de Varsovie (128871). Une fraise similaire à celle de l'effigie du garçon a été représentée dans le portrait du roi Sigismond III Vasa, également au Kunsthistorisches Museum (GG 3302) et les portraits de ses enfants la princesse Anna Maria Vasa à l'âge de 3 ans (ÆTATIS SVÆ Ao. III.) et le prince Ladislas Sigismond Vasa à l'âge de 1 an (ÆTATIS SVÆ I. Ao.) dans le monastère de Las Descalzas Reales à Madrid, peints en 1596. Les portraits du roi Sigismond et de ses enfants ont été créés par son peintre de cour Martin Kober de Wrocław, décédé avant 1598 à Cracovie ou à Varsovie. Tous ont été envoyés aux parents du roi à Vienne et en Espagne. Une copie de l'effigie du prince Ladislas Sigismond a également été envoyée en Bavière (Alte Pinakothek à Munich). De plus, le portrait mentionné de deux enfants à Vienne ressemble également dans le style aux portraits susmentionnés de Kober, qui en 1595 se rendit à Graz pour peindre la famille de la femme de Sigismond, Anna d'Autriche (1573-1598). La même année, le 14 juillet, alors que Stanisław séjourne à Munich, son père Sebastian reçoit de l'empereur Rodolphe II la confirmation et la reconnaissance du titre héréditaire de comte impérial de Wiśnicz, accordé par l'empereur Charles Quint le 15 février 1523 à ses ancêtres (d'après « Genealogie rodów utytułowanych ... » de Tomasz Lenczewski, p. 41). À cette occasion ou même plus tôt, l'empereur a très probablement reçu les portraits du comte et des membres de sa famille, dont son fils aîné et sa sœur Katarzyna. La fille dans le portrait décrit est apparemment plus âgée que le garçon, exactement comme Katarzyna née vers 1581, qui était représentée dans un riche costume similaire dans son portrait au Musée national de Varsovie (157500). Le garçon dans le tableau pourrait avoir 7 ans, donc le tableau doit être daté d'environ 1590, lorsque Kober est revenu de la cour impériale de Prague en Pologne. La peinture peut être vérifiée à la Galerie impériale de Vienne en 1772. Son pourpoint en satin de couleur argentée, son col et sa coiffure sont presque identiques à ceux des portraits de Jacques I(VI) Stuart, roi d'Angleterre et d'Écosse par Adrian Vanson, datés de '1595' (Scottish National Gallery et collection privée) et portrait d'un gentilhomme, anciennement suggéré d'être William Shakespeare, en date « 1602 » (collection privée). Le portrait devrait par conséquent être daté d'environ 1597, lorsque Stanisław Lubomirski, 14 ans, devint le starost de Nowy Sącz et partit bientôt pour l'Italie. Les traits du visage du garçon ressemblent étroitement à d'autres effigies de Stanisław Lubomirski au palais de Wilanów (Wil.1565, Wil.1258). Le même garçon a été représenté dans un autre portrait de la collection Lubomirski peint dans le même style, aujourd'hui à la Galerie nationale d'art de Lviv (huile sur toile, 67 x 78 cm, Ж-1377). Il s'agit vraisemblablement d'un fragment d'une plus grande composition le montrant sous les traits du David biblique avec une épée. Le style des deux tableaux, à Wilanów et à Lviv, est très proche de celui d'Alessandro Maganza (1556-1630), peintre né et actif à Vicence, ainsi qu'à Venise, influencé par le Tintoret, Palma le Jeune et Véronèse. Sa technique distinctive est particulièrement bien visible dans une peinture datée « 1590 » (M.D.LXXXX), aujourd'hui au Nationalmuseum de Stockholm (NM 32), représentant la Vierge et l'Enfant avec des saints, ainsi que dans le portrait d'une femme aux perles (vendu au Capitolium Art à Brescia le 17 octobre 2018, huile sur toile, 40 x 53 cm). Cette dernière effigie est une version d'un portrait de Bianca Cappello (1548-1587), noble vénitienne devenue grande-duchesse de Toscane, peint par Scipione Pulzone en 1584 (Kunsthistorisches Museum de Vienne, GG 1138). Le peintre a très probablement reçu un dessin ou une miniature de la Grande-Duchesse à copier, son séjour à Florence n'étant pas confirmé. Il en fut sans doute de même des effigies du jeune staroste de Nowy Sącz avant sa visite en Italie. Un autre « Portrait de femme » intéressant, peint dans le même style, se trouve au Musée national d'art de Lituanie à Vilnius (huile sur toile, 56 x 44 cm, numéro d'inventaire LNDM T 4018). Il est attribué à Frans Pourbus le Jeune en raison d'une certaine ressemblance avec ses œuvres et la femme représentée est évidemment Marie de Médicis (1575-1642), reine de France. Il est daté « 1614 » dans le coin supérieur droit. Vraisemblablement en 1613, Nicolas Christophe Radziwill d'Olyka (1589-1614), est allé en France, d'où il est revenu via l'Italie du Nord et en mai 1614, à cause de sa maladie, il est resté à Vérone, d'où, le 9 mai 1614, il envoie une lettre à son ami Ferdinand Ier de Gonzague (1587-1626), duc de Mantoue (d'après « Zagraniczna edukacja Radziwiłłów ... » de Marian Chachaj, p. 69). Ce pourrait être lui qui a commandé ce tableau dans la République de Venise, ou il a été commandé par les Vasa. En 1614, le soi-disant « Aigle Treter » (Ordo et series regum Poloniae) aux effigies des monarques de Pologne fut publié à Paris par Jean le Clerc, et un an plus tard, en 1615, une nièce de la reine de Pologne, l'infante Anne d'Autriche (1601-1666) épouse Louis XIII de France, fils de Marie de Médicis.
Portrait de Stanisław Lubomirski (1583-1649) et de sa sœur Katarzyna (décédée en 1612) par Martin Kober, vers 1590, Kunsthistorisches Museum de Vienne.
Portrait de Stanisław Lubomirski (1583-1649), staroste de Nowy Sącz, âgé de 14 ans par Alessandro Maganza, vers 1597, Palais de Wilanów à Varsovie.
Portrait de Stanisław Lubomirski (1583-1649) tenant une épée par Alessandro Maganza, vers 1597, Galerie nationale d'art de Lviv.
Portrait de Bianca Cappello (1548-1587), grande-duchesse de Toscane par Alessandro Maganza, vers 1584, collection particulière.
Portrait de Marie de Médicis (1575-1642), reine de France par Alessandro Maganza, 1614, Musée national d'art de Lituanie.
Portraits de ducs de Savoie par Sofonisba Anguissola
Les contacts diplomatiques de la Pologne-Lituanie avec le duché de Savoie au XVIe siècle remontent avec certitude à l'année 1535, lorsque la reine Bona envisagea d'épouser sa fille aînée Isabelle Jagellon avec Louis (Ludovico) de Savoie (1523-1536), prince de Piémont, fils de Charles III et de Béatrice de Portugal. Elle écrivit à ce sujet à l'ambassadeur du roi Ferdinand Ier, Sigismund von Herberstein, de Vilnius le 14 décembre 1535 et la question fut discutée plus tôt par son envoyé Ludovico Alifio (d'après « Królowa Bona ... » de Władysław Pociecha, p. 206 ). Comme il était de coutume, le portrait de la princesse jagellonne fut certainement envoyé en Savoie, tandis qu'elle reçut le portrait de Louis. Malheureusement, le prince mourut à Madrid le 25 novembre 1536. Certains contacts informels étaient bien antérieurs, par exemple en février 1416 à Chambéry Janusz de Tuliszków, chevalier des armoiries Dryja de la Grande Pologne et diplomate, reçut l'Ordre du Collier (plus tard Ordre de la Très Sainte Annonciation) d'Amédée VIII (considéré comme le dernier antipape). Ils augmentèrent sans doute vers 1587 lorsque la candidature du duc de Savoie à la troisième élection libre fut discutée à Madrid (d'après « Dwór medycejski i Habsburgowie ... » de Danuta Quirini-Popławska, p. 123).
Aux XVIe et XVIIe siècles, le portrait faisait partie de la diplomatie et les monarques de différents pays d'Europe échangeaient fréquemment leurs effigies. Des portraits ont également été envoyés à des amis et à des membres de la famille. En 1558, Georgius Sabinus (1508-1560), poète et diplomate allemand, est envoyé en Pologne-Lituanie pour gagner le soutien des seigneurs polono-lituaniens, dont Stanisław Ostroróg, Jan Janusz Kościelecki, Łukasz Górka, Jan Tarnowski et Jan Zborowski, à la candidature de Sigismond de Brandebourg (1538-1566), fils de Joachim II Hector, électeur de Brandebourg de son second mariage avec Hedwige Jagellon (1513-1572), pour le trône après son oncle Sigismond Auguste. Au nom du jeune prince Sigismond, il donna à chacun d'eux une chaîne d'or, à laquelle pendait le portrait du prince. Comme il n'était connu que de quelques-uns d'entre eux, il voulut leur présenter son effigie « comme un symbole d'amitié » (als ein Symbol der Freundschaft). Les seigneurs polono-lituaniens ont rendu la pareille de sorte que « pratiquement aucun autre envoyé venu en Pologne n'est jamais rentré chez lui avec autant de richesses et de cadeaux que lui » (mit so vielem Reichtum und Gaben wie er, sei wohl kaum je ein zweiter nach Polen beordneter Gesandter heimgekehrt, d'après « Forschungen zur brandenburgischen und preussischen Geschichte ... », tome 11, p. 156). Les miniatures proviennent probablement de l'atelier de Cranach, comme les portraits du père de Sigismond, même s'il n'est pas exclu qu'elles aient été commandées en Italie par la mère du prince, Hedwige. Les missions diplomatiques étaient fréquemment accompagnées d'échanges de cadeaux de valeur et elles représentaient généralement les exportations les plus précieuses du pays, de sorte que les Italiens offraient des peintures, des tissus riches et des cosmétiques de luxe et les Polonais offraient des horloges, des zibelines, des chevaux et de l'ambre. Le cardinal Enrico Gaetani, légat du pape en Pologne d'avril 1596 à juin 1597, offrit au roi Sigismond III Vasa des tableaux de maîtres célèbres, à la reine des voiles richement brodés et une conque au musc sertie dans un cadre riche, le tout valant au moins 800 écus. Le roi a donné au cardinal une belle horloge en forme de temple avec des figurines animées montrant la procession et la bénédiction du Saint-Père d'une valeur de plus de 3 000 écus et 40 zibelines d'une valeur de 500 écus. L'évêque de Kuyavia à Wolbórz a donné au légat deux chevaux avec de riches chabraques de style turc, et le cardinal a distribué des médailles d'or à son image aux courtisans. Boniface Vanozzi, envoyé par le même cardinal Gaetani au chancelier Jan Zamoyski, a distribué des chapelets, des médailles, des agnus dei, des images sur tôle dans des cadres en ébène et il a reçu un cheval avec un chabraque en velours de style turc, une grande médaille d'or représentant le roi Étienne Bathory, un sabot d'élan, beaucoup de gibier, du vinaigre, de l'huile et des sucreries. Au roi et à la reine, Vanozzi a présenté des peintures, des tapisseries tissées en Espagne (ou plus probablement aux Pays-Bas espagnols), des gants colorés parfumés et du musc. Le roi lui a donné des zibelines très chers et une horloge d'une valeur de 1 000 thalers et la reine, divers ustensiles en ambre blanc pour la chapelle, un crucifix, un plateau pour les burettes d'autel, un osculatoire et un ostensoir, tous magnifiquement sculptés à Gdańsk. En 1597, l'ambassadeur du roi d'Espagne, Don Francisco de Mendoza (1547-1623), amiral d'Aragon et marquis de Guadalest, reçut de Sigismond III des zibelines d'une valeur de 2 000 écus et ses courtisans se virent offrir des coupes d'or (d'après « Domy i dwory ... » par Łukasz Gołębiowski, p. 258-259). A cette époque, le monarque élu de la République a également envoyé à son beau-frère, le roi d'Espagne, des portraits de ses enfants par Martin Kober, tous deux datés « 1596 » (Monastère de las Descalzas Reales à Madrid) et en 1621, l'ambassadeur de Pologne à Londres, Jerzy Ossoliński, a reçu des portraits « au long » (en pied / att length) du roi et du prince Charles. Les collections royales de la République avant 1655 étaient donc comparables à celles des monarques espagnols (musée du Prado à Madrid et El Escorial), des empereurs romains (Kunsthistorisches Museum à Vienne et Hofburg), des ducs de Toscane (galerie des Offices à Florence et palais Pitti) ou Ducs de Savoie (Galleria Sabauda à Turin et Palazzo Madama). Malheureusement très peu conservé aujourd'hui dans les anciens territoires de la République, y compris les inventaires et autres documents. Au Musée national de Varsovie, il y a un portrait de deux garçons, attribué au cercle du peintre néerlandais Anthonis Mor, qui a travaillé pour les monarques espagnols et portugais (huile sur toile, 56,5 x 46 cm, numéro d'inventaire M.Ob.941 MNW, antérieur 231117). Il a été acheté en 1962 à Romuald Malangiewicz. Son histoire antérieure est inconnue, nous ne pouvons donc pas exclure la provenance de la collection royale ou magnat en Pologne-Lituanie. Le tableau a été découpé dans un portrait de groupe plus large, car un fragment de la robe d'une femme, très probablement la mère des deux garçons, est visible à droite. De tels portraits étaient particulièrement populaires en Italie au tournant des XVIe et XVIIe siècles - portrait de Maria di Cosimo Tornabuoni, une noble florentine, et de ses deux petits fils, l'un habillé en habit dominicain, par Tiberio di Tito (Tiberio Titi) ou un portrait de Bianca degli Utili Maselli entourée de six de ses enfants, peint par Lavinia Fontana à Rome. Si le tableau provient de la collection royale ou magnat, la partie principale représentant la femme a été détruite lorsque les résidences de la République ont été saccagées et incendiées pendant le déluge (1655-1660) ou plus tard, ou il a été coupé en morceaux pour vendre le tableau de manière plus rentable lorsque le pays s'est appauvri à cause des guerres et des invasions. Un portrait peint dans un style similaire et avec une femme ressemblant aux deux garçons du tableau de Varsovie se trouve maintenant au palais de Kensington en Angleterre (huile sur toile, 42,3 x 33 cm, RCIN 402954, inscription : 305). Il provient de la collection royale, peut-être enregistré dans le vestiaire royal « à côté du paradis » à Hampton Court en 1666 (numéro 60), et était auparavant considéré comme représentant Élisabeth de Valois (1545-1568), reine d'Espagne. Par conséquent, il a été attribué au portraitiste de la cour espagnole Anthonis Mor et plus tard à son élève et successeur sous Philippe II, Alonso Sánchez Coello. Il est maintenant identifié pour représenter peut-être la fille aînée d'Élisabeth, l'infante Isabelle-Claire-Eugénie. Un portrait similaire représenterait donc peut-être sa sœur l'infante Catherine-Michelle d'Espagne (huile sur toile, 42,2 x 32,6 cm, RCIN 402957, 306). Ces effigies ressemblent en effet à d'autres effigies d'infantes, mais se comparent aux portraits d'Isabelle-Claire-Eugénie par Coello au Musée du Prado à Madrid, peint en 1579 (P01137) et par Juan Pantoja de la Cruz vers 1599 (P000717) et des portraits signés de sa soeur Catherine-Michelle du Château de Racconigi (0100399544) et attribuée à Sofonisba Anguissola (vendue chez Christie's à New York, le 14 octobre 2021, lot 101), indiquent que ce devrait être à l'inverse - 305 est le portrait de Catherine-Michelle et 306 d'Isabelle-Claire-Eugénie. En 1585, Catherine-Michelle devient duchesse de Savoie en épousant Charles Emmanuel Ier, duc de Savoie à Saragosse. Un petit portrait similaire (huile sur toile, 55,9 x 45,7 cm) portant l'inscription : DVQUESA / DE.SAVOI, a été vendu chez Period Oak Antiques. Le style du portrait de Catherine-Michelle dans la collection royale en Angleterre ressemble au portrait de sa mère au Prado, attribué à Sofonisba Anguissola (P001031) et à l'autoportrait de Sofonisba au chevalet (château de Łańcut). La composition et le style du portrait de deux garçons à Varsovie sont quant à eux similaires au portrait de l'infante Juana de Austria (Jeanne d'Autriche) avec la naine Ana de Polonia par Sofonisba (Isabella Stewart Gardner Museum à Boston, P26w15). Les deux garçons doivent donc être identifiés comme les fils aînés de Catherine-Michelle - Philippe-Emmanuel (1586-1605) et Victor-Amédée (1587-1637) et leur iconographie connue correspond parfaitement. Les deux princes étaient fréquemment représentés dans leur jeunesse et dans nombre de leurs effigies, principalement créées par le peintre néerlandais Jan Kraeck, dit Giovanni Caracca, ils portent une collerette similaire plus petite (par exemple, un double portrait d'une collection privée à Naples, vendu à Blindarte, novembre 30 décembre 2019, lot 153). Certains d'entre eux ont été créés en plusieurs versions, comme le triple portrait de 1589 (vendu à Aste Bolaffi, le 25 septembre 2013 et au palais du Quirinal à Rome). De 1584 à 1615 environ, Sofonisba résida à Gênes. Bien qu'en 1585 elle rencontre l'infante Catherine-Michelle à son arrivée à Gênes et l'accompagne probablement sur le chemin de Turin, tous les portraits mentionnés ont probablement été réalisés à partir d'esquisses, de dessins d'étude ou de peintures d'autres peintres, comme Kraeck. C'est elle qui, vers 1590, réalise un portrait en miniature de Charles Emmanuel I (vendu en 2005, Christie's à Londres, lot 1009, comme l'effigie de Victor-Amédée I) et le portrait du duc avec sa femme Catherine-Michelle et leurs enfants (Palazzo Madama à Turin, 0611/D), comme l'indique le style des deux tableaux. Le portrait de deux princes à Varsovie était donc un cadeau à Sigismond III Vasa ou à sa tante Anna Jagellon et a probablement été apporté par l'ambassadeur d'Espagne Mendoza ou un autre envoyé.
Portrait de l'infante Catherine-Michelle (1567-1597), duchesse de Savoie par Sofonisba Anguissola, vers 1590, palais de Kensington.
Portrait de Victor-Amédée (1587-1637) et Philippe-Emmanuel (1586-1605), fils de l'Infante Catherine-Michelle (1567-1597), duchesse de Savoie par Sofonisba Anguissola ou atelier, vers 1596-1597, Musée national de Varsovie.
Portrait de l'Infante Catherine-Michelle (1567-1597), duchesse de Savoie avec ses fils par Sofonisba Anguissola ou atelier, vers 1596-1597. Disposition possible de la peinture originale. © Marcin Latka
Portraits en miniatures des Vasa par Sofonisba Anguissola et atelier
De riches cadeaux accompagnaient toutes les missions diplomatiques. Le 14 juin 1592, « après la messe chantée au dîner », Sigismond III, dans son salon privé en présence de quelques sénateurs, donna audience à Pietro Duodo, orateur de la République de Venise (Petro Dodo oratori S. Reipublicae Venetiarum), accompagné de huit nobles vénitiens et assis sur un banc décoré de velours vert (scamno ornato velluto viridi). Il est arrivé pour féliciter le roi pour son mariage avec Anna. Le roi fit chevalier Duodo et « lui présenta un collier d'une valeur de mille en or, et lui accorda les insignes [effigies ?] de la famille royale » (et donavit ei torquem millium aureorum, et concessit insignia familiae regiae). Il alla ensuite rendre visite à la reine, à qui il remit également une lettre, et au nom de la République de Venise il présenta divers vases en argent gravé, pour le prix de quatre mille en or (donavit S. Reginae vasa diversa argenti caelati pro pretio quatuor millium aureorum).
A cette époque, des portraits étaient échangés avec Florence. En 1596, le roi verse une grosse somme de 120 florins au marchand Laurent (Laurentio mercatori) « pour des images de Charles Quint, empereur des Romains » (pro imaginibus Caroli Quinti Caesaris Romanorum). Giovanni Paolo Mucante (mort en 1617), maître de cérémonie de la délégation du légat papal, le cardinal Gaetano, écrivait dans une lettre datée du 21 septembre 1596 que le portrait de feu la reine Anna Jagellon dans la salle était « très naturel » (il suo ritratto, come dicevano, naturalissimo) et en 1601 Andrzej Opaliński (1575-1623) acquiert à Prague un portrait de Michel le Brave (1558-1601), prince de Valachie, pour le roi, selon une lettre du nonce Claudio Rangoni au cardinal Pietro Aldobrandini (3 juin) (d'après « Das Leben am Hof ... » de Walter Leitsch, p. 370, 953, 2277, 2381). Des peintres sont parfois mentionnés, mais les noms manquent. En 1592, avant le mariage, le tailleur Claudio Aubert se rend en Italie pour se procurer tout ce dont il a besoin. Il versa entre autres 96 florins « aux peintres envoyés en Pologne pour servir Sa Majesté » (alli pittori mandati in Polonia al servitio di SM). De nombreuses informations sur le mariage ont été conservées, mais il n'y a aucune mention de peintres italiens nulle part. Dans les comptes de 1601, on trouve seulement la note suivante : « Vilnius pour le paiement des peintres et pour la réparation des tentes, le 28 août » (Vilnae in solutionem pictoribus et in reparationem tentoriorum, die 28 augusti, fl 110). Cela indique que différents ateliers en Italie travaillaient sur des commandes royales et envoyaient leurs agents en Pologne-Lituanie uniquement pour préparer les premiers dessins. Outre le vénitien Redutti, qui a aidé le roi dans les travaux d'orfèvrerie, il existe des preuves que Ruggiero Salomoni a travaillé avec Sigismond. Il vint en Pologne comme aumônier de la première épouse du roi. Il était bien connu pour son talent, car dès 1595, il créa la décoration du tombeau pascal pour le cardinal Radziwill dans la cathédrale de Cracovie, selon une lettre de Sigismundus Ernhofer à l'archiduchesse Marie-Anne en date du 5 avril 1595. Salomoni fut l'agent du roi à Naples vers 1619, envoyant des tableaux, tapisseries et curiosités italiennes pour la collection royale (d'après « The Grove Encyclopedia ... », éd. Gordon Campbell, p. 455). Les articles de luxe étaient achetés en Italie, mais également offerts à des amis là-bas. La mère de Sigismond possédait un miroir en argent, peut-être fabriqué en Italie, et le courtisan royal Stanisław Radziejowski a offert à Marie-Madeleine d'Autriche, grande-duchesse de Toscane et belle-sœur du roi un « miroir d'ambre » (spechio di ambra), selon sa lettre à la grande-duchesse (12 juin 1615). Le roi commanda à l'Italie un grand miroir (speculum grande cocavum), mentionné dans sa lettre à Salomoni (20 janvier 1614). Des envoyés royaux se rendaient en Italie, non seulement pour acquérir ou commander des produits de luxe, mais aussi pour faire venir des artistes et musiciens de renom, comme en décembre 1594, lorsque Krzysztof Kochanowski (neveu du poète Jan) vint à Rome recruter des musiciens italiens pour Sigismond III ou Aubert mentionné, avant 1592. Vers 1598, la cour royale polono-litunienne envoya de nombreuses effigies de membres de la famille royale aux cours étrangères. Les Vasas, comme leurs ancêtres les Jagellon, et d'autres monarques importants d'Europe, commandaient leurs effigies aux meilleurs artistes. C'est pourquoi leurs reliefs en miniatures en cire colorée ont été réalisés par le célèbre atelier d'Alessandro Abondio - bustes de Sigismond III et de son épouse Anna d'Autriche au Bode Museum de Berlin (numéro d'inventaire 881, 882) et au Nationalmuseum de Stockholm (NMGrh 1994, NMGrh 1995). Abondio fut probablement recommandé à Sigismond III par sa belle-mère, l'archiduchesse Marie-Anne de Bavière et son mari Charles II, petit-fils d'Anna Jagellon (1503-1547), dont les miniatures de cire du père d'Alessandro, Antonio, se trouvent à Abegg-Stiftung (9.7.63). Cependant, si l'on considère l'énorme destruction de l'art en Pologne-Lituanie lors du déluge (1655-1660) et d'autres invasions, rien ne peut être dit avec certitude à ce sujet et on pourrait aussi dire à l'inverse que les Jagellon ou les Vasas recommandèrent les Abondio aux Habsbourg. A cette époque, la miniaturiste la plus renommée travaillant pour les Habsbourg en Espagne et en Autriche était Sofonisba Anguissola, qui réalisa plusieurs de ses autoportraits en miniature ou en petit format - au Musée des Beaux-Arts de Boston (60.155), Fondation Custodia à Paris (6607) ou au Kunsthistorisches Museum de Vienne (GG 285), ce dernier était très probablement un cadeau pour les Habsbourg autrichiens. Dans son portrait conservé au musée du Prado à Madrid (P001031), récemment attribué à Sofonisba, la reine Élisabeth de France tient entre ses mains une miniature de son époux le roi Philippe II, probablement également peinte par Anguissola. Ce portrait est un signe de reconnaissance particulière pour l'artiste. Vers 1575 elle réalise une miniature de l'empereur Maximilien II (1527-1576), fils d'Anna Jagellon (1503-1547), vendue à Paris en 2016 (Sotheby's, 16 juin 2016, lot 12, inscrite au verso en italien : Di mano / da Sofonisba / Anguisciola Cre / Monese / Dama Della Regina Isabella / di spagna moglie … / di filippo …). Sofonisba est également l'auteur de plusieurs portraits en miniatures de la collection des ducs de l'Infantado à Madrid, qui appartenaient probablement à l'origine à la collection royale espagnole. Parmi les effigies de l'archiduchesse Marie-Anne (Archivo de Arte Español - Archivo Moreno, 01616 B), de l'empereur Rodolphe II (01696 B) et du roi Sigismond III en costume polonais (01784 B), il y avait aussi son autoportrait en costume espagnol (01616B). Une miniature d'une des filles de Marie-Anne a également été vendue à Paris avec attribution à l'entourage de Pierre Paul Rubens, vers 1610 (huile sur panneau, 8 x 6 cm, vendue à l'Hôtel Drouot, 21 novembre 2014, lot 29). Cette miniature provient probablement d'une collection privée française, on ne peut donc exclure la provenance de la collection de Jean II Casimir Vasa, installé en France après son abdication en 1668, ou d'une autre collection polonaise transférée en France au XIXe siècle. Compte tenu de cela et de la ressemblance avec le portrait du Germanisches Nationalmuseum (Gm661), le modèle est très probablement Anna d'Autriche (1573-1598), future reine de Pologne. Le style de cette peinture ressemble également à des œuvres mentionnées de Sofonisba. Plusieurs miniatures des Vasa polono-lituaniens créées vers 1598 se trouvent aujourd'hui au Musée national bavarois de Munich. Tous étaient probablement des cadeaux aux Wittelsbach ou provenaient de la dot de la princesse polono-lituanienne Anna Catherine Constance Vasa. Ce cycle de petites peintures sur laiton et étain (toutes d'environ 4,5 x 3,5 cm) comprend des effigies de Sigismond III (R. 1462), de sa première épouse Anna d'Autriche (R. 1459, R. 1465) et de leurs enfants Anna Maria Vasa (R. 1497) et Ladislas Sigismond Vasa (R. 1446). Une autre miniature de la reine Anna dans le même style, probablement un cadeau aux Médicis, se trouve à la Galerie des Offices à Florence (huile sur laiton, 4,1 x 3,5, Inventario Palatina, n. 624). La miniature de Sigismond III de ce cycle est particulièrement similaire à la miniature mentionnée de l'empereur Maximilien II. Une autre miniature de Ladislas Sigismond dans la même collection (R. 1455), créée vers 1601, a également été réalisée dans le style d'Anguissola. Ainsi, toutes les miniatures ont été peintes par la même artiste et son atelier. C'est également l'atelier de Sofonisba qui réalisa le portrait de la reine Anna au Château Royal de Varsovie (inscription : ANA D' AVSTRIA REG:A D' POLONIA, huile sur toile, 61 x 48 cm, FC ZKW 1370). Le style de ses bijoux ainsi que l'inscription sont similaires à ceux du portrait de Catherine-Michelle d'Espagne (1567-1597), duchesse de Savoie, attribué à Anguissola (vendu chez Christie's New York, enchères 19994, 14 octobre 2021, lot 101). C'est pourquoi, comme toutes les effigies des Habsbourg mentionnées, les portraits des Vasa ont été commandées dans l'atelier de la peintre sur la base d'autres effigies ou de dessins d'étude.
Portrait en miniature d'une fille de Marie-Anne de Bavière (1551-1608), très probablement l'archiduchesse Anna d'Autriche (1573-1598), par Sofonisba Anguissola ou atelier, vers 1592, Collection privée.
Portrait en miniature du roi Sigismond III Vasa (1566-1632) par Sofonisba Anguissola ou atelier, vers 1598, Musée national bavarois de Munich.
Portrait en miniature de la reine Anna d'Autriche (1573-1598) par Sofonisba Anguissola ou atelier, vers 1598, Musée national bavarois de Munich.
Portrait en miniature de la reine Anna d'Autriche (1573-1598) par Sofonisba Anguissola ou atelier, vers 1598, Musée national bavarois de Munich.
Portrait en miniature de la reine Anna d'Autriche (1573-1598) par Sofonisba Anguissola ou atelier, vers 1598, Galerie des Offices à Florence.
Portrait en miniature de la princesse Anna Maria Vasa (1593-1600) par l'atelier de Sofonisba Anguissola, vers 1598, Musée national bavarois de Munich.
Portrait en miniature du prince Ladislas Sigismond Vasa (1595-1648) par l'atelier de Sofonisba Anguissola, vers 1598, Musée national bavarois de Munich.
Portrait de la reine Anna d'Autriche (1573-1598) par l'atelier de Sofonisba Anguissola, vers 1592-1598, Château Royal de Varsovie.
Portraits d'Anna Vasa et Ladislas Sigismond Vasa par Sofonisba Anguissola
En 1594, un projet de mariage apparaît pendant le séjour d'Anna Vasa en Suède. Le candidat était Jean-Georges de Brandebourg (1577-1624), administrateur de Strasbourg à partir de 1592 et petit-fils de l'électeur de Brandebourg, qui allait devenir gouverneur de Prusse, fief féodal de la couronne de Pologne. Au printemps 1596, un envoyé, Paweł Arciszewski, secrétaire du roi Sigismond III, se rendit en Suède avec un portrait de Jean-Georges à Anna Vasa afin de renforcer la sympathie de la princesse pour son époux (d'après « Das Leben am Hof ... » par Walter Leitsch, p. 2378). Le peintre était très probablement un peintre de la cour de Sigismond III ou un atelier étranger travaillant pour les monarques polono-lituaniens.
Les négociations sur ce mariage ont été menées du côté du Brandebourg par le chancelier de Magdebourg Wilhelm Rudolf von Meckbach et Johann von Löben qui se sont tous deux rendus à Cracovie, et du côté polonais par le secrétaire royal Jan Skrzetuski, qui s'est rendu à Berlin, et Samuel Łaski. La date du mariage fut fixée au 10 avril 1598 à Stockholm et Anna reçut même une dot de 100 000 thalers de son frère Sigismond III Vasa, ainsi que des bijoux, des chevaux, des meubles et 10 000 florins en cadeau de mariage. Anna et ses descendants devaient se voir accorder les droits de succession en Suède. La mort de Jean-Georges, électeur de Brandebourg le 8 janvier 1598, la mort de l'épouse de Sigismond Anna d'Autriche (1573-1598) le 10 février et le déclenchement de l'insurrection en Suède rendirent impossible la conclusion du mariage au lieu et à la date prévus. Lorsque l'oncle de Sigismond le dépose en Suède, ces plans ne se concrétisent pas. Le portrait d'une femme noble et de son mari en costumes de la fin des années 1590 par Sofonisba Anguissola (huile sur toile, 123,3 x 93 cm, vendue chez Sotheby's Londres, 11 juillet 2002, lot 177) est très similaire à d'autres effigies d'Anna Vasa. Son costume de style espagnol et sa pose ressemblent étroitement au portrait de la reine Anna d'Autriche par Martin Kober, créé en 1595 (Collection de peintures de l'État de Bavière et Galerie des Offices à Florence) et au portrait de l'archiduchesse Marie-Anne de Bavière (1574-1616) par Joseph Heintz l'Ancien, créé en 1604 (Kunsthistorisches Museum de Vienne). Le costume d'homme est typique de la France et des pays protestants de la fin du XVIe siècle. Après son retour en Pologne, Sigismond fit d'Anna staroste de Brodnica le 2 octobre 1604, après la mort de Zofia Działyńska née Zamoyska et en décembre 1605, elle assista au mariage de Sigismond à Cracovie, assise dans la voiture de la mariée. Les négociations avec Jean-Georges de Brandebourg furent finalement interrompues en 1609 et le 3 juin 1610, il épousa Eva Christine von Württemberg (1590-1657), tandis qu'Anna resta célibataire. Comme sa mère, la reine Catherine Jagellon, la princesse entretenait une cour splendide et diversifiée avec des personnes différentes, comme en témoigne sa lettre à Halszka Sapieżyna née Radziwill de Cracovie du 28 janvier 1605 : « Nous remercions VS [Votre Seigneurie] pour la naine qui VS nous as amenée, et nous demandons de toute urgence à VS de l'envoyer avec une personne de confiance » (Za karlice, WMci dziękujem, którąś WMć dla nas przywiozła, pilnie prosiem, abyś ją WMć przy kim pewnym sam posłała) (d'après « Archiwum domu Sapiehów ... » d'Antoni Prochaska, p. 449). Bien que les nains de cour des XVIe et XVIIe siècles soient désormais principalement associés à l'Espagne et à leurs magnifiques portraits par Anthonis Mor, Juan van der Hamen et surtout Diego Velázquez, de nombreuses peintures de ce type ont sans doute également été retrouvées en Pologne-Lituanie avant le déluge (1655-1660). En 1551, le peintre Andreas Rul de Wrocław (Andreae Rul pictori Vratislaviensi) peint les portraits de 7 naines royales, pour lesquelles il reçoit le 3 mars 42 thalers, plus le remboursement des frais d'hébergement, et le portrait du roi Sigismond Auguste, l'oncle d'Anna, pour lequel il reçut le 17 mars 10 ducats hongrois (d'après « Słownik artystów polskich i obcych ... » de Jolanta Maurin Białostocka, p. 355). Le portrait ovale de la collection privée du Massachusetts (huile sur toile, 65 x 52,5 cm, vendue chez Bonhams Skinner, 11 novembre 2021, lot 1036, comme par l'école de Frans Pourbus le Jeune), très similaire à la miniature d'Anna de la Galerie des Offices à Florence, est également stylistiquement proche de Sofonisba ainsi qu'une miniature du prince Ladislas Sigismond Vasa dans les collections de peinture de l'État bavarois (huile sur plaque de fer blanc, 4,4 x 3,7 cm, R. 1455).
Portrait de la princesse Anna Vasa (1568-1625) en costume espagnol par Sofonisba Anguissola, vers 1598, Collection particulière.
Portraits de la princesse Anna Vasa (1568-1625) et Jean-Georges de Brandebourg (1577-1624) par Sofonisba Anguissola, vers 1598, Collection particulière.
Portrait de la princesse Anna Vasa (1568-1625), staroste de Brodnica par Sofonisba Anguissola, vers 1605, Collection particulière.
Miniature du prince Ladislas Sigismond Vasa par Sofonisba Anguissola, vers 1605, Collection de peintures de l'État de Bavière.
Portrait de Sigismond III Vasa en armure par Domenico Tintoretto
« L'imago sera gratiosissima pour le roi. Le roi Son Altesse attend les peintures avec une grande joie : une chose étrange comme il aime quand il a quelque chose de merveilleux » (Imago będzie Królowi gratiosissima. Obrazów król Jmć czeka z wielką radością: dziwna rzecz jako się w nich kocha kiedy co cudnego ma), révèle dans une lettre du 12 juillet 1588 écrit à Stanisław Reszka (1544-1600), qui était à Rome, jésuite Bernard Gołyński (1546-1599) au sujet des peintures commandées par Sigismond III Vasa en Italie.
Sigismond était aussi un peintre et un orfèvre de talent. Selon l'historien Franciszek Siarczyński (1758-1829) dans son « L'image de l'ère de Sigismond III » (Obraz wieku panowania Zygmunta III), le roi avec l'aide de son orfèvre de cour, un Vénitien Redutti (Reduta, Redura) fabriqué de nombreux ustensiles d'église, tels que des ostensoirs, des calices, des lampes et des chandeliers, qu'il a donnés à plusieurs églises. Dans la collection de l'Alte Pinakothek de Munich, il y a un tableau qui, selon Edward Rastawiecki dans son « Dictionnaire des peintres polonais » (Słownik malarzów polskich, pp. 96-97) est « un autre ouvrage de ce genre » et il a été donné à fille du roi Anna Catherine Constance Vasa, « au dos, les inscriptions et les sceaux conservés confirment l'origine et l'authenticité de cet intéressant souvenir ». Cette œuvre est cependant répertoriée dans la « Description de la galerie des tableaux électorales à Schleissheim » de Johann Nepomuck Edler von Weizenfeld de 1775 comme l'œuvre du Tintoret (Jacopo Robusti, 1518-1594). Stylistiquement cette oeuvre est très proche de ce peintre vénitien et de son fils Domenico (1560-1635). Le monarque avec la chaîne de l'Ordre de la Toison d'or est très semblable à celui visible dans l'étude pour un portrait de roi, très probablement Sigismond III Vasa, dans la collection de Francis Springell, attribuée à Pierre Paul Rubens, et à l'effigie de Sigismond dans la Procession avec Saint-Aignan par le cercle de Tommaso Dolabella dans l'église Corpus Christi de Cracovie. Au fond, parmi les colonnades, il y a une statue de la Vierge à l'Enfant, et dans les nuages la figure qui est interprétée comme saint Sigismond, patron des monarques. L'hérésie, dépeinte comme une vieille femme, gît enchaînée sur les marches de l'église. À droite, deux jésuites. Saint Sigismond a également une chaîne de l'Ordre de la Toison d'or et il ressemble fortement au beau-père de Sigismond III, l'archiduc Charles II d'Autriche (1540-1590), fils d'Anna Jagellon. Sa couronne est bordée d'hermine comme le chapeau archiducal (couronne). Curieusement aussi la couronne du monarque principal est bordée d'hermine. C'est peut-être l'erreur du peintre ou que Sigismond III a commandé une effigie de son beau-frère Ferdinand II (1578-1637) qui a été élevé par les jésuites et s'est occupé de l'hérésie dans son pays avant de devenir empereur en 1619. Sigismond III a reçu l'Ordre de la Toison d'or de son beau-frère le roi Philippe III d'Espagne en 1600. A cette occasion, il a commandé un service de table en argent à Augsbourg pour 20 000 florins. Le service, créé par Hermann Plixen, a été utilisé pour la première fois lors d'un banquet au château de Varsovie le 25 février 1601. Le roi a également commandé d'autres objets exquis à Augsbourg, comme le sarcophage en argent de saint Stanislas pour la cathédrale de Wawel à Cracovie, et dans d'autres endroits. Par l'intermédiaire de son agent en Perse, Sefer Muratowicz, il commanda une série de kilims avec ses armoiries en 1601 et vers 1611-1615 il acheta une série de 6 tapisseries dans l'atelier de François Spierincx à Delft avec l'Histoire de Diane. Le 29 octobre 1621, Jan Brueghel l'Ancien écrivit à E. Bianchi au sujet de l'envoi de plusieurs tableaux au roi (molti pitture al Re) et la « Bataille de Kircholm en 1605 » par Pieter Snayers, également créée pour Sigismond, se trouve aujourd'hui au Château de Sassenage. A Milan, vers 1600, il commande un lavabo en cristal (aiguière et bassin) avec ses armoiries et son monogramme (Trésor de la Résidence de Munich) et très probablement le casque shishak offert à Feodor Ier de Russie (Musée du Kremlin), créé avant 1591. Ses portraits au Germanisches Nationalmuseum de Nuremberg, perdus pendant la Seconde Guerre mondiale, et au palais de Wilanów à Varsovie le représentent dans une riche armure bleue ciselée, partiellement dorée et polychromée dans le type de mezza armatura (demi-armure), probablement fabriqué à Milan. Portrait d'homme en armure gravée d'or par Domenico Tintoretto de provenance inconnue (vendu en 2016 chez Christie's, lot 163), a des dimensions presque identiques à l'effigie de la sœur de Sigismond III Anna Vasa par Domenico Tintoretto au musée Isabella Stewart Gardner (115,3 x 96,1 cm / 115,5 x 96,7 cm). Il est possible qu'ils aient été créés en même temps. L'homme ressemble beaucoup aux effigies de Sigismond III Vasa du début du XVIIe siècle, en particulier son portrait peint à Prague vers 1605 par le peintre de la cour de l'empereur Rodolphe II, Joseph Heintz l'Ancien (Alte Pinakothek à Munich). Le roi était représenté dans une armure gravée similaire dans L'Habiti Antichi Et Moderni di tutto il Mondo ... de Cesare Vecellio (Rè di Polonia / Poloniæ Rex, p. 346), publié à Venise en 1598 (Bibliothèque Czartoryski à Cracovie).
Portrait de Sigismond III Vasa en armure gravée d'or par Domenico Tintoretto, vers 1592-1600, Collection privée.
Allégorie de la suppression de l'hérésie par Domenico Tintoretto, 1600-1619, Alte Pinakothek à Munich.
Portrait de Sigismond III Vasa en saint Sigismond par l'atelier de Domenico Tintoretto
Vers 1600, très probablement le peintre italien Ottavio Zanuoli (décédé en 1607), a créé un tableau représentant la Communion de la Vierge, aujourd'hui au couvent royal de Las Descalzas Reales à Madrid. Zanuoli était un peintre de la cour de l'archiduc Charles de Styrie (fils d'Anna Jagellon) et de son épouse l'archiduchesse Marie-Anne de Bavière (petite-fille d'Anna Jagellon). D'après la liste manuscrite de toutes les effigies apposée au dos de la toile, le tableau représente la famille de l'archiduc Charles, représenté sous les traits de saint Jean l'Apôtre donnant la communion à la Vierge. Son fils Charles d'Autriche (1590-1624), prince-évêque de Wrocław depuis 1608, tient une cruche en diacre de la messe. Derrière l'archiduchesse Marie-Anne, représentée comme la Vierge Marie, se trouvent ses filles dont Anna (1573-1598) et Constance (1588-1631), deux épouses de Sigismond III Vasa. Le tableau était sans aucun doute un cadeau à Marguerite d'Autriche (1584-1611), fille de Charles et de Marie, qui épousa le 18 avril 1599 le roi Philippe III d'Espagne, son cousin germain. Margaret est devenue une figure très influente à la cour de son mari et une grande mécène des arts.
Le couvent royal de Madrid regorge de telles effigies déguisées des Habsbourg. L'une des plus anciennes est une fresque de la chapelle de Marie-Madeleine (Capilla de la Magdalena, numéro d'inventaire PN 00610451). Dans cette composition d'un peintre inconnu et inspirée de la Vierge au poisson (Virgen del pez) de Raphaël (Musée du Prado), la Madone présente les traits de l'Infante Juana de Austria (Jeanne d'Autriche, 1535-1573), fondatrice du couvent. Viennent ensuite les portraits de l'empereur Maximilien II (1527-1576) en saint Valère de Trèves (PN 00615942) et de l'archiduc Rodolphe d'Autriche (1552-1612), futur empereur, en saint Victor (PN 00615941) et les portraits de quatre filles de l'archiduc Charles de Styrie dans la Salle des Rois (Salón de Reyes) - Anna (1573-1598) en sainte Dorothée, Marie-Christine (1574-1621) en sainte Lucie, Catherine-Renée (1576-1599) en sainte Catherine et Élisabeth (1577-1586) en sainte Agnès. Tous ont probablement été peints en 1582 par Giacomo de Monte (Jakob de Monte) - par exemple le portrait de l'archiduchesse Catherine-Renée représentée avec les attributs de sainte Catherine d'Alexandrie (la roue dentée et l'épée) porte l'inscription suivante en allemand : « 1582, Catherine-Renée, archiduchesse d'Autriche, à l'âge de 6 ans et 8 mois » (1582 / KATERINA RENNEA / ERTZHERTZOGIN ZV / OSTEREICH . IRHES ALTER VI / IAR . VIII MONNET). L'archiduchesse Anna, future reine de Pologne et première épouse de Sigismond III, possède les attributs de sainte Dorothée de Césarée (couronne et panier de roses, PN 00612064) (comparer « Linaje regio y monacal ... » d'Ana García Sainz et Leticia Ruiz, p. 146, 148, 150-151 et « Joyas del siglo XVI en seis retratos infantiles ... » de Natalia Horcajo Palomero, p. 398-399). En 1603, la reine d'Espagne a commandé des peintures à son oratoire privé du palais de Valladolid, peintes par Juan Pantoja de La Cruz, aujourd'hui au musée du Prado à Madrid. L'une, la Naissance de la Vierge montre trois de ses sœurs, ainsi que leur mère, l'archiduchesse Marie-Anne de Bavière, l'autre, la Nativité de Jésus, montre trois de ses frères et trois de ses sœurs, la reine en Vierge Marie et son mari comme berger. Vers 1620, la plus jeune des filles de Charles et Marie-Anne, Marie-Madeleine, qui épousa le 19 octobre 1608 Cosme II de Médicis, grand-duc de Toscane, était représentée en sainte Marie-Madeleine dans un tableau de Justus Sustermans, conservé au Palazzo Pitti à Florence, et dans un exemplaire d'atelier en collection privée. De telles effigies, déguisées en saints et personnages bibliques, étaient également populaires à la cour royale polono-lituanienne à cette époque. La Communion des Jagellons à Jasna Góra en 1477 (Casimir IV Jagellon avec ses fils admis à la Confrérie de Jasna Góra), créée par l'atelier du peintre vénitien Tommaso Dolabella dans le deuxième quart du XVIIe siècle (Monastère de Jasna Góra), montre le roi Sigismond III et ses fils comme leurs prédécesseurs de la dynastie Jagiellon s'agenouillant devant la Vierge noire de Częstochowa. Dans le monastère de Jasna Góra, il y a aussi deux autres peintures créées par l'atelier de Tommaso Dolabella représentant les saints Étienne et Ladislas, rois de Hongrie, toutes deux portant les traits du roi Sigismond III Vasa et un costume connu d'autres portraits du roi. Une peinture de l'atelier de Domenico Tintoretto, également attribuée à son frère Marco, que le testament paternel nomme peintre dans l'atelier de Domenico, provenant d'une collection privée du sud de l'Allemagne (huile sur toile, 113 x 89 cm, vendue à Lempertz, Cologne en mai 2003, lot 1133), d'après certains détails du tableau est identifié comme représentant saint Louis IX, roi de France, agenouillé devant le crucifix. Les symboles traditionnels de ce Saint sont bien visibles dans le tableau, fleur de lys sur son manteau, pendentif, couronne et sceptre, cependant il y a aussi une couronne brodée sur son manteau et la tenue n'est pas bleue comme dans les armoiries royales françaises, fleur de lys dorée sur champ bleu, utilisée sans interruption pendant près de six siècles (1211-1792). Les peintres italiens depuis le début du XVIe siècle savaient bien à quoi devait ressembler le roi de France et les peintures d'Ambrogio Bergognone, actif à Milan et dans les environs, créées entre 1500 et 1520 (Accademia Carrara à Bergame), par Berto di Giovanni, actif à Pérouse, créée vers 1517 (Galleria Nazionale dell'Umbria), par Francesco Curradi, actif à Florence, créée vers 1600 (collection privée) et Matteo Rosselli, actif à Florence, peint entre 1613-1614 (Chiesa della Madonna à Livourne), représentent le saint dans un manteau de monarques français avec des fleurs de lys dorées sur fond bleu. Le saint du tableau du Tintoret n'est donc pas saint Louis IX. Un autre saint monarque lié à la France est saint Sigismond (latin Sigismundus, mort en 524 après JC), roi des Bourguignons, saint patron des monarques et du royaume de Bohême (en 1366, Charles IV, empereur romain germanique, transféra les reliques de Sigismond à Prague et donna le nom du saint à l'un de ses fils, le futur roi Sigismond de Hongrie). Le bras reliquaire de saint Sigismond provenant du trésor de Guelph, créé à la fin du XIe siècle (Musée des Arts décoratifs de Berlin), fut à la fin du XIIIe ou au début du XIVe siècle complété d'un orbe surmonté d'une fleur de lys, représentation abrégée d'un sceptre couronné de lys. La peinture d'autel avec saint Sigismond dans l'église paroissiale de Słomczyn près de Varsovie (Konstancin-Jeziorna), créée vers 1895 d'après un original perdu, est très similaire à la peinture de l'atelier de Domenico Tintoretto. Le saint est agenouillé devant le Crucifix, sa couronne et son sceptre sont sur une table recouverte de tissu cramoisi, son manteau et son pendentif en or ressemblent également beaucoup le saint peint par Tintoretto. Un autre tableau de la même église de la férétoire du XIXe siècle représente saint Sigismond vêtu d'une tunique dorée similaire et agenouillé devant l'autel. L'église de Słomczyn a été fondée au début du XVe siècle par Mrościsław Cieciszewski et le principal patron de la paroisse dès le début était saint Sigismond. Pendant le déluge (1655-1660) l'église fut pillée et les envahisseurs détruisirent les autels. En 1165, Werner, évêque de Płock (au nord de Varsovie), apporta les reliques de saint Sigismond d'Aix-la-Chapelle. En 1370, le roi Casimir III le Grand a commandé un reliquaire en argent pour le saint, aujourd'hui au musée diocésain de Płock, et en 1601, le roi Sigismond III Vasa a ordonné que le diadème du XIIIe siècle soit placé sur le reliquaire de son saint patron. Sigismond III était fréquemment représenté dans une tenue de type żupan similaire à celle visible dans la peinture de Tintoretto, par exemple dans la Communion des Jagiellons mentionnée, dans une autre peinture du cercle de Tommaso Dolabella représentant le tsar de Moscovie Vassili Chouiski prêtant serment d'allégeance à la Parlement de la République polono-lituanienne en 1611 (Musée historique de Lviv) et dans la plaque de son sarcophage avec les campagnes militaires du roi, créée en 1632 (Cathédrale de Wawel). L'homme du tableau de Tintoretto ressemble au portrait de Sigismond III Vasa en armure gravée d'or par le même peintre, réalisé entre 1592-1600 (collection privée), son effigie à la bataille de Smolensk par Antonio Tempesta ou Tommaso Dolabella, peint après 1611 (collection privée) et son profil sur une pièce d'or de 10 ducats (portuguez), frappée par Rudolf Lehman à Poznań en 1600 (Musée national de Cracovie). La composition d'ensemble ressemble au portrait de Piotr Skarga (1536-1612), prédicateur de la cour de Sigismond III, réalisé en 1588 par Karel van Mallery (Bibliothèque nationale d'Espagne à Madrid). La peinture de l'atelier de Domenico Tintoretto faisait partie de la collection du sud de l'Allemagne, exactement comme Allégorie de la suppression de l'hérésie par ce peintre de la collection de la fille de Sigismond III (Alte Pinakothek à Munich). Le roi envoyait souvent des cadeaux à Guillaume V, duc de Bavière, comme le reliquaire des saints Jean-Baptiste et Denys l'Aréopagite, offert en 1614 (Trésor de la Résidence de Munich) ou la statue en argent de saint Bennon de Meissen offerte à l'autel de saint Bennon dans la cathédrale de Munich, créée par Jeremias Sibenbürger en 1625 à Augsbourg (Musée diocésain de Freising). En plus de la statue de saint Bennon, le roi a également fait don de deux reliquaires en argent en forme de main (non conservés) et de 10 000 florins pour célébrer la messe quotidienne, dite messe polonaise, dans la cathédrale.
Portrait du roi Sigismond III Vasa en saint Sigismond agenouillé devant le crucifix par l'atelier de Domenico Tintoretto, 1592-1600, Collection privée.
Portraits du duc Joachim-Frédéric par des peintres flamands
Pendant le mandat d'Andreas Jerin (1585-1596) en tant qu'évêque de Wrocław, la contre-réforme a commencé en Silésie. La pression du catholicisme militant s'est également fait sentir dans le duché de Brzeg, lorsque, entre autres, le commandant des Joannites à Oleśnica Mała près d'Oława a retiré les pasteurs luthériens de ses domaines (1589), tandis que la tentative d'intervention de Joachim-Frédéric est devenue vaine (après « Brzeg : dzieje, gospodarka, kultura » par Władysław Dziewulski, p. 59).
Joachim-Frédéric de Brzeg s'est inspiré de son père Georges II (1523-1586), mais il était un meilleur administrateur que lui. Il a confirmé les anciens privilèges de la ville et soutenu l'artisanat. Le château d'Oława a été reconstruit et agrandi pour Joachim-Frédéric dans les années 1587-1600 par l'architecte italien Bernard Niuron de Lugano. Grâce à ses relations familiales avec la cour impériale de Prague et la cour de Berlin, il obtint plusieurs postes honorifiques. Depuis 1585, il était prévôt luthérien du chapitre de Magdebourg et, en 1588, il fut nommé commandant général de l'armée régulière de Silésie. Après la mort de son frère Jean Georges, décédé sans issue en 1592, Joachim-Frédéric hérite de Wołów et après la mort de sa mère et de son cousin Frédéric IV de Legnica (1552-1596), il devient le seul duc de Legnica-Brzeg-Oława -Wołów (Liegnitz-Brieg-Ohlau-Wohlau en allemand). Joachim Frederick a acquis une grande popularité pour sa douceur et sa diligence. Il aimait la science et il essaya d'améliorer l'administration de la justice en 1599. Comme il occupait le premier rang parmi les princes silésiens, de 1592 jusqu'à sa mort, il dut s'occuper de l'aide à l'empereur, qui était en guerre avec les Turcs. En 1599, le duc et son beau-frère, Charles II de Ziębice-Oleśnica, refusèrent de participer à l'élection de l'évêque Paul Albert car il n'était pas silésien et il acquit de Peter Wok von Rosenberg les villes de Złoty Stok (Reichenstein) et Srebrna Góra (Silberberg), riches en mines d'or et d'argent. Joachim Frederick est décédé le 25 mars 1602 à Brzeg. L'homme du portrait du Musée national de Poznań (huile sur panneau, 47 x 38 cm, numéro d'inventaire Mo 855) ressemble à l'homme du portrait du Kunsthistorisches Museum de Vienne (numéro d'inventaire GG 808). De nombreuses peintures splendides qui ornaient autrefois les murs du Wawel silésien - le château de Piast à Brzeg et qui ont survécu au bombardement de 1741, lorsque le château a été détruit par les forces prussiennes lors de la première guerre de Silésie, ont été déplacées à Berlin. Peut-être aussi cette peinture. L'image de Poznań a été acquise en 1930 auprès de la collection privée de Karl von Wesendonk à Berlin. Les deux peintures, à Poznań et à Vienne, sont attribuées à Adriaen Thomasz. Key, cependant, l'homme de la version Poznań est beaucoup plus âgé. S'il avait environ 25 ans lorsque le tableau de Vienne a été créé vers 1575, alors la version de Poznań devrait être datée d'environ 1600, ce qui exclut la paternité de Key, car il est mort en 1589 ou après. Le centre d'art et d'artisanat le plus important de cette partie de l'Europe à cette époque était la cour impériale de l'empereur Rodolphe II à Prague. De nombreux artistes flamands ont travaillé pour l'empereur et deux d'entre eux ont créé des portraits très similaires de Rodolphe. L'une aux yeux bleu clair, en buste, portant une cuirasse (vendue chez Christie's, le 27 janvier 2010, lot 344), est attribuée à l'entourage de Frans Pourbus le Jeune (1569-1622), peintre flamand d'Anvers, qui à la fin du XVIe siècle travailla pour l'archiduc Albert et l'infante Isabelle à Bruxelles. L'autre aux yeux plus foncés, attribuée à Lucas van Valckenborch (mort en 1597) de Louvain, se trouve aujourd'hui dans la collection des princes du Liechtenstein à Vienne (numéro d'inventaire GE 2484). Le style du tableau à Poznań ressemble à celui de Pourbus, en particulier le portrait d'un homme au Musée des Beaux-Arts de Budapest (numéro d'inventaire 5862). Le même homme a été représenté dans un autre tableau créé vers 1600, dans lequel cependant son visage ressemble davantage au portrait de Varsovie de 1574 (numéro d'inventaire M.Ob.819 MNW). Son serviteur lui donne une coupe de vin. Ce tableau intitulé parfois « Deux fous », à cause de la tenue extravagante du vieil homme, ou « L'empereur Rodolphe II prenant la cure », se trouve aujourd'hui au Kunsthistorisches Museum de Vienne (huile sur toile, 175,5 x 109 cm, numéro d'inventaire GG 2773, vérifiable au dépôt de la galerie en 1868). Il a été attribué à Pieter Isaacsz (décédé en 1625), cercle de Cornelis Ketel (1548-1616) ou à Lucas van Valckenborch. La comparaison avec le tableau du Musée de Silésie à Opava (numéro d'inventaire In 2036 A), qui a été créé par Valckenborch, très probablement avec son assistant ou seulement par lui - Georg Flegel (1566-1638) est la plus adéquate. Dans sa seule effigie peinte connue à ce jour d'une fresque de Balthasar Latomus, le peintre de la cour de Georges II, dans le cabinet ducal du château de Brzeg, peinte en 1583-1584, Joachim-Frédéric était représenté dans un pourpoint rayé rouge-brun, tandis que son père porte une tenue noire. Le duc de Brzeg porte également une fraise et de lourdes chaînes en or avec un médaillon, comme dans le tableau décrit de Valckenborch ou Flegel à Vienne. L'homme d'une grande médaille d'or, très probablement frappée de l'or de Złoty Stok, ressemble le plus à Georges le Pieux (1484-1543), margrave de Brandebourg-Ansbach. Georges, fils de Sophie Jagellon, était un des premiers adhérents du protestantisme. Il entretint une correspondance avec Martin Luther et introduisit la Réforme dans ses possessions silésiennes - Krnov, Bytom, Racibórz et Opole, l'un des plus grands centres de tissage silésien. Son fils Georges-Frédéric (1539-1603), qui à partir de 1577 était également administrateur du duché de Prusse, entretenait de bonnes relations avec la Pologne-Lituanie. Il a frappé des pièces avec la devise officielle de la République polono-lituanienne : « Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous ? » (Guldentaler, 1586, Königsberg), son monument funéraire du monastère de Heilsbronn, attribué à Endres Dietrich Seidensticker, est orné des armoiries de la Pologne (Aigle blanc), répétées trois fois (d'après « Kloster Heilsbronn... » par Graf Rudolph Stillfried-Alcántara, p. 163) et son portrait au Musée national de Wrocław a été réalisé par le peintre silésien Andreas Riehl le Jeune de Wrocław. Le portrait de Georges-Frédéric a été créé en 1601 et il porte une médaille du roi Étienne Bathory avec l'inscription en latin STEFANVS. REX. POLONIA. 1581 (d'après « Portret na Śląsku ...» d'Ewa Houszka, p. 12). En 1571, le régent de Prusse commande également une série de portraits de son père Georges le Pieux à l'atelier de Lucas Cranach le Jeune (deux sont au pavillon de chasse Grunewald à Berlin, GKI1192 et GKI1048) et pour sa femme Élisabeth de Brandebourg-Küstrin (1540-1578), décédé alors qu'elle séjournait à la cour de Varsovie, où Georges-Frédéric devait se voir attribuer le duché par le roi de Pologne, il chargea le sculpteur néerlandais Willem van den Blocke de construire le monument à la cathédrale de Königsberg, qui a été achevée en 1582. Ses terres silésiennes étaient proches de Brzeg et Legnica, de sorte que le margrave, qui est resté principalement à Ansbach, a confié à Georges II de Brzeg la mise en œuvre des nouvelles lois dans son domaine de Krnov. Le buste d'un homme barbu dans la médaille d'or mentionnée dans le portrait de Vienne ressemble aux portraits de Georges le Pieux par Cranach le Jeune et la médaille de 1534 avec son buste au Germanisches Nationalmuseum de Nuremberg. Joachim-Frédéric, luthérien et le plus important des princes silésiens, frappait des pièces à Złoty Stok, comme le ducat d'or de 1602 (Musée national de Varsovie, NPO 350 MNW). C'est donc lui qui a très probablement commandé à la fois la médaille et le portrait dans l'atelier du peintre flamand. En 1582, 41 représentations de guerres hollandaises peintes sur toile furent achetées par la mairie de Brzeg (d'après « Op Nederlandse manier... » de Mateusz Kapustka, p. 35), indiquant que l'art hollandais était fortement représenté dans ses domaines.
Portrait de Joachim-Frédéric (1550-1602), duc de Legnica-Brzeg-Oława-Wołów par l'entourage de Frans Pourbus le Jeune, 1597-1602, Musée national de Poznań.
Portrait de Joachim-Frédéric (1550-1602), duc de Legnica-Brzeg-Oława-Wołów avec médaille d'or avec buste du margrave Georges le Pieux par Lucas van Valckenborch ou Georg Flegel, 1597-1602, Kunsthistorisches Museum de Vienne.
Portrait de Janusz Ier Radziwill par Leandro Bassano
« Le seigneur polonais, à la cour duquel Michelagnolo était déjà employé, a récemment écrit qu'il devait s'y rendre le plus tôt possible, lui offrant une position des plus honorables, c'est-à-dire une place à sa table, habillé comme les premiers gentilshommes de sa cour, deux serviteurs, qui le serviront, et une voiture à quatre chevaux, et plus de 200 ducats hongrois de rente annuelle, soit environ 300 écus, hors dons, ce qui sera beaucoup ; de sorte qu'il est résolu à partir le plus tôt possible, ni n'attend autre chose que l'occasion d'une bonne compagnie, et je crois qu'il partira dans quinze jours, donc je dois l'arranger avec de l'argent pour le voyage, et en plus il faut qu'il apporte avec lui à la demande de son Seigneur certaines choses, pour lesquelles parmi la provision pour un voyage et lesdites choses, je ne peux manquer de loger au moins 200 écus » (Signor Pollacco, a presso di chi è stato Michelagnolo, ha ultimamente scritto, che ei deva quanto prima andare là da lui, offerendoli partito honoratissimo, cioè la sua tavola, vestito al pari dei primi gentil' homini di sua corte, due servitori, che lo servino, et una carrozza da quattro cavalli, et di più 200 ducati ungari di provvisione l'anno, che sono circa 300 scudi, oltre ai donativi, che saranno assai; tal che lui è risoluto di andar via quanto prima, nè aspetta altro che l'occasione di buona compagnia, et credo che tra quindici giorni partirà, onde a me bisogna di accomodarlo di danari per il viaggio, et in oltre bisogna che porti seco ad instanza del suo Signore alcune robe, che tra 'l viatico et le dette robe non posso far di manco di non l'accomodare almeno di 200 scudi), a informé sa mère dans une lettre de Padoue en République de Venise du 7 août 1600 (Mss. Palatini, Parte I, Vol. IV, pag. 11.), Galileo Galilei (Galilée), célèbre astronome, physicien et ingénieur italien.
Déjà en 1593, Michelagnolo Galilei (1575-1631), compositeur et luthiste italien, fils d'un autre compositeur et luthiste, Vincenzo Galilei, et frère cadet de Galileo, se rendit dans la République polono-lituanienne, où les musiciens étrangers étaient très demandés. Très probablement invité par l'influente famille Radziwill, il y resta jusqu'en 1599 et retourna chez son ancien employeur en Pologne-Lituanie en 1600 après un court séjour en Italie. Le « Seigneur polonais », parton de Michelagnolo, est parfois identifié comme étant Christophe Nicolas Radziwill (1547-1603) surnommé « la Foudre », voïvode de Vilnius, Grand Hetman de Lituanie et représentant de la branche de Birzai de la famille des magnats lituaniens (d'après « Galileo Galilei e il mondo polacco » de Bronisław Biliński, p. 69), qui employait plusieurs musiciens à sa cour. Christophe Nicolas était un fils de Nicolas « le Rouge » Radziwill (frère de la reine Barbara), un calviniste et protecteur des calvinistes en Pologne-Lituanie. De sa seconde épouse Katarzyna Ostrogska (1560-1579), fille de Zofia Tarnowska (1534-1570), il eut un fils Janusz I (1579-1620), éduqué à Strasbourg et à Bâle. Janusz a également voyagé en Allemagne, Bohême, Autriche, Hongrie et en France. À partir de 1599, il fut échanson de la Lituanie et le 1er octobre 1600, il épousa la princesse orthodoxe Sophie Olelkovich-Sloutska (1585-1612), l'héritière de Sloutsk et de Kopyl (dans l'actuelle Biélorussie) et la mariée la plus riche de Lituanie. Sophie, canonisée par l'Église orthodoxe en 1983, mourut en couches le 19 mars 1612, laissant tous ses biens à son mari, et quelques mois plus tard, le 27 mars 1613 à Berlin, Janusz épousa Élisabeth Sophie de Brandebourg (1589 -1629), une fille de l'électeur de Brandebourg Jean Georges (1525-1598) et une arrière-petite-fille de Barbara Jagellon (1478-1534), duchesse de Saxe. Il est possible que Michelagnolo ait été invité à la République pour le festin de mariage de Janusz et Sophie. Selon une lettre de Galilée de Padoue du 20 novembre 1601 à son frère à Vilnius, il s'est également rendu à Cracovie et à Lublin. En avril 1606, il retourna en Italie pour vivre avec son frère à Padoue. Le 11 mai 1606, Galilée lui écrivit de Venise de négocier avec un seigneur allemand (Signore tedesco) et il lui obtint une place à la cour de l'électeur bavarois à Munich. En 1608, Michelagnolo épousa Chiara Anna Bandinelli en Bavière, qu'il rencontra probablement en Lituanie et qui était la sœur ou la fille de Roberto Bandinelli, neveu du célèbre sculpteur florentin Bartolommeo dit Baccio, qui s'installa avec sa famille en Lituanie (d'après « Archivio storico italiano », Volume 17, p. 31). Selon le catalogue de l'exposition de portraits à La Haye en 1903 (Meisterwerke der Porträtmalerei auf der Ausstellung im Haag, p. 2, point 2a), dans la collection de la princesse Cecylia Lubomirska née Zamoyska (1831-1904) à Cracovie, il y avait un portrait d'un joueur de luth par Leandro Bassano. Il appartenait plus tard au fils de Cecylia, Kazimierz Lubomirski (1869-1930), probablement perdu pendant la Seconde Guerre mondiale. Un jeune homme avec plusieurs bagues à la main gauche joue une sérénade sur un luth à sa bien-aimée. Il est écouté par son chien, symbole conventionnel de la fidélité, notamment conjugale, portant un collier coûteux, portant éventuellement son blason. La fenêtre en arrière-plan montre sa maison, une villa de style italien semblable aux pavillons du palais Radziwill à Vilnius, le plus grand palais de la branche calviniste de la famille. Le palais Radziwill, initialement un manoir Renaissance construit au XVIe siècle, a été reconstruit et agrandi entre 1635 et 1653 pour Janusz II Radziwill (1612-1655), neveu de Janusz I (1579-1620). Le somptueux édifice a été construit par Jan Ullrich et Wilhelm Pohl selon la conception de l'architecte italien, très probablement Constantino Tencalla, et a été représenté en 1653 sur la médaille de Sebastian Dadler, frappée à l'occasion de l'inauguration de Janusz II en tant que voïvode de Vilnius. Le joueur de luth de la collection Lubomirski a été signé et daté par l'artiste. L'inscription en latin indiquait que l'homme représenté avait 21 ans en 1600 (Anno aetatis suae XXI, MDC), exactement comme Janusz I Radziwill (né en juillet 1579 à Vilnius), lorsqu'il épousa Sophie Olelkovich-Sloutska. Le modèle ressemble beaucoup à d'autres effigies du prince, en particulier une estampe de Jan van der Heyden d'après Jacob van der Heyden, créée en 1609 (Herzog Anton Ulrich-Museum), un portrait d'un artiste inconnu (Musée historique d'État de Moscou) et une médaille avec son buste, publiée à Berlin dans « Médailles de la maison princière de Radziwill » (Denkmünzen des Radziwillschen Fürstenhauses, 1846). On croit généralement que le joueur de luth de Bassano équivaut à un tableau acquis à Venise par le comte Stanisław Kostka Potocki (1755-1821), qui rappelle dans une lettre à sa femme du 22 septembre 1785 de Venise : « je finis mon article de Venise, par te dire que j'ai fait l'aquisition d'un des plus frais tablaux de Paule Véronèse que la aie jamais vue, c'est une St. Famille de la grandeur à peu près de ton Rubens, j'espère que la en sera contente, ajoute ici un portrait du Bassen jouant du luth peint par lui meme qui est vraiment un chef d'œuvre de ce maître, et tu sera contente de moi » (Archives centrales de documents historiques à Varsovie, 262 t. 1, page 60). La Sainte Famille de Véronèse se trouve aujourd'hui très probablement au palais de Wilanów (numéro d'inventaire Wil.1000, également considéré comme le tableau acheté à Paris en 1808) et est actuellement attribuée à son frère Benedetto Caliari. Même si le joueur de luth de la collection Lubomirski a été acquis par Potocki à Venise, il n'exclut pas qu'il représente une personne de la République polono-lituanienne, car les peintures commandées à l'étranger étaient fréquemment créées en série, comme cadeaux à des parents et amis. Dans ce cas, la possibilité qu'il s'agisse d'un cadeau au frère du tuteur, Galileo Galilei, ou à sa famille est probable. Si Michelagnolo était un musicien de la cour de Christophe Nicolas « la Foudre », il pourrait enseigner la musique à son fils Janusz I. « Il était d'usage que les commandes des clients polonais à l'étranger soient payées par l'intermédiaire des bureaux des banquiers qui organisaient le transport. Ainsi, l'intermédiaire entre Sigismond III et le chancelier Zamoyski, d'une part, et les peintres italiens, d'autre part, était l'entreprise de la famille Montelupi de Cracovie, dont la poste apportait en Pologne des œuvres finies et payées. Les banquiers de Gdańsk faisaient la médiation entre notre pays et les Pays-Bas, et grâce à leurs efforts, des peintures et des tapisseries commandés par Ladislas IV à Anvers furent transportés par mer à travers le détroit danois » (d'après « Obrazy z kolegiaty łowickiej i ich przypuszczalny twórca » de Władysław Tomkiewicz, p. 119). Dans les années 1620, très probablement après la mort de Leandro Bassano, décédé le 15 avril 1622, un peintre du cercle des frères Bassano s'installe à Pułtusk, un important centre économique de Mazovie. Entre 1624 et 1627, il a créé trois tableaux représentant des scènes de la vie de Marie pour la cathédrale de Łowicz, commandés par Henryk Firlej (1574-1626), archevêque de Gniezno et primat de Pologne, fils de Jan Firlej (1521-1574), et un autoportrait, aujourd'hui au monastère dominicain de Cracovie.
Portrait de Janusz I Radziwill (1579-1620), 21 ans jouant du luth par Leandro Bassano, 1600, collection Lubomirski à Cracovie, perdu.
Portrait de Sebastian Petrycy par le peintre vénitien
Sebastian Petrycy ou Sebastianus Petricius Pilsnanus, est né en 1554 à Pilzno près de Tarnów dans le sud-est de la Pologne en tant que fils de Stanisław (mort après 1590), marchand de vin. En 1583, il obtint son diplôme de philosophie à l'Académie de Cracovie et commença à y donner des conférences. Un an plus tard, en 1584, Sebastian devint membre du Collegium Minus (Collège Mineur) et prit la chaire de poétique et en 1588 il devint professeur de rhétorique.
En février 1589, Petrycy obtint un congé pour se rendre en Italie et étudier dans une université étrangère sélectionnée. Il décide d'étudier à Padoue, où il obtient le diplôme de docteur en sciences médicales au début du mois de mars 1590. De retour à Cracovie, il demanda la reconnaissance de son diplôme à la Faculté de médecine, mais se vit refuser l'admission et partit pour Lviv, où il se maria avec Anna de dix-huit ans (il avait presque quarante ans), déjà enceinte, la fille d'un riche marchand Franz Wenig, et a ouvert son propre cabinet médical. La mort de sa femme (28 février 1596) et de sa fille unique, Zuzanna, ainsi que le procès perdu pour l'héritage de son beau-père, le poussent à retourner à Cracovie (vers 1600). Il devint le médecin personnel de l'évêque de Cracovie Bernard Maciejowski, qui en 1603 fut nommé cardinal par le pape Clément VIII. Entre 1603 et 1604, il se rendit avec le cardinal en France et en Lorraine et en 1606, en tant que médecin de Jerzy Mniszek et de sa fille Marina, il partit pour Moscou, ce qui lui coûta près d'un an et demi de captivité. Au cours de sa carrière à la cour, il a travaillé sur des traductions d'Aristote en polonais. Il est ensuite retourné à la profession médicale et a pratiqué avec succès pendant les 10 dernières années de sa vie. Petrycy mourut en 1626 à Cracovie, et peu de temps avant sa mort, il fonda pour lui-même une épitaphe en marbre le représentant en prière, créée par un sculpteur de la cour royale. Portrait d'un homme barbu tenant des lunettes, provient de la collection de John Rushout, 2e baron Northwick (1770-1859) à Northwick Park. Il était auparavant attribué à Titien et Lotto Lorenzo, mais stylistiquement, il est également proche de Jacopo Tintoretto (1518-1594) et de son fils Domenico (1560-1635). Le costume de l'homme en soie cramoisie ressemble beaucoup au żupan polonais, son manteau est doublé de fourrure. Cette effigie ressemble beaucoup aux portraits de Sebastian Petrycy et de son fils Jan Innocenty Petrycy (1592-1641), qui comme père était médecin, professeur à l'Académie et étudia à Bologne. Les portraits mentionnés se trouvent aujourd'hui au Collegium Maius de l'Université Jagellonne et ont été créés dans les années 1620 par l'atelier de Tommaso Dolabella (1570-1650), un artiste vénitien installé à Cracovie et peintre de la cour du roi Sigismond III Vasa. Il est possible que l'atelier de Dolabella ait copié des portraits familiaux, créés à Venise. Par conséquent, l'effigie peut être datée du début du XVIIe siècle lorsque Petrycy était médecin de la cour à Cracovie.
Portrait de Sebastian Petrycy (1554-1626) tenant des lunettes par le peintre vénitien, peut-être Domenico Tintoret, 1600-1606, Collection privée.
Portrait d'Uriel Górka, évêque de Poznań par Odoardo Fialetti
Le portrait en pied d'Uriel Górka (vers 1435-1498), évêque de Poznań dans le château de Kórnik près de Poznań est l'une des plus anciennes effigies de hiérarques d'église en Pologne. Cette grande peinture sur toile (219 x 111,5 cm, numéro d'inventaire MK 3360) porte une inscription en latin sur une bande au-dessus du personnage : VRIÆL / COMES DE GORCA DEI GRATIA EPISCOPVS POSNANI / ENSIS. La bande, typique des peintures gothiques, ainsi que le style général de l'œuvre suggèrent qu'il s'agit d'une copie du portrait original de l'évêque, car la peinture elle-même est datée de manière variable de la seconde moitié du XVIe siècle ou du milieu de le XVIIème siècle.
L'original peut être de Stanisław de Kórnik, qui fut le peintre de la cour de l'évêque pendant six ans dans les années 1490, mais également commandé à l'étranger. Uriel, le fondateur du pouvoir familial, s'est distingué dans le domaine du mécénat artistique et il était en contact étroit avec les milieux artistiques de Nuremberg. Il commande de l'argenterie à Albrecht Dürer l'Ancien, père du peintre (selon la facture du 26 août 1486 - Item mein her Uriel her bischoff von Poln hat Albrechtn Durer dem goltschmyd silber gebn), il commande diverses oeuvres au sculpteur Simon Leinberger, comme l'excellente composition du Christ au Jardin des Oliviers sculptée en 1490 pour la cathédrale de Poznań, et les pierres tombales en bronze de lui-même et de son père Łukasz (mort en 1475), le voïvode, au célèbre atelier des Vischer (d'après « Kultura, naród, trwanie ... » par Maria Bogucka, p. 164). L'effigie en pied d'Uriel sur sa dalle funéraire par l'atelier des Vischer de la cathédrale de Poznań est comparable à ce portrait. Alors peut-être que l'effigie originale de l'évêque a également été créée à Nuremberg ou qu'il s'agissait d'une peinture de la galerie de portraits d'évêques de Poznań modo chronicae depicta réalisée après 1508, commandée par l'évêque Jan Lubrański au peintre de Cracovie Stanisław Skórka. Le style de la peinture est évidemment vénitien, proche des Bassano et influencé par le Tintoret, mais aucun artiste vénitien n'est confirmé à Poznań et dans les environs à cette époque, donc la peinture doit être une importation, commandée à Venise, comme les portraits des filles de Łukasz Górka (1482-1542). Stylistiquement le plus proche est le portrait du doge Antonio Priuli (1548-1623), régnant de 1618 jusqu'à sa mort, au palais de Kensington (numéro d'inventaire RCIN 407153). La façon dont le visage, les mains et les tissus à motifs dorés ont été peints est très similaire. Le portrait de Priuli était l'un des quatre portraits de doges acquis par Sir Henry Wotton pendant son mandat d'ambassadeur à Venise (1612-1616 et 1619-1621) « fait après la vie par Eduardo Fialetto », selon le testament de Wotton. Les trois autres portraits sont également stylistiquement proches, notamment l'effigie du doge Giovanni Bembo (RCIN 407152). Odoardo Fialetti, né à Bologne en 1573 et initié à la peinture avec le bolonais Giovanni Battista Cremonini, s'installe à Padoue puis à Venise, où il entre dans l'atelier du Tintoret. Il est possible qu'il ait également passé quelque temps à Rome, complétant sa formation. De 1604 à 1612, Fialetti est membre de la Fraternité vénitienne des peintres (Fraglia dei Pittori). Le fondateur le plus probable du tableau est donc Jan Czarnkowski (mort en 1618/19), courtisan royal, l'un des héritiers de la famille Górka après la mort sans enfant du magnat luthérien Stanisław Górka (1538-1592). Czarnkowski a achevé le mausolée de Górka à Kórnik en 1603 et a remis l'église aux catholiques. L'effigie de l'évêque catholique de Poznań, éduqué en Italie, propriétaire du domaine de Kórnik à partir de 1475 qui amena un jardinier d'Italie à Kórnik (d'après « Zamek w Kórniku » de Róża Kąsinowska, p. 17), s'inscrit parfaitement dans les activités de contre-réforme de Czarnkowski. Il a été commandé en Italie peut-être en opposition à l'école de peinture du nord à prédominance protestante.
Portrait d'Uriel Górka (vers 1435-1498), évêque de Poznań par Odoardo Fialetti, vers 1604, Château de Kornik.
Portraits de Constance d'Autriche par Gortzius Geldorp
« Bien que le roi fût jeune, il était plus enclin à la paix qu'à la guerre, et il ne voulait même pas trouver d'emploi dans quoi que ce soit dans le domaine du dieu Mars. J'ai entendu dire qu'une fois, lorsque l'archevêque et le chancelier l'ont informé de la guerre, il écrivit quelque chose dans un pugilares. Ils pensaient qu'il s'inquiétait du sort de la guerre jusqu'à ce que le roi, qui était un bon peintre, orfèvre et tourneur, leur montre une petite chouette peinte », se souvient dans son journal Albert Stanislas Radziwill, Grand Chancelier de Lituanie sur les débuts du règne de Sigismond III Vasa.
Le roi, si hostile à l'oisiveté (tanto inimico dell'ozio), s'occupait dans ses temps libres d'un certain travail artistique, réalisant ses effigies, peintures et autres objets, qu'il offrait en cadeau, comme « celui de qu'il a peint de sa propre main était le portrait de sainte Catherine de Sienne l'an dernier » (una delle quali che fece di sua mano, fu il ritratto di S. Catherina di Siena l'anno passato), dit de Sigismond III un autre témoin contemporain, le nonce apostolique Erminio Valenti (1564-1618), dans une description manuscrite de la Pologne et de la cour royale en 1603 (Relazione del Regno di Polonia). En 1605, le roi épousa sa parente éloignée (en tant que petite-fille d'Anna Jagellon), la sœur de sa première femme et sœur de la reine d'Espagne, Constance d'Autriche (1588-1631). De nombreux invités éminents sont arrivés à Cracovie pour le mariage de Sigismond, la mariée avec sa mère l'archiduchesse Marie-Anne et sa sœur - Marie-Christine, princesse de Transylvanie, Radu Șerban, voïvode de Valachie ou son envoyé, Mechti Kuli Beg, ambassadeur de Perse, Afanasy Ivanovich Vlasiev, ambassadeur de Russie, entre autres. La ville était magnifiquement décorée à l'entrée du cortège nuptial (aigle mécanique polonais, très probablement issu de décorations éphémères, conservé dans l'église Sainte-Marie de Cracovie). De nombreux artistes sont également venus à Cracovie à cette époque. Le soi-disant « rouleau de Stockholm », une peinture unique de quinze mètres de long représentant le cortège nuptial de 1605, acquis pendant le déluge et rendu en Pologne en 1974 (offert au Château royal de Varsovie), est attribué à Balthasar Gebhardt, peintre de l'archiduc Ferdinand (1578-1637), frère de Constance. Parmi les œuvres les plus distinguées attribuées au roi, il y a une peinture à la gouache sur parchemin avec Allégorie de la Foi au Nationalmuseum de Stockholm. Il porte les armoiries du roi, son monogramme S sous la couronne, la date 1616 et le monogramme M.N.D.F.C. Ci-dessous, il y a aussi une signature de l'épouse du roi Constantia Regina. Comme l'effigie d'une femme ressemble à d'autres effigies de la reine, c'est elle qui prête ses traits à la figure. Un autre tableau traditionnellement lié à Sigismond est Mater Dolorosa dans l' Alte Pinakothek de Munich (numéro d'inventaire 5082), peint sur cuivre. Il provient du château Haag à Geldern dans le district de Clèves, en Rhénanie du Nord-Westphalie et faisait très probablement partie de la dot d'Anna Catherine Constance. Le tableau de Sigismond est une copie d'une œuvre de Gortzius Geldorp représentant une femme sainte en adoration signé du monogramme 'GG F', peint sur bois. Crispijn van de Passe l'Ancien a créé une estampe, publiée à Utrecht en 1612, avec une composition similaire, montrant la pénitente Marie-Madeleine (Rijksmuseum Amsterdam, numéro d'inventaire RP-P-1906-2063), qui est cependant plus proche de la peinture de Sigismond alors à la version de Geldorp. La femme dans la peinture de Geldorp a plus de traits du visage des Habsbourg. La même femme avec la lèvre inférieure saillante a été représentée dans deux autres tableaux de Geldorp, l'un signé du monogramme et daté 'AN ° 1605.GG.F.' (vendu en 2015 chez Christie's, Amsterdam, lot 52, l'autre vendu en 2011 chez Christie's, New York, lot 140). Les deux tableaux représentent une dame en Bérénice, épouse du pharaon Ptolémée III Euergète. Bérénice s'est engagée à sacrifier ses cheveux à la déesse Vénus si son mari était ramené en toute sécurité de la bataille pendant la troisième guerre syrienne. Ses cheveux sont devenus la constellation appelée Coma Berenices (les cheveux de Bérénice) et le symbole du pouvoir de l'amour conjugal. On sait très peu de choses sur Gortzius Geldorp. Il est né à Louvain en 1553 dans ce qui était alors les Pays-Bas espagnols et a appris à peindre de Frans Francken I et plus tard de Frans Pourbus l'Ancien. Vers 1576, il devint peintre de la cour du duc de Terra Nova, Carlo d'Aragona Tagliavia (1530-1599), un noble sicilien-espagnol, qui en 1582 fut nommé gouverneur de Milan et qu'il accompagna dans ses voyages. Le duc mourut à Madrid le 23 septembre 1599 et Geldorp mourut après 1619. Il est très possible que lui ou son élève soit venu à Cracovie en 1605. En 1599, Geldorp réalise un portrait d'une jeune femme en costume vénitien (vendu chez Christie's New York, le 12 janvier 1994, lot 134, signé et daté en haut à gauche : Anº.1599./GG.F), semblable aux costumes de dames vénitiennes publiés en 1590 dans De gli habiti antichi, e moderni di diverse parti del mondo libri due par Cesare Vecellio, cousin du peintre Titien (p. 97-112). La même année, il réalise également un portrait d'Hortensia del Prado (Rijksmuseum d'Amsterdam, numéro d'inventaire SK-A-2081, signé et daté en haut à gauche : Anº 1599./GG.F.). Soit le peintre se rendit pour une courte période à Venise ou en Pologne-Lituanie, soit la dame en costume vénitien visita son atelier ou, très probablement, envoya une miniature, un dessin ou autre portrait à copier. La même femme que celle du tableau vendu à New York, portant une robe vénitienne similaire bordée de dentelle, est représentée dans un autre tableau, peut-être une copie ou une variante du tableau de Geldorp. Ce tableau fait également partie d'une collection privée (vendu chez Bonhams Londres, 6 juillet 2005, lot 113). Il est attribué a une peintre active à Bologne Lavinia Fontana (1552-1614).
Portrait de la reine Constance d'Autriche (1588-1631) en Bérénice par Gortzius Geldorp, 1605, Collection particulière.
Portrait de la reine Constance d'Autriche (1588-1631) en Bérénice par Gortzius Geldorp, vers 1605, Collection particulière.
Portrait de la reine Constance d'Autriche (1588-1631) en une sainte en adoration (sainte Constance ?) par Gortzius Geldorp, vers 1616, Collection particulière.
Portrait d'une dame en costume vénitien par Gortzius Geldorp, 1599, Collection particulière.
Portrait d'une dame en costume vénitien par Lavinia Fontana, vers 1599, Collection particulière.
Portrait de la reine Constance d'Autriche en Vénus par Gortzius Geldorp
« A cette époque, le roi Sigismond III de Pologne lui commanda la fable de Diane avec Calisto au bain & autres Poèmes. Elles plut au Roi, qui lui ordonna d'être invité à sa cour avec une digne récompense. Cependant, le peintre habitué à la confort de sa maison, refusa une si belle occasion, y envoyant Tomaso Dolobella, son disciple […] Il peignit aussi pour le même Roi une partie de la fable de Psyché, partagée avec Palma, et l'œuvre d'Antonio lui ayant plu, il commanda alors à lui une toile avec le martyre de sainte Ursule, qu'il exécuta avec une grande diligence, et sur les couvertures il peignit les saints Vladislas, Démétrius et d'autres saints, que le roi entoura d'un culte, et pour ce travail digne, il a été félicité avec des lettres royales et présenté avec quelques cadeaux », commente les oeuvres du peintre gréco-vénitien Antonio Vassilacchi (1556-1629) dit L'Aliense, Carlo Ridolfi dans un livre publié en 1648 présentant l'histoire de la peinture vénitienne (Le Maraviglie dell'arte). Sainte Ursule était probablement destinée à la maîtresse du roi, l'influente Urszula Meyerin, qui était très probablement représentée comme la sainte martyre.
Comme il a été dit, Palma il Giovane (1549-1628) a travaillé avec Vassilacchi sur une partie de la fable de Psyché, et pour la cathédrale de Varsovie, il a créé deux peintures - une avec le Baptême du Christ (tavola di Christo al Giordano), selon Ridolfi, et la Vierge à l'Enfant avec saint Jean-Baptiste et saint Stanislas (détruit en 1944). Selon la lettre de Palma de janvier 1602, Aliense devait commencer les dessins à Salò, mais il devrait ensuite retourner à Venise pour « terminer certains travaux qu'il fait pour le roi de Pologne ». Deux dessins de Palma, l'un représentant Vénus et Psyché (British Museum, numéro d'inventaire 1862,0809.74) et l'autre Cupidon et Psyché (vendu chez Christie's, le 6 juillet 2021, lot 3), pourraient être des dessins préparatoires au cycle de Psyché. Une lettre du trésorier de la Couronne, Jan Firlej (décédé en 1614), adressée au roi Sigismond III Vasa (datée du 29 avril 1599) indique que dans l'une des salles italiennes (« dans les nouveaux bâtiments ») au château de Wawel à Cracovie, décrite comme « la plus heureuse », « les peintures ont été réalisées à Venise ». Les thèmes de ces peintures décorant l'intérieur, ont très probablement été tirés de thèmes érotiques et mythologiques. Ils couvraient les murs et remplissaient les plafonds à caissons dorés de style vénitien. Selon l'inventaire de Wawel de 1665, « des peintures italiennes avec des cadres dorés » se trouvaient dans l'antichambre de la tour du Pied de Poule, des « peintures » italiens décorant « le plafond sculpté avec de l'or » dans la pièce principale et « environ onze peintures italiennes avec cadres dorés ». Dans la salle « sous les oiseaux », selon l'inventaire de 1692, il y avait « quatre tableaux au-dessus de la porte, entre lesquels il y a neuf tableaux au-dessus des lambris, seulement deux avec des cadres dorés... Dans cette salle il y a neuf tableaux au plafond » (d'après « Weneckie zamówienia Zygmunta III » de Jan Białostocki). Le roi possédait sans doute d'autres chambres et studiolo érotiques et italiens dans d'autres résidences royales à Cracovie (Łobzów), Varsovie (Château Royal, Ujazdów), Vilnius, Grodno et Lviv. Le cardinal Ferdinand de Médicis (1549-1609), devenu grand-duc de Toscane en 1587, possédait très probablement un tel studiolo ou camerino dans sa Villa Médicis à Rome, comme le suggère l'auteur du profil Instagram ARTidbits (post publié le 27 juillet 2023). On y trouve un pavillon avec deux salles, considéré comme le plus intime de tout le complexe. Il a été décoré par Jacopo Zucchi de fresques représentant une pergola, des oiseaux, des plantes et des petits animaux. Zucchi est l'auteur de nombreux portraits de la maîtresse du cardinal Clelia Farnèse (1556-1613), marquise de Civitanova. Elle a été représentée comme Amphitrite, la déesse de la mer, et Ferdinand comme son mari Poséidon, ainsi que diverses dames romaines, dans le tableau intitulé Le Royaume d'Amphitrite (Les pêcheurs de corail), qui se trouve maintenant à la Galerie nationale d'art de Lviv (Ж-272, signé et daté en bas à droite : Jacobus Zuchi fior fecci 159[0]). Le tableau provient de la collection Lubomirski, on ne peut donc pas exclure une provenance de la collection royale de Pologne-Lituanie, en tant que cadeau pour Sigismond III ou sa tante Anna Jagellon. De nombreuses copies de ce tableau existent, toutes toutefois sans le portrait déguisé du cardinal. Le grand-duc correspondit avec le roi de Pologne et dans une lettre du 10 septembre 1595, il recommanda même à Sigismond deux de ses musiciens Luca Marenzio et Francesco Rasi. D'après Le vite de' pittori ... de Giovanni Baglione, publié en 1642, une version ornait le studiolo de Ferdinand dans sa résidence romaine, le Palazzo Firenze (d'après « Jacopo Zucchi's The Kingdom of Amphitrite ... » de Federico Giannini, Ilaria Baratta). Clelia, comme le suggère ARTidbits, a également été représentée comme l'une des Trois Grâces, déesses du charme, de la beauté, de la nature, de la créativité humaine et de la fertilité, dans un tableau provenant d'une collection privée à Rome (Casa d'Aste Babuino à Rome, 27 juin 2023, lot 280). Cette dernière effigie ressemble beaucoup à son portrait attribué à Scipione Pulzone du palais Farnèse de Rome (Dorotheum de Vienne, 22 octobre 2019, lot 15). L'énorme popularité des images érotiques et des nus a inquiété certains prédicateurs de la Contre-Réforme. Dans son poème « La Lucrèce romaine et chrétienne », publié à Cracovie vers 1570, l'évêque Jan Dymitr Solikowski (1539-1603), secrétaire du roi Sigismond II Auguste à partir de 1564, exigea que les peintures représentant « les arts éhontés et toutes les vanités de Jupiter, Mars avec Vénus » à brûler et peintres avec, il faut cependant noter que la page de titre de son ouvrage montre une belle gravure sur bois représentant Lucrèce à moitié nue par Mateusz Siebeneicher ou son entourage (Bibliothèque de l'Université de Varsovie). Plus d'un demi-siècle plus tard, en 1629, le prédicateur de la cour de Sigismond III et de Ladislas IV, le dominicain Fabian Birkowski (1566-1636) met en garde contre « ces fornications peintes », très populaires dans la République polono-lituanienne avant le déluge (1655- 1660) : « et pourtant ce poison oculaire se voit partout, plein de ces immondes images dans les chambres à coucher, les salles, les salles à manger, les jardins et les fontaines, au-dessus des portes, sur les verres et les tasses ». Il a également ajouté « et nos hérétiques ont tellement corrompu leurs yeux qu'ils jettent l'image du Christ crucifié hors des chambres à coucher et des pièces, et à sa place ils accrochent des Faunes, et des Amours, Vénus et Fortuna peints au-dessus de la table, afin qu'ils puissent dîner et souper avec eux. [...] Et il n'y a nulle part d'image de la Sainte Vierge; et l'image de la sale Vénus a sa place, et encore mieux à la maison » (d'après « Kazania » de Fabian Birkowski, 1858, Vol. 1-2, p. 81-82). L'aura sombre et remplie de mort de la fin des années 1620 a provoqué la réflexion. À cette époque, la République polono-lituanienne était aux prises avec l'invasion suédoise de la Prusse polonaise, les défaites militaires et les épidémies de peste associées aux mouvements de troupes. Seulement à Gdańsk 9 324 personnes sont mortes pendant l'épidémie de 1629-1630 (d'après « Przeszłość demograficzna Polski », Vol. 17-18, p. 66). En 1630, Mikołaj Wolski (1553-1630), Grand Maréchal de la Couronne, favori et ami de Sigismond III Vasa, mais surtout excellent collectionneur, qui invita en Pologne le peintre italien Venanzio di Subiaco (1579-1659), a ordonné que des peintures érotiques soient brûlées avant sa mort, sauf ceux des plafonds à caissons de style vénitien. Il écrit dans une lettre du 6 mars à Jan Witkowski « que les images ad libidinem [à la luxure] et incitant au péché, que l'on trouve au château de Krzepice, doivent toutes être brûlées ; et celles qui sont peintes nues sur le mur de ma chambre où j'ai dormi et dans ma chambre, je vous en prie, laissez un peintre capable de peindre n'importe quelle robe et laissez-le couvrir les inhonestates [tromperies]. Peintures de plafond, laissez-les rester telles qu'elles sont » (d'après « Zakon Kamedułów ... » par Ludwik Zarewicz, p. 197). Néanmoins, « un mur plein de peintures avec des gens nus » est mentionné dans certains manoirs encore en 1650 (d'après « Miłość staropolska » de Zbigniew Kuchowicz, p. 165). Deux peintures de la Société des amis de l'apprentissage de Poznań, perdues pendant la Seconde Guerre mondiale, montrent à quel point les intérieurs des résidences de la Première République polonaise étaient merveilleux. Selon la tradition, elles représentaient l'intérieur du Palais Leszczyński, très probablement le Palais de Bogusław Leszczyński, Grand Trésorier de la Couronne à Varsovie, construit entre 1650-1654 sur le projet de Giovanni Battista Gisleni. « Portrait d'une femme élégante sous les traits de Vénus » de Gortzius Geldorp (huile sur panneau, 56,6 x 44,1 cm, vendu chez Sotheby's, New York, le 29 janvier 2016, lot 454) est une version du portrait de la reine Constance d'Autriche (1588-1631) comme Bérénice, créée en 1605. Le visage est identique, tandis que la composition ressemble aux portraits de courtisanes vénitiennes de Domenico Tintoretto, notamment la Dame qui découvre sa gorge au Prado (numéro d'inventaire P000382) et le Portrait de femme en Flore au musée de Wiesbaden (numéro d'inventaire M 296), également attribué à la demi-sœur de Domenico, Marietta Robusti. Aussi le style de la peinture aux coups de pinceau audacieux est plus vénitien et tintoresque, il semble que Geldorp ait copié une œuvre de Tintoretto et s'est inspiré de son style. Sa Pénitente Marie-Madeleine au Mauritshuis à La Haye (numéro d'inventaire 319), s'inspire évidemment de la Madeleine de Domenico aux Musées du Capitole à Rome (PC 32), peinte entre 1598 et 1602. Il copie également Violante ou « La Bella Gatta » de Titan (monogrammé en haut à gauche : GG. F., vendu chez Dorotheum à Vienne, le 19 avril 2016, lot 122).
Portrait de la reine Constance d'Autriche (1588-1631) en Vénus par Gortzius Geldorp, après 1605, Collection particulière.
Vénus et Psyché par Palma il Giovane, premier quart du XVIIe siècle, British Museum.
Amour et Psyché par Palma il Giovane, premier quart du XVIIe siècle, Collection particulière.
Mise au tombeau du Christ avec le portrait de Nicolas Christophe Radziwill « l'Orphelin » par Leandro Bassano ou atelier
Le 16 septembre 1582, le prince Nicolas Christophe Radziwill « l'Orphelin » (1549-1616), Grand Maréchal de Lituanie, accompagné d'une dizaine de personnes (amis et serviteurs), partit de son château familial à Niasvij vers Venise d'où 1583, il se rendit en Terre Sainte. A travers la Dalmatie, les îles grecques, Tripoli, Damas, il atteint Jérusalem au milieu de l'année où, dans la basilique du Saint-Sépulcre, il reçoit le titre de chevalier du Saint-Sépulcre. Puis à travers l'Égypte, où il eut l'occasion de voir le célèbre Grand Sphinx, la côte orientale de l'Italie et encore Venise, il retourna dans sa patrie le 7 juillet 1584.
Nicolas Christophe était le fils de Nicolas Radziwill le Noir et d'Elżbieta Szydłowiecka, fille du chancelier Krzysztof Szydłowiecki. Après la mort de son père, à la suite de son séjour à Rome (il visita également Milan, Padoue et Mantoue), il se convertit en 1567 du calvinisme au catholicisme. Atteint de syphilis, en février 1580, il se rend de nouveau en Italie pour se faire soigner, près de Padoue et de Lucques, et passe le tour de 1580-1581 à Venise, avec une tentative de faire une expédition en Terre Sainte. Il a juré que si sa santé s'améliorait, il irait en pèlerinage. Quelques mois seulement après son retour de Terre Sainte, le 24 novembre 1584, il épousa la princesse Elżbieta Eufemia Wiśniowiecka (1569-1596), qui n'avait que 15 ans à l'époque et avait 20 ans de moins que lui, et il eut 6 fils et 3 filles avec elle. En 1593, lui et sa femme partent pour la dernière fois de sa vie en dehors de la République polono-lituanienne, pour se faire soigner dans une station thermale à Abano Terme près de Padoue. Nicolas Christophe est décédé le 28 février 1616 à Niasvij. Au cours de sa vie, Radziwill fonda lui-même une pierre tombale dans l'église jésuite de Niasvij - mentionnée dans l'inscription sur le piédestal, ainsi que dans le sermon prononcé par le jésuite Marcin Widziewicz lors de ses funérailles. Le co-fondateur était l'épouse de Nicolas Christophe, il doit donc être daté de 1588-1596. La conception générale du tombeau a probablement été calquée sur le tombeau du pape Sixte V à Rome, exécuté entre 1585-1591 par Domenico Fontana et le tombeau de la reine Bona Sforza à Bari, créé entre 1589-1593. Nicolas Christophe a vu le cercueil avec le corps de la reine à Bari en mars 1584 et ses contacts avec la reine Anna Jagellon, fondatrice de la pierre tombale à Bari, n'étaient pas sans importance. Le centre de sa pierre tombale est rempli d'une plaque avec une image en relief du prince de profil agenouillé en prière, la tête relevée et en tenue de pèlerin. Elle est couronnée d'un fronton triangulaire avec l'ordre du chevalier du Saint-Sépulcre. Le tombeau a été conçu par un architecte jésuite Giovanni Maria Bernardoni (décédé en 1605) et créé par un sculpteur italien anonyme actif dans la Petite Pologne, peut-être de la cour royale. Szymon Starowolski (Starovolscius) dans le livre « Une description de la Pologne ou de l'état du Royaume de Pologne » (Polonia sive status Regni Poloniae descriptio) publié en 1632, décrivant les investissements réalisés dans son siège ancestral et ses environs immédiats par Nicolas Christophe « l'Orphelin » (fondation de nombreux monastères, hôpitaux, le collège des Jésuites à Niasvij, le palais et la mairie, ainsi que la reconstruction du château à Mir voisin, l'aménagement de jardins, de vergers et d'étangs à poissons, ainsi que le marquage de routes le long desquelles il y avait des douves et des rangées d'arbres fruitiers), se terminait par l'affirmation que le voïvode « nous a arrangé l'Italie au milieu de la Sarmatie » (d'après « W podróży po Europie » de Wojciech Tygielski, Anna Kalinowska, p. 471). La peinture de Leandro Bassano ou atelier de la fin du XVIe siècle au Musée national d'art de Lituanie à Vilnius (huile sur toile, 110 x 177 cm, numéro d'inventaire LNDM T 3996), montre la scène de la mise au tombeau du Christ avec un donateur agenouillé dans le coin droit, dont la pose est identique à la pose de Nicolas Christophe dans sa pierre tombale. Avant 1941, le tableau appartenait à la Société des amis de la science à Vilnius, à laquelle il fut offert par le comte Władysław Tyszkiewicz (1865-1936), propriétaire du domaine Lentvaris, en 1907. Une scène similaire de la mise au tombeau a été publiée à la page 61 de « La procession de Jérusalem dans l'église du tombeau glorieux du Seigneur Jésus [...] tirée des livres de la Pérégrination de Jérusalem ou du Pèlerinage [...] de Nicolas Christophe Radziwll, prince sur Olyka et Niasvij [...] » (Hierozolimska processia w kosciele chwalebne[g]o grobu Pana Iezusowego [...] wzięta z ksiąg Hierozolymskiey Peregrynatiiey albo Pielgrzymowania [...] Mikołaia Chrzysstopha Radziwiła na Ołyce y Nieświeżu książęcia [...]) de Stanisław Grochowski, publié à Cracovie en 1607. Une peinture de style similaire représentant la Mise au tombeau du Christ a été photographiée vers 1880 par Ignacy Krieger dans la maison du prélat (Prałatówka) de la basilique Sainte-Marie de Cracovie (Musée national de Varsovie, DI 29611 MNW). Dans les collections de la basilique se trouvent des peintures de peintres travaillant pour la cour royale et des magnats de Pologne-Lituanie, comme l'allemand Hans Suess von Kulmbach (vers 1480-1522) et le flamand Jacob Mertens (mort en 1609). L'homme ressemble beaucoup aux effigies de Nicolas Christophe « l'Orphelin », notamment à son premier portrait connu, un dessin de David Kandel au musée du Louvre, réalisé entre 1563 et 1564 lors de ses études à Strasbourg. Dans la chapelle Notre-Dame de la Paix (Cappella della Madonna della Pace) à la Santi Giovanni e Paolo à Venise, se trouve également une composition horizontale de Leandro Bassano. L'église est considérée comme le panthéon de Venise en raison du grand nombre de doges vénitiens et d'autres personnages importants qui y sont enterrés depuis sa fondation. La chapelle a été construite entre 1498 et 1503 pour abriter l'icône byzantine de la Madone, apportée à Venise en 1349. Les stucs du plafond sont l'œuvre d'Ottaviano Ridolfi et la majorité des peintures ont été réalisées par des artistes travaillant pour le roi Sigismond III Vasa - Palma il Giovane (Palma le Jeune) a peint au plafond quatre médaillons représentant les vertus de saint Hyacinthe de Pologne (San Giacinto Odrovaz), Antonio Vassilacchi, dit Aliense, a créé une grande Flagellation du Christ, à droite et Leandro la grande toile avec saint Hyacinthe marchant sur le eau du fleuve Dniepr (huile sur toile, 230 x 462 cm), à gauche. Ce tableau est daté d'environ 1606-1610 et représente la scène de « Saint Hyacinthe à l'arrivée des Tartares se promène sur les eaux du Dniepr portant en sécurité le Saint-Sacrement et l'image de Notre-Dame ». Leandro a créé d'autres tableaux pour ce temple, comme « Le pape Honoré III approuvant la règle de saint Dominique en 1216 » dans lequel la scène du XIIIe siècle est transportée dans la Rome du début du XVIIe siècle avec de nombreux portraits contemporains, le pape en robe pontificale, les cardinaux, les gardes suisses du pape en robes typiques à collerettes. La scène de la Ruthénie du XIIIe siècle est également ramenée au XVIIe siècle et la majorité des personnages portent des costumes italiens. Fait intéressant, en 1606, les raids tatars ont commencé en janvier. Le seigneur de guerre des steppes Khan Temir (mort en 1637) mena 10 000 hommes pour attaquer la Podolie et fut vaincu par l'hetman des champs Stanisław Żółkiewski à la bataille d'Udycz (28 janvier 1606). « Christophe, chevalier du Christ au Sépulcre » (Christophorus Eques Christi dni Sepulchro) (257) est mentionné parmi les tableaux de la collection de la princesse Louise Charlotte Radziwill (1667-1695), inventoriés en 1671 (d'après « Inwentarz galerii obrazów Radziwiłłów z XVII w. » de Teresa Sulerzyska).
Mise au tombeau du Christ avec le portrait du prince Nicolas Christophe Radziwill « l'Orphelin » (1549-1616) en donateur par Leandro Bassano ou atelier, avant 1616, Musée national d'art de Lituanie à Vilnius.
Portraits de l'infante Anna Vasa par Lavinia Fontana
La sœur de Sigismond III, Anna Vasa (1568-1625), était passionnée de botanique. En 1604, elle reçut de son frère la charge de staroste de Brodnica, et en 1611 de Golub en Poméranie et s'installa dans ses domaines. Elle a créé un véritable centre culturel à Brodnica et Golub et a rassemblé autour d'elle des personnes d'horizons différents. Anna a financé l'impression de l'Herbier de Szymon Syreniusz (Zielnik Herbarzem z ięzyka Łacinskiego zowią), publié à Cracovie en 1613, et elle a fondé un grand jardin botanique à Golub, où elle cultivait des plantes médicinales et des herbes rares, dont le tabac.
À Brodnica, la princesse luthérienne agrandit et reconstruisit les intérieurs du soi-disant palais d'Anna Vasa. Elle a également aménagé un jardin autour du palais. Le plan de Brodnica conservé aux Archives militaires de Suède (Krigsarkivet) à Stockholm, réalisé pour les besoins militaires par les Suédois en 1628, juste après la mort de la princesse, montre deux jardins dans la zone du château. Le palais Renaissance a été construit avant 1564 par Rafał Działyński, staroste de Brodnica, après l'incendie du château teutonique en 1550 et reconstruit après 1604. L'architecte était très probablement un Italien actif à la cour royale de Varsovie, peut-être Paolo del Corte ou Giacomo Rodondo, qui travaillaient à l'époque à la reconstruction du château royal. Pour tous ses besoins, la princesse se tourna vers Varsovie, car elle se considérait abandonnée dans la Prusse polonaise. De la capitale, elle apportait des robes, des tissus, de la bière, du vin, du jus de mûrier et même du papier (d'après « Listy Anny Wazy (1568-1625) » de Karol Łopatecki, Janusz Dąbrowski, Wojciech Krawczuk, Wojciech Walczak, p. 20, 26, 38, 59, 157-158). Vers 1615, Anna possédait également un manoir à Varsovie, non loin du château royal. Il s'agit probablement de la vieille maison dans le jardin mentionnée dans le document de 1622, à proximité de la résidence d'été de la reine Constance. Elle résidait également dans un château teutonique à Osiek au bord du lac Kałębie, entre Grudziądź et Pelplin, qui fut transformé en une belle résidence Renaissance par le staroste Adam Walewski en 1565 (démoli en 1772 par l'administration prussienne). La princesse avait un penchant particulier pour la musique, la danse et le ballet. La lettre du nonce Claudio Rangoni au cardinal Pietro Aldobrandini (Cracovie, 18 juillet 1604), décrit la prestation de l'épouse du comte Cristoforo Sessi signore di Riolo, une dame « excellente en chant et en jeu de l'alto », « dans la chambre de la princesse [Anna Vasa], également entendue par le roi [Sigismond III], restant dans un endroit où il ne pouvait pas être vu » (quel conte Christofaro di Ruolo è partito di ritorno a Praga dopo l'esser stato alcuni giorni qui, ove la moglie sua ha cantato una volta in camera della principessa, sentita anco dal re, ch'era in luogo onde non poteva esser veduto). En 1619, elle aida la fille d'un musicien de la cour Wincenty Lilius (Vincenzo Gigli) à entrer dans un couvent à Braniewo (lettre de Varsovie du 17 novembre) et en 1624 elle intercéda auprès d'Urszula Meyerin pour demander au roi un salaire annuel ou le poste de maire pour un autre musicien italien Zygmunt Petart (Sigismondo Patard) (lettre de Brodnica du 1er octobre). Elle aimait organiser des mariages pour ses dames de la cour. En 1605, lors des célébrations liées au mariage de Sigismond III à Cracovie, elle organisa un coûteux « bal masqué des dames ». Anna et ses dames de la cour ont d'abord demandé au roi, puis à l'archiduc, au prince, « et à d'autres messieurs et courtisans, qui devaient aussi sauter comme eux ». Elles étaient particulièrement amusées par les messieurs qui n'étaient pas de bons danseurs « même s'ils étaient allés en Italie ». Quelques jours plus tôt, le 13 décembre 1605, un ballet avait eu lieu en présence de toute la cour dans une salle de danse spéciale en l'honneur de la nouvelle reine Constance. Les danseurs masqués portaient des costumes espagnols masculins et féminins, il y avait aussi une Commedia dell'arte italienne (Pantaleonów włoskich, którzy długo po włosku z sobą się swarzyli), ainsi que des danses espagnoles, italiennes et polonaises. Les aristocrates masqués jouaient à la fois des rôles masculins et féminins (d'après « Balety na królewskich godach 1605 roku » de Jacek Żukowski). Les masques étaient probablement importés de Venise, car par exemple en 1609 à Cracovie, Wincenty Zygante (Vincenzo Ziganti) avec le deuxième aîné de la guilde des peintres estimait les possessions d'Adam Niestachowski (ou Romanowski), à savoir plusieurs dizaines de masques vénitiens, avec barbes, moustaches, barbes taillées, de Noirs, de vieilles femmes, de jeunes filles, de femmes mariées, etc. Le ballet préparé pour la naissance de la princesse Anna Catherine Constance Vasa, le 7 août 1619, était tout aussi splendide. Anna dirigeait des « danses avec piétinement » interprétées par des femmes nobles, et son neveu, le prince Ladislas Sigismond, dirigeait des jeunes hommes habillés en Turcs. La collection du Musée de Varsovie comprend une tenue parfaitement conservée d'Adam Parzniewski (1565-1614), burgrave du château de Cracovie et maréchal de la princesse Anna Vasa, retrouvée avant 1952 dans la crypte de la cathédrale de Varsovie. Il s'agit d'une tenue faite de matériaux d'origine italienne, probablement cousue à Varsovie et composée d'un manteau, d'un pantalon court bouffant et d'un caftan italien en velours (velluto ceselato), à l'origine violet, appelé pavonazzo en italien (d'après « Marmur dziejowy ... », édité par Ewa Chojecka, p. 232), inspiré de la mode espagnole. Selon Gabriel Joannica, éditeur et auteur de l'introduction à l'herbier de Szymon Syreniusz, Anna avait « la capacité de parler des langues, d'abord notre polonais, comme si elle était native, puis d'autres, étrangères : allemand, italien, français et en partie appris le latin ». Elle parlait également bien son suédois natal. Sa plus proche confidente à la cour de Varsovie était la « ministre en jupe » et « bigote jésuite » Urszula Meyerin (Ursula Meierin), maîtresse du roi et fervente catholique. Elle correspondait fréquemment avec Jung frau Ursull, l'appelant Mein Liebt Vrsul (Ma chère Ursul) en allemand ou mosci Pano Vrsolo (Madame Ursola, proche de l'italien Orsola) en polonais dans ses lettres. La majorité de ses lettres sont aujourd'hui conservées à Stockholm (Svenska Riksarkivet), prises lors du déluge (1655-1660). Dans la plus ancienne lettre connue de la princesse à Urszula, datée de Varsovie le 16 août 1599, elle lui demande d'acheter des chapeaux pour la princesse et ses dames. Pour souligner ses droits héréditaires à la couronne suédoise, la princesse, comme sa tante Anna Jagellon avant les élections royales en Pologne-Lituanie dans les années 1570, a utilisé le titre espagnol d'Infante (Serenissima Infant. Sueciae Annae, Infanti Sueciae Anna, Serenissimae Infantis Sueciae Anne). L'inscription sur le sarcophage en étain financé par Sigismond III Vasa, publiée dans Monumenta Sarmatarum ... par Szymon Starowolski en 1655, l'appelle « La princesse la plus sereine, D. [Domina/Donna/Doña] Anna infante de Suède » (Serenissima Princeps, D. Anna Infans Sueciæ). Ses lettres en polonais étaient généralement signées « Anna, princesse de Suède » (Anna królewna szwedzka) ou simplement Anna, dans des lettres en allemand à Urszula Meyerin. La favorite du roi Urszula, proche des deux épouses de Sigismond III, correspondait avec leur mère Marie-Anne de Bavière (1551-1608), archiduchesse d'Autriche, et elle fut probablement intermédiaire dans certaines commandes artistiques d'Anna Vasa. Le médecin officiel de la reine était le vénitien Giovanni Battista Gemma, décédé à Cracovie en 1608, envoyé par sa mère à la cour de Varsovie. Comme à la cour de l'archiduchesse (ses portraits du peintre flamand Cornelis Vermeyen, de l'italien Giovanni Pietro de Pomis ou des peintres espagnols) et à la cour royale de Varsovie, à Brodnica aussi la mode espagnole et l'art flamand et italien devaient être très populaire. On sait très peu de choses sur le mécénat artistique de la princesse-infante. Rien n'a été conservé à Brodnica ou à Golub (du moins confirmé). Les envahisseurs, principalement suédois, ont probablement tout pillé ou détruit. Dans une lettre datée du 21 octobre 1605 de Cracovie (Bibliothèque polonaise de Paris, rkps 56/36, en polonais) à l'hetman Jan Karol Chodkiewicz (mort en 1621), elle exprime sa grande joie à l'annonce de la victoire de l'armée de la République dirigée par par Chodkiewicz lors de la bataille de Kircholm en 1605, au cours de laquelle il inflige une défaite majeure à une armée suédoise trois fois plus nombreuse que la sienne. Les Suédois envahissent la République au milieu de 1605, peu avant le mariage du frère d'Anna avec Constance d'Autriche (11 décembre 1605). La Pologne-Lituanie était à cette époque l’un des pays les plus riches d’Europe et la République pouvait se permettre une armée beaucoup plus puissante et plus nombreuse que celle de la Suède. Cependant, les dépenses militaires ont été limitées par le parlement (Sejm) parce que les magnats du sénat et les nobles craignaient qu'une armée aussi puissante ne soit utilisée contre eux pour renforcer le pouvoir du roi et transformer le pays en monarchie absolue (voir « Mecenat kulturalny i dwór Stanisława Lubomirskiego ... » de Józef Długosz, p. 33). « Anna, par la grâce de Dieu, princesse [héréditaire] des Suédois, des Goths et des Vandales, héritière du Grand-Duché de Finlande. Seigneur, cher à nous. Que Dieu soit éternellement loué pour une victoire si grande et si significative, qui il a daigné donner contre un ennemi si principal et si féroce du Roi Son Altesse et de la nation d'ici. [...] Et puisque nous avons un plaisir particulier et grand de cette victoire, afin d'en avoir une plus parfaite, nous vous demandons donc instamment en souvenir de cela, Votre Seigneurie, d'ordonner à une personne experte et consciente, prenant un peintre, de peignez la scène de bataille, les formations et toutes les actions, comment cette bataille s'y est déroulée, après avoir appris les noms, les lieux et les personnes, vous nous ferez une chose grande et très reconnaissante », écrit l'infante dans la lettre mentionnée. Le tableau le plus ancien et le meilleur représentant la bataille se trouve aujourd'hui au château de Sassenage, près de Grenoble en France. Il est attribué à Peter Snayers, actif à Anvers entre 1612 et 1621 puis à Bruxelles, et provient probablement de la collection du fils de Sigismond III, Jean II Casimir Vasa, établi en France après son abdication en 1668. Sigismond a très probablement commandé la peinture, par l'intermédiaire de son agent à la cour de l'archiduc Albert VII à Bruxelles dans les années 1620, et l'original, peut-être aussi par un peintre flamand ou italien, était très probablement le tableau commandé par la princesse en 1605. Anna est décédée le 6 février 1625 à Brodnica, et les derniers moments de la princesse-infante luthérienne ont été vivement commentés à Rome et à Florence - lettres du nonce Giovanni Battista Lancellotti au Saint-Siège de Varsovie, 9 février et 18 février 1625 et lettre de Giovanni Battista Siri, envoyé de la famille Médicis, du 21 février 1625 de Cracovie (Alii 7 stante passo ad'altra vita la Ser[enissi]ma infante ...). Le premier monographe polonais d'Anna, Marian Dubiecki, a écrit dans Przegląd Powszechny en 1896 sur les efforts de Sigismond III Vasa pour obtenir la permission papale d'enterrer sa sœur à la cathédrale du Wawel. Il est possible qu'à travers des rumeurs sur une prétendue conversion sur le lit de mort de l'infante, une fervente luthérienne, la cour royale polonaise ait voulu convaincre Rome qu'elle devait être enterrée avec d'autres membres de la famille et près des Jagellon. Ce n'est qu'en 1636 que son neveu, le roi Ladislas IV Vasa, décida d'enterrer Anna dans la ville voisine de Toruń, dans un mausolée baroque construit spécialement à cet effet en 1626 dans l'église de la Bienheureuse Vierge Marie, alors temple protestant. Les sources survivantes confirment que le corps d'Anna Vasa, vêtu d'une robe coûteuse et décoré de bijoux, attendait à Brodnica, dans la « salle voûtée », sans sépulture. En mai 1626, le roi Gustave Adolphe lança son invasion de la Prusse polonaise. Le 4 octobre 1628, Brodnica capitula, rendu par le commandant de la garnison polonaise, le Français La Montagne, et tomba aux mains des Suédois pendant plus d'un an. Seule la trêve conclue le 26 septembre 1629 (à Stary Targ) les obligea à quitter la ville le 6 octobre, aussi la veille au soir, les soldats suédois organisèrent un pillage. Quelques-uns d'entre eux sont entrés par effraction dans le tombeau d'Anna Vasa, où ils ont profané le cadavre de la princesse-infante, lui arrachant sa robe et volant ses bijoux. Les citoyens de Brodnica ont été choqués, alors le tribunal judiciaire s'est rapidement réuni et la cour royale de Varsovie a été informée. Le chancelier de la République, Jakub Zadzik, a envoyé une lettre acerbe au roi de Suède dans laquelle, sur la base d'une déclaration écrite du tribunal de Brodnica, il a présenté des actes honteux. Le chancelier du Royaume de Suède, Axel Oxenstierna, a répondu en reconnaissant que partiellement la faute de ses compatriotes, tout en essayant de rejeter la responsabilité sur les Polonais (d'après « Skarb Anny Wazówny ... » de Piotr Grążawski). Le sarcophage a probablement été remis en ordre car la copie du reçu de prise de Brodnica de l'armée suédoise délivrée par Mikołaj Hannibal Stroci (un descendant de la famille florentine Strozzi), un mois plus tard (26 octobre/6 novembre 1629), ne mentionne pas la profanation du cadavre. La crypte d'Anna Vasa à Toruń a été ouverte le 7 avril 1994 et l'exploration a confirmé toutes les informations connues sur les vols. Aucun matériel funéraire n'a été retrouvé. Le squelette était assez bien conservé, cependant, il s'est avéré que l'avant-bras droit manquait, peut-être à cause du comportement brutal des cambrioleurs lors du vol des bijoux. Aucune trace des bijoux de l'infante n'était connue jusqu'à ce qu'un document soit trouvé à Stockholm dans les années 1980 décrivant une découverte faite dans la cathédrale d'Uppsala en 1777. Un bracelet en or a été trouvé sur le sol avec un monogramme gravé d'Anna - APS (Anna Princeps Sveciae) et les symboles de la famille Vasa, aujourd'hui conservés à l'Armurerie royale (Livrustkammaren) à Stockholm (d'après « Śmierć i problemy pochówku Anny Wazówny ...» d'Alicja Saar-Kozłowska, p. 76-77). Le bracelet a probablement été fabriqué à Gdańsk ou à Toruń, puisque des bracelets très similaires sont représentés dans les portraits de dames patriciennes d'Anton Möller des années 1590 (Musée national de Gdańsk et Musée national de Finlande), ainsi que dans un portrait de dame, probablement une noble de la République polono-lituanienne, au Musée national de Stockholm (château de Gripsholm, NMGrh 426) et un bracelet en or similaire a été trouvé parmi les bijoux de Zofia Magdalena Loka (Trésor de Skrwilno à Toruń), cachés pendant le déluge. La collection de bijoux d'Anna Vasa était célèbre et estimée à 200 000 thalers. Certains des bijoux elle a hérité de sa mère Catherine Jagellon. En 1606, pour rembourser diverses dettes destinées à moderniser la starostie et sa résidence, elle décide de vendre certains de ses bijoux au tsar Faux Dimitri Ier. En 2022, un portrait de dame au riche costume orné de bijoux et d'un jardin en arrière-plan a été vendu à New York (huile sur toile, 121 x 95,5 cm, Sotheby's, 26 mai 2022, lot 223). Le tableau provient d’une collection privée du Connecticut et était auparavant considéré comme représentant la reine Élisabeth Ire d'Angleterre. Le visage ressemble à certaines effigies de la reine, comme le « portrait Darnley » ou le « portrait avec arc-en-ciel », mais le modèle est vêtu d'un costume espagnol de la fin du XVIe ou du début du XVIIe siècle. La reine d'Angleterre porte une robe de son plus grand ennemi, c'est très peu probable, c'est pourquoi l'identification a été changée en celle de l'infante Isabelle-Claire-Eugénie (1566-1633). Le portrait est très similaire au portrait de l'infante espagnole de Juan Pantoja de la Cruz, peint entre 1598-1599 (Musée du Prado à Madrid, P000717). Le costume, la pose, même le paysage se ressemblent beaucoup. Dans son portrait, Isabelle-Claire-Eugénie tient une miniature de son père Philippe II d'Espagne, tandis que dans le portrait décrit, le joyau principal est un grand pendentif en forme d'aigle en or serti de diamants. Même si l'infante espagnole n'était pas un membre proche de la famille impériale, elle pouvait hériter d'un tel pendentif de son grand-père, l'empereur Charles Quint, ou le recevoir de la branche autrichienne de la famille des Habsbourg. En 1543, Charles Quint offrit un tel « aigle en diamant avec rubis » (orzel dyamentowy z rubinami) à sa nièce Élisabeth d'Autriche (1526-1545) à l'occasion de son mariage avec Sigismond II Auguste (aujourd'hui dans le trésor de la résidence de Munich, Sch 49). Dans la majorité de ses portraits, Isabelle-Claire-Eugénie porte une grande croix en diamant et aucun autre portrait avec un aigle n'est connu. Il manque deux éléments importants pour considérer le portrait de New York comme son effigie - une tête d'aigle, le symbole impérial étant un oiseau bicéphale - un pendentif en or avec un aigle impérial à deux têtes des années 1600, appartenant très probablement à Constance d'Autriche, se trouve au monastère de Jasna Góra à Częstochowa, et la lèvre saillante des Habsbourg, clairement visible dans son portrait par Pantoja de la Cruz. Le modèle n’est donc pas un membre de la famille impériale ou un Habsbourg. Un pendentif en forme d'aigle similaire peut être vu sur plusieurs portraits de la reine Constance d'Autriche - par Jakob Troschel d'environ 1610 (Germanisches Nationalmuseum de Nuremberg, Gm 699, 7009/7277), par un peintre inconnu des années 1610 (Musée de Zamość, 62) ou par Pieter Soutman vers 1624 (Staatsgalerie Neuburg, 985). Dans son portrait à Nuremberg, la reine porte également un diadème en or avec un aigle polonais héraldique et une robe espagnole - saya, probablement un cadeau de l'Espagne ou cousue alla moda d'un modèle espagnol. La reine de Pologne était également représentée dans une robe typiquement espagnole dans son portrait réalisé par un peintre italien, aujourd'hui conservé au Philadelphia Museum of Art (huile sur toile, 186,1 x 107,3 cm, 1883-137), un pendant du portrait de sa sœur cadette Marie-Madeleine d'Autriche, grande-duchesse de Toscane, dans la même collection (1883-136). La mode espagnole, italienne (vénitienne et florentine), flamande, française et turque était à cette époque très populaire dans la République, comme le confirme Piotr Zbylitowski dans sa « Réprimande de la tenue extravagante des femmes » (Przygana wymyślnym strojom białogłowskim), publiée à Cracovie en 1600. Le pays devint très riche grâce au commerce des céréales et ces costumes « extravagants » et riches n'étaient pas chers. La prochaine reine de Pologne, Cécile-Renée d'Autriche, était également représentée avec un bijou en forme d'aigle - portrait avec une tulipe (Alte Pinakothek à Munich, 6781) et une gravure d'Eberhard Wassenberg, et une broche en or avec un aigle polonais au Musée du Louvre (MR 418) a probablement été réalisée pour elle. Anna Vasa a été représentée avec un pendentif en forme d'aigle dans une miniature de Sofonisba Anguissola datant d'environ 1592 (château de Rohrau). Le jardin derrière la femme du tableau new-yorkais a été réalisé pour elle et une villa au centre est sa résidence. La disposition de ce jardin correspond presque parfaitement au palais d'Anna Vasa à Brodnica, tel que représenté dans le dessin mentionné à Stockholm de 1628. En supposant que les deux représentations soient très exactes, les différences proviennent du fait que la résidence a été modifiée au fil du temps (Anna a agrandi le bâtiment et construit une cuisine) et il y a environ 20 ans de différence entre eux. Le tableau est attribué à un peintre flamand, cependant le style de cette œuvre est très caractéristique et typique d'une grande peintre Lavinia Fontana (1552-1614) et de son atelier. Il est comparable à ses autoportraits - à l'épinette avec une servante (Académie nationale de San Luca de Rome et collection privée), dans son atelier (Galerie des Offices à Florence et collection privée) des années 1570, portrait signé de la famille Gozzadini de 1584 (Pinacothèque nationale de Bologne) et portraits de Marguerite de Gonzague (1564-1618) et de ses dames et d'Alphonse II d'Este (1533-1597), duc de Ferrare dans la scène de la visite de la reine de Saba au roi Salomon de 1599 (Galerie nationale d'Irlande). Lavinia est née à Bologne dans les États pontificaux et elle et sa famille ont déménagé à Rome en 1604 à l'invitation du pape Clément VIII. Son père était un autre peintre éminent au service des papes - Prospero Fontana (1512-1597). Un portrait en miniature de couple provenant d'une collection particulière (huile sur cuivre, 19 cm), attribué au cercle de Prospero, est une effigie de Guillaume V, duc de Bavière et de son épouse, Renée de Lorraine. Si lui ou son atelier étaient auteurs, il acceptait donc des commandes de l'étranger à partir de dessins d'études ou d'effigies d'autres peintres, son séjour en Bavière n'étant pas confirmé dans les sources. La cour royale et les magnats polono-lituaniens commandaient fréquemment des peintures à Rome au tournant des XVIe et XVIIe siècles. Elles furent livrées au roi par des étrangers restés à Rome, comme le jésuite Antonio Possevino (1533-1611), ses envoyés et courtisans, comme le cardinal André Bathory (1563-1599), Stanisław Reszka (1544-1600) et Tomasz Treter (1547-1610) et d'autres, ainsi que des passants, comme les maréchaux Mikołaj Wolski (1553-1630) et Zygmunt Gonzaga Myszkowski (vers 1562-1615). Les tableaux, dont les sujets ne sont pas connus, envoyés de Rome par Reszka en 1588 ont dû plaire au roi, puisque Bernard Gołyński rapportait qu'ils étaient de loin supérieurs aux tableaux envoyés au roi par Possevino (d'après « Z dziejów polskiego mecenatu ... » par Władysław Tomkiewicz, p. 23). Eustachy Wołłowicz (1572-1630), prévôt (praepositus) de Trakai et référendaire à la cour de Sigismond III Vasa possédait peut-être un tableau de Michel-Ange (Pietà), reproduit dans une estampe de 1604 par Lucas Kilian avec ses armoiries et l'inscription MICHAEL: ANG. / B. pinxit Romae. Ils possédaient également de nombreux portraits, notamment d'Italiens célèbres. Dans la deuxième édition de son autobiographie, publiée en 1608, le poète le plus connu de Bologne, Giulio Cesare Croce (1550-1609), écrit poétiquement à propos de son portrait réalisé par Lavinia, envoyé en Pologne : « Et il y a peu de temps j'ai eu mon portrait réalisé par Lavinia Fontana et mon portrait a été emmené vivre en Pologne" (E' poco tempo ch'io mi fei ritrare, / A Lavinia Fontana, e'l mio ritratto, / Fù portato in Polonia ad habitare, « Descrittione della vita del Croce », p. 20). Stylistiquement, le paysage derrière la femme du tableau new-yorkais ressemble aux œuvres de Domenico Tintoretto, en particulier au portrait de la princesse Anna Vasa conservé au musée Isabella Stewart Gardner (P24e2). Il est possible que Lavinia ait reçu un tableau de Domenico ou de son atelier pour le copier et s'est inspirée de son style. Les traits du visage d'une femme ressemblent beaucoup à l'infante polono-lituanien-suédoise du portrait mentionné de Tintoretto et du portrait ovale de Sofonisba Anguissola, ainsi qu'aux effigies de son frère Sigismond III par Joseph Heintz l'Ancien (Alte Pinakothek de Munich, 11885) et par Jakob Troschel (Château Royal de Varsovie, ZKW 1176). Dans son portrait de 1584 de la famille Gozzadini, Lavinia a « ressuscité » deux membres de la famille – Ginevra (décédée en 1581) et son père, le sénateur Ulisse Gozzadini (décédé en 1561). Si elle pouvait peindre le défunt comme une personne vivante, elle pouvait aussi peindre les personnes vivant loin de son atelier, comme Anna Vasa. La femme était également représentée dans un portrait en pied actuellement conservé au musée Lázaro Galdiano de Madrid (huile sur toile, 198 x 114 cm, 08470). Ce tableau a probablement été acquis entre 1936 et 1939 et faisait partie de la collection constituée par José Lázaro à Paris. L'identité du modèle n'a pas été établie, même si « elle devait être une personne de haut statut courtois, à en juger par sa tenue vestimentaire » (Se ignora todo de la retratada, que hubo de ser persona de elevada situación cortesana, a juzgar por su traje), selon la description du musée. En raison du riche costume de la femme du début des années 1600, qui est évidemment espagnol, le tableau a été attribué au peintre espagnol dont le style était comparable - Rodrigo de Villandrando (1588-1622). Cependant, non seulement le visage et le costume sont similaires au tableau new-yorkais, mais aussi le style de cette œuvre. Le portrait de Madrid ressemble au style du portrait mentionné de la famille Gozzadini, mais le plus similaire est la manière dont a été peint le portrait de Raffaele Riario (mort en 1592), attribué à Lavinia (vendu au Dorotheum de Vienne, le 24 avril 2018, lot 52). Le portrait d'une dame avec un éventail et un chien du début du XVIIe siècle, aujourd'hui conservé au château de Lysice en Tchéquie (huile sur toile, 85 x 65 cm, LS00081a), est également très comparable. Les détails du costume et la façon dont les mains et le visage étaient peints sont très proches du style de Fontana. Le visage du portrait avec pendentif en forme d'aigle, comme modèle, a été copié dans un autre tableau de la même période vendu en 2017, également à New York (huile sur toile, 66,7 x 53,7 cm, Christie's, vente 14963, 18 octobre 2017, lot 572). Il provient de la collection de la Hispanic Society of America à New York. Ce « Portrait de femme en buste » (Portrait of a lady, bust-length) est également attribué à l'école flamande, mais de style le plus proche est encore un tableau de Lavinia Fontana, qui se trouve aujourd'hui au Musée national de Cracovie (huile sur toile, 77 x 62,3 cm, MNK XII-A-664). Le portrait de Bianca Lucia Aliprandi, née Crivelli (vendu chez Christie's Londres, vente 20055, 7 décembre 2021, lot 29) et le tableau mentionné de Fontana à la National Gallery of Ireland sont également très similaires. Un autre portrait de la même femme réalisé par le même peintre se trouve à la Galerie nationale d'art de Lviv, en Ukraine (54,5 x 42, numéro d'inventaire Ж-1945). Il provient de la collection Lubomirski et a été offert à l'Ossolineum de Lviv par le prince Henryk Ludwik Lubomirski (enregistré en 1826). Il aurait été acheté en 1826 à Vienne auprès de P. della Rovere (« Catalogue d'exposition : Pierre Paul Rubens - Antoine van Dyck » de Svetlana Stets, p. 576-577), donc peut-être envoyé aux Habsbourg ou provenant des anciennes collections Lubomirski. Le tableau est attribué à un suiveur d'Antoine van Dyck. Le style de sa robe indique que le tableau a été réalisé à la fin des années 1580 car il ressemble à la robe hispano-italienne de Marguerite de Gonzague (1564-1618), duchesse de Ferrare d'après son portrait par Jean Bahuet (collection particulière) ou son effigie par Jacopo Ligozzi à Lisbonne (Musée National d'Art Ancien, 453 Pint), peint vers 1593. Le tableau mentionné de Lavinia Fontana, conservé au Musée national de Cracovie, pourrait provenir de la collection royale, probablement mentionnée dans la collection du roi Jean III Sobieski dans l'inventaire du palais de Wilanów de 1696 (n° 77). Avant 1924, il faisait partie de la collection d'Antoni Strzałecki à Varsovie. Le tableau a été réalisé au début du XVIIe siècle car son costume et sa coiffure sont similaires à ceux vus dans les effigies de ce qu'on appelle Bellezze di Artimino au Palais Pitti ou dans le portrait de Marguerite de Gonzague (1591-1632), duchesse de Lorraine vers 1605 (Metropolitan Museum of Art, 25.110.21). Selon l'entrée du catalogue du musée par Dorota Dec et d'autres publications, il s'agit de l'autoportrait de l'artiste et elle se représente comme l'héroïne biblique Judith (comparez « Judith » de Lawrence M. Wills, p. 140), étant fondamentalement une femme qui surmonte la violence d'un homme grâce à son intelligence rusée. Quel meilleur cadeau pour les clients du Royaume de Vénus ?
Portrait de la princesse Anna Vasa (1568-1625) par Lavinia Fontana, vers 1588, Galerie nationale d'art de Lviv.
Portrait de l'infante Anna Vasa (1568-1625), staroste de Brodnica, en robe espagnole avec pendentif en forme d'aigle par Lavinia Fontana et atelier, vers 1605-1610, collection particulière.
Portrait de l'infante Anna Vasa (1568-1625), staroste de Brodnica, en robe espagnole par Lavinia Fontana et atelier, vers 1605-1610, Musée Lázaro Galdiano de Madrid.
Portrait de l'infante Anna Vasa (1568-1625), staroste de Brodnica, en buste par Lavinia Fontana, vers 1605, collection particulière.
Autoportrait en Judith avec la tête d'Holopherne par Lavinia Fontana, années 1600, Musée national de Cracovie.
Bataille de Kircholm en 1605 par Pieter Snayers, années 1620, Château de Sassenage.
Portrait de la reine Constance d'Autriche par Domenico Tintoretto
Au début du XVIIe siècle, comme à l’époque précédente, les monarques et magnats polono-lituaniens collectionnaient les portraits des dirigeants et des personnages célèbres. En 1612, Jan Ostroróg (1565-1622), voïvode de Poznań, demanda un portrait de l'électeur de Brandebourg (lettre de Salomon Leuper à Jean Sigismond, électeur de Brandebourg, 3 février 1612) et la même année Guillaume V, duc de Bavière envoie un portrait de son fils Albert (1584-1666) à la reine Constance d'Autriche, à l'occasion du mariage d'Albert (lettre du 4 janvier 1612). La reine échangea des portraits avec Albert en 1624. Dans une lettre datée du 15 octobre 1613, Alessandro Cilli rapporta au duc d'Urbino que la reine Constance « garde dans sa chambre les portraits des princes et princesses les plus sereins que lui envoient de Florence leur Altesses » (tiene in camera sua i ritratti dei s-mi principi et principesse mandatigli da Fiorenza dalle loro Altezze s-m) (d'après « Das Leben am Hof ... » de Walter Leitsch, p. 370-371, 911, 2377, 2378 , 2381).
Près de deux ans plus tard, en 1615, par l'intermédiaire de l'ambassadeur Krzysztof Koryciński, la reine Constance demanda et reçut également d'Espagne des portraits des enfants et du mari de sa sœur Marguerite d'Autriche « aussi naturels que possible » (los mas naturales que sea possible), selon au rapport du Consejo du 15 janvier 1615 (El gran desseo que la serenisima reyna su señora tenia de los retratos de VM y de su felicissima prole. Y suplica agora a VM sea servido de mandar se hagan assi el de VM como los de la reyna de Francia, del serenisimo principe nuestro señor, infantes y infantas los mas naturales que sea possible y a proporcion de sus estaturas, porque no podra llevar a la reyna su señora cosa mas cara y que tanto recreasse su vista, como la effigie y semejança de VM y de sus serenisimos hijos y a que nuestro señor le ha quitado la comodidad de ver los originales. Al consejo parece que es muy justo que se le den al dicho embaxador los retratos que pide en nombre de al reyna de Polonia). Cela fut suivi par la décision du Conseil Royal, probablement d'avril 1615, d'accorder des « portraits de leurs majestés » (y los retratos de sus majestades y altezas afin que la serenisima reyna su señora reciva el gusto y consuelo que dessea tal vista). En 1620, les nouveaux portraits des monarques espagnols sont livrés à la cour royale polono-lituanienne, dont celui d'Élisabeth de France (1602-1644), épouse du prince Philippe d'Espagne, futur Philippe IV (1605-1665), envoyé par un père dominicain polonais, d'après une lettre de Francesco Diotallevi (1579-1622), nonce apostolique en Pologne (1614-1621), au cardinal Scipione Borghese (1577-1633) (E giunto qua un padre dominicano Polacco, che per molti anni si è tratenuto in Spagna al quale è stato consignato dalla majestà cattolica per presentarlo in suo nome a questa majestà il ritratto della principessa venuta di Francia, moglie del principe figliolo di SM cattolica havendo gli gia per prima mandati i ritratti di tutti gl'altri principi della casa reale, 10 janvier 1620). Quelques années plus tard, en 1624, la reine Constance lance une grande campagne pour disposer d'une véritable galerie de portraits de famille. Mais cela a pris du temps car le peintre travaillant à Vienne était très occupé. Il dut probablement réaliser des portraits similaires ou identiques pour les cours de Madrid, Bruxelles et Florence. Nikolaus Nusser, chambellan de Ferdinand II, écrivait fin novembre que l'achèvement ne pouvait être attendu que dans trois mois et que le prince Ladislas Sigismond Vasa pourrait emporter les peintures avec lui lors du voyage de retour d'Italie. Par l'intermédiaire du prince Radziwill (vraisemblablement Sigismond Charles), l'impératrice Éléonore de Gonzague (1598-1655) envoya des portraits d'elle-même et des archiducs Maximilien-Ernest (1583-1616) et Jean-Charles (1605-1619), tous deux déjà décédés et dont les portraits devaient être copiés à Graz. Nusser, pensait que les portraits de l'empereur et de l'Impératrice devaient être envoyés dans le même format. « Mais l'impératrice découvrit qu'elle avait envoyé des bustes à la cour polonaise » (So hat aber die kaiserin vermelt, das sy bei dem polnischen gesandten brustbilder geschickt), écrivait Nusser en juin 1625, car la cour polono-lituanienne ne voulait pas être fourni avec trop de peintures. Certains peintres étaient actifs à la cour royale, mais à part Jakob Troschel, Jan Szwankowski, Jakob Mertens, Tommaso Dolabella, Wojciech Borzymowski, qui aurait été chargé par Sigismond III de décorer les chambres du château de Varsovie, et en 1630 pour le primat Łubieński, il a peint un portrait du prince Ladislas Sigismond à Gdańsk, et peut-être de Philipp Holbein II (orfèvre, bijoutier et peintre), ils étaient des intérimaires ou des agents d'ateliers étrangers. Nous savons seulement que l'archiduchesse Marie-Anne a emmené avec elle le peintre de la cour Balthasar Gebhard au mariage de Constance en décembre 1605, car celui-ci s'était cassé une côte lors de son séjour à Cracovie. Urszula Meyerin a reçu 100 florins pour les soins du patient. Dans les comptes de 1627, il y a aussi une note : « 200 florins donnés au peintre polonais du Jasthof [Jazdów?] » (Dem polnischen mahler auf den Jasthof gegeben fl 200, 12 septembre 1627). A cette époque, de nombreux objets étaient achetés en Italie, à Venise, notamment des livres. Gian Battista Gemma, médecin vénitien, donnait à lire au roi des livres, dont certains étaient « hérétiques ». C'est pourquoi la très pieuse reine Constance considérait Gemma comme une hérétique et menaçait même de « le jeter hors de la chambre » (per heretico et minacciarli che lo cacciarà di camera), selon la lettre de Claudio Rangoni au cardinal Scipione Borghese du 11 novembre 1606. Lorsqu'en 1606 le pape eut un différend avec Venise et imposa des interdictions à l'ensemble de l'État (Interdit vénitien), le roi ne voulut pas parler ouvertement contre Venise et évita habilement de prendre une décision. Chope en cristal avec les armoiries et le monogramme de Sigismond III Vasa et Constance d'Autriche (SCA - Sigmundus et Constantia Austriacae), motifs floraux et anse en forme de femme nue, attribuée à l'atelier Miseroni de Milan (Musée national bavarois, R. 2157), est l'un des rares objets conservés commandés par le roi et son épouse en Italie au début du XVIIe siècle. Au musée du Prado à Madrid, déposé à l'ambassade d'Espagne à Berne, il existe un portrait décrit comme « Reine Éléonore d'Autriche » (La reina Leonor de Austria) du début du XVIIe siècle (huile sur toile, 108 x 88 cm, inventaire numéro P001265). On dit qu'il représente Éléonore d'Autriche (1498-1558), qui devint par la suite reine du Portugal (1518-1521) et de France (1530-1547). Son costume espagnol et sa large collerette indiquent qu'il s'agit plutôt d'un personnage vivant dans le premier quart du XVIIème siècle et non du XVIème siècle. Selon un article de Gloria Martínez Leiva (« El incendio de la Embajada española en Lisboa de 1975 », 16 janvier 2018), il s'agit d'une effigie d'Anna d'Autriche (1573-1598), reine de Pologne issue d'une série créée de Bartolomé González (Retrato de Ana de Habsburgo), mais la femme ne ressemble aux effigies de la reine. L'attribution du tableau à Juan Bautista Martínez del Mazo (inventaire du Buen Retiro, 1794, n° 897) et à Bartolomé González est désormais rejetée et le tableau est qualifié d'œuvre anonyme. La femme porte une tira semblable à celle visible sur plusieurs effigies de Marguerite d'Autriche, reine d'Espagne (par exemple portrait à la Galerie nationale hongroise de Budapest avec inscription MARGARETA. AVS/TRIA. HISP. REGINA.) ou de Madeleine de Bavière (1587- 1628), comtesse palatine de Neubourg et duchesse de Juliers-Clèves-Berg par Peter Candid (Collections de peintures de l'État bavarois, 2471, 3217), elle est donc une reine consort ou duchesse régnante. Le modèle ne pouvait donc pas être la sœur cadette de Marguerite, l'archiduchesse Éléonore d'Autriche (1582-1620), qui, après des tentatives de mariage infructueuses le 3 octobre 1607, prit le voile et devint religieuse à Hall en Tyrol. Une collerette en dentelle et une coiffure haute similaires sont visibles dans un portrait décrit comme représentant une dame d'honneur de la reine Constance d'Autriche, acheté en 1935 par le Musée national de Varsovie à Z. Iłowicki (déposé au palais de Wilanów à Varsovie, huile sur toile, 82 x 65 cm, 120735), généralement daté après 1605 (d'après « Portrety osobistości polskich » de Stefan Kozakiewicz, Andrzej Ryszkiewicz, p. 251). La comparaison avec plusieurs portraits d'une série intitulée « Beautés d'Artimino » (Bellezze di Artimino), indique que les deux femmes sont habillées selon la mode du sud de l'Italie, les plus proches étant les portraits de dames romaines et napolitaines - Comtesse de Castro (Uffizi, Inv. 1890, 2265), Emilia Spinelli (Palazzo Davanzati, Inv. 1890, 2262), Belluccia Carafa, duchesse de Cerce (Uffizi, Inv. 1890, 2263) et Porzia de' Rossi (Uffizi, Inv. 1890, 2266). La série comprenait des portraits de dames florentines, romaines et napolitaines liées à la cour de Ferdinand Ier de Médicis, grand-duc de Toscane. Dans l'inventaire de 1609 de la Villa Médicis « La Ferdinanda » d'Artimino, dressé à la mort de Ferdinand, il y avait soixante-cinq effigies de ce type, quarante-deux florentines, dix-sept romaines et six napolitaines. Les effigies de dames romaines et napolitaines se distinguent de la série, non seulement par leur coiffure, mais aussi par le style des peintures probablement peintes à Rome entre 1602 et 1608 et attribuées à l'atelier de Jacopo Ligozzi, peut-être peintes par Achille Gianré. Le modèle présente une grande ressemblance avec les effigies de Constance d'Autriche, notamment le portrait de Frans Pourbus le Jeune (Kunsthistorisches Museum, GG 3306), Joseph Heintz l'Ancien (Kunsthistorisches Museum, GG 9452), et par un peintre inconnu (Château du Wawel, 1783). Un portrait peint dans un style très similaire et de la même époque se trouve également au musée du Prado (huile sur toile, 112 x 92 cm, P002405). Selon le catalogue du musée, il s'agit d'une effigie d'Éléonore de Médicis (1567-1611), duchesse de Mantoue, cependant, le modèle ressemble beaucoup aux effigies de Marguerite de Gonzague (1564-1618), duchesse de Ferrare, Modène et Reggio en deuil, tel que reproduit par Maike Vogt-Lüerssen (kleio.org, Die Gonzaga). Le tableau est considéré comme une copie de Rubens, mais à la fin du XVIIIe siècle, il était décrit comme une œuvre de Jacopo Tintoretto (Otra de Tintoreto, retrato de una madama Veneciana, inventaire du Buen Retiro, 1794, n° 40). Le portrait de Marguerite en veuve au Palazzo Franchini à Vérone (identifié comme le portrait d'Éléonore de Gonzague par l'entourage de Frans Pourbus le Jeune), étant une copie du portrait attribué à l'entourage de Jacopo Ligozzi (Musée Castelvecchio à Vérone), est de style très vénitien et pourrait être l'œuvre d'Alessandro Maganza. Le style des deux peintures décrites au Prado ressemble beaucoup aux peintures attribuées au fils de Jacopo, Domenico Tintoretto - portrait d'un homme avec une lettre et un crucifix (Musée Soumaya à Mexico) et portrait d'une dame (Musée Wiesbaden). Le style dans lequel les mains ont été peintes est particulièrement similaire. Les détails du costume de la saya en satin de Constance peuvent également être comparés au pourpoint du début du XVIIe siècle d' « un homme portant un costume richement brodé » (Collection privée). Bien que la reine de Pologne soit le plus souvent représentée en saya espagnole, dans deux tableaux créés par son mari, elle porte une tenue plus confortable - Allégorie de la foi de 1616 (Musée national de Stockholm, NMH 436/1891) et une miniature du Coffret royal (Musée Czartoryski, DMK Cz 196/I), offert par le roi au prédicateur de la cour Piotr Skarga (Hanc imaginem, Sigismvndvs Rex. Pol. manv propia pin/xit eamq. donavit Cancionatori svo R. Petro Scargae), selon l'inscription sur l'inverse. Constance portait également une coiffe ornée de bijoux de style oriental et semblable au kokochnik russe, qui portait l'idée de fertilité et était populaire dans différents pays slaves. Elle était représentée avec une telle coiffe dans son portrait de la collection du marquis de Leganés à Madrid (huile sur toile, 219 x 140 cm, inscription : La Reina de Polonia, Archivo Moreno, 19513 B), vendu en mai 2009 avec attribution à l'école flamande ou génoise. L'auteur possible pourrait être Sofonisba Anguissola, qui vécut à Gênes jusqu'en 1620.
Portrait de la reine Constance d'Autriche (1588-1631) en costume espagnol/italien par Domenico Tintoretto, vers 1605-1610, Musée du Prado à Madrid.
Portrait de Marguerite de Gonzague (1564-1618), duchesse de Ferrare, Modène et Reggio en deuil par Domenico Tintoretto, vers 1605-1610, Musée du Prado à Madrid.
Portrait de la reine Constance d'Autriche (1588-1631) en costume espagnol par école flamande ou génoise, peut-être Sofonisba Anguissola, années 1610, collection privée.
Portraits de Constance d'Autriche et Hortensia del Prado par Gortzius Geldorp
« Vive le roi Sigismond le Trois, sous ses auspices Tout ce qui s'est passé, le Seigneur a restauré depuis les fondations » (Vivat Sigismundus Rex Tertius, auspicio ejus Omne quod accepit restituit Dominus a fundamentis), est un fragment d'une inscription latine de 1610 sur un dalle de pierre non conservée, qui se trouvait avant la Seconde Guerre mondiale sur la façade de la maison des Giza à Varsovie (place du marché de la vieille ville, numéro 6). Il commémore la reconstruction de la maison après le grand incendie de Varsovie en 1607, au cours duquel « de nombreux biens chers persans et turcs ont été brûlés, 22 maisons rien que sur la place du marché », selon le père Franciszek Kurowski. La maison gothique construite entre 1448-1455 a été reconstruite pour le marchand Jan Giza, qui a également ajouté l'inscription suivante « La bravoure et la raison humaine peuvent faire beaucoup, Mais l'argent sera toujours le chemin le plus court » (Multa vi et ingenio, sed citius pecunia Comparantur omnia). À partir de 1655, cette maison appartenait à Marcin Martens, un menuisier, peut-être un parent d'un Hollandais Willem Martens (Mertens, Mertensone, Martinson), qui acheta des pierres et des marbres pour Sigismond III Vasa entre 1618-1619.
D'énormes profits du commerce des céréales, qui était exporté de Gdańsk, le roi et les nobles dépensent en produits de luxe commandés ou achetés dans différentes parties de l'Europe (le grenier royal de Gdańsk, conçu par Abraham van den Blocke, a été construit par Jan Strakowski vers 1621). Les descriptions dans les registres des biens mobiliers appartenant à la noblesse fournissent souvent des informations sur le lieu d'origine des œuvres d'art. Ils montrent qu'ils provenaient pour la plupart de l'étranger (par exemple, argenterie principalement d'Augsbourg, textiles de France, d'Italie ou d'Orient, meubles et horloges de France) (d'après « Kolekcjonerstwo w Polsce ... » d'Andrzej Rottermund, p. 40). Sigismond III a mené une longue correspondance diplomatique avec les dirigeants des Pays-Bas du Sud sur des questions artistiques, par ex. concernant des éléments en pierre forgés sur la Meuse à partir de modèles livrés directement de Pologne. « Les archives de Bruxelles, La Haye et Gdańsk révèlent les noms de tailleurs de pierre et d'agents commerciaux hollandais travaillant pour Sigismond III. Dans ce contexte, on peut même parler d'un réseau commercial bien organisé et fonctionnant efficacement entre les deux régions d'Europe » (d'après « Dostawy mozańskiego kamienia budowlanego ... » de Ryszard Szmydki). La seconde épouse du roi, Constance, avec le souci des finances, gère la cour royale et les terres de sa dot. En 1623, elle visita Gdańsk pour la première fois et un an plus tard pour 600 000 zlotys, elle acquit Żywiec et fit de cette possession la propriété privée de la Maison de Vasa, car les monarques de la République polono-lituanienne étaient généralement interdits d'acquérir des terres. Elle s'est engagée avec diligence dans la charité, a fréquenté des poètes et des peintres et le compositeur Asprilio Pacelli lui a appris à chanter. Constance était également notoirement célèbre pour sa grande piété catholique, son intolérance envers les autres religions et sa faveur envers les germanophones. Elle attachait également une grande importance à l'étiquette stricte, suivant le modèle hispano-habsbourgeois (d'après « Dynastia Wazów w Polsce » de Stefania Ochmann-Staniszewska, p. 128). A titre d'exemple, à Jastrowie, qui faisait partie de sa dot, la reine demanda à son mari de confisquer le temple aux hérétiques et à Żywiec, elle délivra un privilège (le 5 mars 1626 à Varsovie), interdisant aux Juifs de commercer et de vivre dans sa ville. La reine a également arrangé les mariages de ses dames d'honneur allemandes avec des nobles catholiques, ainsi, les représentants de la noblesse qui professaient le protestantisme et l'orthodoxie et souhaitant faire carrière à la cour devaient se convertir au catholicisme. Elle montra un grand soin à ses effigies et refusa de donner son portrait au maréchal Zygmunt Myszkowski, invoquant l'absence d'une telle coutume. Elle ne voulait pas non plus présenter un artefact similaire à un franciscain excommunié qui demandait un tel substitut pour une audience (d'après « Prawna ochrona królewskich wizerunków » de Jacek Żukowski). Tout cela a contribué à sa grande impopularité dans un pays multireligieux et multiculturel. Parmi ses agents artistiques se trouvait l'orfèvre et marchand d'Augsbourg Simon Peyerle, qui s'occupait d'envoyer de Munich à Varsovie les objets hérités par Urszula Meyerin de sa mère ainsi que le grand tableau hérité par la reine Constance, après la mort de son oncle, le duc de Bavière. (d'après « Świat ze srebra ... » d'Agnieszka Fryz-Więcek, p. 32). Grâce à lui, elle a acquis de grandes quantités de bijoux. Il est à noter qu'à cette époque les peintures étaient presque à la toute fin de la hiérarchie, répertoriées parmi les outils ménagers et les ustensiles de cuisine et après les bijoux, les armes de parade, l'argenterie, les tissus décoratifs, qui étaient considérés comme les plus précieux (d'après « Kolekcjonerstwo w Polsce ... » par Andrzej Rottermund, p. 40). Une petite peinture de cabinet avec l'Allégorie de la justice marchande du premier quart du XVIIe siècle au Musée national de Varsovie (huile sur panneau, 37,7 x 28, M.Ob.181 MNW), provient de la collection de Piotr Fiorentini (1791 -1858) à Varsovie. La figure féminine avec une balance et une épée, personnification communément admise de la Justice, est assise parmi des objets liés au commerce (poids, barils, marchandises emballées, une grande échelle en arrière-plan). La femme a une petite couronne sur la tête et les traits de son visage avec la lèvre inférieure saillante (mâchoire des Habsbourg) ressemblent à d'autres effigies de Constance d'Autriche. Le style de la peinture se réfère fortement à celui de Gortzius Geldorp. Un autre tableau très proche de Geldorp de la collection Fiorentini du même musée est le portrait d'une jeune femme de 21 ans, daté « 1590 » (huile sur panneau, 45,2 x 34,4 cm, M.Ob.196 MNW). Son visage et son costume ressemblent beaucoup à ceux d'Hortensia del Prado (décédée en 1627) d'après ses deux portraits de Geldorp au Rijksmuseum Amsterdam, l'un daté de « 1596 » (SK-A-2072) et l'autre de « 1599 » (SK-A- 2081). Hortensia, une femme noble d'origine espagnole comme son nom de famille l'indique, a d'abord été mariée au marchand Jean Fourmenois et après sa mort, elle a épousé Peter Courten à Cologne. Le couple s'est installé à Middelburg dans le sud-ouest des Pays-Bas, où ils ont vécu à Het Grote Huis dans la Lange Noordstraat, que Courten avait commandée et Hortensia avait un beau jardin avec des arbres fruitiers « de tous les pays étrangers », des plantes « de tous les rivages étrangers », décrit par le poète Jacob Cats. Portrait d'homme par Gortzius Geldorp de la collection de Jan Popławski, identifié comme représentant un noble Jacques du Mont, le montre en grande collerette du premier quart du XVIIe siècle (Musée national de Varsovie, numéro d'inventaire M.Ob.2415 MNW, antérieur 35817). Il est possible que les deux portraits se soient retrouvés dans la République polono-lituanienne peu de temps après avoir été peints comme cadeaux pour les entrepreneurs ou les amis.
Portrait de la reine Constance d'Autriche (1588-1631) en personnification de la Justice par Gortzius Geldorp ou suiveur, 1605-1625, Musée national de Varsovie.
Portrait d'Hortensia del Prado (1569-1627), âgée de 21 ans par Gortzius Geldorp ou atelier, 1590, Musée national de Varsovie.
Portrait en miniature de Rafał Leszczyński par l'atelier de Frans Pourbus le Jeune
Rafał Leszczyński, arrière-grand-père du roi Stanisław Leszczyński (Stanislas Leczinski), est né en octobre 1579 en tant que fils unique d'Andrzej Leszczyński (décédé en 1606), voïvode de Brześć Kujawski et d'Anna Firlej, fille d'Andrzej Firlej (décédé en 1585), châtelain de Lublin. Il avait trois demi-frères : Jan, grand chancelier de la Couronne, Wacław, primat de Pologne, et Przecław, voïvode de Tartu.
Il a étudié à l'école des Frères tchèques à Koźminek, puis il fait ses études en Silésie (Głogów), Heidelberg (1594), Bâle (1595), Strasbourg (1596-1598) et Genève (1599). Il visita l'Angleterre, l'Ecosse, les Pays-Bas et l'Italie, où à Padoue en 1601 il fut l'élève du célèbre physicien, astronome et mathématicien italien Galilée. Il a commencé son activité publique en tant qu'envoyé au Sejm de la voïvodie de Sandomierz en 1605. En 1609, il est devenu maréchal du Tribunal central, en 1612 - châtelain de Wiślica et en 1618 - châtelain de Kalisz. En tant que l'un des dirigeants des protestants polonais, il s'oppose à la politique pro-Habsbourg du roi Sigismond III Vasa. Il était aussi appelé le « pape des calvinistes polonais ». De retour en Pologne (1603), il entretint des contacts avec des savants étrangers. Il s'intéressait à l'armée et à la cartographie. Il a commandé une carte des régions frontalières du sud-est de la république polono-lituanienne, malheureusement, malgré l'aide du géodésiste et cartographe Maciej Głoskowski, le travail n'a pas été achevé. En plus du latin, il parlait couramment le français, l'allemand et l'italien. Il écrivit des poèmes, comme une paraphrase du poème « Judith » de Guillaume du Bartas, publié par Andrzej Piotrkowczyk à Baranów en 1620. Dans son beau château Renaissance de Baranów, construit par Santi Gucci, il gardait une grande bibliothèque qui, selon un inventaire de 1627, comptait environ 1 700 volumes. Un portrait en miniature de la collection de Leon Piniński, aujourd'hui à la Galerie nationale d'art de Lviv (numéro d'inventaire Ж-50), montre un homme dans un costume italien/français à la mode. Il a été peint sur cuivre et selon l'inscription en latin l'homme avait 28 ans en 1607 ([...] SVAE 28. ANNO DOMINI 1607.), exactement comme Rafał Leszczyński. Le style de cette miniature ressemble beaucoup à un portrait en miniature d'un homme inconnu d'environ 1600 au Victoria and Albert Museum, également peint sur cuivre, et attribué à un peintre flamand (numéro d'inventaire P.28-1942) et portrait en miniature d'un homme inconnu au Rijksmuseum Amsterdam, créé en 1614 (Aº 1614), peint sur cuivre et attribué à un peintre hollandais (numéro d'inventaire SK-A-2104). Portrait du sculpteur Pierre de Francqueville (Pietro Francavilla, 1548-1615) par l'atelier de Frans Pourbus le Jeune en collection privée, créé entre 1609-1615 (d'après l'original de la Galerie des Offices à Florence, numéro d'inventaire 746 / 1890), représente un style de peinture et de costume similaire. Un tel collier est également visible sur un portrait d'un homme inconnu du palais de Wilanów à Varsovie, réalisé vers 1600 et attribué à Agostino Carracci (numéro d'inventaire Wil.1627). Frans Pourbus le Jeune (1569-1622), qui à partir d'octobre 1600 était un peintre de la cour du duc Vincenzo Gonzaga à Mantoue, était le principal portraitiste et miniaturiste flamand travaillant dans le nord-est de l'Italie au début du XVIIe siècle. Il s'est également rendu à Innsbruck (1603 et 1608), Turin (1605 et 1608), Paris (1606) et Naples (1607), et en 1609 la reine Marie de Médicis l'appelle à Paris comme peintre de la cour. Frans et son atelier ont également pris des commandes de l'étranger, ne voyant pas le modèle réel. Plusieurs portraits de Philippe III, roi d'Espagne et de son épouse Marguerite d'Autriche lui sont attribués ou à son atelier (Rijksmuseum Amsterdam, The Phoebus Foundation). Ses visites à Prague et à Graz ne sont pas confirmées, cependant un portrait de l'empereur Rodolphe II (en buste, portant une cuirasse, collection privée) et un portrait de l'archiduchesse Constance d'Autriche (1588-1631), future reine de Pologne, et ses sœurs (Kunsthistorisches Museum de Vienne) lui sont toutes attribuées. Vers 1604, Hans von Aachen et le deuxième peintre de la cour de Prague, Joseph Heintz, ont également peint leurs portraits en rivalité directe avec Pourbus. Très probablement à l'occasion de son mariage avec Marguerite de Savoie à Turin en 1608, Pourbus ou son atelier réalisent un portrait en miniature de François de Gonzague, le fils aîné du duc Vincent Ier (vendu comme « Portrait d'un jeune moustachu » par l'école italienne à la galerie Bassenge à Berlin, vente 113, lot 6003). En 1609, un peintre de l'entourage de Hans von Aachen réalise le portrait d'un gentilhomme âgé de 40 ans (inscrit et daté A 1609 A 40., en haut à droite), peignant une miniature (collection particulière). L'homme avait le même âge que Pourbus lorsqu'il s'installa à Paris en 1609. En 1607, le deuxième fils de Rafał Leszczyński est né, nommé Rafał d'après son père. A cette occasion, Leszczyński, qui vient d'hériter du domaine Baranów de son père, a pu commander une série d'effigies de lui-même et de sa famille en Italie. Il est également possible qu'un peintre de l'atelier de Frans Pourbus à Mantoue se trouvait à cette époque en Pologne. L'homme de la miniature décrite ressemble aux effigies des demi-frères de Rafał Leszczyński, Jan (1603-1678) et Wacław Leszczyński (1605-1666).
Portrait en miniature de Rafał Leszczyński (1579-1636) âgé de 28 ans par l'atelier de Frans Pourbus le Jeune, 1607, Galerie nationale d'art de Lviv.
Portrait en miniature de François de Gonzague (1586-1612) par l'atelier de Frans Pourbus le Jeune, vers 1608, Collection particulière.
Portrait de Frans Pourbus le Jeune (1569-1622) âgé de 40 ans, peignant une miniature par l'entourage de Hans von Aachen, 1609, Collection particulière.
Portrait d'Adam Venceslas, duc de Cieszyn par Bartholomeus Strobel ou l'entourage
Un autre tableau créé par l'école de peinture de Prague de Joseph Heintz l'Ancien et Hans von Aachen est un petit portrait ovale d'un homme dans un gorgerin. L'homme porte également un pourpoint de soie blanche, une tunique militaire brodée d'or et un col en dentelle de la réticelle. Le tableau provient d'une collection privée à Varsovie et a été vendu en 2005 (Agra-Art SA, 11 décembre, Nr 7831). Le style de la peinture est proche de Bartholomeus Strobel, un peintre maniériste-baroque de Silésie, né à Wrocław, qui a travaillé à Prague et à Vienne à partir de 1608 environ. En 1611, il retourne à Wrocław pour aider son père à travailler dans l'église des Augustins et en 1619, grâce au soutien du roi Sigismond III Vasa, il obtient le statut de peintre de la cour (serviteur) de l'empereur Mathias.
Ce portrait peut être comparé aux œuvres signées de Strobel, portrait de Władysław Dominik Zasławski-Ostrogski de 1635 au palais de Wilanów à Varsovie (signé et daté : B. Strobell 1635) et la Crucifixion dans l'église Saint-Jacques de Toruń (signée et daté : B. Strobel 1634). Selon l'inscription en latin (AETATIS SVAE 37 / ANNO 1611), l'homme avait 37 ans en 1611, exactement comme Adam Venceslas (1574-1617), duc de Cieszyn lorsqu'il fut nommé commandant suprême des troupes silésiennes par le nouveau roi de Bohême Mathias, empereur à partir de 1612. Comptant sur les faveurs impériales Adam Venceslas, élevé dans le protestantisme, se convertit au catholicisme et expulsa le pasteur Tymoteusz Lowczany de Cieszyn le 23 février 1611. Il accompagna le roi Mathias à la cérémonie d'entrée à Wrocław avec une suite de près de trois cents chevaux. Le portrait est similaire à l'effigie du duc Adam Venceslas au Musée de la Silésie de Cieszyn, attribuée à Piotr Brygierski (ca. 1630-1718). Le costume (gorgerin, pourpoint de soie, tunique militaire et un col) et les traits du visage se ressemblent beaucoup.
Portrait d'Adam Venceslas (1574-1617), duc de Cieszyn, âgé de 37 ans par Bartholomeus Strobel ou l'entourage, 1611, Collection particulière.
Portrait de Sigismond Charles Radziwill par Gortzius Geldorp
En 1616, Sigismund Charles Radziwill (1591-1642), fils de Nicolas Christophe Radziwill « l'Orphelin » (1549-1616) et d'Elżbieta Eufemia Wiśniowiecka (1569-1596) arrive à la cour royale de Varsovie et obtient, en 1617, le titre de dignité de maître d'hôtel de la cour de la reine Constance d'Autriche.
Il a étudié au Collège des Jésuites de Niasvij, puis à Bologne. En 1612, il rejoint l'Ordre des Chevaliers de Malte (Chevaliers Hospitaliers) et combat avec les Turcs en Méditerranée. De retour en Pologne en 1614, son père lui fonde une commanderie maltaise en Lituanie. Au début de 1618, convoqué par le Grand Maître, il se rendit à Malte. En janvier 1619, il est à Vienne où se tient une grande congrégation de chevaliers hospitaliers. Il est nommé par le Grand Maître commissaire général, avec Charles II de Gonzague (1609-1631), duc de Nevers. « Ayant reçu une licence de Son Altesse l'Empereur... demain, si Dieu le veut, je pars », écrit-il dans une lettre datée du 15 janvier 1619 de Vienne à son frère Jean Georges Radziwill (1588-1625). En février 1619, il était à Venise, et il rapporta encore à son frère : « J'ai trouvé sa seigneurie Alexandre, notre frère, en bonne santé à Venise et j'espère que Notre-Seigneur le ramènera rapidement et que Votre Majesté le verra dans notre pays ». Après son retour dans le République en 1621, il participa à la bataille de Khotine et en 1622 il commanda l'unité de cavalerie légère polono-lituanienne (Lisowczyk) dans l'armée impériale. Il meurt le 5 novembre 1642 à Assise en Italie. Avant la découverte d'un portrait d'homme en costume noir daté de 1619 et signé par Gortzius Geldorp avec son monogramme « GG.F. », on croyait généralement qu'il était mort en 1616 à Cologne. Une copie de la Violante de Titien de sa main, vendu en 2016 à Vienne (Dorotheum, lot 122, monogrammé en haut à gauche : « GG.F. »), indique qu'il était à Venise et à Vienne. Selon l'inscription en latin dans le coin supérieur droit du portrait mentionné d'un homme en costume noir, le modèle avait 28 ans en 1619 (AETATIS. SVAE. 28. / .1619.) exactement comme Sigismond Charles Radziwill lorsqu'il était à Venise et à Vienne. Le costume d'un homme et ses traits du visage ressemble beaucoup à l'effigie de Sigismond Charles Radziwill au Musée de l'Ermitage (ОР-45868), créé d'après l'original d'environ 1616. Son costume de style espagnol, typique de la cour impériale de Vienne, est presque identique à celui visible dans le portrait d'Antonio Barberini, Grand Prieur de Rome de l'Ordre de Malte, créé en 1625 par Ottavio Leoni. Des tenues similaires sont également visibles dans les portraits de Bernardo Strozzi, comme dans le portrait de Giovanni Battista Mora l'Ancien, noble de Vicence près de Venise, au Walters Art Museum et dans le portrait de Mikołaj Wolski (1553-1630) par Venanzio di Subiaco dans le Monastère des Camaldules à Bielany, créé vers 1624.
Portrait de Sigismond Charles Radziwill (1591-1642) âgé de 28 ans par Gortzius Geldorp, 1619, Collection particulière.
Portrait de Łukasz Żółkiewski par Johann Philipp Kreuzfelder
À la fin du XVIe siècle, l'art flamand/néerlandais était le modèle dominant des portraitistes de Nuremberg. Sous l'influence de Nicolas Neufchatel et Nicolas Juvenel, deux éminents artistes flamands/néerlandais installés dans la ville impériale, le portrait anversois très développé a trouvé sa place dans l'art local du portrait (d'après l'entrée au catalogue par Judith Hentschel pour un portrait d'une femme de 1626). Les élèves de Juvenel étaient parmi les portraitistes les plus réussis et les plus recherchés de la ville et de l'extérieur.
Jakob Troschel (1583-1624) de Nuremberg, peintre de la cour du roi Sigismond III Vasa, a été formé dans le cercle de Juvenel - selon « Historische Nachricht ... » de Johann Gabriel Doppelmayr, il a appris de Johann Juvenel et Alex Lindner, et Johann Philipp Kreuzfelder (1577-1636), fils d'un orfèvre de Nuremberg, fit son apprentissage à l'atelier de Juvenel entre 1593 et 1597. En 1612 et 1617, Kreuzfelder dépeint les conseillers de Nuremberg et en 1614 Bartolomeo Viatis (1538-1624), un marchand de Venise (Collections d'art de la ville de Nuremberg), puis il travaille comme portraitiste pour les comtes d'Oettingen et de Hohenlohe-Langenburg. On pense qu'il a séjourné à Rome avec l'artiste Adam Elsheimer (1578-1610) et des influences du portrait flamand et italien peuvent être trouvées dans son travail. Kreuzfelder s'est vu attribuer le monogramme « JC » (pour Johannes Creutzfelder) par des chercheurs. En 1626, le peintre voyagea probablement aussi à Munich, car le portrait signé de sa main représentant une dame en riche robe noire (vendu chez Koller, 1 octobre 2021, lot 3013) porte un blason similaire à celui de la famille Sentlinger, une riche famille patricienne de Munich, et à Constance dans le sud de l'Allemagne en 1628, comme l'effigie de Nikolaus Tritt von Wilderen, membre du conseil municipal de Constance, lui est attribuée. Un petit portrait d'un jeune noble (34 x 25,5 cm, huile sur cuivre) provenant d'une collection privée du sud de l'Allemagne (vendu chez Lempertz KG, 19 novembre 2022, lot 1516) a été peint dans le style similaire au portrait d'un femme de la famille Sentlinger. Il porte un pourpoint noir en soie richement peint et une culotte ample. Les garnitures en dentelle blanche finement peintes du col et des poignets somptueux sont caractéristiques de Kreuzfelder. La signature de l'artiste en haut à droite est également très similaire. La peinture a été attribuée à l'école allemande du début du XVIIe siècle et le monogramme a été déchiffré comme TB f. (?) (chevauchement), cependant, il pourrait aussi s'agir de JPC f. pour Johannes Philippus Creutzfelder fecit en latin. Selon le reste de l'inscription, également en latin, l'homme représenté avait 25 ans en 1619 (Aetatis. 25 / 1619), exactement comme Łukasz Żółkiewski (1594-1636), le fils cadet du chambellan de Lviv Mikołaj Żółkiewski (décédé en 1596). Il a étudié à l'étranger, peut-être au collège jésuite d'Ingolstadt, une ville située entre Nuremberg et Munich dans le duché et l'électorat de Bavière, très populaire parmi la noblesse polono-lituanienne à cette époque. Le roi Sigismond III commanda des œuvres d'art en Bavière et les envoya à Guillaume V, duc de Bavière, tandis que la maîtresse du roi, influente « ministre en jupe » ou « bigote jésuite » Urszula Meyerin (1570-1635), est très probablement née près de Munich en Bavière. Neveu du célèbre hetman Stanisław Żółkiewski (1547-1620), Łukasz a participé à la campagne turque de 1620 et a été capturé à la bataille de Cecora, dans laquelle son oncle a perdu la vie. Quatre ans plus tard, en 1624, il accompagne le prince Ladislas Sigismond Vasa (futur Ladislas IV) lors d'un voyage à l'étranger à la demande du roi Sigismond III. Żółkiewski, qui devint le voïvode de Bratslav, mourut sans enfant dans une bataille avec les Cosaques en novembre ou décembre 1636 et fut enterré dans l'église jésuite de Pereïaslav, qu'il fonda un an plus tôt (1635) avec le collège jésuite. Plus tard, les Cosaques ont détruit Pereïaslav, y compris l'église, et ils ont jeté le corps du fondateur du cercueil (d'après « Ilustrowany przewodnik po zabytkach kultury na Ukrainie » de Jacek Tokarski, Zbigniew Hauser, Volume 4, p. 180). La ressemblance familiale de l'homme de 25 ans avec les effigies de l'hetman Stanisław Żółkiewski, l'oncle de Łukasz, est frappante. La forme du visage, la mâchoire inférieure et la lèvre inférieure, la couleur des cheveux et la coiffure se ressemblent beaucoup. Le style du portrait est très similaire à deux miniatures du Musée national de Varsovie (numéro d'inventaire Min.1014 et Min.1015), identifiées comme des effigies de Gotthard Kettler (1517-1587), duc de Courlande, qui faisait partie de la République polono-lituanienne, et sa femme Anna de Mecklembourg (1533-1602). Il ne peut être exclu que Kreuzfelder soit arrivé à un moment de sa carrière dans la République ou que Żółkiewski ait commandé une série de ses effigies lors de son séjour potentiel à Nuremberg, car le peintre était connu parmi les clients polono-lituaniens.
Portrait de Łukasz Żółkiewski (1594-1636), âgé de 25 ans par Johann Philipp Kreuzfelder, 1619, Collection particulière.
Portrait en miniature de Gotthard Kettler (1517-1587), duc de Courlande par Johann Philipp Kreuzfelder, premier quart du XVIIe siècle, Musée national de Varsovie.
Portrait en miniature d'Anna de Mecklembourg (1533-1602), duchesse de Courlande par Johann Philipp Kreuzfelder, premier quart du XVIIe siècle, Musée national de Varsovie.
Portraits de Tomasz Zamoyski et Katarzyna Ostrogska par Domenico Tintoretto
Dans les années 1615-1617, « accomplissant la dernière volonté de son père », Tomasz Zamoyski (1594-1638), fils de Jan Zamoyski, grand chancelier de la Couronne (1542-1605) et de Barbara Tarnowska (1566-1610), fille de Stanisław Tarnowski (d. 1618), châtelain de Sandomierz, entreprit des pérégrinations à l'étranger. Presque tous les jeunes magnats ont fait de tels voyages éducatifs à cette époque.
Par Cracovie au sud de la Pologne, il atteignit Gdańsk au nord, où il séjourna « environ six dimanches » - du 12 décembre 1614 environ aux derniers jours de janvier 1615, visitant également Malbork et Elbląg. Dans les derniers jours de janvier 1615, après avoir reçu des lettres de recommandation du roi Sigismond III Vasa, le jeune Zamoyski partit de Gdańsk accompagné d'une petite cour avec le père Wojciech Bodzęcki, professeur à l'Académie Zamość, et Piotr Oleśnicki, cousin de Tomasz, qui étudia à Paris et Padoue aux frais de Jan Zamoyski. De Lübeck, il est allé à Amsterdam, et de là en Angleterre. Il arriva à Londres à la mi-juillet 1615 et y passa environ 5 mois. Jacques Ier, capturé par l'esprit et la gentillesse de Tomasz, l'invitait souvent à la chasse et aux banquets. À la demande de Zamoyski, le roi a libéré plusieurs catholiques anglais de prison - dont le père Fludd qui était détenu à la prison de Gatehouse. « Il était tenu en haute estime par le roi, qui avait souvent des audiences avec lui. Il allait souvent à la chasse avec son fils Charles. Les chevaux royaux étaient toujours à la disposition du Seigneur lui-même et de ses serviteurs pour s'amuser. Le roi Jacques reçut une décoration de chapeau coûteuse avec des plumes de héron », a écrit le serviteur de Tomasz, Stanisław Żurkowski, dans une biographie. Voulant mieux connaître le pays, il entreprit un voyage autour de l'île, qui dura environ deux mois. Puis il a voyagé en France. Zamoyski arriva probablement à Tours, où séjournait alors le roi Louis XIII, dans les premiers jours de mars 1616. De Tours, il se rendit à Orléans puis à Paris. Son séjour dans la capitale de la France fut très chargé : il apprit la langue française, « écouta les tribunaux au parlement », il fut « dans des académies sur divers actes et disputes », il se perfectionna en escrime et en équitation, et il a appris à jouer du luth. Il assiste aux audiences du roi Louis XIII, organise des réceptions pour les fonctionnaires et officiers de la cour de France et leur rend visite. Il se lie d'amitié avec les princes de Guise, de Rohan, de Nevers et de Montmorency. De France, le jeune Zamoyski est venu en Italie en janvier 1617. Dès son plus jeune âge, il a été en contact avec la culture italienne car son père y a fait ses études. Il a visité Naples et Rome, où il a eu des audiences avec le pape Paul V. Puis il est allé à Loreto, Padoue et Venise. En Italie également, il a maintenu la splendeur de sa suite. Il fréquente les ateliers des maîtres de la gravure, de la peinture et des orfèvres, acquiert des produits de luxe, organise des fêtes et fait des cadeaux aux gens de la classe dirigeante. Le coût du voyage de Zamoyski s'élevait à une somme énorme de plus de 20 000 zloty, tandis que les revenus d'un village à cette époque fluctuaient entre 140 et 240 zloty par an. Dans les premiers jours de novembre 1617, à travers la Suisse, la Bavière, la Bohême et la Silésie, Zamoyski retourna en Pologne, où à Kościan, il fut accueilli par des serviteurs de Zamość et des soldats de ses unités privées. Quelques jours plus tard, il arrive à Poznań, où « il a rangé ses vêtements étrangers, s'est coupé les cheveux et est revenu à la tenue polonaise », comme le rappelle Żurkowski dans sa biographie. De Poznań, il se rendit à Łowicz, pour rendre visite à l'archevêque de Gniezno, Wawrzyniec Gembicki dans son magnifique palais, puis à Varsovie, où il resta environ deux semaines. Ce n'est que le 20 décembre qu'il arrive à Zamość, où il est solennellement accueilli. Peu de temps après son retour, sa carrière politique progressa, en 1618 il devint voïvode de Podolie et en 1619 voïvode de Kiev (d'après « Peregrynacje zagraniczne Tomasza Zamoyskiego w latach 1615-1617 » d'Adam Andrzej Witusik). Il décida également d'épouser Katarzyna Ostrogska (1602-1642), petite-fille de Zofia Tarnowska (1534-1570), princesse d'Ostroh du côté paternel, et arrière-petite-fille de la duchesse Anna de Mazovie (1498-1557) du côté maternel. Katarzyna, 18 ans, et Tomasz, 25 ans, se sont mariés à l'église Corpus Christi de Jarosław le 1er mars 1620. En dot, Katarzyna a reçu 53 333 zloty, 6 châteaux, 13 villes, environ 300 villages et folwarks. Elle est née en 1602 dans la famille du prince Alexandre d'Ostroh, voïvode de Volhynie, et de sa femme Anna Kostka (1575-1635), comme la plus jeune de huit enfants. La famille vivait dans la ville de Jarosław. Son père est décédé subitement l'année suivant sa naissance, laissant un riche héritage à ses trois filles devenues adultes : Zofia, Anna Alojza et Katarzyna. Le portrait d'un jeune homme en manteau noir doublé de fourrure attribué à Domenico Tintoretto, aujourd'hui à la National Gallery de Londres (numéro d'inventaire NG173), a été présenté en 1839 par Henry Gally Knight (1786-1846), homme politique et écrivain britannique. Sa main droite repose sur une table placée devant une fenêtre ouverte, et sur laquelle se trouve un vase d'argent contenant un brin de myrte, consacré à Vénus, déesse de l'amour et utilisé dans les couronnes nuptiales. Dans sa main gauche, il tient un bonnet noir. Une fenêtre ouverte donne sur un paysage de terres agricoles avec deux bâtiments rustiques, peut-être des granges, avec ce qui ressemble à des toits de chaume soutenus par des troncs ou des poteaux en bois, typiques de la Pologne, de l'Ukraine et des grands domaines des Zamoyski près de Zamość. Des marchands de pays aussi éloignés que l'Espagne, l'Angleterre, la Finlande, l'Arménie et la Perse sont arrivés pour la grande foire annuelle de trois semaines, l'une des plus grandes d'Europe, à Jarosław à proximité - selon Łukasz Opaliński (1612-1662), 30 000 bovins ont été vendus lors d'une foire de Jarosław (Polonia Defensa Contra Joan. Barclaium, 1648). Le même homme a également été représenté dans un portrait en pied, également par Domenico Tintoretto, qui, avant la Seconde Guerre mondiale, se trouvait dans le château de Łańcut près de Jarosław (catalogue « For Peace and Freedom. Old masters: a collection of Polish-owned works of art ... », image 37). Il porte un costume noir français/anglais à la mode, très semblable à celui montré dans le portrait d'un jeune homme, attribué à Salomon Mesdach, daté sur la table : Aº 1617 (Rijksmuseum Amsterdam, numéro d'inventaire SK-A-913). Une vue d'un canal à Venise est visible à travers la fenêtre derrière lui, suggérant que le portrait est un souvenir de sa visite dans la ville. L'homme des deux portraits ressemble beaucoup aux effigies de Tomasz Zamoyski en costume polonais, enfant de 12 ans, créé par Peter Querradt en 1606 (Österreichische Nationalbibliothek) et âgé de 44 ans, créé par Jan Kasiński en 1637 (Musée diocésain de Sandomierz). Le portrait d'une dame, connue sous le nom de Donna delle Rose, à la Villa Gyllenberg à Helsinki a été peint dans le même style que le portrait d'un homme avec du myrte à la National Gallery de Londres. Cette œuvre est également attribuée à Domenico Tintoretto, elle a une composition similaire et des dimensions similaires (116,5 x 85,5 cm / 119,5 × 98 cm), peut donc être considérée comme un pendant ou un portrait d'une série créée à la même époque. La tenue à la mode portée par cette jeune femme témoigne d'une grande richesse. Son costume est très similaire aux robes de cour vénitiennes visibles dans une estampe publiée en 1609 dans « Costumes d'hommes et de femmes vénitiens » de Giacomo Franco (Habiti d'hvomeni et donne venetiane). La collerette nord, cependant, a été remplacée par un collier reticella de la fin des années 1610, en forme d'une queue de paon ouverte derrière la tête, semblables aux colliers italiens et français des courtisans du roi Sigismond III Vasa. La procession avec Saint-Aignan de l'atelier Tommaso Dolabella (église du Corpus Christi à Cracovie) et la bannière avec l'adoration de saint François de Jan Troschel (monastère de Leżajsk), témoignent de la diversité de la mode de cour dans la République polono-lituanienne dans les années 1620 avec des styles polonais, espagnol, italien, français et allemand représentés. La rose blanche dans ses cheveux symbolise la pureté et l'innocence d'une mariée. Le visage de la femme ressemble beaucoup aux portraits conservés de Katarzyna Ostrogska, tous créés lorsqu'elle était veuve et offerts à différents monastères (Musée de Zamość), ou au portrait de sa fille Gryzelda Wiśniowiecka (Palais de Kozłówka). Madame Zamoyska dans un costume vénitien peint par Domenico Tintoretto ? Ce n'était pas surprenant pour les habitants des domaines Zamoyski. Les Italiens étaient nombreux à Zamość, à l'Académie, au service du chancelier Jan Zamoyski, à commencer par l'architecte de la cour, le vénitien Bernardo Morando. En 1596, Boniface Vanozzi, secrétaire du cardinal Enrico Gaetani en Pologne, décrit Zamość, ville idéale de la Renaissance construite pour le chancelier, « un amoureux de la nation italienne » (amatore della natione italiana), à partir de zéro : « Il a commencé à construire cette ville en 1581 et aujourd'hui elle compte déjà jusqu'à 400 maisons, pour la plupart construites à l'italienne ». Avant 1604, il a commandé à l'autel principal de l'église collégiale de Zamość, plusieurs peintures dans l'atelier de Domenico Tintoretto. Des négociations avec l'artiste ont été menées au nom de Zamoyski par des représentants des familles italiennes Capponi et Montelupi et des peintures achevées ont été livrées en Pologne en 1604. Le plus grand tableau représentait le Christ ressuscité avec saint Thomas l'Apôtre - le patron du temple, des peintures dans les parties latérales : saint Jean-Baptiste et saint Jean l'Évangéliste - les patrons du fondateur, et la peinture au sommet de l'autel - Dieu le Père. Cet autel a été transporté à l'église de Tarnogród en 1781 et seules les peintures latérales ont été conservées. Tomasz, son père et sa femme en costume vénitien ont également été représentés dans deux tableaux de l'église de l'Assomption à Kraśnik (Messe d'action de grâce et Procession du chapelet). Les deux ont été créés par Tommaso Dolabella en 1626. À partir de 1604, Kraśnik faisait partie du domaine de Zamość et le protecteur de l'église était Tomasz Zamoyski, voïvode de Kiev. Le voïvode et sa femme ont fondé des stalles pour l'église avec leurs armoiries et dans l'un des autels latéraux il y a une peinture de Salvator Mundi par Paris Bordone ou son atelier.
Portrait de Tomasz Zamoyski (1594-1638) en costume français/anglais du château de Łańcut par Domenico Tintoretto, vers 1617, lieu actuel inconnu.
Portrait de Tomasz Zamoyski (1594-1638) par Domenico Tintoretto, vers 1620, National Gallery de Londres.
Portrait de Katarzyna Ostrogska (1602-1642) en costume vénitien par Domenico Tintoretto, vers 1620, Villa Gyllenberg à Helsinki.
Saint Jean Baptiste et Saint Jean l'Évangéliste de la Collégiale de Zamość par Domenico Tintoretto, vers 1604, Église de la Transfiguration à Tarnogród.
Portrait du prince Ladislas Sigismond Vasa en fraise par Pierre Paul Rubens ou atelier
« Ce prince qui fut Ie délice des seuls Polonais est devenu maintenant, ô Belges, l'objet de votre affection et de celle du monde » (Quod sibi delicium soli tenuere Poloni, / Nunc est, o Belgæ, vester, et orbis amor) est l'inscription en latin, paraphrasant Titus, sous une gravure représentant le portrait du prince Ladislas Sigismond Vasa (1595-1648), fils aîné du roi Sigismond III Vasa (d'après la traduction d'Alain van Dievoet dans « Les Lignages de Bruxelles », n° 75-76, 1978, p. 59). Cette estampe a été réalisée à Anvers par Pieter de Jode l'Ancien (P. de Iode sculp.) et Joannes Meyssens (Ioann. Meyssens exc.), très probablement entre 1625-1632, et montre le prince de profil en armure, avec l'ordre de la Toison d'or et tenant un bâton militaire (Musée national de Cracovie, MNK III-ryc.-40877).
Bien que les monarques de Pologne-Lituanie aient commandé de nombreuses œuvres d'art à Anvers et à Bruxelles dès le début du XVIe siècle au moins (principalement des tapisseries et des peintures), après le séjour du prince dans ces villes en 1624, ces commandes ont considérablement augmenté. Le prince a été peint pour l'infante Isabelle-Claire-Eugénie d'Espagne par Pierre Paul Rubens, commandé dix tapisseries illustrant l'histoire d'Ulysse (Odysseus) au tisserand bruxellois Jacob Geubels le Jeune et a acheté de nombreux objets de valeur. Il convient cependant de noter que déjà une décennie plus tôt, vers 1615 ou même avant, le graveur flamand Pieter Serwouters (1586-1657), né et travaillant à Anvers avant de s'installer à Amsterdam en 1622, créa une gravure à une autre effigie du prince en costume national (inscription : Vladislaus Sigismundus Dei Gratia Polonia Sueciæq Princeps, signé : P. Serwouters fecit, Veste Coburg, VII,347,1). Concernant le costume, Ladislas était représenté dans différentes tenues et dans les premiers portraits connus, principalement en costume étranger – italien, français ou espagnol. Le principal tailleur de la cour royale à cette époque était Nicolas Dugietto ou Nicolas Dugudt (Nicolò Dughetto da Parigi, Dziugiet), servant au moins jusqu'en 1616, très probablement un Français de Paris, payé 612 florins par an. En juin 1617 le serviteur du prince, acteur et musicien Jerzy Wincenty, achète en Angleterre pour son maître, son père et sa belle-mère 36 paires de bas de soie (noirs et colorés), 15 paires de gants, des parfums, 2 chapeaux de castor, un gilet (wastcot) et 6 gants coûteux, 6 autres gilets et autant de bonnets de nuit (night capps) et une douzaine de gants d'équitation. En 1617, le prince fit appel aux services du tailleur de son père Sébastien (actif au moins à partir de 1601), et en avril 1624 il fut servi par un certain Pallioni (d'après « Pompa vestimentis » de Jacek Żukowski, p. 54-55, 58). Bien qu'au cours de son voyage il commandait fréquemment des vêtements aux meilleurs tailleurs locaux, la tenue à l'espagnole représentée dans son portrait par Rubens a très probablement été confectionnée avant son départ de Varsovie, car le pourpoint de satin noir, peut-être à partir d'un tissu commandé à Venise, était décoré du monogramme S, faisant référence à son père Sigismond III. Vers le 13 septembre 1624, l'ambassadeur de France Nicolas de Bar, seigneur de Baugy, rapporte depuis Bruxelles au secrétaire d'État que : « Le peintre Rubens est en cest ville. L'Infante luy a commandé de tirer le pourtraict du Prince de Pologne ». Le tableau original de Rubens, mentionné dans l'inventaire du palais du Coudenberg à Bruxelles de 1659 (n° 122/84), fut probablement perdu lors de l'incendie du palais en 1731, mais le prince commanda plusieurs exemplaires de cette effigie pour lui et ses amis et certains d’entre eux ont été préservés. La copie la plus célèbre et peut-être la plus fidèle réalisée par Rubens et son atelier est celle conservée au château de Wawel à Cracovie (huile sur toile, 125,1 x 101 cm, achetée par le Metropolitan Museum of Art en 1929, plus tôt en Angleterre, offerte par le Met en 2020). Un autre exemplaire, dont on ne sait rien, se trouve très probablement dans une collection privée. La copie ovale conservée au palais Durazzo-Pallavicini de Gênes (huile sur toile, 77 x 66 cm, 1890 A), était peut-être un cadeau pour Agostino Balbi, dont le prince vit le palais en novembre 1624. Il existe également une bonne copie du XVIIe siècle au Musée national de Varsovie (huile sur toile, 76 x 58 cm, M.Ob.2434, antérieure 34348), qui ressemble cependant davantage aux œuvres de Gaspar de Crayer et de son atelier, comme le portrait du cousin de Ladislas, Philippe IV d'Espagne (1605-1665) en armure de parade au Met (45.128.14). La copie perdue lors de l'Insurrection de Varsovie en 1944, lorsque la ville fut détruite par les forces allemandes, était de style comparable. Ce tableau a été offert par Henryk Bukowski en 1886 au Musée polonais de Rapperswil (reçu du roi de Suède, huile sur toile, 72 x 57 cm, numéro d'inventaire 501). Willem van Haecht a inclus la même effigie du prince dans son tableau représentant la galerie de Cornelis van der Geest, peint en 1628 (Rubenshuis, huile sur panneau, 102,5 x 137,5 cm, RH.S.171). Rubens a peut-être également peint un portrait en pied du prince pendant le siège de Breda - « il a fait son portrait d'après nature » (lo ritrasse al naturale), selon Le vite de' pittori ... de Giovanni Pietro Bellori, publié à Rome en 1672, ce qui est parfois interprété comme grandeur nature. Plusieurs indices suggèrent que des contacts importants entre les monarques polono-lituaniens et l'atelier de Rubens ont commencé avant 1624. Au tournant des années 1619 et 1620, Piotr Żeromski vel Żeroński (Petro Jeronsquy), envoyé de Sigismond III Vasa, apparu à Anvers, acheta tableaux de Rubens pour lesquels le prêt s'élève à 1 125 ducats polonais (d'après « Rubens w Polsce » de Juliusz A. Chrościcki, p. 135, 139, 161, 164, 166, 207, 214). Żeromski a offert à la cathédrale Saint-Nicolas de Kalisz un grand tableau de Rubens ou d'atelier, représentant la Descente de Croix (détruit ou volé en 1973). En 1619, Jan Brueghel l'Ancien, qui coopérait fréquemment avec Rubens, était exonéré de droits de douane par Albert d'Autriche pour des peintures réalisées pour le roi de Pologne dont 9 portraits et en 1621, il peignit trois portraits de rois polonais pour lesquels il fut payé 300 florins par le secrétariat de l'archiduc Albert et de l'infante Isabelle Clara Eugenia le 16 décembre (En Brusselas, a 11 de deciembre se libraron 300 fl. a Juan Brueghle, pintor, vecino de Amberes, por tres retratos que ha hecho de los reyes de Polonia en el tercio postrero deste anno 1621). De nombreuses peintures de Rubens se trouvaient dans les collections royales et des magnats de la République avant le déluge (1655-1660). Roger de Piles dans sa « Dissertation sur les ouvrages ... », publiée à Paris en 1681, affirme que « La chasse aux Lions, par exemple, & la chûte de S. Paul [La conversion de saint Paul] ont esté faites pour le Roy de Pologne, & quatre autres chasses pour le Duc de Bavières » (p. 25). Rubens a très probablement créé une série d'effigies des rois historiques de Pologne et Wespazjan Kochowski dans son panégyrique écrit en 1669 à l'occasion du couronnement du roi Michel Korybut Wiśniowiecki fait référence à un tableau du maître représentant le roi Casimir le Grand (Na cóż tu Rubens Kazimierzu tobie / Wielki, te mury przydał ku ozdobie?). Une autre série a probablement été commandée à Vienne à Frans Luycx, élève de Rubens, car le grand tableau représentant le père de Casimir le Grand - Ladislas le Bref se trouvait à la Gemäldegalerie Alte Meister de Dresde avant la Seconde Guerre mondiale (huile sur toile, 145 x 115 cm, Gal-Nr. 514/Gal.-Nr. 2674 L). Malheureusement, nous ne pouvons aujourd'hui qu'imaginer ces peintures, car rien n'est conservé en Pologne des collections originales. Les envahisseurs lors du déluge et d’autres invasions n’avaient aucun respect pour le pays et ses habitants, sans parler de ses collections artistiques. Pierre des Noyers, secrétaire de la reine Marie-Louise de Gonzague, décrit les nombreuses atrocités et barbaries des envahisseurs entre 1655 et 1660, le pillage de tout, y compris les sols en marbre, les fenêtres, la destruction des panneaux dorés pour obtenir quelques grammes d'or et qu' « ils avaient pris jusqu'aux vieilles jupes des filles [dames de compagnie] de la reine et les avaient envoyées en Suède ». Dans la lettre du 27 juillet 1656 de Varsovie, il ajoutait que « les Suédois ont fait tant de saletés dans le château de Varsovie, qu'il est inhabitable; ils ont mis leurs chevaux jusque dans les chambres du troisième étage qui sont pleines de fumier et de corps morts de leurs soldats ». D'autres villes de la République furent également pillées et ruinées. A Vilnius, l'armée russe détruisit la riche chapelle Saint-Casimir et transforma la cathédrale en écurie pour leurs chevaux (d'après « Lettres de Pierre Des Noyers ... », publiées en 1859, p. 40, 212). Un tableau de Pierre Paul Rubens, qui pourrait provenir de collections historiques lituaniennes, peut-être acquis avant le déluge et qui a survécu aux invasions, se trouve aujourd'hui au Musée national d'art de Kaunas. Il s'agit de la Crucifixion (huile sur panneau, 107 x 76 cm, ČDM Mt 1335), qui se trouvait dans la seconde moitié du XIXe siècle dans le palais des comtes Tyszkiewicz (Tiškevičius) à Astravas, près de Birzai, où étaient conservées les riches collections artistiques de la famille Radziwill. Il est intéressant de noter que ce tableau est généralement daté de la première période d'activité de Rubens, entre 1600-1615, lorsqu'il séjourna en Italie (1600-1608), en Espagne (1603) et aux Pays-Bas (1612). Dans le château de Neubourg près de Munich, où étaient entreposés avant 1804 de nombreux objets de la dot de la sœur de Ladislas Sigismond Vasa, se trouve un « Portrait de jeune homme » de Pierre Paul Rubens ou de son atelier (Galerie nationale de Neubourg, huile sur panneau, 57,7 x 43,1 cm, 342). Le tableau provient de la galerie électorale de Munich et les monarques polono-lituaniens et les électeurs de Bavière échangeaient fréquemment des cadeaux. Déjà en 1612, la reine Constance louait les intérêts artistiques de son beau-fils dans une lettre au duc Guillaume V, duc de Bavière, qui en février 1623 envoya plusieurs tableaux en Pologne-Lituanie et le tableau devant lequel le duc célébrait les offices fut envoyé à Varsovie après sa mort - le transport (via Vienne) dura de juin 1626 à février de l'année suivante (d'après « Świat polskich Wazów: eseje », p. 298-299, 311). L'effigie de saint polonais Stanislas Kostka en prière par cercle de Rubens, provenant de la collection des électeurs de Bavière dans la Résidence de Munich (Alte Pinakothek, 7520), pourrait être un don de Pologne, mais créée en Flandre. La ressemblance du jeune homme avec les effigies du prince Ladislas Sigismond Vasa, représenté dans les gravures mentionnées par Serwouters et de Jode, ainsi que dans les médailles avec le profil du prince d'Alessandro Abondio (Kunsthistorisches Museum, Landesmuseum Württemberg ou le musée Bode à Berlin), est frappant. Il convient également de noter la ressemblance avec le portrait de la Galerie des Offices à Florence (Inv. 1890, 2350) ainsi que le visage du prince dans le tableau mentionné de l'atelier de Rubens au château de Wawel. Dans ses premiers portraits, comme les peintures des collections de Wittelsbach (Château royal de Varsovie, ZKW 66, don du gouvernement de l'Allemagne de l'Ouest en 1973) et du château de Neubourg (Collection de peinture de l'État de Bavière, 6817), le prince porte une fraise. Une collerette très similaire est visible sur un portrait de l'oncle de Ladislas Sigismond, le roi Philippe III d'Espagne (1578-1621), attribué à Andrés López Polanco et daté d'environ 1617. Le portrait de Philippe III se trouve désormais au château de Skokloster (LSH DIG3535) et fut probablement pillé en Pologne-Lituanie par Carl Gustaf Wrangel (1613-1676), ami proche et conseiller de confiance du « brigand de l'Europe » le roi Charles X Gustave de Suède. Dans ce portrait, le prince ne porte pas l'ordre de la Toison d'Or, qu'il a reçu en 1615, le portrait pourrait donc être daté peu de temps avant qu'il ne reçoive l'ordre. Cependant, dans de nombreuses effigies ultérieures, Ladislas a été représenté sans la Toison d'Or. Par exemple, dans la série de portraits des monarques polonais commandés par le conseil municipal de Toruń pour la chambre royale de l'hôtel de ville, Sigismond III Vasa porte l'ordre, tandis que son fils et successeur est représenté sans cette distinction. En 2019, une copie en miniature de cette effigie, attribuée à Abraham van Diepenbeeck, élève de Rubens qui travailla pour les clients de la République et s'installa à Anvers en 1621, fut vendue aux États-Unis (huile sur vélin, 13,34 x 9,53 cm, Concept Art Gallery à Pittsburgh, 8 juin 2019, lot 1239). Dans cette version de l'effigie, le jeune prince ressemble particulièrement aux effigies de son père Sigismond III, notamment le portrait de profil au château de Wawel (9009), acheté à Munich en 2008 (Hermann Historica, vente 54, 10 avril 2008, lot 3223).
Crucifixion par Pierre Paul Rubens, vers 1600-1615, Musée national d'art de Kaunas.
Portrait du roi Philippe III d'Espagne (1578-1621) par Andrés López Polanco, vers 1617, château de Skokloster.
Portrait du prince Ladislas Sigismond Vasa (1595-1648) dans une fraise par Pierre Paul Rubens ou atelier, vers 1615-1621, Galerie nationale de Neubourg.
Portrait du prince Ladislas Sigismond Vasa (1595-1648) dans une fraise par Abraham van Diepenbeeck, après 1621, Collection particulière.
Portrait du prince Ladislas Sigismond Vasa (1595-1648) dans un chapeau par l'atelier de Pierre Paul Rubens, vers 1624, Château royal du Wawel.
Portrait du prince Ladislas Sigismond Vasa (1595-1648) dans un chapeau par l'atelier de Pierre Paul Rubens, vers 1624, localisation actuelle inconnue.
Portrait du prince Ladislas Sigismond Vasa (1595-1648) dans un chapeau par l'atelier de Pierre Paul Rubens, vers 1624, Palais Durazzo-Pallavicini à Gênes.
Portrait du prince Ladislas Sigismond Vasa (1595-1648) dans un chapeau par l'atelier de Gaspar de Crayer, vers 1624, Musée national de Varsovie.
Portrait du prince Ladislas Sigismond Vasa (1595-1648) dans un chapeau par l'atelier de Gaspar de Crayer, vers 1624, Musée polonais de Rapperswil, perdu.
Portrait du prince Ladislas Sigismond Vasa (1595-1648) dans un chapeau, détail de la galerie de Cornelis van der Geest par Willem van Haecht, 1628, Rubenshuis à Anvers.
Portrait du prince Ladislas Sigismond Vasa par Giovanni Antonio Galli
Après la Seconde Guerre mondiale, qui fut le point culminant d'horribles invasions et partitions de la Pologne par ses voisins, très peu d'effigies des Vasa polono-lituaniens ont été conservées dans les anciens territoires de la République. Ce qui est très significatif, c'est que nombre d'entre eux ont été acquis à l'étranger au XIXe siècle par des aristocrates désireux de préserver la mémoire du pays le plus tolérant de l'Europe de la Renaissance. L'un de ces tableaux est un portrait en pied du prince Ladislas Sigismond Vasa, futur roi Ladislas IV, peint par un peintre italien lors de sa pérégrination dans la péninsule italienne en 1624-1625, aujourd'hui au château de Kórnik près de Poznań (huile sur toile, 234 x 116 cm, numéro d'inventaire MK 03369).
Il fut acheté en 1850 à Paris par le comte Tytus Działyński (1796-1861). Selon l'inscription en bas, l'effigie a été commandée par la famille Gundulić (connue en italien sous le nom de Gondola), patriciens de Dubrovnik (République de Raguse), installés à Ancône dans les États pontificaux. Il était destiné à servir de souvenir du séjour du prince dans leur maison les 13 et 14 décembre 1624. Ivan Gundulič (1589-1638), un parent des hôtes, un remarquable poète croate et patricien de Dubrovnik, a probablement rencontré le prince polono-lituanien là-bas et lui a dédié le poème « Osman ». Il est probablement aussi l'auteur de l'inscription sur le portrait (VLADISLAO SIGISMUNDI POLONORum REGIS FILIO / SCYTHAR, TVRCARVMQ: TIVMPHATORI INVICTo / GVNDVLA FAMILIA HOSPITI SVO / VT CVIVS HVMANSmam MAEST SEVELIN HIS ÆDIBVs ASPEXIt / SEMPER IN IMAGINE SVSPICIAT.). Au XIXe siècle, l'image était accrochée à la Casa Gunduli à Ancône (d'après « „Królewska” galeria obrazów ... » de Barbara Dolczewska, p. 250). Le prince chauve, qui plus tard portait fréquemment des perruques, était représenté dans un costume noir hispano-italien à la mode avec l'ordre de la Toison d'Or accroché sur sa poitrine et une rapière à son côté. Au cours de sa pérégrination, Ladislas Sigismond était considéré comme un connaisseur, ce que confirme le fait que le duc Guillaume V de Bavière demanda au prince d'évaluer la copie du tableau de sainte Véronique, réalisée d'après l'original romain. Déjà en 1612, la reine Constance louait les intérêts artistiques de son beau-fils dans une lettre au duc Guillaume. La lettre de Ladislas Sigismond du 18 septembre 1624, envoyée de Bruxelles à Urszula Meyerin, et indirectement à son père, contient une mention importante de sa conscience de collectionneur : « J'ai acheté plusieurs tableaux originaux. Il y a ici beaucoup de véritables chefs-d'œuvre [capolavori] ». A Milan, il admire les « métiers du cristal ». Il a probablement visité l'atelier de van Dyck à Gênes et a regardé les peintures du palais Neri local et les fresques d'Agostino Carracci dans le palais d'été de Parme. Il admire les œuvres de Domenico Ghirlandaio à Florence et visite l'atelier de Guido Reni à Bologne (d'après « Świat polskich Wazów: eseje », p. 311-312). La tante du prince, grande-duchesse de Toscane, dans une conversation avec l'envoyé de Mantoue, Ferrante Agnelli Soardo, a déclaré qu'il « aime être bien reçu, apprécie la musique, aime la peinture » (selon une lettre de Soardo à Ferdinand I Gonzaga, duc de Mantoue, Florence, 4 février 1625). Dans une lettre envoyée le 26 février 1625 depuis Bologne, Ladislas Sigismond mentionne l'embauche d'un « bon organiste » (peut-être Angelo Simonelli) et d'un « eunuque » (peut-être le célèbre castrat Baldassare Ferri) dans le service royal, exprimant également l'espoir d'embaucher un altiste qualifié. A Naples, il put admirer la tenue représentative du vice-roi Antonio Álvarez de Toledo y Beaumont, 5e duc d'Alba, qui avait « sur lui un bijou en diamant et une cynturyn [ceinture - cinturón, citrine ?] dans son chapeau, estimée à plusieurs centaines de milliers » et qu'à l'âge de soixante-dix ans (septuagenario) il se teint les cheveux et la barbe (d'après « Obraz dworów Europejskich ... » de Stefan Pac, p. 134). En fin d'après-midi du 12 janvier 1625, il écouta « Adriana [Basile-Baroni] chanter avec son fils et ses filles ». A Venise, qui selon lui « est probablement la plus véritable merveille du monde » (lettre à Urszula Meyerin, 5 mars 1625), il visita la maison d'un marchand de diamants. Le 7 mars, il se rend à Murano « pour écouter une religieuse qui était ici célèbre pour sa voix merveilleuse ». Deux jours plus tard, il apparaît incognito « au Concile de Venise » et le 20 mars 1625, depuis Palmanova, le prince envoie une lettre de remerciement à la République de Venise pour une somptueuse réception. Il apporta au pays de nombreux cadeaux - sculptures, coffrets, bijoux et « peintures de maîtres anciens et célèbres », reçus du duc de Mantoue, Carlo Magalotti, du cardinal Francesco Barberini et un tableau dans un cadre précieux du pape Urbain VIII. Il effectua également de nombreux achats et, comme à Venise, ils étaient exonérés des droits de douane et des frais supplémentaires (d'après « Listy Władysława Wazy ... » de Jacek Żukowski, p. 63, 66, 71, 73, 76, 78). Les Italiens ont également reçu de nombreux cadeaux et effigies du prince et des membres de la famille royale. Au palais Durazzo-Pallavicini de Gênes se trouve une bonne copie d'atelier du portrait de Ladislas Sigismond par Rubens. Le cardinal Francesco Maria del Monte (1549-1627), patron du Caravage, avait dans son palais romain (Palazzo Madama) « un portrait du prince, fils du roi de Pologne dans un cadre noir » (un ritratto del Principe figlio del Re di Polonia con cornice nere) et le cardinal Francesco Peretti di Montalto (1597-1655), possédaient en 1655 « un tableau représentant un portrait du prince de Bologne [Pologne] en costume polonais, tenant à la main un bijou [très probablement une masse bulava] » (quadro uno con ritratto del Principe di Bologna [Polonia] in habito Polacco, che tiene in mano un gioielo). Il s'agissait probablement de copies du portrait de Ladislas Sigismond en costume polonais par Rubens, puisque le peintre flamand a très probablement créé deux versions de son effigie, l'une commandée par l'Infante « avec un chapeau sur la tête » (con el sombrero en la caveza), et l'autre - alla polacca, c'est-à-dire en costume polonais. Deux de ces exemplaires, identifiés par moi en 2012, ont été offerts aux Médicis (Palais Pitti à Florence, Inv. 1890, 5178 et 5673). On croyait qu'il s'agissait d'images du roi Michel Korybut Wiśniowiecki, et l'un de ces portraits porte même une inscription en italien : MICHELE VIESNOVISKI RE DI / POLONIA. Alors que les Polonais préféraient souvent la mode italienne, française ou flamande, les aristocrates étrangers voulaient des vêtements de style polonais. La grande-duchesse de Toscane a reçu de tels vêtements de sa sœur la reine Constance d'Autriche en 1622. En 1631, l'archiduc Léopold V (1586-1632) voulait également des vêtements polonais pour son fils Ferdinand Charles (1628-1662), âgé de trois ans, qui ont été confectionnés et envoyés par la reine. Léopold aimait les vêtements et voulait les payer, mais Constance dit qu'un portrait du « jeune cher Pollack » (deß jungen lieben Pollacken conterfet) serait suffisant (d'après la lettre d'Urszula Meyerin à l'archiduc du 4 avril 1631). Les portraits des jeunes ducs de Toscane en tenue polonaise existèrent en plusieurs versions et copies, dont certaines furent sans doute également envoyées en Pologne-Lituanie. C'est pourquoi le portrait d'un prince, réalisé dans un style proche de Justus Sustermans et ressemblant aux effigies des fils de la tante de Ladislas Sigismond, Marie-Madeleine d'Autriche, grande-duchesse de Toscane, est considéré comme l'effigie d'un des frères de Ladislas Sigismond (Académie Saint-Luc de Rome, numéro d'inventaire 298). L'effigie du jeune Vasa dans son somptueux costume a sans doute également été créée en plusieurs exemplaires pour le prince, sa famille et ses amis. Malheureusement, c’est la seule version connue à ce jour, qui indique également l’ampleur de la destruction de l’art en Pologne. Semblable à d’autres effigies exquises créées au cours de son voyage, celle-ci est également finement peinte. La plus proche est la Marie-Madeleine pénitente du Walters Art Museum de Baltimore (37.651), datée d'environ 1625-1635. Cette toile est attribuée à un peintre actif à Rome Giovanni Antonio Galli, appelé lo Spadarino (1585-1652), membre des Caravaggisti (disciples du Caravage). Une autre œuvre peinte de la même manière se trouve à Ancône, où était initialement conservé le portrait du prince. Cette toile est également attribué à Spadarino et montre une effigie en pied de saint Thomas de Villanova faisant l'aumône. Le tableau, aujourd'hui conservé à la Pinacothèque civique d'Ancône (huile sur toile, 192 x 112 cm, inv. 51), est daté d'environ 1618-1620 (en 1618, le saint espagnol fut béatifié par le pape Paul V). Il provient de la sacristie de l'église médiévale Sant'Agostino d'Ancône, mentionnée par Marcello Oretti, qui visita Ancône en 1777. Deux effigies pendantes de Ladislas et de sa seconde épouse Marie Louise de Gonzague, créées dans le style de Spadarino ou de son atelier, ont été vendu à Rome en 2022. Aucun portrait signé de Spadarino n'est connu, donc peut-être tous ont-ils été détruits en Pologne-Lituanie ou sont en attente de découverte.
Portrait du prince Ladislas Sigismond Vasa (1595-1648) en costume hispano-italien par Giovanni Antonio Galli, dit lo Spadarino, ver 1624-1625, château de Kórnik.
Portraits de Ladislas Vasa en costume national et espagnol par Gaspar de Crayer et Pieter Claesz. Soutman
En 1633, le roi nouvellement élu Ladislas IV Vasa décida d'étonner les puissances d'Europe occidentale avec la richesse, la diversité et le charme oriental de la République polono-lituanienne. Le « Seigneur des Trois Couronnes », car en plus d'être élu monarque de la République, il était également le roi héréditaire titulaire de Suède et élu grand-duc titulaire de Moscou (Rè di Polonia, e Suetia eletto gran Duca di Moscovia) (à part l'emblème de la Suède), envoyé son ambassadeur Jerzy Ossoliński auprès du pape Urbain VIII, avec annonce officielle du couronnement et confirmation de sa loyauté envers le pape. La grande suite de l'ambassadeur, composée de 20 véhicules, 10 chameaux et un grand nombre de chevaux, bœufs et mulets, passant par Vienne, Trévise, Padoue et Bologne, arriva aux frontières de Rome le 20 novembre 1633. Le 27 novembre 1633, l'envoyé fait une magnifique entrée dans la Ville éternelle.
Cette splendide entrée a été immortalisée dans plusieurs tableaux ainsi que dans des gravures du dessinateur et graveur florentin Stefano della Bella (1610-1664), ainsi que dans la Relatione della solenne entrata ... de Virginio Parisi, domestique d'Urbain VIII, publié en deux éditions (en 1633 et 1634), dont une avec une dédicace à l'ambassadeur. D'après le récit de Parisi et les descriptions des estampes de della Bella, la suite comprenait des chameaux richement habillés conduits par des Perses et des Arméniens, vingt pages habillés de satin, des chevaux aux riches harnais dont cinq beaux chevaux turcs conduits par des Tartares et des Arméniens, avec de très superbes selles recouvertes d'or pur, de diamants, de rubis et de turquoises. La majorité des membres de la suite étaient vêtus de costumes nationaux. M. Kociszewski (Chociszewski ou Cochiszewsky), chamblain principal de l'envoyé, très probablement d'origine arménienne, était vêtu d'un riche costume persan (alla Persiana) et montait un cheval richement habillé avec des fers à cheval d'or et Jakub Zieliński, maréchal de la cour de l'envoyé tenait à la main une masse d'argent (mazza d'Argento in mano). Parisi ajoute que « chacun des chevaux avait sur la tête de gros bouquets de plumes de héron, et sur les jambes des fers à cheval en or massif, dont deux se brisaient en plusieurs morceaux au cours de leur marche, qui étaient pour la plupart des proies pour le peuple [de Rome] » (Haveva ciascuno de' Cavalli grossi mazzi d'Aironi in testa, et alle gambe, e piedi grosse maniglie, e ferri d'oro massiccio, doi de' quali nel camminare si ruppero in diversi pezzi, che per lo più furono preda del popolo). Plusieurs aristocrates espagnols (Diversi Signori Spagnoli), français (altri Cavalieri franzesi) et italiens ainsi que des courtisans des cours des cardinaux se sont joints au cortège. Puisque Rome était la capitale du monde chrétien pour les catholiques, cette entrée de propagande était dédiée non seulement aux Italiens mais aussi aux monarques d'Espagne et de France. Outre le prestige et le renforcement des alliances contre les ennemis de la République, le but était probablement aussi de favoriser l'arrivée de spécialistes car la République des nobles avait constamment besoin d'ingénieurs, d'architectes, d'artisans, d'artistes et même de soldats qualifiés pour protéger les frontières. Des aristocrates et des dignitaires fabuleusement riches de la République commandaient des articles de luxe dans les meilleurs ateliers à l'étranger, non seulement en Europe, mais aussi en Perse et en Turquie. En 1603, Jan Zamoyski (mort en 1614), archevêque catholique de Lviv, commanda à Istanbul vingt grands tapis décorés de ses armoiries et les fit don à la cathédrale de Lviv (d'après « Sztuka Islamu w Polsce ... » de Tadeusz Mańkowski, p.20). Le pays est devenu très riche grâce au commerce (céréales, bois, bétail, peaux d'animaux, chevaux, ambre, cochenille polonaise, hydromel, miel, cire et produits de luxe importés de l'Est), à l'exploitation du sel, du plomb, du soufre et du cuivre. Les tapis, killims et selles persans, les harnachements, harnais, tissus et armes turcs sont fréquemment mentionnés dans les inventaires avant 1655, ainsi que les verreries vénitiennes, les peintures et tapisseries italiennes, hollandaises et flamandes, l'argenterie d'Augsbourg et les icônes ruthènes et russes. Grâce à cette activité, ils ont soutenu de manière significative les économies, l'artisanat et le commerce étrangers. Pour répondre à la demande d'articles de style oriental, les ateliers arméniens de la République fabriquaient également de tels produits. Par exemple, l'inventaire de 1633 du château de Radziwill à Lubcha en Biélorussie (Archives centrales des documents historiques de Varsovie, 1/354/0/26/45) répertorie 16 selles riches différentes, certaines en velours, brodées d'or, décorées d'argent, rubis, turquoises et nacres, fabriqués principalement localement (domowey Roboty) et persans (Adziamskie), ainsi que 7 selles cosaques et 2 allemandes, 19 harnachements pour chevaux, fabriqués localement ou en Turquie (Rząd srebrny złocisty suty Turecki, cinq articles - 2, 3, 6, 7, 9) et de nombreux tapis persans. La diversité du pays se reflète également dans diverses pièces de monnaie. Dans le premier quart du XVIIe siècle, Piotr d'Ossa Ozhga (Piotr Ożga, décédé en 1622), référendaire de la couronne et staroste de Terebovlia, gardait dans son coffre 8 000 ducats, 270 pièces de 20 ducats portugaises (ou de style portugais), 700 doublons espagnols (ou de style espagnol), 1 000 pièces d'or de Moscou et 2 000 thalers. Une transaction commerciale (vente de bœufs) réalisée par le staroste de Sniatyn, Piotr Potocki (mort en 1648), lui rapporta 55 000 en or et les dots des riches nobles pouvaient aller de 25 000 à 400 000 en or (d'après « Obieg pieniężny ... » par Andrzej Mikołajczyk, p.129). La richesse de la République des nobles a provoqué une immense tragédie - le déluge (1655-1660) au cours duquel les pays voisins ont envahi le pays (du nord, du sud, de l'est et de l'ouest) avec une force supérieure et se sont livrés à un pillage et à une destruction qui a duré cinq ans. Les trésors de Skrwilno (découvert en 1961), Nieszawa (1963), Bydgoszcz (2018), Kiekrz à Poznań (1890) ou Nasvytaliai (1926) rappellent ces horribles événements. L'invasion a laissé la majorité du pays en ruines et considérablement appauvri, de sorte que de nombreuses structures n’ont jamais été reconstruites et ont été abandonnées. Alors que dans de nombreux pays européens, les visiteurs peuvent admirer de magnifiques châteaux et palais, en Pologne, les ruines des châteaux de Tenczyn, Krzyżtopór, Ogrodzieniec, Janowiec, Kazimierz Dolny, Tarnów, Pińczów, Siewierz, Bodzentyn, Kamieniec, Drzewica, Chęciny et d'autres lieux ne sont que des souvenirs de leur gloire passée. Certains châteaux et palais riches ont complètement disparu, comme le palais de Łowicz, les châteaux et palais royaux de Knyszyn, Radom et Kalisz. La destruction du patrimoine fut si considérable que de nombreux objets significatifs liés aux monarques de Pologne-Lituanie durent être acquis à l'étranger, comme une série de miniatures de la famille Jagellon par l'atelier de Lucas Cranach le Jeune achetée à Londres au milieu du XIXe siècle par Adolf Cichowski (Musée Czartoryski). En 1648, le peintre hollandais Pieter Claesz. Soutman (mort en 1657) a créé un tableau intéressant pour la salle dite d'Orange (néerlandais : Oranjezaal) du palais Huis ten Bosch à La Haye (signé : P. Soutman. F. 1648.). Il est issu d'une série de tableaux réalisés par différents peintres hollandais et flamands glorifiant Frédéric-Henri (1584-1647), prince d'Orange et son épouse Amélie de Solms-Braunfels (1602-1675). Le tableau de Soutman représente une procession triomphale avec des butins de guerre, notamment les œuvres d'art en or et en argent. Un tableau similaire de Salomon de Bray, réalisé deux ans plus tard (signé : SDBray - 1650) représente un cortège triomphal avec les armes capturées. On ne sait pas si le triomphe fait référence à un événement particulier. Dans certaines peintures du cycle, il y a une référence à l'empire espagnol - bannière dans la procession avec les porte-étendards de Pieter de Grebber (signé : P. DGrebber Ao 1648) et au Saint-Empire romain germanique - bannière impériale dans la procession avec des musiciens et bannières capturées par Salomon de Bray (signé : SD:Bray. - 1649). Ces tableaux pourraient faire référence à la bataille de Prague, survenue entre le 25 juillet et le 1er novembre 1648, à la suite de laquelle une partie de la fabuleuse collection d'art des parents de Ladislas IV, rassemblée au château de Prague par l'empereur Rodolphe II (1552-1612), a été pillé et expédié en Suède. Dans le tableau de de Bray de 1650, on peut voir des mercenaires allemands (Landsknecht) portant un butin composé d'armures et de casques à l'italienne, de carquois de flèches et menant des chevaux orientaux, comme en référence à l'estampe de della Bella montrant les pages de l'envoyé de la République en 1633 (lettre I). Le titre original du tableau de Soutman est « Procession triomphale des armes conquises, bols, bassins et grande coupe en argent, femme couronnée avec un chandelier en argent devant » (Triomftocht van de veroverde wapens, zilveren schalen, bekkens en grote beker, een bekranste vrouw met zilveren kandelaar voorop). Il fut réalisé dans l'atelier du peintre à Haarlem avant décembre 1648 et il fut payé 500 florins. Parmi les armes dans le tableau, on peut voir le signe SPQR - « Le sénat et le peuple romain » (Senatus Populusque Romanus), bien que continué à être utilisé sous l'empire romain, cette expression abrégée fait généralement référence à l'ancienne République romaine. L'homme en sueur à droite pourrait être Hercule et les statues en or que tiennent les enfants font probablement référence aux coutumes romaines d'adorer divers dieux sous la forme de petites statues (d'après « Oranjezaal » de Charles Julien, p. 26). La composition pourrait donc être interprétée comme un triomphe sur le paganisme antique ou le pluralisme démodé. L'élément le plus intrigant de ce tableau est cependant le casque qui couronne la composition avec un vase doré. Un casque presque identique était représenté dans deux portraits peints par Soutman et son atelier quelques années plus tôt. Tous deux représentent Ladislas IV Vasa lorsqu'il était prince héritier et portant le costume national - l'un au palais de Wilanów (huile sur toile, 206 x 127,5 cm, Wil.1134) et l'autre au musée historique de Lviv - palais Korniakt, tous deux probablement du fin des années 1620 ou début des années 1630. De tels portraits étaient généralement réalisés en série comme cadeaux pour différentes cours d'Europe. Les inventaires des collections du Coudenberg à Bruxelles de 1643, 1659 et 1692 mentionnent plusieurs portraits du Prince en armure ou costume polonais ou hongrois (à comparer « Rubens w Polsce » de Juliusz Chrościcki, p. 214-215). Dans la collection d'Henry Metcalfe, au milieu du XIXe siècle, il y avait probablement un portrait similaire de Ladislas en costume national rouge. Il est possible qu'un tel tableau de Soutman ait également été retrouvé à La Haye. Le costume du prince a probablement inspiré un peintre qui a créé la scène biblique de Ruth dans le champ de Boaz, aujourd'hui conservée à la Galerie nationale du Danemark (huile sur toile, 124 x 163,5 cm, KMSsp356). Ce tableau est attribué à Adam Camerarius, actif à Groningue et à Amsterdam dans les années 1640 (également attribué à Pieter de Grebber et Soutman). L'histoire biblique du grand-père du roi David et de la récolte d'orge semble parfaitement adaptée au paysage de la République, le pays autrefois appelé le « Paradis des Juifs » (Paradisus Judæorum) et le « Grenier de l'Europe » (Granarium Europæ) (parfois rétréci à Gdańsk, qui était le port principal du pays). Le casque, inspiré du persan kulah khud, était typique des hussards ailés polono-lituaniens et était représenté dans le tableau de Gołuchów, frontispice de Florus Polonicus par Joachim Pastorius, publié à Leyde en 1641, et dans le soi-disant « Rouleau de Stockholm », datant d'environ 1605. Le casque figurait dans le portrait du prince car il constituait un symbole important, un symbole de la force militaire de la République. L'inclusion d'un tel objet dans le tableau de la Huis ten Bosch était également symbolique, tout comme d'autres éléments de la composition. Le 20 mai 1648, Ladislas IV décède et le 17 novembre de la même année, son demi-frère Jean Casimir Vasa est élu nouveau roi. Parmi les peintures importantes de la salle d'Orange se trouve un portrait du gendre de Frédéric-Henri, Frédéric-Guillaume (1620-1688), électeur de Brandebourg, peint avec son épouse par Gerard van Honthorst (signé : GHonthorst 1649). Mais aujourd'hui, on ne peut que supposer que l'électeur, vassal de la République, qui connaissait parfaitement les faiblesses du pays et qui, lors du déluge (en 1656), selon Wawrzyniec Jan Rudawski, « a emporté en Prusse comme butin, les peintures les plus précieuses et l'argenterie de la table royale », planifiait ou anticipait déjà en 1648 le grand pillage des « conquérants du Nord » après 1655 (y compris lui-même) et le suggéra à ses alliés hollandais. Soutman, qui « devrait aussi être reconnu comme un peintre royal en Pologne » (Petrus Soutman co nomine celebrandus quoque, quod regius Pictor in Polonia fuerit), selon Theodori Schreveli Harlemum, sive vrbis Harlemensis incunabula, publié à Leyde en 1647 (p. 290) est généralement considéré comme le peintre de la cour de Sigismond III Vasa entre 1624 et 1628. Peut-être que le peintre Peter, mentionné dans les récits de la cour de Sigismond III, qui fut apparemment payé 315 florins pour la préparation des peintures (réalisées du 1er novembre 1626 au 30 novembre 1627), était Soutman. De retour dans sa ville natale de Haarlem le 20 octobre 1628, il demanda aux autorités administratives des Pays-Bas espagnols l'autorisation d'apporter une caisse contenant des peintures de Pologne pour l'infante Isabelle. Il s'agissait très probablement de portraits de la famille de Sigismond III, mentionnés dans les inventaires du Coudenberg, qui étaient accrochés dans les pièces les plus importantes de la résidence bruxelloise, principalement dans la Grande Galerie construite par la régente des Pays-Bas, Marie de Hongrie (d'après « Świat polskich Wazów: eseje », p. 48, 287). Bien que la majorité des peintures de la période Vasa réalisées en Flandre ou dans le style flamand soient attribuées à Soutman et Rubens ou leurs ateliers, parce que leurs contacts avec les monarques de Pologne-Lituanie sont confirmés dans les sources, le portrait du prince Ladislas Sigismond en costume national, conservée au Musée Czartoryski (huile sur toile, 198 x 118 cm, MNK XII-353), rappelle les œuvres d'un autre peintre éminent des Pays-Bas espagnols - Gaspar de Crayer. Son style rappelle particulièrement plusieurs effigies du cousin de Ladislas, le roi Philippe IV d'Espagne, comme le portrait en armure de parade du Metropolitan Museum of Art (45.128.14), le portrait avec un nain du Palacio de Viana à Madrid ou le portrait équestre de l'Alte Pinakothek de Munich (2529), peut-être issu de la dot de la demi-sœur de Ladislas. Les effigies des membres de la famille étaient fréquemment échangées avec l'Espagne et commandées aux mêmes peintres. Pour le baptême d'Anna Catherine Constance en 1619, sa mère, la reine Constance d'Autriche, réussit à obtenir des portraits d'enfants de la cour de Madrid et en 1624, afin d'actualiser la galerie familiale, la reine lança une autre grande campagne et ordonna le peintures à Vienne. Deux autres portraits de Ladislas Sigismond en costume national, également proche de de Crayer et de son atelier, se trouvent aujourd'hui au Palais Pitti à Florence (huile sur toile, 135 x 98, Inv. 1890, 5178 et huile sur toile, 131,5 x 90, Inv. 1890, 5673). Les deux sont considérés comme des effigies du roi Michel I Korybut Wiśniowiecki (1640-1673) et ont été correctement identifiés par moi en 2012. Les peintures étaient probablement des cadeaux à la tante du prince Marie-Madeleine d'Autriche (1589-1631), à la grande-duchesse de Toscane ou à d'autres ducs italiens. Un autre portrait similaire de la collection d'Izydor Czosnowski (1857-1934) se trouvait avant 1961 à l'Ambassade de la République de Pologne auprès le Saint-Siège (reproduit dans « Elementa ad Fontium Editiones », tome III, Tab. I-III), avec deux autres tableaux du même collection - portrait de la reine Marie-Louise de Gonzague (1611-1667) datant d'environ 1650 et portrait d'un prince de profil (une copie du tableau maintenant à l'Académie de San Luca à Rome, 298), identifié comme le portrait de Jean Casimir Vasa, mais très probablement représentant le cousin de Ladislas IV et de Jean Casimir - Giancarlo de' Medici (1611-1663), fréquemment représenté dans des costumes polono-lituaniens dans son enfance. En 1976, Léon, le fils d'Izydor, fait don de plusieurs tableaux de la collection de son père à l'hospice polonais à Rome, dont le portrait du prince (huile sur toile, 133 x 95 cm, d'après « Kościół polski w Rzymie ... » de Józef Skrabski, p. 294, 296). Le plus grand contraste de nuances et de couleurs dans le portrait du prince de la collection Czosnowski et la plus grande ressemblance avec la peinture de Soutman à Wilanów indiquent que lui ou plus probable son atelier en étaient les auteurs. De nombreux magnats de la République possédaient également des effigies royales, sans doute créées par les meilleurs peintres. L'inventaire des tableaux de la collection de la princesse Louise Charlotte Radziwill (1667-1695), dressé en 1671, recense deux portraits du jeune Ladislas, qui pourraient être des tableaux de Soutman ou de Crayer, cependant les noms des peintres ne sont pas mentionnés - « Le roi Ladislas à la polonaise, quand il était jeune » (157/8) et « Le prince Ladislas à la polonaise avec une masse » (191/17) (d'après « Inwentarz galerii obrazów Radziwiłłów z XVII w. » de Teresa Sulerzyska). Le nombre relativement restreint de peintures conservées illustre également l'ampleur de la destruction du patrimoine de la République. Dans le palais de Wilanów se trouve également un autre portrait intrigant de Ladislas, attribué à l'école hollandaise du XIXe siècle (huile sur toile, 65,6 x 54 cm, Wil.1394). Il est également très proche du style de Soutman (notamment la façon dont les cheveux de sa moustache étaient peints et le contraste des couleurs et des nuances), comparable aux tableaux signés par ce peintre, comme le cortège triomphal mentionné à La Haye ou un jeune homme tenant un bâton à la National Gallery of Art de Washington (2010.19.1, signé : P. Soutman / F.A. 1640) et des œuvres attribuées, comme le portrait de femme tenant un gant au Mauritshuis de La Haye (numéro d'inventaire 755). Ladislas est plus âgé dans ce portrait que dans les autres effigies mentionnées. Il porte un costume espagnol et cette image ressemble beaucoup aux portraits du cousin de Ladislas, le roi Philippe IV d'Espagne, peints par l'atelier de Diego Velázquez vers 1656 (Musée de l'Ermitage, ГЭ-297 et Académie royale des beaux-arts de San Fernando à Madrid, 0634) ou un portrait antérieur, peint vers 1632 (Kunsthistorisches Museum, GG 314). L'image du roi de Pologne devrait être datée d'environ 1634, lorsqu'il intensifia ses contacts avec l'Espagne et envoya Jerzy Sebastian Lubomirski (1616-1667) comme ambassadeur. L'inventaire des biens de la reine Marie-Louise de Gonzague, dressé trois mois après sa mort, le 27 septembre 1667, recense un « le portraict du Roy de Pologne à cheval à l'Espagnole ». Il s'agissait probablement d'une effigie de son premier (Ladislas IV) ou de son deuxième mari (Jean Casimir) en costume espagnol.
Portrait du prince Ladislas Sigismond Vasa (1595-1648) en costume national par Gaspar de Crayer, 1624-1632, Musée Czartoryski.
Portrait du prince Ladislas Sigismond Vasa (1595-1648) en costume national par Gaspar de Crayer ou atelier, 1624-1632, Palais Pitti à Florence.
Portrait du prince Ladislas Sigismond Vasa (1595-1648) en costume national par l'atelier de Gaspar de Crayer, 1624-1632, Palais Pitti à Florence.
Portrait du prince Ladislas Sigismond Vasa (1595-1648) en costume national par l'atelier de Pieter Claesz. Soutman, 1624-1632, Hospice polonais à Rome.
Portrait du prince Ladislas Sigismond Vasa (1595-1648) en costume national par Pieter Claesz. Soutman, 1624-1632, Palais de Wilanów à Varsovie.
Portrait du roi Ladislas IV Vasa (1595-1648) en costume espagnol par Pieter Claesz. Soutman, vers 1634, Palais de Wilanów à Varsovie.
Ruth dans le champ de Boaz par Adam Camerarius ou Pieter Claesz. Soutman, années 1640, Galerie nationale du Danemark.
Procession triomphale avec butin de guerre par Pieter Claesz. Soutman, 1648, Palais Huis ten Bosch à La Haye.
Portraits de Sigismond Guldenstern (Le Cavalier souriant) par Frans Hals et Bartholomeus Milwitz
En 1623, Sigismond Guldenstern (1598-1666), également connu sous le nom de Zygmunt Guldensztern ou Sigismund Güldenstern, se rendit avec son frère aîné Johan (1597-1658) à Leyde aux Pays-Bas, où ils s'inscrivirent dans la célèbre université le 27 février de la même année. On ne sait pas combien de temps ils y restèrent, mais en 1626 Johan devint chambellan de Marie-Éléonore de Brandebourg (1599-1655), reine de Suède, et Sigismond retourna en Pologne-Lituanie.
Sigismond Guldenstern est le fils de l'amiral suédois Johan Nilsson Gyllenstierna (1569-1617) de la branche Lundholm de la famille noble dano-suédoise et de son épouse la comtesse Sigrid Brahe (1568-1608). Son père s'est rangé du côté de Sigismond III Vasa et après la déposition du roi en Suède, il a émigré vers la République polono-lituanienne avec toute sa famille. Il a probablement aussi donné à son fils le nom du roi. Ils se sont installés dans la ville royale de Toruń, qui était l'une des villes les plus grandes et les plus influentes de la Prusse polonaise (voïvodie de Chełmno) et jouissait du droit de vote aux élections royales libres. Parce que la région était dominée par la communauté germanophone, ils ont commencé à utiliser leur nom de famille sous la forme allemande - Guldenstern, qui dérive de leurs armoiries, une étoile d'or à sept branches. Avant de partir à l'étranger, le jeune Guldenstern fréquente le gymnase académique de Toruń (Schola Thoruniensis) et, en février 1615, s'inscrit avec son frère pour étudier à l'université de Rostock. Plus tard, avant d'arriver à Leyde, il fréquente également l'université de Strasbourg. Durant ses études, il a appris plusieurs langues étrangères. Après son retour dans la République au milieu des années 1620, il servit comme courtisan à la cour du roi Sigismond III et fut nommé gardien du lit royal - łożniczy (responsable de la chambre royale). En 1633, lors du Sejm de couronnement, il reçut du nouveau roi Ladislas IV un indigenat (naturalisation), c'est-à-dire une reconnaissance de noblesse étrangère dans la République, après quoi il acquit tous les droits et libertés des nobles locaux. Tout au long de sa vie, il entretint des relations cordiales avec la maison régnante de Pologne-Lituanie et la lettre de la princesse-infante Anna Catherine Constance Vasa (1619-1651), écrite en polonais de Vilnius le 14 juillet 1636, en est un bon exemple. En 1636, avec Christophe Radziwill (1585-1640), voïvode de Vilnius et Andrzej Rej (mort en 1641), starost de Libusza, il présida les funérailles de la princesse-infante Anna Vasa (1568-1625), tante du roi Ladislas IV, à Toruń, à l'église luthérienne. Il s’agissait de la dernière manifestation politique d’une telle ampleur de dissidents dans la République. En raison de différences religieuses, le roi lui-même n'a pas participé aux funérailles (d'après « Listy Anny Wazy (1568-1625) », p. 47). La religion, qui à l'époque précédente n'était pas un obstacle dans un pays où les chrétiens orthodoxes et les juifs dominaient dans de nombreuses régions, les protestants étaient sénateurs, envoyés et fonctionnaires importants, les catholiques épousaient des orthodoxes, des luthériens ou des calvinistes, en raison de l'influence de la Contre-Réforme et des Habsbourg à la cour royale, devint souvent un obstacle pendant les Vasa. Très probablement en 1627, à Varsovie, Sigismond épousa la fille de Fabian Czema (décédé en 1636), châtelain de Chełmno et staroste de Sztum, Anna Czemówna (1599-1673). Elle était l'héritière de grands domaines de Cachoubie, transformés par son père et sa mère Katarzyna Leszczyńska en centres du calvinisme. En mariant sa fille unique à un luthérien, Fabien l'obligea par un contrat de mariage à entretenir des prédicateurs calvinistes dans les domaines d'Anna (d'après « Bracia czescy w Wielkopolsce ... » de Jolanta Dworzaczkowa, p. 105). L'inventaire du trousseau de Czemówna - « Registre des choses que Sa Seigneurie le Seigneur de Chełmno, certaines pour lui-même, certaines pour sa fille, Mlle Anna Cemianska, a pris de Toruń en 1627, le 20 mai, certaines avec elle (y compris les bijoux) lorsque aller en Pologne [la Couronne] depuis Toruń [Prusse polonaise] il y a un an » (Spisanie rzeczy, ktore Jego Mość Pan chełminski częścią dla siebie, częścią dla Corki swey Jej Mci Panny Anny Cemianskey Roku 1627 d 20. Maja z Torunia wiosł, częścią tej z sobą (jako niektore kleinoty) przed rokiem z Torunia jadąc do Polski wzięła) aux Archives d'État de Toruń (69/833/0/16.4/498, p. 157-162), énumère un grand nombre de bijoux et d'autres objets de valeur, tels que des médailles d'or à l'effigie de Rafał Leszczyński (1579-1636), voïvode de Belz et celle de la Dame de Vilnius, très probablement Élisabeth Radziwill (1583-1611), épouse de Lew Sapieha (1557-1633), des cuillères et fourchettes en or, 9 « cols flamands » et « deux tapis persans rouges pour Madame en route vers Varsovie » (Odlewka twarzy na złocie duże Jedna Jego Mci Pana Wojewody Bełskiego, Druga Xięzney Pani Wilenskey [...] Złota łyszka, Złote widelice, [...] Flamskich kołnierzów No. 9, [...] Dwa Kobierce Adziamskie czerwone dla Jej Mci w drogę do Warszawy). Les tableaux et autres ustensiles ménagers, tels que les casseroles et le linge de maison, étaient probablement inventoriés séparément ou non répertoriés car considérés comme de moindre valeur. Aujourd'hui, rien n'a conservé en Pologne de cette grande richesse, ni aucune effigie. Pendant le déluge (1655-1660), les Suédois pillèrent et incendièrent les domaines de Guldenstern, y compris l'église luthérienne de Jasna près de Dzierzgoń (d'après « Protestanci w dobrach prywatnych ... » d'Aleksander Klemp, p. 119). Compte tenu de son éducation à l'étranger ainsi que de sa position importante à la cour, les effigies de Sigismond devaient être nombreuses et splendides. Le plus connu des biens meubles de la famille est le tapis dit Kretkowski-Guldenstern conservé au Musée national bavarois de Munich (inv. 1612). Il a très probablement été réalisé dans des ateliers arméniens de la République ou en Turquie à l'occasion du mariage de Jan Kazimierz Kretkowski et Katarzyna Lukrecja Guldensztern, fille de Sigismond et Anna Czemówna, peut-être comme élément de son trousseau et orné de leurs armoiries (elle épousa Kretkowski en janvier 1670). En 1624, alors que Sigismond étudiait probablement encore à Leyde, Frans Hals l'Ancien (1582/83-1666), peintre actif dans la ville voisine de Haarlem, peignit son célèbre portrait du Cavalier souriant également connu sous le nom de Chevalier hollandais (De Hollandse ridder), aujourd'hui dans la Wallace Collection à Londres (huile sur toile, 83 x 67,3 cm, P84). La provenance du tableau remonte à la collection de Johan Hendrik van Heemskerk (1689-1730) à La Haye, puis à Amsterdam, Paris et enfin à Londres. Les stathouders de la République néerlandaise avaient leur résidence à La Haye, la provenance de leurs collections est donc possible. Une copie de ce tableau réalisée par un autre peintre et montrant des différences de costumes, datée vers 1630, a été vendue en 2010 à Londres (huile sur panneau, 69,7 x 59,8 cm, Bonhams, 7 juillet 2010, lot 34). Pendant plus d'un siècle, lorsque le tableau est devenu célèbre sous son titre actuel, l'identité du modèle n'a pas été établie avec certitude, ce qui indique qu'il n'était pas néerlandais comme beaucoup le pensent. L'historien de l'art Pieter Biesboer a suggéré que le tableau pourrait représenter le marchand hollandais de lin et de soie Tieleman Roosterman (1598-1673), qui avait le même âge que le modèle et qui fait également l'objet d'un autre portrait de Hals, peint en 1634, aujourd'hui au Cleveland Museum of Art (1999.173). Cependant, les différences dans la physionomie de son visage sont évidentes : Roosterman a un nez plus grand, plus de cheveux et une couleur d'yeux différente. De telles différences seraient possibles si les portraits avaient été peints par des peintres différents, qui d'ailleurs n'auraient pas vu le modèle réel et copié d'autres effigies, mais Roosterman était l'un des citoyens les plus riches de Haarlem, à l'époque où Hals y vivait. Alors que dans le portrait de Roosterman peint en 1634 son costume est plutôt typique d'un marchand, le pourpoint richement brodé du « Cavalier souriant » indique qu'il s'agit plutôt d'un aristocrate fortuné (ou se faisant passer pour tel), comme Janusz Radziwill (1612-1655), dont le portrait en riche costume français fut peint à Leyde par David Bailly vers 1632 (Musée national de Wrocław, VIII-578). Un riche noble portant un costume similaire se promène dans la forêt avec sa femme vêtue d'un costume typique de Gdańsk dans un dessin tiré du livre d'amitié (album amicorum/Stammbuch) de Heinrich Böhm de Namysłów, réalisé entre 1627 et 1633 (Bibliothèque de Kórnik, BK01508). Le catholique Gabriel Kilian Ligęza de Bobrek était représenté dans un costume similaire sur la gravure de sa thèse, réalisée par Schelte Adamsz. Bolswert en 1628 (British Museum, 1858,0417.1259), ainsi que Christophe Michel Sapieha/Sapega (1607-1631) dans son portrait peint en 1709 d'après l'original datant d'environ 1631 (Château royal du Wawel, 9150). Il a également été proposé que le portrait pourrait être un portrait de fiançailles, comme le suggèrent les emblèmes associés à la fortune, à la force, à l'amour et à la vertu (flèches, cornes d'abondance enflammées et nœuds d'amoureux), brodés sur son costume. Un si bon portrait aiderait l'homme à faire carrière à la cour et à obtenir la main d'une riche héritière. D'après l'inscription latine dans le coin supérieur droit, l'homme du portrait de Hals avait 26 ans en 1624 (Æ'TA. SVÆ 26 / A° 1624), exactement comme Sigismond Guldenstern, lorsqu'il visita probablement Haarlem avant son mariage avec Czemówna. Malgré le fait que le peintre voulait voir ses modèles, et pour son grand tableau connu sous le nom de « La maigre compagnie » en mars 1636, il promit d'achever le tableau rapidement, à condition que les seize miliciens du XIe arrondissement d'Amsterdam viennent à Haarlem (Rijksmuseum, SK-C-374), lui et son atelier ont également peint des personnages que le peintre n'a probablement jamais rencontrés en personne, comme le philosophe français René Descartes (1596-1650), qui a vécu aux Pays-Bas entre 1628 et 1649. Bien qu'il existe aucune trace de leur rencontre, les portraits de Descartes au Louvre (INV 1317 ; MR 738) et au Statens Museum for Kunst à Copenhague (DEP7) sont attribués à l'atelier de Hals ou à un suiveur et l'original peint par Hals, considéré comme perdu, a été gravé par Jonas Suyderhoef vers 1650 (Rijksmuseum, RP-P-OB-60.717, signé : F. Hals pinxit). Parce que l'original du « Cavalier souriant » a été peint à Haarlem, la copie ultérieure vendue en 2010 a été attribuée à l'école de Haarlem, cependant, le style de ce tableau ressemble beaucoup aux peintures attribuées à Bartholomeus Milwitz (vers 1590-1656), peintre probablement originaire de Poméranie occidentale, actif à Gdańsk à partir de 1615. Le 18 novembre 1606, il épousa Geertruyd Arnouts de Bois-le-Duc et entre 1626 et 1629, pendant la guerre polono-suédoise, il vécut à Amsterdam. Vers 1633, il peint le splendide portrait de Ladislas IV Vasa en robe de couronnement, aujourd'hui conservé au Château royal de Varsovie comme dépôt du Musée national de Varsovie (huile sur toile, 150 x 116 cm, MP 4982). Le portrait du roi provient de la collection du dernier monarque élu de la République Stanislas Auguste Poniatowski (n° 181) et a été acheté à Roman Potocki en 1950. Le portrait du conseiller de Gdańsk Salomon Giese (1590-1651) au Musée de Gdańsk (MHMG/S/17), est également attribuée à Milwitz et son style est très similaire à celui vendu à Londres. Outre les portraits, Milwitz a également peint de grands paysages et des scènes batalistiques, comme la bataille d'Oliwa de 1627 à la mairie principale de Gdańsk, peinte en 1649 et très probablement détruite pendant la Seconde Guerre mondiale. De magnifiques peintures représentant l'entrée de la reine Marie-Louise de Gonzague à Gdańsk le 11 février 1646, aujourd'hui au château de Wawel (ZKnW-PZS 5520 et ZKnW-PZS 6934), sont également attribuées à Bartholomeus. Comme pour les portraits de Descartes, Hals et son atelier ont très probablement créé plusieurs versions et copies du portrait de 1624, dont l'une a ensuite été copiée par Milwitz.
Portrait de Sigismund Guldenstern (1598-1666), âgé de 26 ans par Frans Hals, 1624, Wallace Collection à Londres.
Portrait de Sigismond Guldenstern (1598-1666) par Bartholomeus Milwitz, vers 1630, Collection particulière.
Portrait du roi Ladislas IV Vasa (1595-1648) en robe de couronnement par Bartholomeus Milwitz, vers 1633, Château royal de Varsovie.
Portraits de Sigismond III Vasa et Ladislas Sigismond Vasa par Gaspar de Crayer
En 2009, un portrait de Mechteld Lintermans (décédée en 1641) et de ses deux enfants a été mis aux enchères à New York (huile sur toile, 231,1 x 130,8 cm, Sotheby's, 4 juin 2009, lot 15). Ce tableau est considéré comme le pendant de l'un des deux portraits en pied connus du mari de Mechteld, Jan Bierens (1591-1641), agent artistique de Ladislas IV Vasa (1595-1648), monarque élu de la République polono-lituanienne.
L'un de ces portraits de Bierens, en cuirasse, figurait avec le portrait de son épouse dans la collection Sulley à Londres, jusqu'à ce qu'ils soient vendus en lots séparés en 1934. L'autre, aujourd'hui conservé à l'Arnot Art Museum de New York (huile sur toile, 235 x 135 cm), provient de la collection du baron Maximilian van Erp à Rome. Les effigies de Bierens et de son épouse ont une composition et des dimensions similaires. Le portrait de Mechteld a été attribué à divers peintres flamands, comme Antoine van Dyck, entourage de Pieter Claesz. Soutman et Cornelis de Vos. La pièce complémentaire, représentant Bierens, n'est pas d'aussi belle qualité que celle de sa femme et a été attribuée à un autre artiste de moindre importance que de Vos. Erick Duverger, dans son article de 1995 sur Bierens, suggère qu'Abraham van Diepenbeeck (1596-1675), le parrain de Maria Bierens, pourrait être l'auteur probable du portrait de Mechteld. « Cependant, même si Diepenbeeck était connu pour peindre des miniatures de la famille, il n'était jamais connu pour avoir peint des compositions de grand format telles que la présente toile ». Le portrait de Bierens à New York est également attribué à Diepenbeeck, tandis que l'effigie de son épouse était proposée à la vente avec attribution à Gaspar de Crayer (1584-1669), en raison de ses « liens avec la cour, de son patronage par la classe supérieure et la prédominance des portraits formels en pied dans son œuvre » (d'après la note de catalogue d'Amy Walsh). De Crayer était un artiste prolifique s'inspirant de ses différents homologues, dont Rubens, van Dyck et Cornelis de Vos, ainsi que des maîtres vénitiens du XVIe siècle, en particulier Titien et Paolo Véronèse. Comme Rubens, il coopère également avec des peintres spécialisés dans certains domaines, comme Peter Snayers, peintre connu pour ses scènes de bataille panoramiques (le paysage du portrait du comte-duc d'Olivares par de Crayer est attribué à Snayers). Bien que né à Anvers, de Crayer a vécu et travaillé à Bruxelles pendant la majeure partie de sa vie. À partir de 1612, il était au service de l'archiduc Albrecht VII d'Autriche et de l'infante Isabelle-Claire-Eugénie d'Espagne et de leurs successeurs - le cardinal-infant Ferdinand d'Autriche (1609-1641) et l'archiduc Léopold Guillaume d'Autriche (1614-1662), parents de Ladislas IV. En 1641, il fut nommé peintre de la cour du cousin de Ladislas, le roi Philippe IV d'Espagne. De Crayer a également créé un grand nombre de retables pour des églises, des monastères et des abbayes tout au long de sa carrière. Semblable à Jan Brueghel l'Ancien, de Crayer s'est également engagé dans des activités d'agent artistique pour ses mécènes, les Habsbourg. En 1619, Brueghel, peintre de natures mortes de fleurs et de tableaux de cabinet, fut libéré des douanes par Albert d'Autriche pour des peintures réalisées pour Sigismond III, dont 9 portraits de monarques européens, qui pourraient être de Crayer ou Rubens. Entre 1640 et 1645, Gaspar achète des œuvres d'art du domaine de Rubens pour Philippe IV. Il reçut de nombreuses commandes et possédait un grand atelier, où il forma un grand nombre d'élèves qui retouchèrent et complétèrent partiellement les œuvres de Crayer, parmi lesquels vraisemblablement Anselm van Hulle, Jan Boeckhorst, Nicolas de Liemaeckere, Antoon van den Heuvel, François Duchatel, Jacques d'Artois, Lodewijk de Vadder, Pieter Boel, Jan van Cleve (III) et François Monnaville. Bien que, selon des sources connues, il n'ait probablement jamais quitté les Pays-Bas espagnols, un nombre considérable d'effigies de personnes qu'il n'a probablement jamais rencontrées en personne lui sont attribuées. Il s'agit notamment du portrait de l'impératrice Anne du Tyrol (1585-1618), candidate au mariage du roi Sigismond III en 1603, peint vers 1612 (Nationalmuseum de Stockholm, NM 408), du roi Philippe IV avec un nain, d'environ 1627- 1632 (Palais de Viana à Madrid) et en armure de parade, datant d'environ 1628 (Metropolitan Museum of Art, 45.128.14) et portrait mentionné de Don Gaspar de Guzmán (1587-1645), comte-duc d'Olivares à cheval, peint entre 1627-1628 (The Weiss Gallery en 2018). Olivares était un favori royal (valido) de Philippe IV. Les portraits équestres sont fréquents dans son œuvre et lui et son atelier ont réalisé de nombreuses versions et copies de ces effigies. Vers 1635-1640, il réalise plusieurs versions du portrait équestre du cardinal-infant Ferdinand. Le portrait du roi Philippe IV à cheval du château de Neubourg, peint vers 1628, pourrait provenir de la dot de la sœur de Ladislas, Anna Catherine Constance Vasa (Alte Pinakothek de Munich, 2529). A cette époque, il peint également le portrait équestre de Don Diego Felipez de Guzmán (1580-1655), 1er marquis de Leganés (Kunsthistorisches Museum de Vienne, GG 9112), tandis que Cornelis de Vos réalise un portrait de Sigismond III à cheval (Nationalmuseum de Stockholm, NMGrh 2012), tous deux inspirés du portrait du duc de Lerma peint par Rubens en 1603 et du portrait de Don Rodrigo Calderón, comte d'Oliva vers 1612-1615. Le portrait du prince héritier Ladislas Sigismond Vasa (plus tard Ladisalus IV) à cheval, très similaire dans son style et sa composition au portrait équestre d'Olivares, se trouve aujourd'hui au château de Wawel (huile sur toile, 262 x 188,5 cm, 6320). La toile fut achetée à Londres par Julian Godlewski, demeurant à Lugano, et offerte aux collections du Wawel en 1977. Du 6 septembre au 14 octobre 1624, le prince, voyageant incognito et accompagné d'une quarantaine de personnes, séjourna à Bruxelles, Anvers, au camp de Breda et de nouveau à Bruxelles où il rencontre Rubens. Les dessins préparatoires pourraient être réalisés lors de cette visite, mais ils pourraient aussi être empruntés à Rubens ou envoyés de Pologne-Lituanie. Ce qui est intéressant dans ce portrait et l'effigie du père du prince par de Vos, c'est que le peintre a également utilisé le même ensemble de dessins d'étude que dans le portrait de l'archiduc Albert VII d'Autriche avec une vue d'Ostende. La version originale, que l'on croit perdue, est très probablement le tableau documenté par Jan Brueghel l'Ancien en 1617 dans une Allégorie de la vue (Prado, P001394). Alors que l'original dans le tableau de Brueghel apparaît plutôt proportionné, dans les copies, probablement réalisées par l'atelier de Gaspar de Crayer, la tête et la main de l'archiduc n'ont pas été habilement ajoutées et il a un aspect grotesque (vendu au Dorotheum de Vienne, le 10 octobre 2016, lot 87 et collections du prince de Liechtenstein, GE 402). Si toutes ces peintures ont été réalisées à l'origine pour le Coudenberg à Bruxelles, comme le pensent certains auteurs, les gouverneurs des Pays-Bas espagnols possédaient une collection assez particulière d'effigies de différents monarques où seuls quelques détails différaient. Compte tenu de l'énorme destruction de l'art en Pologne lors de nombreuses guerres et invasions, on ne peut également exclure qu'une effigie de Sigismond III soit l'original et non celle d'Albert VII. Le portrait de Bierens conservé au Musée d'Art d'Arnot est comparable dans son style à toutes les œuvres mentionnées de de Crayer. Sa composition rappelle un autre tableau de lui - portrait du cardinal-infant Ferdinand conservé au Musée du Prado à Madrid, daté de « 1639 » (P001472). Un tableau similaire dans son style et sa composition (colonne torsadée baroque, paysage, tissu) aux effigies de Bierens et de son épouse est le portrait du roi Sigismond III Vasa du château de Neubourg, aujourd'hui conservé à l'Alte Pinakothek de Munich (huile sur toile, 220,5 x 138,2 cm, 4576). Il provient probablement aussi de la dot d'Anna Catherine Constance, la fille du roi. Sigismond était représenté avec une collerette, une armure et des hauts-de-chausses de style espagnol. Le portrait du duc Jean II de Bragance (1604-1656), futur Jean IV du Portugal, au Château royal de Varsovie, déposé par la Fondation Ciechanowiecki (huile sur toile, 224 x 147 cm, ZKW-dep.FC/25), est semblable au portrait de Sigismond, tant en termes de technique que de composition. Le portrait du duc ressemble quant à lui au style de Saint Benoît recevant Totila, roi des Ostrogoths dans l'église Notre-Dame-Saint-Pierre de Gand par Gaspar de Crayer. Les liens entre la République et l'Espagne à cette époque étaient forts, ce qui se reflétait dans la littérature (par exemple La vida es sueño de Pedro Calderón de la Barca, créée en 1635) et dans la mode. Les Polonais de la cour royale portaient fréquemment des vêtements espagnols, tandis que l'un des types de hauts-de-chausses populaires en Espagne à cette époque était les hauts-de-chausses de style polonais (calzas a la polaca de rayas transversales) (d'après « Glosario de voces de armería » d'Enrique de Léguina, p. 194). Même la « mode » des favoris de la cour (validos) a été imitée, intentionnellement ou non, en Pologne-Lituanie. Philippe III d'Espagne, beau-frère de Sigismond III, avait pour valido le duc de Lerma, auquel succéda le comte-duc d'Olivares, sous le règne de Philippe IV. Dans la République, il y avait le « ministre en jupe », maîtresse influente de Sigismond III, Urszula Mayerin, et plus tard Adam Kazanowski sous Ladislas IV. Il en va de même pour le portrait : si Rubens et de Crayer peignent des monarques espagnols, ils travaillent aussi pour leurs proches en Pologne-Lituanie. Un fait qui peut en partie documenter les contacts de de Crayer avec la République est qu'il a inclus plusieurs personnages en costumes orientaux dans certaines de ses compositions. Parmi les toiles qui pourraient représenter les nobles de Pologne-Lituanie visitant son atelier, on peut citer Saint Benoît recevant Totila, peinte en 1633 (Art Gallery of Ontario, 95/140), avec le personnage central portant un manteau blanc-cramoisi, la Décapitation de Jean-Baptiste, peinte en 1658 (Cathédrale Saint-Bavon de Gand), avec le personnage central portant un caftan żupan cramoisi et un chapeau de fourrure kolpak et le Martyre de sainte Dorothée (vendu chez Christie's Londres, vente 6708, 9 avril 2003, lot 7), dans laquelle la figure de l'avocat païen Théophile à droite s'inspire très probablement des effigies de l'empereur Matthias (1557-1619) en costume hongrois-bohémien ou du roi Sigismond III Vasa en costume national polono-lituanien. Dans tous les contacts des Vasas avec de Crayer et d'autres peintres, Bierens, « agent et domesticque de son Alteze le Sérénissime Prince Wladislaus Sigismundus, Prince de Poloigne et de Suède », également appelé « agent du Seigneur Prince de Pologne » (agente del Signor Principe di Polonia), était sans aucun doute un intermédiaire. Ce marchand-bijoutier était le fils de Lucas Bierens, un marchand d'Eindhoven. Il est probablement né en 1591 car en 1637 il prétendait avoir 46 ans et est décédé le 25 juillet 1641. Bierens possédait une maison à Anvers dans la Kerkhofstraat et, à partir du milieu des années 1630, il occupait une résidence spacieuse au coin de la Zwanestraat, constitué de deux maisons auparavant séparées (d'après « Annotations concernant ... » d'Erik Duverger, p. 119-157). Entre 1624 et 1627, il supervise le tissage des tapisseries avec l'Histoire d'Ulysse et les verdures réalisées à Bruxelles par Jacques Geubels le Jeune pour Ladislas. Dans sa collection, il possédait « une grande peinture sur toile avec le portrait du prince Ladislas de Pologne » (een groote schilderye op doeck wesende het conterfeytsel van prince Vladislaus van Polen), ainsi que deux médailles d'or à l'effigie de Ladislas, lorsqu'il était prince et après son élection comme roi de Pologne.
Portrait équestre du roi Sigismond III Vasa (1566-1632) par Cornelis de Vos, vers 1625-1630, Nationalmuseum de Stockholm.
Portrait équestre du prince Ladislas Sigismond Vasa (1595-1648) par Gaspar de Crayer, vers 1625-1630, Château royal du Wawel.
Portrait du roi Sigismond III Vasa (1566-1632) par Gaspar de Crayer, vers 1625-1630, Alte Pinakothek de Munich.
Portrait du duc Jean II de Bragance (1604-1656) par Gaspar de Crayer, vers 1630, Château royal de Varsovie.
Portrait de Jan Bierens (1591-1641), agent artistique de Ladislas IV Vasa par Gaspar de Crayer, vers 1625-1630, Arnot Art Museum.
Portraits du roi Sigismond III Vasa par Peter Paul Rubens et atelier de Tommaso Dolabella
Le portrait du roi Sigismond III Vasa (1566-1632) de la collection Heinz Kisters à Kreuzlingen en Suisse (huile sur toile, 121 x 91 cm) est considéré par les experts comme l'œuvre de Pierre Paul Rubens lui-même (attribué par Ludwig Burchard), mais ils conviennent également que le peintre n'a jamais visité la République polono-lituanienne (comparer « Rubens w Polsce » de Juliusz A. Chrościcki, p. 135, 176). Toute tentative de déterminer comment le peintre et le roi se sont rencontrés serait vaine, puisque Sigismond n'a pas quitté les frontières de la République après sa déposition en Suède (1599).
Le portrait doit donc avoir été réalisé à partir d'une autre effigie du roi ou à partir de dessins d'études envoyés de Pologne. La vieillesse du roi permet de dater l'ouvrage vers la fin de sa vie, il est donc possible que l'auteur de l'étude initiale soit Pieter Claesz. Soutman qui séjourna en Pologne-Lituanie entre 1624 et 1628 et qui dans de nombreuses lettres envoyées de Haarlem entre 1629 et 1645 se fait appeler en italien : « Peintre de Sa Majesté de Pologne » (Pittore di Sua Maesta de Polonia) - par exemple des lettres datées de décembre 19 février 1644 et 8 février 1645 à Matthijs Musson (1593-1678) (dans « Na Peter Pauwel Rubens » de Jean Denucé, p. 26-28). Le tableau de la Crucifixion avec la signature similaire de ce peintre au pied de la croix (P. P. Soutman Pittore de sua de Polonia f.) se trouve au couvent franciscain de Séville (Convento de los Terceros Franciscanos) (d'après « Archivo hispalense ... », tome 3, p. 385-386). Ce qui est également intéressant dans ce tableau, c'est qu'il a longtemps été considéré comme l'effigie du docteur Théodore Turquet de Mayerne (1573-1655), qui soignait les rois de France et d'Angleterre, en raison d'une certaine ressemblance avec ses portraits de Rubens. C'est en 1953 que le portrait fut reproduit par Horace Shipp dans « Les Maîtres flamands » (The Flemish Masters) comme l'effigie de Sigismond III (d'après « Un Portrait de Sigismond III ... » de Karolina Lanckorońska, p. 175). Si Rubens prenait comme modèle des dessins ou un tableau de Soutman, ils lui étaient envoyés de Bruxelles ou de Haarlem. Il est également possible qu'ils aient été réalisés par d'autres peintres de la cour du roi, car un portrait en pied très similaire de Sigismond au palais de Wilanów (huile sur toile, 207 x 127 cm, Wil.1164, antérieur 572) n'est certainement pas un œuvre de Soutman, ni de Rubens ou de leurs ateliers. Ce tableau est mentionné pour la première fois dans la collection de Wilanów dans un catalogue de peintures du milieu du XIXe siècle. Bien que le portrait du roi à Wilanów ne soit pas aussi bien peint, le style le plus comparable semble être le célèbre portrait de Stanisław Tęczyński, un chef-d'œuvre attribué au peintre vénitien Tommaso Dolabella, actif dans la République, réalisé entre 1633 et 1634 (Musée national de Varsovie, 128850, déposé au château du Wawel). Les œuvres peintes de la même manière comprennent la présentation par l'hetman Stanisław Żółkiewski des frères Chouïski à la diète de Varsovie en 1611 au Musée historique de Lviv et le Jugement des Ariens en 1638 dans le plafond de style vénitien du palais des évêques de Cracovie à Kielce, attribué à l'atelier de Tommaso Dolabella. Comme le montre la photographie conservée, le portrait de l'hetman Stanisław Żółkiewski du palais Zamoyski à Varsovie (perdu pendant la Seconde Guerre mondiale), peint vers 1606, était de style similaire. En ce qui concerne la composition (pose, tissu, tableau), le plus similaire est le portrait en pied du prince Ladislas Sigismond Vasa conservé au Musée historique de Lviv, très probablement réalisé par l'atelier de Pieter Claesz. Soutman. Les artistes de la République hollandaise et des Pays-Bas espagnols étaient considérés parmi les meilleurs d'Europe dans la première moitié du XVIIe siècle. Les ateliers de peinture et d'imprimerie s'y sont considérablement développés et ont fourni une qualité élevée, de sorte qu'au XVIe siècle, les clients de Pologne-Lituanie préféraient Venise, au siècle suivant, de nombreux livres ont été publiés aux Pays-Bas et en Flandre. A titre d'exemple, on peut citer Respublica Siue Status Regni Poloniæ, Lituaniæ, Prussiæ, Livoniæ, etc. diuersorum Autorum, publié à Leyde en 1627 avec une page de titre montrant les armoiries de Sigismond III Vasa, créée par Pieter Serwouters, qui avait créé auparavant l'effigie gravée du fils du roi. En 1632, Pierre Paul Rubens dessine le frontispice du Lyricorvm libri IV de Maciej Kazimierz Sarbiewski (Musée Plantin-Moretus d'Anvers, MPM.V.IV.058), gravé par Cornelis Galle l'Ancien et publié à Anvers en 1632 (Pet. Paul. Rubens pinxit, Corn. Galle sculpsit., Bibliothèque nationale de Pologne, SD W.2.1241). Un artiste proche de Pierre Paul Rubens a probablement réalisé le portrait de Sarbiewski, prédicateur de la cour du roi Ladislas IV Vasa, considéré comme le plus éminent poète latin du XVIIe siècle (dessin conservé au musée Plantin-Moretus). Ainsi, malgré la distance, par rapport aux œuvres de Rubens, les collections artistiques de Pologne-Lituanie étaient sans doute comparables à celles de Madrid ou de Munich, mais aujourd'hui presque rien n'est conservé dans les anciens territoires de la République. Outre le portrait de Sigismond III en Suisse, parmi les œuvres du maître lui-même (et non de l'atelier ou des suiveurs) qui furent probablement commandées par les Vasa polono-lituaniens, on peut citer la Madone dans une couronne de fleurs de Rubens et Jan Brueghel l'Ancien (Alte Pinakothek de Munich, 331). Ce tableau provient de la galerie de Düsseldorf, comme les portraits de Sigismond III et de son épouse en robes de couronnement (Galerie nationale du Neubourg, 984 et 985). La lettre de Juan de Arrazola Oñate, secrétaire de l'infante Isabelle du 18 septembre 1619, dans laquelle il s'adressait au trésorier général Monsieur Monfort pour qu'il libère des douanes les tableaux envoyés par Jan Brueghel l'Ancien en Pologne, confirme la première commande connue de Sigismond III (6 paysages, 9 portraits dont des portraits de l'archiduc Albert et de l'infante Isabelle et d'autres monarques européens, 3 grands tableaux batalistiques). Le 29 octobre 1621, Jan Brueghel l'Ancien écrivit à son agent, le noble milanais Ercole Bianchi, au sujet de l'envoi de nombreux tableaux au roi Sigismond III Vasa (molti pitture al Re) et dans une lettre au cardinal Federico Borromeo, datée du 22 août 1625, son fils fait référence à une grande guirlande à l'effigie de Marie de Brueghel l'Ancien vendue 400 escudi au prince de Pologne, « qui acheta presque toutes ses œuvres » (... la Madonna, ma è ordinato tutto in un altra maniera che quello delli fiori che tiene v. s. Ill.mo in la biblioteca, e larga tre palmi et alto qualro e medso incirca. El paro di questo fu venduto al sig. Prencipe di Pollonia, il quale compraua quasi tutti li sue opre, lo fu pagato 400 escudi, dans « Giovanni Brueghel pittor fiammingo ... » de Giovanni Crivelli, p. 340). Ce tableau pourrait être un cadeau pour les électeurs de Bavière, comme le portrait du jeune Ladislas Sigismond en fraise par Rubens ou atelier (Galerie nationale du Neubourg, 342), identifié par mes soins, ou l'effigie d'un saint polonais Stanislas Kostka par l'entourage de Rubens (Alte Pinakothek, 7520). Dans une lettre datée du 8 juin 1632 d'Anvers au marchand d'art Crisostomo van Immerseel, Jan Brueghel le Jeune (1632, Amberes 8 Junio Juan Bruegel) fait référence à la Guirlande de fruits avec figures de Rubens, l'œuvre la plus importante réalisée par son père, qui a été vendu à Ladislas Sigismond Vasa pour 1 600 florins (te weten den grooten Girlande van vruchten, de beelden van Rubens, het fraijste ent meeste werc dat vader syn leven gedaen heeft gelyc UI can considereren aen den prys twelc het verkocht is, te weten voor 1600 gul. aen den prins van Polen). Ce tableau est parfois considéré comme la Nature ornée au Kelvingrove Art Gallery and Museum de Glasgow, datant d'environ 1615 (huile sur panneau, 106,7 x 72,4 cm, inv. 609, comparer « Rubens & Brueghel », édité par Anne T. Woollett, Ariane van Suchtelen, p. 157, 164-165). La Marche de Silène représentée dans la Collection d'art du prince Ladislas Sigismond, peinte à Varsovie en 1626 (Château royal de Varsovie, ZKW 2123), était sans aucun doute l'œuvre de Rubens. Certains tableaux mentionnés dans l'inventaire de la collection du dernier Vasa sur le trône de Pologne - Jean II Casimir, vendus à Paris en 1673, pourraient être des œuvres de Rubens, comme le n° 107, Miracles de saint Ignace de Loyola, qui pourrait ressembler au tableau de la Dulwich Picture Gallery (inv. 148) ou n° 439, l'Éducation de la Vierge, qui pourrait être similaire au tableau du Musée royal des Beaux-Arts d'Anvers (inv. 306). Dans la chambre du comte de Buy, chambellan du roi à Nevers, se trouvait « un tableau en hauteur, peint sur toile, représentant en nudité un Cupidon, qui bande son arc, avec deux petits enfants entre ses jambes », une copie de Cupidon fabriquant son arc par Parmigianino, aujourd'hui conservée au Kunsthistorisches Museum de Vienne (d'après « Z dziejów polskiego mecenatu ... » de Władysław Tomkiewicz, p. 234). Il existe un tableau de Rubens à Munich daté de 1614, qui est une copie du tableau de Parmigianino de Vienne dont la plus ancienne mention dans la galerie électorale date de 1748 (huile sur toile, 142,5 x 107 cm, 1304), il est donc possible qu'il ait été acquis à Paris après la mort de Jean Casimir, qui réussit à évacuer certains tableaux des collections royales vers la Silésie en 1655 lors du déluge. A Vienne, il existe quant à lui une copie du portrait de la mère de Sigismond III en blanc, d'après l'original du Titien (GG 531), identifié par mes soins. Le tableau qui pourrait provenir des collections royales de Pologne-Lituanie est très bien peint portrait d'Élisabeth de France (1602-1644), reine d'Espagne, peint après 1628 et attribué à l'atelier de Rubens, aujourd'hui au château du Wawel (huile sur toile, 58,5 x 46 cm, 6378). Le tableau provient de la collection privée de Cracovie (donnée en 1978 aux Collections de l'État) et il n'y a aucun lien avéré avec les collections royales, mais cela est très probable puisque de nombreux portraits ont été échangés avec l'Espagne au début du XVIIe siècle. Un autre tableau qui pourrait provenir des collections royales ou des magnats de Pologne-Lituanie est les Trois Grâces tenant un panier de fleurs de l'atelier de Rubens et Jan Brueghel le Jeune, peint entre 1620 et 1625, aujourd'hui au Nationalmuseum de Stockholm (NM 601). On ne sait rien de ses débuts, si ce n'est qu'il était déjà arrivé en Suède au XVIIe siècle et faisait partie de la collection du comte Magnus Gabriel De la Gardie (1622-1686), qui, lors du déluge, pilla avec son armée une grande partie du pays. Les contacts importants des clients de la République avec Rubens et des peintres flamands se reflètent dans deux autres tableaux du début des années 1620. Ils représentent Tomyris, reine des Massagètes (également connue comme la reine des Scythes), qui a mené ses armées pour se défendre contre une attaque de Cyrus le Grand de l'empire achéménide, et l'a vaincu et tué en 530 avant JC. L'une de ces peintures se trouve au Museum of Fine Arts de Boston (huile sur toile, 205,1 x 361 cm, 41.40) et provient très probablement de la collection de l'infante Isabelle-Claire-Eugénie d'Espagne (1566-1633), plus tard, avant 1662, dans la collection de la reine Christine de Suède à Rome. L'autre se trouve au Louvre à Paris (huile sur toile, 263 x 199 cm, INV 1768 ; MR 991) et provient de la collection d'Everhard Jabach (1618-1695), qui la vendit au roi Louis XIV en 1671. Un dessin pour une gravure (non réalisée), attribuée à Pieter Claesz. Soutman, semblable au tableau de Paris, est aujourd'hui conservé au musée Plantin-Moretus (PK.OT.00117). Bien que les deux tableaux mentionnés, à Boston et à Paris, soient attribués à Rubens ou à son école, leur style se rapproche plus des œuvres de Gaspar de Crayer, peintre de la cour de l'infante, notamment les portraits de Sigismond III et de Constance d'Autriche, attribués par moi. La reine Tomyris a ordonné que le corps de Cyrus lui soit apporté, puis l'a décapité et a plongé sa tête dans un vaisseau de sang dans un geste symbolique de vengeance pour sa soif de sang et la mort de son fils. Le tableau original de Rubens, gravé par Paulus Pontius en 1630 (Rijksmuseum, RP-P-OB-70.057), inscrivait : « Rassasie-toi du sang dont tu as toujours été assoiffé » (SATIA TE SANGVINE QVEM SEMPER SITISTI) et signé : Petrus Paulus Rubens pinxit. / Paulus Pontius sculpsit., diffère dans de nombreux détails de la peinture de Boston. L'original doit donc être considéré comme perdu. Une copie réduite du tableau de Rubens, datant très probablement du XVIIe siècle, se trouvait dans la cathédrale de Kielce, dont le portail a été fondé par le cardinal Jean Albert Vasa en 1635. Ce tableau se trouve aujourd'hui au musée diocésain de Kielce. Il convient également de noter que la reine dans les deux tableaux ressemble beaucoup aux effigies de l'infante Isabelle-Claire-Eugénie, notamment le portrait dans le goût de Gaspar de Crayer à la National Gallery de Londres (NG3819) et celui de Rubens et Jan Brueghel l'Ancien au Musée du Prado à Madrid (P001684). Dans les deux compositions, les soldats de la reine portent des costumes traditionnels des nobles de la République polono-lituanienne, une autre illustration parfaite du royaume détruit et oublié de Vénus au sommet de sa richesse et de sa puissance avant le déluge, et un avertissement puissant à tous les tyrans. Déjà vers 1522, Andrzej Krzycki (1482-1537), secrétaire de la reine Bona Sforza, dans une épitaphe dédiée à Anna Radziwill (1476-1522), comparait la duchesse de Mazovie à la reine Tomyris (Qualis erat Tomyrisque suae Cleopatraque genti, / Qualis Amazonio Penthesilea solo, / Talis erat fecunda tibi, Masovia tellus, / Anna Radiviliae gloria magna domus).
Cupidon fabriquant son arc par Pierre Paul Rubens d'après Parmigianino, 1614, Alte Pinakothek de Munich.
La Nature ornée par Pierre Paul Rubens et Jan Brueghel l'Ancien, vers 1615, Kelvingrove Art Gallery and Museum.
Portrait de l'hetman Stanisław Żółkiewski (1547-1620) par l'atelier de Tommaso Dolabella, vers 1606, Palais Zamoyski à Varsovie, perdu pendant la Seconde Guerre mondiale.
Portrait du roi Sigismond III Vasa (1566-1632) par l'atelier de Tommaso Dolabella, vers 1625-1632, Palais de Wilanów à Varsovie.
Portrait du roi Sigismond III Vasa (1566-1632) par Pierre Paul Rubens, vers 1625-1632, collection Heinz Kisters à Kreuzlingen.
Portrait d'Élisabeth de France (1602-1644), reine d'Espagne par l'atelier de Pierre Paul Rubens, après 1628, Château royal du Wawel.
La reine Tomyris fait plonger la tête de Cyrus dans un vase rempli de sang, avec des figures en costumes traditionnels des nobles de la République polono-lituanienne par Gaspar de Crayer, années 1620, Musée du Louvre.
La reine Tomyris fait plonger la tête de Cyrus dans un vase rempli de sang, avec des figures en costumes traditionnels des nobles de la République polono-lituanienne par Pieter Claesz. Soutman, années 1620, Musée Plantin-Moretus à Anvers.
La reine Tomyris fait plonger la tête de Cyrus dans un vase rempli de sang, avec des figures en costumes traditionnels des nobles de la République polono-lituanienne par Gaspar de Crayer, années 1620, Museum of Fine Arts de Boston.
La reine Tomyris fait plonger la tête de Cyrus dans un vase rempli de sang, avec des figures en costumes traditionnels des nobles de la République polono-lituanienne par Paulus Pontius d'après Peter Paul Rubens, 1630, Rijksmuseum Amsterdam.
Portrait de Zygmunt Kazanowski par Gaspar de Crayer
Du 6 septembre au 14 octobre 1624, le jeune noble des armoiries de Grzymała, Adam Kazanowski (vers 1599-1649), ami et valet du prince Ladislas Sigismond Vasa, séjourna à Bruxelles et à Anvers avec le prince et une quarantaine de personnes de son entourage.
Le séjour de deux semaines à Bruxelles était une série de grands divertissements et de fêtes en l'honneur du prince, organisées par l'infante Isabelle-Claire-Eugénie d'Espagne (1566-1633). A Anvers, ils ont visité les ateliers de divers peintres, dont Pierre Paul Rubens et Jan Brueghel l'Ancien, ainsi que la galerie de Cornelis van der Geest. Lors de ce voyage, Kazanowski tenait un album Liber Amicorum dans lequel les entrées des Habsbourg, comme l'archiduc Léopold V du Tyrol (n°11), l'archiduc Léopold Guillaume (13) et sa sœur Cécile-Renée, future reine de Pologne (16), réalisées à Vienne, et de nombreux diplomates espagnols apparaissent. A Munich, on retrouve les inscriptions de Maximilien Ier, électeur de Bavière et de son épouse (45-46), à Augsbourg des membres de la famille Fugger (48-51), à Bruxelles de l'infante (54), Geneviève d'Urfé, la duchesse de Croy (65 ans) et les nobles espagnols. Après un séjour en Italie, ils retournèrent à Varsovie en mai 1625. L'année suivante, 1626, l'album de Kazanowski contient des entrées de diplomates espagnols en Pologne-Lituanie - Jean de Croÿ, comte de Solre et Charles de Bonnières, baron d'Auchy (n° 145-146), ainsi que Louis de Custine, seigneur de Villers-le-Rond, maître de camp de l'infante (26 juin 1626, n° 147, tous trois venus des Pays-Bas espagnols), et d'autres envoyés espagnols et français (d'après « Biblioteka Warszawska », 1853, tome 2). Ils montrent à quel point les contacts avec l'Espagne et les Pays-Bas espagnols étaient importants pour le jeune Kazanowski. Entre 1627 et 1628, Adam étudia à Padoue. Dans les années suivantes, et surtout après l'élection de Ladislas comme nouveau roi, sa richesse et son influence augmentèrent considérablement. En tant que favori du nouveau roi, il remplaça l'influente « ministre en jupe » Urszula Meyerin (1570-1635), et sa position peut être comparée, à certains égards, même à celle de Gaspar de Guzmán, comte-duc d'Olivares, favori (valido) de Philippe IV d'Espagne, cousin de Ladislas. En 1639-1642, Kazanowski tenta de forcer une alliance militaire anti-française avec l'Espagne et au printemps 1639, il négocia avec l'envoyé de Philippe IV, D. Fernando de Monroy (mort en 1656). À partir de 1642, il était maréchal de la couronne (mareschalus curiæ), dont les pouvoirs habituels comprenaient la supervision de la cour royale et il était l'adjoint du grand maréchal de la couronne. Lorsqu'il reçut un palais de Ladislas en 1632, il l'agrandit et l'embellit. Ce magnifique bâtiment était le deuxième en taille après le château royal, mais il était plus grand que le palais du chancelier Jerzy Ossoliński, le palais du grand hetman de la couronne Stanisław Koniecpolski, et peut-être même plus grand que la Villa Regia (Villa Royale), comme visible dans une estampe de Nicolas Pérelle de 1696 représentant Varsovie vers 1655. Cette estampe a été réalisée d'après un dessin d'un ingénieur militaire suédois, le comte Erik Dahlbergh. Il est intéressant de noter qu'en comparaison avec une estampe réalisée par Adam Pérelle d'après un autre dessin de Dahlbergh, montrant la capitale de l'empire qui voulait détruire la République (Traité de Radnot) - Stockholm en 1669, on voit une nette différence. Dahlbergh, qui savait glorifier l'empire suédois, il agrandissait parfois les bâtiments dans ses dessins et les rendait plus impressionnants. Cependant, alors que dans le panorama de Varsovie les structures sont de taille comparable, dans le panorama de Stockholm, le château royal (Arx Regia, Tre Kronor) domine le centre de la composition et l'ensemble du paysage urbain. Dans le palais Ossoliński, entre les portraits des ancêtres du chancelier, des empereurs romains et des peintures historiques, il y avait un portrait de Ladislas IV avec l'inscription « Premier parmi les pairs » (Primus inter pares) (d'après « Piękno ocalone ... » de Maria Lewicka, Barbara Szymanowska, p. 44). Dans la Pologne-Lituanie républicaine, les magnats rivalisaient hardiment avec le roi dans de nombreux domaines, y compris le mécénat. Comme le roi, Kazanowski a très probablement acquis et commandé des œuvres d'art aux Pays-Bas et en Italie, y compris ses effigies, mais rien n'a été conservé en Pologne. Il reçut également du roi de nombreux objets de valeur, comme un tableau de la Lamentation du Christ de Rubens, peint sur bois, qui appartenait en 1840 à M. Piotr Romanowicz, avocat à Lviv (d'après « Rzecz o obrazach ... » par Ludwik Zieliński, z. 3, Lwowianin, p. 63). Il se peut également qu'il ait reçu de tels objets de ses amis espagnols et belges et qu'il ait, comme eux, commandé les tableaux aux mêmes peintres. Dans les « Variétés polonaises » (Rozmaitości Polskie) datant d'environ 1833, une collection de gravures d'Antoni Oleszczyński (1794-1879), il y a une intéressante effigie en pied de Kazanowski. Alors que dans les effigies de Jan Karol Chodkiewicz (mort en 1621) et Lew Sapieha (1557-1633), il créa un fond néogothique ou avec des panoplies, à l'image de Kazanowski il utilisa un fond similaire à celui visible dans un portrait de la cousine de Ladislas IV - Anne d'Autriche (1601-1666), reine de France, réalisée par l'atelier de Rubens entre 1620-1625 (Musée du Louvre, INV 1794 ; MR 984). Il a également été utilisé dans un portrait de femme assise dans un intérieur de Gonzales Coques (collection particulière). Cependant, si dans le portrait de la reine et de la femme le fond est presque identique, dans la gravure d'Oleszczyński, la niche derrière Kazanowski est différente et montre une scène avec une femme nue dansant et un ours. Adam Jarzębski dans son « La route principale, ou une brève description de Varsovie » (Gościniec abo krótkie opisanie Warszawy) de 1643 mentionne dans le palais du maréchal de nombreuses peintures, dont « Des gens nus au-dessus de la table » (Nad stołem nagie osoby, vers 1097). Si Oleszczyński a copié l'arrière-plan du tableau original, le tableau a probablement été créé par l'atelier de Rubens ou par un autre peintre flamand. Le 13 août 1634, le père d'Adam, Zygmunt Kazanowski, mourut à Varsovie. Avec son frère Stanisław Kazanowski (1601-1648), staroste de Krasno, qui fut expulsé de la cour par Sigismond III pour promiscuité, Adam fonda un magnifique tombeau en marbre pour son père. En 1843, le monument fut transféré à la cathédrale de Varsovie depuis l'église démolie des religieuses bernardines, située près du château royal. Il a été détruit lors d'un bombardement allemand de la cathédrale en 1944. Le monument était fait de marbre multicolore, de forme similaire à celle de l'autel. La base était taillée dans une pierre brune, sur laquelle se trouvaient deux piliers aux chapiteaux corinthiens blancs. Au milieu, sur une dalle noire, un bas-relief en marbre blanc représentait Kazanowski agenouillé devant la Vierge Marie (d'après « Katedra św. Jana w Warszawie ... » de Wiktor Czajewski, p. 99-100). Zygmunt était représenté en costume national, comme c'était l'usage pour les monuments funéraires, car à la cour la plupart des gens préféraient le costume étranger, si bien qu'un poète inconnu avant le déluge s'écria : « De nos jours, on reconnaît à peine les Polonais, il y a des Italiens, des Français, en grand nombre à la cour » (d'après « Jakuba Teodora Trembeckiego ... » d'Aleksander Brückner, tome I, poème 165). Même si dans la vie de tous les jours ou à la cour les gens préféraient les costumes étrangers, dans le portrait officiel ils voulaient toujours souligner leur attachement à la République et à ses traditions par un costume approprié. Ce monument est attribué au sculpteur Conrad Walther de Gdańsk et à son atelier et, selon les spécialistes, il a été réalisé principalement à partir de calcaire importé, principalement de Belgique - « noir belge » de la province de Namur (« noir de Namur ») et albâtre anglais très cher (d'après « Lapidarium warszawskie » de Michał Wardzyński, Hubert Kowalski, Piotr Jamski, p. 288). Zygmunt était chambellan sous le règne des rois Étienne Bathory et Sigismond III Vasa, puis tuteur et maréchal de la cour du prince Ladislas Sigismond. Lors de l'expédition militaire de 1617-1618, en tant que conseiller du prince, il intrigua contre Chodkiewicz, le commandant suprême. Les deux fils de Zygmunt, Adam et Stanisław, furent élevés à la cour royale et étaient amis de Ladislas Sigismond, exerçant une influence sur le jeune prince. Lors des funérailles du roi Sigismond et de la reine Constance, Zygmunt portait les insignes royaux. En 1627, il céda les villages de Grzymałów, Kazanów et Ciepielów à ses fils. En 1607, Seweryn Bączalski consacre un panégyrique à Kazanowski : « La couronne polonaise, très triste, fait des demandes sincères… » (Korona polska barzo smutna prośby serdeczne czyni), louant Zygmunt comme un modèle d'honnêteté, de masculinité, de chevalerie, de piété, coutumes courtoises et raison, de sorte que le roi le trouva digne et lui confia la tutelle de son fils. D'autres ont comparé Kazanowski à Aristote, le précepteur d'Alexandre le Grand. L'emploi de Kazanowski comme tuteur du prince fut un tournant dans sa vie, et probablement dans celle de toute la famille. Il était considéré comme un ami à la fois par les catholiques, comme Albert Stanislas Radziwill, et par les protestants, comme Christophe Radziwill, duc de Birzai. Il possédait plusieurs bateaux situés sur la Vistule, près de Solec à Varsovie (d'après « Kariera rodu Kazanowskich ... » de Krzysztof Zemeła, p. 45, 47-48), et participait ainsi au transport fluvial et au commerce de Gdańsk. À la National Gallery de Londres se trouve un « Portrait d'homme » du peintre flamand, précédemment attribué à Rubens et Jordaens (huile sur toile, 116,2 x 85,8 cm, NG1895). Il a été acheté à T. Humphrey Ward, Clarke Fund, en 1902. La pose du modèle et la composition sont directement inspirées du portrait du prince Ladislas Sigismond, réalisé par Rubens en 1624 et gravé par Paulus Pontius (Ex Archetypo Petri Pauli Rubenij Paulus Pontius fecit anno MDCXXIIII, Bibliothèque nationale de Pologne, G.10661/II). Semblable à Ladislas, le vieil homme porte un costume hispano-flamand. Le fait que l'homme sur ce portrait ait voulu être représenté de manière similaire au prince de Pologne-Lituanie indique que c'était quelqu'un de proche, ce qui a conduit à interpréter qu'il s'agit d'un portrait du père du prince Sigismond III (comparer « Rubens w Polsce » de Juliusz A. Chrościcki, p. 178). C'était une pratique courante à cette époque, par exemple le portrait équestre de Don Diego Felipez de Guzmán (1580-1655), 1er marquis de Leganés, cousin du puissant valido comte-duc d'Olivares, peint par Gaspar de Crayer entre 1627- 1628 (Kunsthistorisches Museum de Vienne, GG 9112), est très similaire à bien des égards au portrait d'Olivares à cheval, peint par de Crayer et Peter Snayers (paysage) à la même époque (The Weiss Gallery en 2018). L'homme ne peut pas être Sigismond III, car selon l'inscription latine originale, il avait 63 ans en 1626 (ÆTATIS SVE / 63 1626), alors que le roi à cette époque avait 60 ans (né en 1566) et il ne porte pas l'ordre de la Toison d'Or, qui devrait être inclus dans le portrait de style hispano-flamand. Le portrait de Londres porte également des armoiries, qui ont cependant été peintes dans un style différent et ont été ajoutées plus tard, car l'inscription indiquant l'âge, qui devrait normalement être habilement placée sous l'emblème, est dans ce cas déplacée vers la droite. La position de l'inscription, proche du bord et presque coupée, indique que le tableau a probablement été coupé lors de l'ajout des armoiries. L'emblème est identifié comme appartenant à la famille De Waha, dont les domaines étaient proches de Namur, d'où furent acquis les marbres du tombeau de Kazanowski. Dans les publications précédentes, le modèle s'appelle le baron Waha de Linter de Namur, mais aucun lien avec un membre concret de cette famille n'a jamais été établi. Il est possible qu'ils possédaient le portrait et que lorsque l'identité du modèle fut perdue, il fut considéré comme un membre de la famille, et peut-être vers 1816, lorsqu'ils reçurent le titre de baron, les armoiries furent ajoutées. L'homme du portrait ressemble beaucoup au père d'Adam Kazanowski comme le montre sa sculpture funéraire (forme des oreilles, moustache, sourcils) et est comparable aux effigies d'Adam - d'après un tableau de Peter Danckerts de Rij et une gravure de Jeremias Falck Polonus. Son âge correspond également parfaitement à celui de Zygmunt, le maréchal de la cour princière, qui avait 63 ans en 1626 lorsque plusieurs envoyés hispano-flamands arrivèrent à Varsovie - il avait 71 ans au moment de sa mort en 1634 selon l'inscription sur son tombeau, donc né en 1563 (placide vitam cum morte commutavit Varsaviæ die XIII Augusti anno Christi MDCXXXIV ætatis suæ 71 patri desideratissimo Adamus tituli paterni successor). Le style de ce tableau est le plus proche des portraits équestres mentionnés du marquis de Leganés et du comte-duc d'Olivares, peints par Gaspar de Crayer, peintre de la cour de l'infante Isabelle-Claire-Eugénie, et du portrait du prince Ladislas Sigismond conservé dans du Musée national de Varsovie (M.Ob.2434 MNW), considérée comme la copie du XVIIe siècle d'après l'original de Rubens.
Portrait du prince Ladislas Sigismond Vasa (1595-1648) par Paulus Pontius d'après Pierre Paul Rubens, 1624, Bibliothèque nationale de Pologne.
Portrait de Zygmunt Kazanowski (1563-1634), maréchal de la cour du prince Ladislas Sigismond Vasa, âgé de 63 ans, par Gaspar de Crayer, 1626, National Gallery de Londres.
Portrait d'Adam Kazanowski (vers 1599-1649), maréchal de la couronne par Antoni Oleszczyński d'après l'original perdu de Gaspar de Crayer d'environ 1642 (?), vers 1833, Bibliothèque nationale de Pologne.
Portrait de l'archiduchesse Cécile-Renée d'Autriche par Justus Sustermans
« Il a été rapporté ici que le prince polonais avait quitté le royaume pour épouser la fille de l'empereur [Ferdinand II] ou du roi d'Espagne [Philippe III], ce qui a suscité de grands soupçons dans l'empire [turc] », a écrit l'ambassadeur d'Angleterre à Istanbul dans une lettre à Londres sur le voyage du prince Ladislas Sigismond Vasa entre 1624 et 1625. Il a également ajouté que la reine Constance d'Autriche, sa belle-mère, avait tenté de créer une faction soutenant son fils aîné, Jean Casimir Vasa, dans sa candidature au trône. L'ambassadeur d'Angleterre dans la lointaine Istanbul avait de bons informateurs, car lors de la réunion du Consejo de Estado à Madrid en novembre 1624, la lettre de l'infante Isabelle-Claire-Eugénie, écrite à Bruxelles, fut discutée. L'infante demanda au roi Philippe IV la permission d'épouser le prince polonais avec l'infante Marie-Anne d'Espagne (1606-1646), sœur du roi et cousine de Ladislas Sigismond en tant que fille de la sœur de sa mère. L'un des participants à ce concile commentait ainsi : « Le mariage avec un prince polonais est très bien, mais avec un prince allemand est plus avantageux ». Concernant le mariage avec les filles de l'empereur, il y a eu l'absence de consentement du pape Urbain VIII à une éventuelle dispense pour le mariage du prince avec une proche parente, l'archiduchesse Marie-Anne (1610-1665) ou Cécile-Renée (1611-1644), qui devint finalement sa première épouse (d'après « Świat polskich Wazów: eseje », p. 48, 280-281, 311).
Afin de prouver à son fils que les filles de son oncle l'empereur Ferdinand II n'étaient pas atteintes de handicaps, contrairement à leur mère Marie-Anne de Bavière (1574-1616), Sigismond III Vasa les fit spécialement représenter, comme le rapporte l'évêque Giovanni Battista Lancellotti, nonce papal dans la République polono-lituanienne, dans une lettre datée du 17 mars 1627 au cardinal Francesco Barberini (Scuoprì meco di nuovo SM l'intento suo desiderio d'accasarlo con una delle figliuole dell'imperadore per altro aborrite da SA asserendo ella questa esser derivata in quelle da certa natural indispositione della loro madre e mi disse SM d'haverne fatto venir qua i ritratti per certezza del contrario) (d'après « Das Leben am Hof ... » de Walter Leitsch, p. 2378). On ne sait pas si ces effigies étaient bonnes ou fidèles, peut-être comme dans le cas des portraits de la tante de Sigismond Anna Jagellon ou de ses deux épouses, il s'agissait de peintures de nus, cependant, plus tard dans une lettre écrite à Varsovie le 31 octobre 1644, Ladislas demanda au cardinal Mazarini des portraits fiables de candidates à sa seconde épouse. Lors de son séjour à Vienne le 23 juin 1624, le prince eut l'occasion de rencontrer les deux filles de l'empereur. Il admirait également les collections artistiques de l'empereur, notamment « un ensemble de portraits de nombreux empereurs et autres personnalités notables de la maison d'Autriche ». A Salzbourg, il a vu « diverses peintures », à Munich l'Antiquarium et à Augsbourg les peintures de la famille Fugger. Philipp Hainhofer, connaisseur et agent d'art d'Augsbourg, raconte dans son journal que le prince lui a offert « un bijou inhabituel en ambre jaune ». A Nuremberg, Ladislas Sigismond admira « les célèbres tableaux de Dürer » et les peintures du plafond par Rubens. Dans les années 1620, deux filles de l'empereur Ferdinand II étaient fréquemment représentées et leurs effigies étaient envoyées à diverses cours amies d'Europe, dont celle de Pologne-Lituanie (toutes probablement détruites ou perdues pendant les guerres). La plupart d'entre elles sont proches par leur style des œuvres du peintre flamand Justus Sustermans, peintre de la cour de la famille Médicis, qui entre 1623 et 1624 travailla à Vienne sur commande de l'empereur. Dans un tableau de la collection Esterházy du château de Forchtenstein, probablement réalisé par l'atelier de Sustermans, Marie-Anne et Cécile-Renée sont représentées ensemble. Les deux sœurs s'agenouillent derrière leur mère Marie-Anne de Bavière et leur belle-mère Éléonore de Gonzague (1598-1655) dans un tableau votif de l'empereur Ferdinand II de Matthias Mayer, peint en 1631 pour la cathédrale Saint-Guy de Prague. Quelques années plus tard, vers 1640, un peintre proche de Frans Luycx créa des effigies similaires de la famille impériale agenouillée devant la Vierge dans l'église des Dominicains de Vienne, lorsque Cécile-Renée, était déjà reine de Pologne et sa sœur Marie-Anne, électrice de Bavière (leurs ressemblances ont été inspirées par d'autres portraits envoyés à Vienne). Parmi les portraits de Marie-Anne réalisés par Sustermans et son atelier se trouve un tableau du château de Neuburg (Alte Pinakothek de Munich, numéro d'inventaire 2792). Il s'agit d'une copie d'un tableau de la collection Médicis, aujourd'hui conservé à la Villa Médicis de Cerreto Guidi (inv. 1890 / 4275), qui est considéré comme représentant la princesse Éléonore de Médicis (1591-1617), fille de Ferdinand Ier de Médicis, ainsi qu'un autre portrait similaire de Cécile-Renée, la sœur de Marie-Anne, conservé dans la Galerie des Offices à Florence (inv. 1890 / 2297), mais tous deux sont « clairement identifiées comme les filles de l'empereur Ferdinand dans l'inventaire de 1624 de la Villa del Poggio Imperiale et comme sœurs de l'empereur Ferdinand dans l'inventaire 1654-1655 » (d'après « Le The Grand Duke's Portraitist ...» de Lisa Goldenberg Stoppato, p. 35). Une copie de l'effigie mentionnée de Cécile-Renée des Offices (inv. 1890 / 2297), se trouve également à Munich (inv. 6958), mais le visage du modèle est endommagé. On pense que ce portrait représente l'archiduchesse Marguerite d'Autriche et il provient également du château de Neubourg. Les deux archiduchesses étaient également représentées dans deux portraits similaires de la galerie Wallenstein, aujourd'hui au château de Hrádek u Nechanic (d'après « The Wallenstein portrait gallery in the Cheb Museum », p. 71). Dans ces effigies, Marie-Anne (inv. 3318 / 3802) et Cécile-Renée (inv. 3320 / 3804) se ressemblent beaucoup et portent des costumes espagnols identiques. L'un d'eux était également représenté dans un tableau du château royal de Racconigi, qui fut la résidence officielle de la lignée Carignan de la maison de Savoie, attribué au peintre flamand (huile sur toile, 64 x 49 cm, R 5576). La femme était autrefois identifiée comme princesse de la maison de Savoie et maintenant comme Marguerite d'Autriche (1584-1611), reine d'Espagne et du Portugal. Son visage ressemble davantage à l'effigie de Cécile-Renée des Offices (inv. 1890 / 2297) et de Hrádek u Nechanic (inv. 3320 / 3804). Une effigie très similaire de la reine de Pologne a été reproduite dans une gravure anonyme réalisée avant 1700 (Bibliothèque universitaire de Leipzig, 8/61) avec une inscription en allemand : Cecilia Renata ErtzHerzogin zu Osterreich / Uladislas Königs in Pohlen Gemahlin. Comparaison avec des effigies ultérieures des deux sœurs - portraits de Marie-Anne, électrice de Bavière par l'entourage de Joachim von Sandrart, réalisés vers 1643, du château de Dachau (Alte Pinakothek de Munich, 3093) et de la collection Médicis, identifiés par moi (Palais Pitti à Florence, inv. 1890 / 5261) et Cécile-Renée de Peter Danckerts de Rij également peints en 1643, au château de Gripsholm, très probablement pillé pendant le déluge (signé : Peter. Danckers fecit A:o 1643, Nationalmuseum de Stockholm, NMGrh 299) et version réduite de la Salle de marbre du château royal de Varsovie (Musée historique d'État de Moscou, И I 5922 / 74493), indique qu'il s'agit d'un portrait de la future reine de Pologne car l'électrice a le nez pointu. Le style de ce tableau est particulièrement proche des portraits des proches de Cécile-Renée au Palais Pitti à Florence - son père l'empereur Ferdinand II (Palatina 209), sa belle-mère Éléonore de Gonzague (Palatina 203) et son oncle l'archiduc Charles d'Autriche (1590-1624), prince-évêque de Wrocław comme grand maître de l'ordre Teutonique (Palatina 293). Toutes ces peintures ont été réalisées par Justus Sustermans vers 1623. Puisque cette effigie est une version d'un portrait de Hrádek u Nechanic, la montrant vers 1626-1627, elle pourrait être réalisée à l'occasion de la préparation des portraits pour Sigismond III. La couleur des robes des deux archiduchesses (blanc et rouge, utilisées comme couleurs nationales de la Pologne-Lituanie dans le soi-disant « rouleau de Stockholm » datant d'environ 1605, Château Royal de Varsovie, ZKW/1528/1-39) dans les peintures de Hrádek u Nechanic et le portrait de Racconigi pourraient également indiquer que l'une d'elles était considérée comme une future reine de Pologne en 1627.
Portrait de l'archiduchesse Cécile-Renée d'Autriche (1611-1644), future reine de Pologne par Justus Sustermans, vers 1626-1627, Château royal de Racconigi.
Portrait de l'archiduc Charles d'Autriche (1590-1624), prince-évêque de Wrocław par Justus Sustermans, vers 1623, Palais Pitti à Florence.
Portraits de Sigismond III Vasa et de Constance d'Autriche en robes de couronnement par Gaspar de Crayer
« Portrait grandeur nature qui montre l'empereur en tenue pontificale, avec une couronne sur la tête, un sceptre dans la main droite et un orbe royal dans la gauche, c'est le roi de Pologne » (n° 26/22) et « Portrait de l'impératrice, vêtue de drap d'argent, avec un sceptre dans la main droite et un orbe dans la main gauche, son épouse » (n° 27/23), ainsi l'inventaire du palais du Coudenberg à Bruxelles de 1659 décrit les portraits du roi Sigismond III Vasa et de sa seconde épouse Constance d'Autriche en tenues de couronnement, connus grâce aux copies, aujourd'hui conservées à la Galerie nationale de Neubourg.
Les peintures bruxelloises pourraient être les peintures de Pieter Claesz. Soutman amené de Pologne-Lituanie en 1628 pour l'infante Isabelle-Claire-Eugénie d'Espagne (1566-1633), gouvernante des Pays-Bas espagnols, mais on ne sait rien de leur auteur et les tableaux furent probablement détruits dans un incendie accidentel qui se déclara dans la nuit de 3 février 1731. Trois autres portraits du fils et successeur de Sigismond, Ladislas IV, figuraient également dans la collection des gouverneurs des Pays-Bas espagnols - en pied lorsque le prince en costume national avec une main sur son épée (n° 40/36), avec un chapeau par Pierre Paul Rubens (n° 122/84) et en costume cramoisi, dit hongrois (n° 123/85) et un autre portrait de Sigismond avec un chapeau et un manteau doublé de fourrure (n° 124/86) (comparer « Rubens w Polsce » de Juliusz A. Chrościcki, p. 158, 162, 214). Les portraits du Neubourg ont une composition (appelée pendants) et des dimensions similaires (huile sur toile, 220,5 x 131,8 cm, 984 et huile sur toile, 219 x 132,7 cm, 985). On pense que les deux proviennent de la dot de l'infante Anna Catherine Constance Vasa (1619-1651), fille de Sigismond et Constance, et auraient donc été faites peu avant son mariage à Varsovie en 1642. Toutes deux ont également été attribuées à Soutman (d'après « Portrety tzw. koronacyjne ... » de Jerzy Lileyko, p. 377). Les portraits de monarques étaient fréquemment réalisés en série et parfois copiés par différents peintres. Il est possible que les originaux aient effectivement été réalisés par Soutman avant 1628. Cependant, même si l'attribution à ce peintre est aujourd'hui rejetée, les portraits de Neubourg sont clairement réalisés par un peintre formé en Flandre, comme l'indique leur style. Le roi et son fils organisaient les commandes et le transport des œuvres d'art par l'intermédiaire de leurs agents dont Jan Bierens (1591-1641), ainsi qu'un autre marchand et financier anversois Joris Descamps. Il a servi d'intermédiaire en transférant 1 000 puis 800 florins d'une banque d'Amsterdam à Rubens en guise de paiement impayé pour des peintures pour Sigismond III. Dans le même temps, Descamps accepte de transférer 1 000 florins supplémentaires d'une banque d'Amsterdam pour les tableaux précédemment livrés à la collection de Ladislas Sigismond. La lettre du 16 juillet 1626 mentionne deux autres créanciers du prince, à savoir Bierens (290 florins) et un certain Jacob Wijz ou Weez (20 thalers). Parmi les agents du prince se trouvait également le français Mathieu Rouault, chargé en septembre 1625 de livrer à Gdańsk les objets achetés à Anvers. À une occasion, les gardes-frontières espagnols à Dunkerque ont trouvé et confisqué dans ses malles de voyage des portraits de la famille royale française, à savoir Henri IV et son épouse Marie de Médicis, Louis XIII et son épouse Anne d'Autriche, Gaston, duc d'Orléans et le cardinal de Richelieu, ainsi que des effigies du roi Jacques Ier d'Angleterre, de l'infante Isabelle-Claire-Eugénie et de son mari l'archiduc Albert d'Autriche, l'archiduc Ernest d'Autriche, l'empereur Ferdinand II et Elisabeth de Lorraine, électrice de Bavière (d'après « Świat polskich Wazów: eseje », p. 290-291). À bien des égards, notamment en matière de mode et le mécénat, les monarques élus de la République ont imité les dirigeants du plus grand empire de l’époque, l’Espagne. Même s'il y avait de nombreux peintres éminents en Espagne, les artistes d'autres régions de l'empire travaillaient fréquemment pour la cour de Madrid, les Habsbourg espagnols, leurs parents et alliés. C'est ainsi que les collections de peinture de Florence (Uffizi, Palais Pitti), de Vienne (Kunsthistorisches Museum, Hofburg), de Munich (Alte Pinakothek, la Résidence) sont par bien des aspects comparables à celles de Madrid (Prado, Alcazar historique), surtout lorsqu'elles vient aux portraits échangés entre les pays. Les collections royales de la République d'avant 1655 devraient donc être comparables, malheureusement presque toutes ont péri dans la destruction délibérée par les envahisseurs, les incendies et les pillages. Plusieurs portraits importants du neveu de la reine Constance, le roi Philippe IV d'Espagne, ont été réalisés par Gaspar de Crayer, portraitiste de cour de sa tante l'infante Isabelle-Claire-Eugénie (comme le portrait équestre du musée du Prado à Madrid, P001553), qui n'a probablement jamais rencontré le roi en personne. On sait qu'entre 1621-1622 de Crayer peignit le roi et son épouse Élisabeth de France pour la Chambre des comptes du Brabant, mais ces œuvres ont été perdues. Les portraits de Juan de Velasco et de son frère José de Velasco, probablement peints vers 1620 lors de leur séjour à Bruxelles, sont attribués à Gaspar, qui, même dans ses œuvres ultérieures, n'a pas appliqué le pinceau lâche de Rubens, mais a continué à travailler dans le style traditionnel avec lequel il répondait peut-être à une préférence de ses clients (d'après « Gaspar de Crayer ... » de Hans Vlieghe, Tome I, pp. 43, 213, 251-252). Dans ses œuvres ultérieures, nous pouvons voir davantage les influences d'Antoine van Dyck et de Paolo Véronèse, mieux visibles dans le tableau signé représentant saint Ambroise, créé vers 1655 (Prado, P005198, signé en bas à droite : GAS. DE CRAYER FE.), qui fait partie d'une série des saints fondateurs du couvent Saint-François de Burgos. Quant à la composition, le portrait du roi et de la reine de Pologne à Neubourg suit la même convention avec une représentation en pied et une loggia ouverte en arrière-plan. En termes de style, les tableaux ressemblent davantage au portrait de Mechteld Lintermans (décédée en 1641), épouse de Jan Bierens (Sotheby's à New York, 4 juin 2009, lot 15), daté 1625-1630 et portrait de Juan de Velasco (1574-1621), secrétaire du roi Philippe III d'Espagne, beau-frère de la reine Constance (collection privée en Cantabrie). Ainsi créés avant que les influences de van Dyck ne deviennent plus visibles dans son œuvre à partir de 1631. Dans l'Alte Pinakothek de Munich, une autre effigie similaire de la reine Constance du château de Neuburg est conservée, donc probablement aussi de la dot de sa fille. Ce « portrait de dame », attribué à l'école allemande, est dans un mauvais état de conservation (huile sur toile, 77 x 59 cm, 6807), on y remarque cependant le style de de Crayer ainsi qu'une similitude avec le portrait du frère de Juan de Velasco - José (1571-1623) (collection particulière à Madrid). Concernant les tableaux bruxellois, environ 30 ans après leur création, la notion de qui était représenté était très vague. S'il n'était pas clairement précisé qu'il s'agit d'une effigie du roi de Pologne dans l'inventaire, les inscriptions pourraient être considérées comme concernant des effigies de membres de la famille des Habsbourg - l'empereur et son épouse. Le principal document confirmant les contacts de de Crayer avec des clients de la République est sa lettre à Matthijs Musson (1593-1678) à Anvers, datée du 2 décembre 1645 de Bruxelles, concernant l'arrivée de Krzysztof Opaliński (1609-1655), voïvode de Poznań, envoyé du roi Ladislas IV Vasa, et son entourage : « Nous avons été informés que les Polonais seraient ici vendredi ou peut-être jeudi. Ils ont vu une Assomption de Notre-Dame à Lierre que j'ai faite pour les Pères Jésuites et ils en désirent une copie » (Wy hebben hier avies dat de Polacken zullen hier wesen vrydagh oft mogelyck donderdach. Zy hebben gesien een Hemelvaert van Onse live Vrouwe tot Lier die ick hebbe gemackt voor de paters van Jesuiten en hebben begeert eene copye) (d'après « Na Peter Pauwel Rubens ... » de Jean Denucé, p. 36). Opaliński a visité l'atelier du peintre et a commandé une copie de son Assomption. Des copies du XIXe siècle de portraits du roi et de la reine en robes de couronnement se trouvent au château royal de Wawel (8555, 8556). Les exemplaires de la collection Przeździecki à Varsovie et de la collection Léopold Méyet, également à Varsovie, ont très probablement été détruits pendant la Seconde Guerre mondiale.
Portrait du roi Sigismond III Vasa (1566-1632) en robe de couronnement par Gaspar de Crayer, vers 1630, Galerie nationale de Neubourg.
Portrait de la reine Constance d'Autriche (1588-1631) en robe de couronnement par Gaspar de Crayer, vers 1630, Galerie nationale de Neubourg.
Portrait de la reine Constance d'Autriche (1588-1631) par Gaspar de Crayer ou atelier, vers 1630, Alte Pinakothek de Munich.
Portraits du prince Jean Casimir Vasa par Rembrandt
Les rois et aristocrates polono-lituaniens possédaient de nombreuses œuvres de Rembrandt, son atelier ou ses disciples, il peignait fréquemment des personnages en costumes très similaires à ceux connus des effigies de la noblesse polono-lituanienne, il commença sa carrière dans l'atelier de fournisseur du roi de Pologne et épousa son parent, il vécut à Amsterdam, où des tonnes de céréales polonaises, de grandes quantités de fourrure et d'autres produits étaient expédiées chaque année au XVIIe siècle, mais il n'aurait peint aucun Polonais connu de nom (concernant les effigies conservées).
En raison du manque de sources écrites le confirmant explicitement, même le « cavalier polonais » ou le « noble polonais » de Rembrandt ou son école sont interrogés comme ne représentant peut-être pas le peuple polono-lituanien, de même avec la « reine de Pologne » par l'élève de Rembrandt, Ferdinand Bol. Ce vaste pays multiculturel aux langues incompréhensibles, à la monarchie élective, à la tolérance religieuse et à l'influence grandissante des papistes et des Habsbourg, représentait tout le mal de cette planète pour les pieux protestants. Ils ont dû saluer le fait que le prince calviniste de Transylvanie Georges II Rakoczi (1621-1660) a rejoint d'autres pays et a envahi la République polono-lituanienne par le sud pendant le déluge (1655-1660). Joost Cortwiert publia en 1657 à La Haye un manifeste de huit pages en néerlandais intitulé « Un manifeste de Georges Rakoczi, prince de Transylvanie, contenant les raisons pour lesquelles il attaque le royaume de Pologne avec son armée » (Manifest van Georgius Ragotsky, prins van Transilvanien. Vervattende de redenen waer om hy metsyn chrijchs-macht int koninck-rijck Polen valt). À cette époque également, un portrait de cet allié important a été publié, bien qu'en raison de l'absence d'effigie appropriée, peut-être par erreur, une gravure antérieure de Jan van Vliet d'après une peinture de Rembrandt ait été utilisée. Il a été créé en 1631 et représente un prince oriental, qui n'a cependant aucune ressemblance avec d'autres effigies de Georges II Rakoczi (1621-1660) ou de son père Georges I (1593-1648) (comparer « 323 The Rákóczy identity » de Gary Schwartz). Cette effigie a également été publiée en tant que portrait de Skanderbeg (1405-1468), seigneur d'Albanie. La marche de l'armée de Rakoczi vers Varsovie a été marquée par des atrocités, des destructions et des pillages. Simultanément, les forces de Jerzy Sebastian Lubomirski organisèrent une invasion vengeresse de la Transylvanie. Après la défaite et la retraite subséquente de ses alliés cosaques, Rakoczi capitula devant Lubomirski, promettant de rompre son alliance avec la Suède et d'abandonner la ville royale de Cracovie. Non seulement des gens ont été tués, des biens pillés, des bâtiments détruits, mais l'invasion étrangère a déclenché des maladies épidémiques, une profonde crise économique et un nettoyage ethnique. Les peuples qui ont survécu à l'invasion luttaient pour survivre dans un pays ruiné, comme à Kazimierz Dolny sur la Vistule, le joyau maniériste de la République, qui a pris de l'importance après 1561 grâce au commerce des céréales en tant que port fluvial important. La ville fut saccagée et incendiée en février 1656 par les troupes du Brigand de l'Europe (comme l'appelait Stefan Czarniecki), Charles X Gustave de Suède, qui envahit le pays par le nord, et de nouveau par les troupes de Transilvanie en 1657. Avant 1661, les troupes de Stefan Czarniecki détruisirent la synagogue locale et tuèrent de nombreux Juifs, accusés par les catholiques de soutenir les envahisseurs. De l'une des nations les plus riches d'Europe, la Pologne-Lituanie est devenue l'une des plus pauvres. Riches résidences royales et de magnats ont été saccagés et incendiés. Un document conservé - inventaire des biens transportées à Stockholm depuis Varsovie le 9 mars 1657 répertorie « 188 grands et petits tableaux et portraits peints sur panneau et toile » (188 St. stoora och små Skillerij och Conterfey på trää och lerfft måhlat), « Une peinture de l'autel, peinte sur bois » (1 måhlat alltaretafla af trää duger intet) et « Peintures à l'huile qui se trouvaient dans des plafonds à Varsovie, de cinq pièces » (Schillerij som hafwer suttit under taket i Warschow till 5 Cambrer af Wattnferger) de l'inventaire des objets pris au château de Varsovie en 1656 (d'après « Inwentarz przedmiotów wywiezionych z Warszawy ... » de Katarzyna Wagner). Les plafonds à charpente dorée de style vénitien des résidences royales étaient remplis de peintures à l'huile, similaires à celles conservées dans le palais des évêques de Cracovie à Kielce, créées par l'atelier de Tommaso Dolabella (1570-1650) vers 1642, ou dans le château de Koniecpolski à Pidhirtsi (Podhorce) près de Lviv dans l'ouest de l'Ukraine, également par l'atelier de Tommaso Dolabella et du peintre hollandais Jan de Baen (1633-1702), élève de Jacob Adriaensz Backer à Amsterdam (années 1640 et 1660). Les expéditions polonaises de céréales et d'autres produits vers Amsterdam ont pratiquement cessé pendant l'invasion, mais Johann Köstner, un marchand de Gdańsk, a souligné en 1660 que la Hollande s'était débrouillée avec des céréales d'ailleurs. Curieusement, cependant, le déclin de la carrière de Rembrandt coïncida avec l'invasion de la République. Le 24 novembre 1655, Titus, 14 ans, le quatrième et seul enfant survivant de Rembrandt, rédige son dernier testament et nomme son père comme son unique héritier, y compris ce qu'il avait hérité de sa mère. Le peintre, qui vivait au-dessus de ses moyens, n'a pas réussi à rembourser les emprunts. Après sa déclaration d'insolvabilité en 1656, sa propriété est vendue. Le monarque de la République à cette époque était Jean II Casimir Vasa, le fils aîné de Sigismond III et de sa seconde épouse Constance d'Autriche, élu par le Parlement polono-lituanien pour succéder à son demi-frère Ladislas IV en 1648. Pendant le déluge, il s'enfuit en Silésie en emportant certains des objets les plus précieux de la collection royale. Déjà en 1626, lors du Toruń Sejm, il fut proposé par les partisans de sa mère et à son initiative comme candidat à l'héritier du trône. Simultanément, à la fin des années 1620, les contacts entre la cour royale polono-lituanienne et la République néerlandaise s'intensifient. Abraham van Booth, secrétaire de la délégation néerlandaise qui s'est rendue en Pologne entre 1627 et 1628 avec une mission de médiation dans le différend qui a surgi entre Sigismund III Vasa et Gustave II Adolphe, roi de Suède, a créé quelques dessins, notamment du château royal de Varsovie et audience avant Sigismond III dans l'ancienne salle du Sénat. Le camp ultra-catholique de la République, dont le prince Jean Casimir était considéré comme le chef, perdit de son importance après la mort subite de la reine en 1631. Entre 1632 et 1635, Ladislas IV chercha à accroître son influence en négociant le mariage de Jean Casimir avec la reine Christine de Suède, sa parente éloignée. Jean Casimir, grand mécène comme son père et son frère, fut probablement l'un des premiers connaisseurs royaux de l'art de Rembrandt. Le roi possédait dans sa collection un tableau de « Diane au bain et Actéon » de Rembrandt (Un tableau en hauteur, peint sur toile, qui est un bain de Diane avec Acteon) vendu en 1673 à Paris à François Andrault de Buy de Langeron (pièce 88 de l'inventaire). Sa résidence à Nieporęt près de Varsovie, « un chef-d'œuvre de menuiserie » selon Jean Le Laboureur qui visita le palais le 3 mars 1646, était richement décorée principalement de tapisseries flamandes. Avant 1643, Samuel von Sorgen payait à un peintre inconnu à Vienne, très probablement Frans Luycx, « ad rationem des autels à Nieporęt » et en 1651 un architecte hollandais et un mennonite Peeter Willer (ou Willert) construit une écluse à Nieporęt sur la rivière Narew, une « maison hollandaise » (un manoir de chasse) et une brasserie, et à Varsovie un pavillon appelé « maison de plaisir » (lusthauz) pour les dames de la reine au palais Villa Regia et un moulin. Peut-être après son accession au trône vers 1649, le peintre de la cour de Jean Casimir, Daniel Schultz, a créé son portrait dans la salle de marbre du château royal de Varsovie. Schultz a été formé aux Pays-Bas et il a étudié à Leyde en 1643 (il est très probablement mentionné comme « Daniel Schultz Borussus »). Le portrait mentionné de la salle de marbre, très dans le style de Rembrandt, montre le roi dans un grand chapeau de fourrure, une chemise et une chaîne très similaire au portrait d'un homme de profil avec un bonnet à plumes et de longs cheveux ondulés dans une collection privée en Allemagne, monogrammé en bas à gauche « RHL », exactement comme une estampe de Jan van Vliet, signé dans la planche « RHL. v Rijn. Jn. / 1631. / JG v. vliet fecit » (comparer « 323 The Rákóczy identity » de Gary Schwartz). Ce portrait, très probablement l'un d'une série, était sans aucun doute un modèle pour l'estampe de van Vliet. Le même profil a également été inclus dans un dessin d'étude ou une esquisse préliminaire de Rembrandt au Barber Institute of Fine Arts de Birmingham. Le jeune homme à la lèvre inférieure saillante ressemble beaucoup aux autres effigies de Jean Casimir (surtout son buste en marbre de Giovanni Francesco Rossi), qui avait 22 ans en 1631 lors de la réalisation des portraits et hérita de la mâchoire des Habsbourg (ducs de Masovie) de sa mère Constance d'Autriche. La même année, Rembrandt a déménagé de Leyde dans la maison d'un agent d'art du roi Sigismond III Vasa, Hendrick van Uylenburgh, à Amsterdam. Rembrandt devint le peintre en chef de l'atelier et épousa en 1634 la parente de Van Uylenburgh, Saskia. Toujours en 1631, deux importants magnats polono-lituaniens arrivèrent aux Pays-Bas, Janusz Radziwill (1612-1655) à Leyde et Jerzy Sebastian Lubomirski (1616-1667) à Louvain aux Pays-Bas espagnols (peut-être aussi à Leyde cette année-là).
Une feuille d'études de figures avec un portrait du prince Jean Casimir Vasa (1609-1672) par Rembrandt, années 1630, The Barber Institute of Fine Arts.
Portrait du prince Jean Casimir Vasa (1609-1672) dans un chapeau de fourrure par Rembrandt ou suiveur, vers 1631, Collection particulière.
Portrait du prince Jean Casimir Vasa (1609-1672) dans un chapeau de fourrure par Jan van Vliet d'après Rembrandt, 1631, Rijksmuseum à Amsterdam.
Portraits de Jerzy Sebastian Lubomirski par Rembrandt et Ferdinand Bol
En 1629, Jerzy Sebastian (1616-1667) et son frère aîné Aleksander Michał (1614-1677), fils du fabuleusement riche voïvode de Ruthénie, le prince Stanisław Lubomirski (1583-1649), partent étudier à l'étranger. Aleksander avait 15 ans et Jerzy 13 ans. Jakub Piotrowicki, prêtre catholique et professeur de l'Académie de Cracovie, est devenu leur tuteur, ils étaient également accompagnés de l'intendant Sebastian Kokwiński. La première destination fut l'université jésuite d'Ingolstadt (17 septembre 1629). De là, ils se rendirent à Louvain aux Pays-Bas espagnols en 1630, où il y avait aussi une université catholique, très populaire auprès de la noblesse et des magnats polonais, et à Cologne en 1632. Puis en avril 1633, Jerzy Sebastian était à Leyde protestant pour étudier le génie militaire et il y rencontra probablement Janusz Radziwill (1612-1655), un calviniste, qui y étudiait également. Plus tard, il visita l'Angleterre, la France, l'Espagne et l'Italie. Au cours de ces voyages, il apprend l'art de la fortification, la rhétorique, la grammaire, la mathématique, les langues, et il a l'occasion de rencontrer des nobles et des monarques étrangers. Il retourna en Pologne en 1636.
Entre 1639-1641, un peintre flamand Mattheus Ingermann (Ingenraen) d'Anvers, qui a étudié la peinture à Rome, a travaillé comme peintre de la cour de Stanisław Lubomirski (le père de Jerzy Sebastian), peignant son fils Aleksander, ce qui est confirmé par l'inventaire conservé du galerie de Wiśnicz. Son « Annonciation » de la chapelle du château de Wiśnicz se trouve aujourd'hui dans l'église Sainte-Anne de Varsovie-Wilanów. Il a également réalisé des peintures grand format pour l'église carmélite de Nowy Wiśnicz. Après la mort de Stanisław en 1649, ses trois fils Jerzy Sebastian, Aleksander Michał et le plus jeune Konstanty Jacek (1620-1663) ont géré les domaines, y compris l'opulent château de Wiśnicz. Pendant le déluge (1655-1660), Aleksander Michał s'empara de quelques riches meubles du domaine de Wiśnicz (château et monastère) et les emmena à Spiš. Quittant Wiśnicz le 19 septembre 1656, l'armée du Brigand de l'Europe, comme l'appelait Stefan Czarniecki, roi Charles X Gustave de Suède, pilla les objets les plus précieux et aurait emporté jusqu'à 150 wagons de butin précieux et 35 canons. L'« Inventaire des biens épargnés des Suédois et des évasions faites le 1er décembre 1661 à Wiśnicz » dans les Archives centrales des documents historiques à Varsovie, répertorie certaines des peintures conservées, principalement de maîtres italiens comme Raphaël, Titien, Véronèse, Guido Reni, Guercino, Domenichino, des noms flamands ne sont que Paul Bril et Daniel Seghers, mais à côté d'eux l'inventaire recense de nombreuses peintures flamandes et hollandaises, « en général, bien plus que des peintures italiennes », selon Jerzy Mycielski (1856-1928) - réunion de la Commission pour l'étude de l'histoire de l'art en Pologne le 26 février 1903, en outre, les portraits de la famille Lubomirski, peints à Venise par Nicolas Régnier (Niccolò Renieri) et à Gdańsk par Daniel Schulz. En 1660, Jerzy Sebastian invita en Pologne Tylman Gamerski (Tielman van Gameren, né à Utrecht), un architecte et ingénieur néerlandais, qui travaillait à l'époque à Venise, apparemment en tant que peintre de scènes de bataille. À partir de 1674, Gamerski travailla au château royal d'Ujazdów à Varsovie, dévasté pendant le déluge et vendu au fils de Jerzy Sebastian, Stanisław Herakliusz Lubomirski (1642-1702). L'une des premières œuvres de l'élève peut-être le plus doué de Rembrandt, Carel Fabritius (1622-1654), la Résurrection de Lazare au Musée national de Varsovie peinte vers 1643 (signée CAR.FABR.), provient du domaine Lubomirski à Ujazdów (avant 1702 très probablement dans l'église Sainte-Anne d'Ujazdów avec une statue du Christ mort du sculpteur flamand Giusto Le Court). Certains membres de la famille Lubomirski possédaient également des tableaux de Rembrandt ou de son entourage. Avant 1790, dans la collection du comte Lubomirski à Lviv se trouvait un Portrait de jeune homme (huile sur toile 71 x 59,7 cm), attribué à Barent Fabritius et plus tard à Samuel van Hoogstraten (d'après « Rembrandt After Three Hundred Years ...» par Jay Richard Judson, Egbert Haverkamp Begemann, p. 74). Le catalogue des peintures de la collection de la comtesse Eleonora Teresa Jadwiga Lubomirska née Husarzewska (1866-1940), exposée à Lviv en 1909 (« Katalog ilustrowany wystawy mistrzów dawnych ...» de Mieczysław Treter, article 52, p. 18), est la plus ancienne provenance sûrement documentée du tableau de Rembrandt ou de son suiveur, aujourd'hui conservé au Indianapolis Museum of Art (2023.4). D'après le catalogue, le tableau était signé et daté en bas à gauche : f. R. H. 1628 (année non visible aujourd'hui). Il est considéré comme l'un de ses premiers autoportraits. Le tableau a probablement été évacué de Pologne pendant la Seconde Guerre mondiale (1939-1945) par ses propriétaires. La comtesse possédait également « Agar renvoyée dans le désert » de l'école de Rembrandt (huile sur toile, 75 x 52 cm, article 56, p. 19). La majorité des effigies conservées de Jerzy Sebastian proviennent de ses dernières années et ont été créées par des artistes flamands, dont un portrait par Jan de Herdt (Château royal de Varsovie), créé vers 1664. Le portrait d'un jeune homme avec une épée par Ferdinand Bol au Dayton Art Institute (huile sur toile, 205,7 x 130,8 cm, 1962.18), représente un homme en riche costume princier. Sa tunique de velours fortement brodée, sa pose et son sabre oriental sont très similaires à l'effigie du roi Ladislas IV Vasa de « Het Groot Balet » (Caricature des négociations de paix après la bataille de Lützen) au Rijksmuseum d'Amsterdam, estampe anonyme créée après 1632. Chaussures en cuir très similaires de style polonais, ainsi qu'un étui à flèches en velours et un carquois ont été offerts par Jean II Casimir Vasa, monarque élu de la République polono-lituanienne, au roi de Suède âgé de cinq ans Charles XI vers 1660. Ils sont également visibles dans le célèbre Cavalier polonais (Lisowczyk) de Rembrandt ou son entourage, qui représentent très probablement Marcjan Aleksander Ogiński (1632-1690), colonel de la cavalerie légère polono-lituanienne. Ce dernier tableau, aujourd'hui dans la Frick Collection à New York, provient de la collection royale polonaise (acquise en 1791 par le roi Stanislas Auguste Poniatowski). Ogiński a été portraituré par Bol au moment de ses études aux Pays-Bas. Cette effigie portant l'inscription MO / STR (en bas à droite), identifiée comme « Marcjan Ogiński / Staroste de Trakai », et le montrant coiffé d'un chapeau de fourrure se trouve dans une collection privée (d'après « O amerykańskich polonikach Rembrandta ... » de Zdzisław Żygulski, p. 49). Bol, qui avait le même âge que Jerzy Sebastian Lubomirski, tous deux nés en 1616, a été amené enfant à Amsterdam. Il a dû entrer très jeune dans l'atelier de Rembrandt, probablement vers l'âge de seize ans (d'après Emile Michel « Rembrandt, His Life, His Work and His Time », tome 1, p. 244). Le portrait décrit est daté d'environ 1635-1640, donc très probablement lorsque Lubomirski n'était plus aux Pays-Bas, cependant, cela n'exclut pas la possibilité qu'il ait été réalisé sur la base de dessins créés plus tôt dans l'atelier de l'artiste ou envoyés de Pologne. Le sabre et le harnachement de style oriental de Jerzy Sebastian se trouvent aujourd'hui au musée Czartoryski de Cracovie. Le même homme a été représenté dans deux tableaux de Rembrandt ou de son entourage. L'un intitulé Jeune homme au chapeau à plumes, aujourd'hui au Toledo Museum of Art (huile sur panneau, 81,3 x 66 cm, 1926.64), a été créé en 1631 lorsque Rembrandt a déménagé à Amsterdam depuis sa ville natale de Leyde (monogrammé et daté en bas à gauche : RHL. 1631), pour vivre dans la maison de l'agent artistique du roi de Pologne. La seconde, au North Carolina Museum of Art (huile sur toile, 118,1 x 96,5 cm, GL.60.17.68), signée et datée « 1633 » dans le coin supérieur droit, montre l'homme tenant une lourde épée ancienne, semblable aux épées de l'âge du bronze trouvées à Nowy Żmigród, dans le sud-est de la Pologne, non loin des domaines de Lubomirski à Łańcut et Nowy Wiśnicz, aujourd'hui au Musée des Basses-Carpates à Krosno. Ce n'est pas un simple soldat, c'est un connaisseur extrêmement riche, descendant des anciens sarmates (ancêtres légendaires de la noblesse polonaise), formé à Leyde comme ingénieur militaire.
Portrait de Jerzy Sebastian Lubomirski (1616-1667) avec un chapeau à plumes par Rembrandt ou cercle, 1631, Toledo Museum of Art.
Portrait de Jerzy Sebastian Lubomirski (1616-1667) avec une ancienne épée par Rembrandt ou cercle, 1633, North Carolina Museum of Art.
Portrait de Jerzy Sebastian Lubomirski (1616-1667) avec un sabre oriental par Ferdinand Bol, 1634-1640, Dayton Art Institute.
La résurrection de Lazare par Carel Fabritius, vers 1643, Musée national de Varsovie.
Portrait du prince Vladislav Dominik Zaslavsky-Ostrogsky par un suiveur de Frans Hals
Le 12 juin 1633, riche héritier des fortunes Zaslavsky et Ostrogsky, le prince Vladislav Dominik (décédé en 1656) épousa Zofia Pudencjana Ligęzianka (décédée en 1649), qui devait recevoir une dot de 60 000 florins en espèces et 10 000 en bijoux. À l'âge d'environ 15 ans, le marié était propriétaire d'immenses domaines dans le sud de la Pologne et en Ruthénie - 23 villes et environ 400 villages et des domaines allodiaux composés de 19 villes et environ 160 villages. Peu de temps après le mariage, le jeune magnat fut envoyé avec les nobles Florian Zamoyski et Piotr Minocki en voyage éducatif, d'abord à Padoue puis à Bologne. Il visite également Leyde, Paris, Lyon, Florence, Lorette, Rome, Naples et Pouzzoles. En novembre 1635, il retourna dans la République polono-lituanienne par voie maritime via Gdańsk, probablement depuis les Pays-Bas, et le voyage coûta 26 053 zlotys (comparer « Akademickie niestatki ... » de Jarosław Pietrzak, p. 17-18).
Très probablement à Gdańsk, Bartholomeus Strobel a peint en 1635 le magnifique portrait du prince, représenté dans un riche costume français, aujourd'hui au palais de Wilanów (Wil. 1654) et peu de temps après, lui ou son entourage en a également peint une version en pied, maintenant conservé au Musée national d'art de Biélorussie (ЗЖ-106). Vladislav Dominik est né avant le 22 juin 1618 car il est mentionné dans un document de cette date délivré par son grand-père maternel le prince Janusz Ostrogski (1554-1620) concernant l'héritage des domaines d'Ostroh. Dès les premières années, toute l'éducation du prince était gérée par un conseil de tuteurs dirigé par sa mère, Euphrosyne Zaslavska née Ostrogska (décédée en 1628), ainsi que Bogusław Radoszewski, évêque de Loutsk et Marcin Szyszkowski, évêque de Cracovie. Avant de partir en voyage éducatif à l'étranger, le prince a étudié à l'Académie de Cracovie. Les études à Leyde protestante étaient probablement importantes pour les tuteurs ou pour le prince lui-même, car ses deux jeunes frères Constantin Alexandre (1620-1642) et Janusz Isidore (1622-1649) y étudièrent également. Après avoir étudié à Padoue (à partir d'octobre 1638), les frères Zaslavsky et leur tuteur Jan Hieronim Rychłowski s'installèrent en 1641 aux Pays-Bas, où ils reçurent 12 000 florins des tuteurs pour poursuivre leurs études. Janusz Isidore décède subitement à l'âge de 22 ans et ses funérailles ont lieu à Leyde le 15 juillet 1642. La cérémonie, reportée de plusieurs mois, réunit à Leyde de nombreux Polonais venus de tous les Pays-Bas. Elle fut honorée par un discours du savant néerlandais Marcus Zuerius van Boxhorn (1612-1653), linguiste et professeur à l'université de Leyde, publié en 1642 - Oratio in excessum illustrissimi et splendidissimi principis Constantini Alexandri, principis Ostrogiae, ducis Zasłaviae etc. Le prince Zaslavski-Ostrogski était connu pour son style de vie somptueux. Il dépensait des sommes énormes lors de ses voyages constants à travers le pays, pour organiser des divertissements, tels que des concerts d'artistes royaux, des représentations d'acteurs, la chasse et pour entretenir son propre orchestre de musique. Des sommes fixes étaient dépensées en peintures, dessins et livres. L'inventaire de ses biens de 1657 contient 415 tableaux, principalement des portraits, 887 livres et un petit nombre de dessins et graphiques. La galerie de peintures principalement néerlandaises, fondée par le père du prince Alexandre (mort en 1629), a été complétée par d'autres œuvres apportées de l'étranger et achetées plus tard (d'après « Bartłomiej Strobel ... » de Jacek Tylicki, p. 185). Outre les portraits de Strobel, on connaît un autre portrait peint de Vladislav Dominik, en pied, en costume national, aujourd'hui conservé au palais de Wilanów (Wil.1167). On pensait auparavant qu'il s'agissait de l'effigie de son arrière-grand-père Constantin Vassili (1526-1608), prince d'Ostroh, et il a été correctement identifié par moi en 2014 par comparaison avec un dessin perdu représentant le portrait de Vladislav Dominik du milieu du XVIIe siècle (Musée national de Varsovie, Rys.Pol.2500). Son père, formé aux universités d'Ingolstadt, Padoue et Bologne, qui selon Kasper Niesiecki (1682-1744), « ne dépensait pas beaucoup pour ses vêtements », l'avait prévenu avant de partir étudier à l'étranger « de ne pas changer le costume polonais » (d'après « Tłuścioch wilanowski ... » de Jacek Żukowski). Les registres des biens meubles du magnat de 1649 et 1656 recensent des costumes à la française, des pourpoints violets dont un brodé d'argent, un alomont de drap vert, de nombreuses manches, une paire de bas de soie et de coton, des ceintures constellées de pierres précieuses et de nombreux bijoux. Ainsi, non seulement pendant son voyage et peu de temps après, comme en témoigne le portrait de Strobel, le prince portait des costumes étrangers. Plus tard, un pamphlet anonyme a ridiculisé l'éducation de Vladislav Dominik à l'étranger : « Il n'était pas comme son père et sa mère / élevé négligemment et licencieusement par ses tuteurs [évêques catholiques] / Initié à toutes sortes de plaisirs à Cracovie / Sous le nom d'arts libéraux. / Un héritier paresseux, inactif, stupide et un jeune homme épris de luxe / Qui, se précipitant avec mépris à l'étranger / n'a rien appris à Padoue, se livrant aux plaisirs ». Dans la Galerie des peintures d'Anhalt-Georgium à Dessau se trouve un portrait d'un garçon portant une collerette, attribué auparavant à Frans Hals et maintenant à un suiveur (huile sur panneau, 66 x 50 cm, inv. 62). Il provient de la collection de la princesse Henriette Amalie d'Anhalt-Dessau (1720-1793), qui a acheté la majorité des tableaux à titre privé et aux enchères, notamment lors de la vente aux enchères de la succession de Caroline-Louise de Waldeck et Pyrmont (1748-1782), duchesse de Courlande à Francfort en janvier 1783 (d'après « Catalog der Gemälde-Sammlung der Fürstlichen Amalienstiftung zu Dessau », p. 3, 27). La Courlande faisait alors partie de la République polono-lituanienne. Le garçon ressemble beaucoup au prince Zaslavsky-Ostrogsky d'après ses portraits mentionnés. D'après l'inscription en haut à gauche, le portrait a été réalisé en 1634, lorsque le prince voyageait et étudiait à l'étranger, et l'âge du modèle est de 15 ans, mais le dernier chiffre est indistinct (AETATIS SUAE. 1[5?] / FH A 1634) (comparer « Die holländischen Gemälde ... », éd. Alexandra Nina Bauer, p. 63). Le nombre pourrait aussi être 16 ou 18, ce qui correspond généralement à l'âge de Vladislav Dominik en 1634, considéré comme né entre 1616 et 1618. Bien qu'aucune peinture de Hals ne se trouve aujourd'hui dans les collections publiques en Pologne, plusieurs proviennent de collections historiques polonaises, comme deux portraits de la collection du dernier monarque élu de la République Stanislas Auguste Poniatowski (1732-1798), aujourd'hui dans une collection privée (comparer « Frans Hals » de Henricus Petrus Baard, p. 71-72) ou deux portraits de la collection du comte Maurycy Zamoyski (1871-1939) à Varsovie (Saint Louis Art Museum, 272:1955 et The Nelson-Atkins Museum of Art, 31-90). L'homme du portrait, provenant de la collection des comtes Branicki à Varsovie (huile sur toile, 79,5 x 58,5 cm, Sotheby's à Londres, 4 décembre 2013, lot 35), pourrait être, comme Vladislav Dominik, un visiteur aux Pays-Bas de la République polono-lituanienne.
Portrait du prince Vladislav Dominik Zaslavsky-Ostrogsky (mort en 1656) par un suiveur de Frans Hals, 1634, Galerie des peintures d'Anhalt-Georgium à Dessau.
Portrait d'homme en noir au col de dentelle de la collection Branicki à Varsovie par Frans Hals, 1635-1640, Collection particulière.
Portraits d'Anna Kiszczanka par Rembrandt et Giacinto Campana
« Puis-je avoir, honorable dame, selon votre dignité, / Un cadeau en or pour votre fête / Et des œuvres subtiles de pays étrangers » (Żebym miał, zacna pani, według twej godności / Na twoje imieniny upominek złoty / I krajów cudzoziemskich subtelne roboty), a exprimé ses vœux le jour de la Sainte-Anne en 1633 dans un poème dédié à Anna Kiszczanka (1593-1644), à la princesse Radziwill, le poète de la cour Daniel Naborowski (d'après « Anna Kiszczanka Radziwiłłowa ... » de Mariola Jarczykowa, p. 95-97, 102-103).
Il a été écrit dans une sombre atmosphère de guerre avec Moscou, lorsque lors des élections royales après la mort de Sigismond III Vasa, l'armée russe, soutenue par la Suède, a attaqué la frontière orientale et a assiégé Smolensk. Naborowski a loué la piété de la princesse Anna, ce qui a été confirmé dans une lettre du ministre calviniste Baltazar Krośniewicz de Birzai (29 août 1617). En 1631, avec son mari Christophe Radziwill (1585-1640), elle fonde « une grande église en brique sur la place de Kedainiai » et une école calviniste. En outre, ils fondèrent « une deuxième église en brique et un cimetière pour les funérailles évangéliques sur la montagne près de notre manoir, sur la place qu'ils appellent Januszów. Là, à Januszów, nous construisons un hôpital pour les pauvres, les personnes âgées, les infirmes, les handicapés et les malades » (d'après « Upamiętnienie Radziwiłłów … » d'Aliaksandr Prudnikau, p. 92-93). Le fort sentiment anticatholique de Kiszczanka illustre le mieux le document du 8 juin 1644. Il s'agit d'un extrait des dossiers du tribunal contenant la protestation de Mikołaj Karol Białozor, curé de Kedainiai, contre Anna, pour avoir refusé la procession de la Fête-Dieu à Kedainiai. Elle arrive en ville la veille de la célébration, soit le 25 mai 1644, et impose des sanctions à tous ceux qui participeraient au cortège le lendemain. Le jour même de la fête, elle a ordonné le blocage du pont, ce qui a empêché le passage du cortège (d'après « Katolikom nabożeństwa zabroniła ... », Habemus Documentum, AGAD 1/354/0/10/707). Anna était la fille de Stanislas Kiszka et d'Élisabeth Sapieha et l'héritière d'immenses domaines, dont Kedainiai. Elle épousa Christophe en 1606, alors qu'elle n'avait que 13 ans. Parmi leurs six enfants, deux ont survécu jusqu'à l'âge adulte, Janusz (1612-1655) et Catherine (1614-1674). Son fils, Janusz, est diplômé du gymnase calviniste de Slutsk et part étudier à l'étranger à l'âge de 16 ans. Il poursuit ses études à Leipzig, Altdorf et Leyde. En 1632, en tant qu'ambassadeur de la République, il visita la France et l'Angleterre. Un an plus tard, en 1633, après avoir engagé 1 000 fantassins et 200 dragons aux Pays-Bas, il retourne en Pologne-Lituanie et participe à la guerre de Smolensk. Au cours de l'été 1628, Boguslas Radziwill (1620-1669), qui vivait en Allemagne avec sa mère, après son second mariage, fut confié aux soins de son oncle et de sa tante et s'installa au Grand-Duché de Lituanie. Boguslas a été éduqué, comme Janusz auparavant, par le pasteur protestant Paweł Demitrowicz, qui avait auparavant été recteur des écoles calvinistes de Vilnius et de Slutsk. Peu de temps après être devenu courtisan du roi Ladislas IV Vasa, il part également étudier aux Pays-Bas en 1637, comme son cousin Janusz. Parmi les effigies les mieux peintes des deux cousins figurent des portraits réalisés par des peintres hollandais - le portrait de Janusz par David Bailly (1584-1657), peint vers 1632 à Leyde (Musée national de Wrocław, VIII-578) et le portrait de Boguslas, attribué à Willem van Honthorst (1594-1666), peint vers 1665 comme l'indique son costume (collection particulière), peut-être à l'occasion de son mariage avec sa parente catholique Anna Maria Radziwill (1640-1667). En raison des liens de la branche protestante de la famille Radziwill en Europe, en 1633, pendant la guerre de Smolensk, le prince Jean Casimir Vasa, alité, proposa d'épouser la fille d'Anna, Catherine. Son père, cependant, sans doute impliqué dans les deux unions protestantes souhaitées par le roi - Jean Casimir devait épouser la reine Christine de Suède et Ladislas voulait épouser sa mère Marie-Éléonore de Brandebourg, refusa poliment. Catherine Radziwill vivait avec sa mère malade - la princesse Anna écrivit à son mari de Birzai le 9 octobre 1628 qu'elle avait des ulcères à l'oreille gauche. Elle but de l'eau thermale et alla finalement se rétablir en 1632 à Cieplice Śląskie-Zdrój, selon une lettre de Dolatycze près de Novogroudok à Janusz, datée du 9 juillet. À Kapyl, sur l'avis des médecins, la princesse « prit de la vapeur dans la baignoire » (d'après « Zdrowie Władysława IV » de Rumbold z Połocka, p. 171-172). Pour commémorer leur fils et son cousin Anna et Christophe fondèrent deux villes qui portent leur nom - Januszpol près de Kedainiai et Bogusławpol près de Minsk, qui allaient devenir d'importants centres d'artisanat et de commerce. En raison du déclin de la lignée protestante de la famille Radziwill après le déluge, Januszpol et Bogusławpol ont perdu leur nom. Le 17 août 1643, la veuve Anna Kiszczanka délivra le privilège de Januszpol, également connu sous le nom de Januszów et Janopol, confirmant que la majorité de ses habitants étaient des étrangers, invités à s'installer dans la nouvelle ville par son mari. Selon le document, « j'ai été accueilli par les habitants célèbres de ma ville, Januszów, des gens de nations étrangères, recrutés par diverses lettres de sa majesté le prince, voïvode de Vilnius, grand hetman du Grand-Duché de Lituanie, mon mari ». Répondant à la demande des habitants de Januszpol, Anna a ordonné à son gouverneur de Kedainiai, Andrzej Przystanowski, porte-épée de Samogitie, de mesurer les carrés et de les distribuer aux personnes « venant de nations étrangères ». Les nouveaux résidents furent affranchis pendant 10 ans de toutes charges monétaires et douanières envers le trésor princier. Les colons de Januszpol et de Kedainiai étaient pour la plupart des réfugiés évangéliques venus d'Écosse, d'Angleterre, des Pays-Bas et d'Allemagne. Dans une lettre datée du 12 janvier 1612 en provenance de Hambourg, Daniel Naborowski informa son patron Christophe Radziwill du recrutement d'Anglais aux Pays-Bas (d'après « Korespondencja i literatura okolicznościowa ... » de Mariola Jarczykowa, p. 114). L'architecture de Kedainiai avant 1655, comme le montrent les reconstitutions virtuelles créées pour le musée de Kedainiai, ressemble davantage à des villes des Pays-Bas, d'Angleterre et d'Allemagne qu'à des villes fondées par des mécènes catholiques, comme Zamość, peuplé d'Italiens, d'Arméniens, de Juifs et de Grecs. Le registre des dépenses d'Anna Kiszczanka de 1641 pour son domaine à Zabłudów près de Białystok indique que la plupart de ses dépenses étaient destinées à des fins personnelles, à la nourriture, à la rénovation des manoirs et à l'achat de produits de luxe, dont la plupart étaient des produits importés achetés à Gdańsk et Toruń. Les dépenses liées aux activités caritatives ou éducatives constituaient une marge de revenus des domaines de Zabłudów (d'après « Rozchody i wydatki księżnej Anny Kiszczanki » d'Antoni Mironowicz, p. 274). Aucune effigie peinte de la princesse Anna n'est connue, mais il doit y en avoir beaucoup, probablement par des peintres hollandais ou par un peintre de la cour royale. L'inventaire des peintures de la collection de l'arrière-petite-fille d'Anna (fille de Boguslas et petite-fille de Janusz) Louise Charlotte Radziwill (1667-1695), dressé en 1671, répertorie deux effigies d'Anna Kiszczanka - articles 78/8 et 106/5 (d'après « Inwentarz galerii obrazów Radziwiłłów z XVII w. » par Teresa Sulerzyska). Les peintres ne sont pas mentionnés, mais cette collection comprenait sans aucun doute les peintures des meilleurs maîtres anciens européens. Certains titres indiquent que certaines peintures ont été réalisées aux Pays-Bas, comme « Une jeune Hollandaise » (314/23), « Un Hollandais avec un verre et une pipe » (337/13), « Un Hollandais joue d'un instrument et rit » (343/19), « Un Hollandais joue de la viole et chante » (345/21), « Un Hollandais joue de la flûte » (346/22), « L'art hollandais, des paysans buvant » (429/17), « Un tableau hollandais » (446/6), « Un Hollandais courtise une dame et elle prend de l'argent dans sa bourse » (492/12), « Une dame hollandaise avec un arrosoir » (696/9), « Une dame hollandaise est en train de lire un livre et un arrosoir est à côté d'elle » (730/43) et le trompe-l'œil « Un Hollandais peint sur panneau mais sur toile » (797/13). Aux côtés de portraits de monarques polono-lituaniens, de monarques de France, d'électeurs de Brandebourg et de Saxe, de nobles étrangers et polono-lituaniens comme Leszczyński ou Lubomirski, l'inventaire comprend de nombreuses effigies de membres de la famille Radziwill issus des deux branches catholique (Niasvij-Olyka) et calviniste (Birzai-Dubingiai). Une effigie créée à l'époque du vivant d'Anna Kiszczanka est confirmée. Il s'agit d'un dessin conservé au Musée de l'Ermitage (ОР-45863), une étude pour une gravure d'une série d'effigies de membres de la famille (peut-être créée entre 1646 et 1653). Il est inscrit en polonais : Anna Kiszczanka Żona et la montre dans une riche saya de style espagnol des années 1620 et avec un chapeau et un manteau de fourrure typiquement polono-lituanien. La série n'a probablement pas été imprimée à cause du déluge, qui a également affecté et appauvri considérablement la famille Radziwill. On peut supposer que les études ont été créées pour être envoyées à un graveur renommé de Gdańsk, comme le néerlandais Willem Hondius, ou des Pays-Bas. Cette effigie (ou très similaire) fut publiée plus d'un siècle plus tard, en 1758, dans le cycle Icones familiæ ducalis Radivilianæ, où le visage d'Anna fut légèrement modifié. Il en va de même pour l'image du fils d'Anna, Janusz, qui pourrait avoir été calquée sur son portrait de Daniel Schultz, aujourd'hui conservé au Musée national d'art de Biélorussie. Lors du déluge (1655-1660), les envahisseurs ont pillé presque tout ce que les habitants ne pouvaient pas évacuer ou protéger d'une manière ou d'une autre. Au cours des siècles suivants, les Radziwill durent à plusieurs reprises évacuer leurs collections. De telles activités ainsi que le chaos d'après-guerre ont contribué à des identifications incorrectes des modèles dans les effigies conservées, c'est pourquoi il existe des erreurs évidentes dans Icones familiæ ducalis Radivilianæ, comme le portrait d'Anna Kiszczyna née Radziwill (1525-1600) dans lequel le modèle ressemble à des effigies de la fin du XVIIe siècle ou du début du XVIIIe siècle et non du XVIe siècle ou d'une autre Anna Kiszczanka, qui d'après l'inscription a vécu dans le premier quart du XVIe siècle (née en 1513 et décédée en 1533) et l'effigie représente une dame en costume semblable à l'effigie mentionnée d'épouse de Christophe Radziwill, ainsi créée dans le premier quart du XVIIe siècle. Au Metropolitan Museum of Art de New York se trouve un portrait de femme de Rembrandt, provenant de la collection Radziwill de leur château de Niasvij (huile sur bois, 67,9 x 50,2 cm, numéro d'inventaire 14.40.625). Plus tard dans la collection de Cyprian Lachnicki (1824-1906) à Varsovie, le tableau fut vendu à Paris le 15 juin 1867 (« Catalogue de la collection de tableaux de M. Lachnicki », Hôtel Drouot, n° 24). Dans la vente de Paris, il figurait après le portrait de Rembrandt, aujourd'hui conservé au Musée national de Varsovie (M.Ob.296, avant 734). L'œuvre a été signée et datée par le peintre (en bas à gauche) : Rembrandt f· / 1633·, bien qu'elle soit également considérée comme l'œuvre de Rembrandt (visage) et de ses collaborateurs (costume). Le costume du modèle est typique de la mode hollandaise de cette époque et peut être vu dans de nombreux portraits de différents peintres. Portrait d'Aechje Claesdr. par Rembrandt à la National Gallery de Londres (NG775) est très similaire, tant en termes de composition que de tenue vestimentaire du modèle. Aechje était la veuve du brasseur de Rotterdam Jan Pesser et l'une des personnalités de la communauté remonstrant de Rotterdam. Les remonstrants étaient protestants, mais leurs croyances étaient légèrement différentes de l'orthodoxie calviniste qui dominait la religion en Hollande à l'époque. Ce tableau était également signé et daté (Rembrandt.ft / 1634) et indique également son âge (Æ. SVE. 83). Une effigie semblable à celle de New York a également été reproduite dans les Icones familiæ ducalis Radivilianæ. La fraise de la femme indique qu'elle a été peinte à peu près à la même époque que le tableau de Rembrandt, mais selon l'inscription, elle représente Anna Fiedkonis née Radziwill (décédée en 1492). Ce qui est très intéressant, c'est qu'en Lituanie une copie du tableau de Niasvij a été conservée, aujourd'hui au Musée national d'art à Vilnius (huile sur toile, 72 x 51 cm, LNDM T 4153). Le tableau a évidemment été peint par un autre peintre, il n'est donc pas associé à Rembrandt mais, principalement en raison du costume de la femme, à l'école hollandaise du XVIIe siècle. Bien que la femme porte la tenue d'une protestante des Pays-Bas, le style de ce tableau est plus italien que hollandais et peut être comparé à Sainte Marie-Madeleine de Giacinto Campana au palais de Wilanów à Varsovie (Wil.1732), attribuée par moi. Campana arrive à Varsovie en 1637 et en 1639 il travaille à Vilnius pour qu'il puisse copier un tableau de Rembrandt ou d'un autre peintre de la collection Radziwill. La femme dans les deux tableaux ressemble à Anna Kiszczanka, princesse Radziwill d'après toutes les effigies mentionnées, ainsi qu'aux portraits de son fils Janusz par Bailly, par Bartholomeus Strobel (Musée national d'art de Biélorussie) et à la gravure de Hondius (Musée Czartoryski). Le portrait de Niasvij (New York) ou une série fut donc commandé à l'atelier de Rembrandt en 1633 à l'occasion de la fête d'Anna. Le portrait de Vilnius formait un pendant avec un portrait représentant une autre femme d'âge et de costume similaires (huile sur toile, 71,5 x 50 cm, LNDM T 3990). Les deux ont été représentées ensemble parce qu’elles étaient sœurs ou liées d’une autre manière. En supposant que la première femme soit Anna Kiszczanka, l'autre devrait être identifiée comme sa belle-sœur Christine Kiszczyna née Drutska-Sokolinska (décédée en 1640). Comme son père, Michel Drutsky-Sokolinsky (décédé en 1621), voïvode de Polotsk et de Smolensk, elle était très probablement aussi calviniste. Le mari de Christine, Janusz Kiszka (vers 1586-1654), hetman de champ de Lituanie et voïvode de Polotsk, élevé dans le calvinisme, se convertit au catholicisme vers 1606. En 1624-1626, il étudia à Padoue, où le 4 mars 1625 il rencontra le Le prince Ladislas Sigismond Vasa et l'accompagna à Venise. Le nonce papal Honorato Visconti a donné la description suivante du voïvode de Polotsk et de l'hetman de champ de Lituanie (rapport au cardinal Francesco Barberini, 15 juillet 1636 de Varsovie) : « il est aussi un meilleur soldat que sénateur. Catholique mais seulement de nom, impulsif, peu pieux, il a encore de nombreuses superstitions hérétiques, dans lesquelles son père est resté » (d'après « Relacye nuncyuszów apostolskich » d'Erazm Rykaczewski, tome 2, p. 252). Janusz Kiszka épousa Christine, la veuve de Sebastian Gnoiński, en 1608 ou 1609. Elle jouissait de la grande confiance de son mari, comme en témoigne le fait que lors de son séjour à l'étranger pendant plusieurs années, le 20 avril 1624, il lui confia le gestion de tous les domaines. De retour au pays en 1627, préoccupé par le service militaire, il laissa sa propriété sous sa pleine gestion jusqu'au 16 mai 1633. En 1629, Kiszczyna conclut un contrat avec Abraham Jonaszewicz, un bourgeois de Gdańsk, pour la vente du domaine de Czaśniki avec la ferme Smolany. Les marchands de Gdańsk voulaient organiser l'exportation des produits forestiers et agricoles à grande échelle, en contournant les douanes de Vitebsk (d'après « Próba utworzenia gdańskiej faktorii handlowej ... » de Jarosław Zawadzki, p. 43, 46). Christine est décédée en 1640 et à l'occasion de ses funérailles, un livret de deuil intitulé « Ombres de deuil après les rayons lumineux » (Cienie żałobne po jasnych promieniach) de Melchior Stanislav Savitsky a été publié à Vilnius. Une autre version ou originale de ce portrait se trouve désormais dans la collection Kremer à Amsterdam (huile sur panneau, 45 x 35,5 cm). Il provient de la collection de la famille Kielmansegg à Vienne et a été taillé, peut-être d'une forme ovale. Ce tableau est attribué à Jacob Adriaensz Backer, suiveur de Rembrandt, et date d'environ 1634. Stanisław Koniecpolski (1591-1646), grand hetman de la couronne, a peut-être reçu des copies des portraits des deux femmes, car deux de ces tableaux sont visibles sur une photographie d'Edward Trzemeski prise vers 1880 et montrant l'antichambre orientale de son palais de Pidhirtsi près de Lviv en Ukraine. Dans un portrait de famille en donateurs par un peintre de Cracovie, peint vers 1620 (Musée national de Cracovie), les modèles portent des costumes italiens (l'homme et le garçon à côté de lui) et hollandais (les autres membres de la famille). Le style de peinture est inspiré de l'école italienne, tandis que la famille agenouillée devant le Christ ressuscité ressemble davantage à des peintures hollandaises, silésiennes ou de Gdańsk. Bien que la noblesse de Pologne-Lituanie ait favorisé différentes modes depuis au moins le deuxième quart du XVIe siècle, des vêtements spécifiques avaient des connotations importantes et étaient l'expression d'opinions et de sympathies politiques. Dans un tableau réalisé en 1665, dans l'église du Corpus Christi de Poznań, la reine Jadwiga (Hedwige d'Anjou, 1373-1399) était représentée dans un costume typiquement espagnol des années 1620. Cette effigie a probablement été inspirée par le portrait de la reine Constance d'Autriche (1588-1631) ou par d'autres effigies non conservées de Jadwiga commandées par des catholiques sympathisants de l'empire espagnol et des Habsbourg. Il était naturel que lorsque les catholiques et les Habsbourg affirmaient leur position à la cour royale de Varsovie et que leurs partisans la manifestaient à travers la mode espagnole, italienne ou flamande, les aristocrates calvinistes étaient représentés dans les costumes hollandais. Le portrait de la reine Bona Sforza d'Aragona (1494-1557) conservé au Musée national de Lublin (huile sur toile, 60,5 x 51 cm, S/Mal/609/ML), peint dans un style comparable aux deux tableaux de Vilnius, montre la reine dans la convention des portraits bourgeois du XVIIe siècle, soulignée par tous les auteurs. Son style est plus italien, cependant, le costume est clairement nordique et la peinture est attribuée à l'école hollandaise. On en voit de semblables dans de nombreux portraits réalisés vers 1640 et attribués à l'école hollandaise (comme le portrait de Dorothea Berck, collection particulière), Willem van Honthorst (Musée des Beaux-Arts de Lille), cercle de Bartholomeus van der Helst (collection particulière), plusieurs portraits attribués à l'école flamande (datés de 1641 et 1646, collection particulière) ou encore un portrait d'une dame française, peut-être huguenote, signé du peintre inconnu Panuier et peint en 1641 (collection particulière). Contrairement à la cour royale, sa tenue vestimentaire est modeste et ses cheveux ne sont pas teints en blond vénitien. L'inscription avec une couronne - REGINA BONA, semble être originale, c'est pourquoi la peinture a probablement été créée pour rappeler à certaines personnes que la République était dès le début un pays tolérant avec des peuples, des coutumes et des religions différentes.
Portrait d'Anna Kiszczanka (1593-1644), princesse Radziwill par Rembrandt, 1633, Metropolitan Museum of Art.
Portrait de Christine Kiszczyna née Drutska-Sokolinska (décédée en 1640) par Jacob Adriaensz Backer, vers 1634, collection Kremer à Amsterdam.
Portrait d'Anna Kiszczanka (1593-1644), princesse Radziwill par Giacinto Campana, vers 1639, Musée national d'art à Vilnius.
Portrait de Christine Kiszczyna née Drutska-Sokolinska (décédée en 1640) par Giacinto Campana, vers 1639, Musée national d'art à Vilnius.
Portrait de la reine Bona Sforza d'Aragona (1494-1557) par Giacinto Campana ou cercle, ca. 1640, Musée national de Lublin.
Sainte Marie-Madeleine de Giacinto Campana, années 1640, palais de Wilanów à Varsovie.
Portraits de la princesse Catherine Radziwill par Rembrandt et atelier
Le célèbre peintre hollandais du XVIIe siècle Rembrandt était probablement tellement occupé par ce petit nombre de tableaux que les experts s'accordent à lui attribuer directement, qu'il ne savait même pas de quelle couleur étaient les yeux de sa célèbre épouse. De même pour les membres de son atelier, qui voyaient probablement la femme de Rembrandt tous les jours. Saskia van Uylenburgh (1612-1642), parente de l'agent artistique du roi de Pologne Hendrick van Uylenburgh (décédé en 1661), muse et l'une des plus grandes célébrités de l'Europe du XVIIe siècle (même si en fait très peu de gens ont probablement entendu parler d'elle au cours de sa vie), a des yeux de couleur différente dans des images similaires (du bleu, bleu-brun au brun).
Malgré sa beauté moyenne, apparemment beaucoup de gens voulaient avoir son portrait et payaient cher pour l'obtenir, il a donc fallu créer de nombreux portraits. Le peintre, son atelier et de nombreux suiveurs ont copié l'effigie de Saskia. Ils représentaient l'épouse d'un peintre de marchands hollandais comme une princesse orientale, portant des vêtements en tissus coûteux et des bijoux. Le sarcasme est justifié car il n’a aucun sens. Bien qu'il n'existe aucune preuve fiable de l'époque, beaucoup de gens veulent encore croire à cette invention datant probablement du XIXème siècle, lorsque la Pologne n'existait pas sur les cartes d'Europe, que Rembrandt peignait principalement lui-même, sa femme et sa famille. De nombreux Polonais croyaient également à ce concept, c'est pourquoi les portraits de femmes inconnues du cycle de Rembrandt provenant d'anciennes collections polonaises sont traditionnellement connus sous le nom de Saskia. La plus ancienne mention connue de Saskia par un biographe indépendant est une note d'Arnold Houbraken, qui écrivait à propos de Rembrandt en 1718 : « il avait pour femme une petite fermière de Raarep, ou Ransdorp à Waterland, plutôt petite de personne, mais bien faite en apparence et un corps dodu » (Hy had ten Huisvrouw een Boerinnetje van Raarep, of Ransdorp in Waterlant, wat klein van persoon maar welgemaakt van wezen, en poezel van lichaam). Vers 1633, lorsque de nombreux portraits présumés de l'épouse de Rembrandt furent créés, l'une des jeunes mariées les plus riches de la République polono-lituanienne était la princesse Catherine Radziwill (1614-1674). En 1633, Rembrandt peint un portrait de la mère de la princesse - Anna Kiszczanka (1593-1644) (Metropolitan Museum of Art, 14.40.625), en 1635 le peintre et son atelier réalisent un portrait de son père Christophe Radziwill (1585-1640), grand hetman de Lituanie, coiffé d'un bonnet à plumes (Abbaye de Buckland, NT 810136) et vers 1640 Govert Flinck, l'un des meilleurs élèves de Rembrandt, créa son portrait en pied tenant une canne (Musée national de Varsovie, M.Ob.2584 MNW), tous identifiés par mes soins. Catherine est née à Jasiunai près de Vilnius en décembre 1614. Élevée dans la foi évangélique, elle reçut à la cour de sa mère une éducation à domicile adaptée à sa position sociale. Comme le montre sa propre correspondance, elle connaissait bien la Bible, s'intéressait aux questions théologiques et supervisait personnellement ses affaires immobilières. Son père projetait de la marier à l'étranger (d'après « Testamenty ewangelików ... » d'Urszula Augustyniak, p. 215). Les candidats potentiels doivent donc avoir reçu ses portraits. Pendant l'interrègne après la mort de Sigismond III Vasa en 1632, des rumeurs circulèrent sur l'intention d'épouser Catherine par le fils aîné du roi, le prince Ladislas Sigismond Vasa, élu Ladislas IV (comparer « Dynastia Wazów ... » de Stefania Ochmann-Staniszewska , p.184). Selon le nonce papal Honorato Visconti (rapport au cardinal Francesco Barberini, 15 juillet 1636 de Varsovie), Ladislas « avait un penchant pour la fille du prince Christophe Radziwill - voïvode de Vilnius, hetman de Lituanie, chef des calvinistes » (après « Relacye nuncyuszów... » de Jan Chrzciciel Albertrandy, p. 206). La princesse aurait donc pu devenir la première reine protestante de Pologne, mais le roi épousa Cécile-Renée d'Autriche en 1637. Le 25 février 1640, Catherine épousa le catholique George Charles Hliabovitch (mort en 1669), Hlebowicz en polonais, intendant de Lituanie, qui lui garantit le libre exercice de sa religion et lui permet d'élever ses deux filles comme calvinistes. Le mariage a été célébré par un ministre calviniste et s'est déroulé magnifiquement avec des courses et des feux d'artifice. Le roi envoya aux jeunes mariés un cadeau de 20 000 zlotys et un lit tissé d'or. Après son mariage, elle a continué à détenir le titre de princesse. Catherine était impliquée dans les affaires de l'Église évangélique de Lituanie. Elle fut profondément affectée par le procès de l'église protestante de Vilnius en 1640, comme en témoignent ses lettres à son père. Sa fille aînée Marcybella Anna (1641-1681) épousa Marcjan Aleksander Ogiński (1632-1690), dont le portrait à cheval par Rembrandt se trouve dans la Frick Collection à New York (1910.1.98). Elle décède le 2 décembre 1674. Dans son testament, rédigé le 16 août de la même année à Ros près de Grodno (Biélorussie), elle demande à être enterrée à côté de ses parents, dans la crypte de l'église de Kedainiai. Aucun portrait fiable de la princesse n'est connu. L'effigie de Icones familiae ducalis Radivilianae - CATHARINA PRINCEPS RADIVILIA / CHRISTOPHORI II Defuncti 1640 ..., montre une femme en costume du début du XVIIe siècle, elle ne peut donc pas la représenter telle qu'elle est née en 1614. Dans la copie peinte de cette effigie réalisée entre 1733-1737 (Musée national de Varsovie, MP 4453 MNW), elle a les cheveux blancs qui étaient à la mode à l'époque où ce tableau a été réalisé, mais indique que l'auteur a copié un dessin simplifié représentant un membre de la famille Radziwill. Bien qu'en général les effigies de cette série soient fiables, il existe également de nombreuses erreurs, comme dans le cas d'une effigie de la seconde épouse du frère de Catherine - Maria Lupu de Moldavie (1625-1660). Une gravure de son portrait avec la première épouse de Janusz par Johann Schröter au Musée national d'art de Biélorussie (ЗЖ-125), ou une autre version de celui-ci, a été décrit à tort comme Katarzyna Tomicka (vers 1517-1551). Le registre des peintures appartenant au cousin de Catherine Boguslas Radziwill (1620-1669) de 1657 (AGAD 1/354/0/26/84), répertorie trois portraits de son mari (P. Hlebowicz Sta Zmudzki, P. Hlebowicz młody, Chlebowicz Sta Zmudzki) et « L'Entrée de M. Hliabovitch à Smolensk » (Wiazd P. Hlebo do Smolenska), ainsi que deux portraits de sa mère (Anna Kiszczanka Wdzina Wilenska, Kiszczanka Radziwiłowa Wdzina Wilen) et un seul qui représentait probablement Mme Hliabovitch (Katarzyna Radziwiłowna), après quoi « Une peinture hollandaise » (Obraz Holenderski) est mentionnée. Ce petit nombre de ses effigies dans cet inventaire est probablement dû au fait que la voïvode Hlebowiczowa eut des conflits fonciers avec son cousin puis avec les tuteurs de sa fille Louise Charlotte, et attaqua même certains de ses domaines avec son armée privée. L'ovale « portrait de Saskia » de Rembrandt, également connu dans le catalogue du Rijksmuseum d'Amsterdam comme « Une jeune femme en costume fantastique » (huile sur panneau, 65 x 48 cm, SK-A-4057) est connu de plusieurs copies contemporaines d'atelier ou cercle du peintre. Ce tableau a été réalisé en 1633 (signé et daté : Rembrandt ft. 1633). La première provenance confirmée de ce tableau est la collection privée de Thomas Bruce (1766-1841), 7e comte d'Elgin et 11e comte de Kincardine. Son « costume fantastique » ressemble beaucoup à celui de Teodora Krystyna Sapieżyna née Tarnowska (1625-1652) d'après son portrait du XVIIIe siècle, copie de l'original des années 1640 (Château royal du Wawel, 8690) et la femme a un fort air de famille avec Anna Kiszczanka d'après son portrait mentionné par Rembrandt dans le Met. Un bon exemplaire de ce tableau dans le goût de Salomon Koninck (1609-1656), peintre issu de l'entourage de Rembrandt et de l'académie de Hendrick van Uylenburgh, a été vendu en 2014 à Londres avec attribution au copiste du XVIIIe siècle (huile sur toile, 65,2 x 53,6 cm, Bonhams, 29 octobre 2014, lot 165). Il ne s'agit pas d'une copie exacte car Koninck a ajouté à son buste une broche baroque, semblable à celle visible dans le portrait de Maria Eleonora Stibichen (décédée en 1660), peut-être par Tomasz Muszyński, au Musée national d'art de Lituanie à Vilnius (LNDM T 3940). Un autre bon exemplaire réalisé par l'atelier du peintre en 1634 (signé : Rembrandt f. 1634) se trouve au Musée Lázaro Galdiano de Madrid (huile sur toile, 91 x 80,4 cm, 08452). Il faisait partie de la collection rassemblée par José Lázaro à Paris, probablement acquis fin 1939 comme original par Rembrandt. En 1633, Govert Flinck, vivant habituellement dans la maison de Hendrick van Uylenburgh à Amsterdam, créa un autre portrait similaire de la même femme habillée en bergère, aujourd'hui conservé au Metropolitan Museum of Art (huile sur toile, transférée du bois, 66,7 x 50,5 cm, 60.71.15). Ce tableau se trouvait très probablement à Paris au XVIIIe siècle. Il était inscrit en bas à droite : Rembrandt f. / 1633. Cette signature fut longtemps considérée comme originale et l'œuvre comme un tableau du maître lui-même, ce qui indique que Rembrandt, travaillant en 1633 sur une grande commande princière, signa une œuvre de son élève. Ses riches clients de la République attendaient non seulement une bonne qualité, mais aussi que les peintures soient réalisées par le maître lui-même. Cependant, dans le cas de grosses commandes, cela était probablement difficile à réaliser. Un autre tableau similaire de la même femme de Flinck, également signé par Rembrandt (Rembrandt f / 1633), se trouve au Fries Museum de Leeuwarden (huile sur panneau, 72 x 48 cm, S1948-041). Le tableau provient probablement de la collection du cardinal Joseph Fesch (1763-1839) à Rome, vendue en 1845. Qui sait, peut-être que ce splendide « portrait princier de Saskia » fut déjà envoyé à Rome en 1633. Une autre version de ce portrait fut probablement à Paris au XVIIIe siècle car il fut gravé par Antoine de Marcenay de Ghuy en 1768 sous le titre « La Dame aux Perles » ou « La Dame a la plume » et inscription : Rembrant pinx. La même femme, dans un costume similaire, également peinte en 1633, était représentée dans un tableau aujourd'hui conservé au Musée national de Varsovie (huile sur panneau, 60,4 x 49,6 cm, M.Ob.35, antérieur 60). Le tableau est également attribué à Govert Flinck, bien qu'il porte également la même signature : Rembrandt / 1633 (au centre à droite). Le tableau a été acheté en 1865 dans la collection de Karol Jezierski. « Princesse Saskia » portant un diadème, des boucles d'oreilles en perles, un collier de perles et de corail avec un pendentif, une double chaîne en or accrochée autour de son corps et deux bracelets au bras gauche, une robe coûteuse en velours cramoisi et tenant un œillet dans sa main droite a également été représenté dans un tableau conservé à la Gemäldegalerie Alte Meister de Dresde (huile sur panneau, 98,5 x 82,5 cm, Gal.-Nr. 1562). Ce tableau signé en bas à gauche : [...]brandt. f 1641 fut acheté en 1742 par De Brays à Araignon à Paris (prix 1500 livres) pour la collection du monarque élu de la République polono-lituanienne Auguste III (1696-1763) à Dresde. Le geste de la femme, tenant un œillet, symbole de l'amour, indique qu'elle s'adresse à son mari, probablement représenté sur un tableau pendant inconnu. Une bonne copie de ce tableau, probablement du XVIIe ou XVIIIe siècle, provenant de la collection Radziwill, se trouve au palais de Nieborów (pastel sur papier, 64,5 x 54 cm, NB 791 MNW). L'auteur pourrait être Louis Marteau ou Anna Rajecka, pastellistes ayant travaillé pour l'aristocratie polono-lituanienne. Outre plusieurs tableaux de Rembrandt qui se trouvaient au palais de Nieborów avant 1835, le catalogue de la collection Radziwill répertorie également un tableau de Govert Flinck : « 340. Portrait d'une dame au bonnet, à fraise blanche et vêtements noirs ; elle tient un mouchoir blanc à la main. Peint sur bois » (d'après « Katalog galeryi obrazow sławnych mistrzów ... » d'Antoni Blank, p. 102). Une très bonne copie d'atelier de l'autoportrait de Rembrandt à la fraise, peint en 1632 (signé et daté : RHL van Rhyn / 1632), aujourd'hui dans la Burrell Collection à Glasgow (35/600), se trouve au Musée national de Varsovie (huile sur panneau, 64 x 47,2 cm, M.Ob.296, antérieur 734). Cet exemplaire non signé provient de la collection de Cyprian Lachnicki (1824-1906), qui a acquis de nombreux tableaux issus de collections historiques polono-lituaniennes dans les anciens territoires de la République ou à Saint-Pétersbourg où de nombreux tableaux ont été déplacés après les partages de la Pologne. Au moins deux autres exemplaires anciens de cet autoportrait conservés en Pologne, l'un très probablement du XIXème siècle, au Musée National de Varsovie (211446 MNW) et l'autre de forme octogonale, très probablement de la seconde moitié du XVIIIème siècle, dans le château de Łańcut (S.1419MŁ). Il est probable que de nombreuses effigies de ce type aient trouvé leur chemin en Pologne-Lituanie dès le XVIIe siècle, ce qui indique que, à travers ce portrait aux allures de tronie, Rembrandt ou Hendrick van Uylenburgh faisait la publicité de l'atelier du peintre dans la République ou que des clients de le pays voulait avoir une effigie d'un peintre qui travaillait pour eux. Le style du portrait de la collection Lachnicki ressemble au portrait de Catherine de 1633 par Flinck conservé au Musée national de Varsovie, il a donc très probablement été peint par cet élève de Rembrandt.
Portrait de Rembrandt en fraise par Govert Flinck, après 1633, Musée national de Varsovie.
Portrait de la princesse Catherine Radziwill (1614-1674) par Rembrandt, 1633, Rijksmuseum d'Amsterdam.
Portrait de la princesse Catherine Radziwill (1614-1674) par Salomon Koninck, vers 1633, Collection privée.
Portrait de la princesse Catherine Radziwill (1614-1674) par l'atelier de Rembrandt, 1634, Musée Lázaro Galdiano à Madrid.
Portrait de la princesse Catherine Radziwill (1614-1674) en bergère par Govert Flinck, 1633, Metropolitan Museum of Art.
Portrait de la princesse Catherine Radziwill (1614-1674) par Govert Flinck, 1633, Fries Museum de Leeuwarden.
Portrait de la princesse Catherine Radziwill (1614-1674) par Govert Flinck, 1633, Musée national de Varsovie.
Portrait de la princesse Catherine Radziwill (1614-1674), tenant un œillet par Rembrandt, 1641, Gemäldegalerie Alte Meister à Dresde.
Portrait de la princesse Catherine Radziwill (1614-1674) d'après Rembrandt, après 1641, Palais de Nieborów.
Portraits de Jan Zawadzki, ambassadeur du roi de Pologne par Rembrandt
« Le lendemain, par beau temps et par le vent le plus favorable, nous arrivâmes à Amsterdam. Beaux sont les édifices de cette ville, les canaux la traversant, les rues bordées de tilleuls, les forêts de mâts de navires, les riches entrepôts marchands. [...] Le marché marchand est beau et riche. Maison de réforme, magnifiques bâtiments de la Compagnie des Indes, remplis des marchandises les plus chères. Le 14e jour, ayant envoyé la cour et les choses à La Haye, nous arrivâmes seuls à Leyde, le jour de la Pentecôte, nous avons écouté la messe dans une chapelle catholique privée où nous avons rencontré avec joie les fils du prince Wiśniowiecki, voïvode de Ruthénie, qui nous ont invités à dîner, puis nous avons reçu la visite de nos autres compatriotes, c'est-à-dire des Messieurs Żółkiewski, Zieliński, Kreitz et Korfa. Ce jour-là, l'envoyé, le Conseil de la reine de Bohême, l'a informé de son arrivée, qui l'a immédiatement invité le lendemain pour une audience à trois heures de l'après-midi. [...] Après 16 jours de séjour coûteux le 1er juin, nous avons quitté La Haye. [...] Le 22 juin, près du village de Leith près d'Edimbourg, nous avons jeté l'ancre. Il envoya immédiatement un envoyé au chancelier écossais pour annoncer son arrivée », se souvient l'auteur du manuscrit de la collection du comte Józef Sierakowski à propos de Jan Zawadzki (décédé en 1645), staroste de Świecie et chambellan du roi, envoyé de Son Altesse Ladislas IV, roi de Pologne et de Suède aux princes allemands, aux reines de Suède et de Bohême, aux Provinces-Unies des Pays-Bas et au roi d'Angleterre en 1633.
Le 19 juillet, Zawadzki arriva à Londres. « Nous avons visité la maison du duc de Buckingham, tué par un meurtrier il y a quatre ans. [...] Dans ce palais, les pièces sont magnifiquement peintes par Vandyck. [...] Nous étions aussi au marché marchand [...] Ici, selon l'ancienne coutume, l'envoyé recevait des cadeaux du roi, trois grands bassins avec des aiguières, six grandes coupes, quatre plus petites, un encensoir, des coupes pour le sel et le sucre. L'envoyé donna aux porteurs 50 Jacobs ( 2000 fl.). De Londres, nous sommes repartis pour les Pays-Bas, [...] le 10 août nous sommes arrivés à Amsterdam ». L'envoyé a également apporté de nombreux cadeaux de valeur: « au sous-secrétaire royal, j'ai fait un cadeau en argent pour qu'il fasse attention à nos affaires. J'ai donné au maître de cérémonie une chaîne avec des diamants, le maître de cuisine et d'autres fonctionnaires, les bagues chères ou cadeaux en argent ». En 1636, il offrit au roi d'Angleterre, après une audience privée, les chevaux, « vêtus de harnachements avec sabres et masses. Cheval de hussard de pure race avec un harnachement de cheval serti de turquoises, une peau de léopard dessus, sur un bai, deuxième harnachement de style arabe - un arc, un carquois, un très beau harnachement. [...] Deux soroks de zibeline pour la reine, dont ils sont très surpris, et estiment de grande valeur. Il a également donné au prince, cinq nappes tovaglia, dont le travail est grand en admiration » (d'après « Zbiór pamiętników o dawnej Polszcze » de Julian Ursyn Niemcewicz, tome 3, p. 105-133). Lors de l'audience solennelle de 1636 devant le roi d'Angleterre, les serviteurs de Zawadzki étaient vêtus de żupan de velours rouge, de delia beiges ou écarlates et avaient des plumes d'autruche sur leurs chapeaux. Ils étaient suivis de quinze autres personnes vêtues à l'italienne et de M. Poręmbski et M. Wilczkowski tenant des masses d'or, tous deux vêtus de żupan de velours rouge doublés de lynx et de zibeline. Puis le fils de Zawadzki dans une robe de drap d'or, un chapeau avec des plumes de grue et un fermoir de diamant et l'envoyé lui-même dans un manteau czamara doublé de fourrure de zibeline, fermoir de rubis et une chaîne. Il était suivi de serviteurs en delia rouges et avec trois plumes de grue sur leurs bonnets, rouges, blancs et bleus, et vêtus de delia azur. La suite de l'ambassadeur comptait environ 66 personnes. Zawadzki était un fils de Jan des armoiries Rogala, juge de Ciechanów et de la suédoise Izabela Guldenstern (de Gyllenstierna). Par sa mère, il était lié à la maison royale de Vasa. Il est probablement né en 1580 et à l'âge de 18 ans, il entra au collège jésuite de Braniewo et après avoir obtenu son diplôme, il se rendit à Louvain pour poursuivre ses études. A cette époque, il entre au service du comte Christophe de Frise orientale (1569-1636), fils d'Edzard II, comte de Frise orientale, et de la princesse suédoise Catherine Vasa (1539-1610). Le roi Sigismond III entretenait des contacts étroits avec cette partie de la famille, et une intimité particulière avec le comte Christophe est attestée par la correspondance qu'ils échangeaient. Le comte envoya Zawadzki comme envoyé auprès de Sigismond III. La disposition joyeuse et amicale de Zawadzki lui a garanti la sympathie du roi et il a effectué diverses missions diplomatiques pour lui. Avant octobre 1617, il fut également nommé secrétaire royal et entre 1624 et 1625, il fut membre de la suite accompagnant le prince Ladislas Sigismod Vasa (futur Ladislas IV) lors de ses voyages en Europe occidentale (d'après « Misja Jana Zawadzkiego na dwory Europy Północnej ...» de Marta Szymańska). Désireux de regagner le trône de Suède, Ladislas IV a envoyé huit légations dans divers pays européens entre 1633 et 1634. En plus de l'ambassade de 1633, Jan Zawadzki fut envoyé en mission en Angleterre, à La Haye et à Paris en 1636. Parmi les objectifs de ces missions figurait également le mariage du roi et peut-être d'autres affaires familiales, cependant, ces négociations étaient tenues secrètes. « Après l'audience avec le roi d'Angleterre, notre envoyé ira chez la reine Sa Majesté et lui demandera une audience secrète », ordonna Zawadzki l'évêque Jan Gębicki en 1636. Au début de 1634, Zawadzki séjourne brièvement à Hambourg (8 jours, au cours desquels il est en proie à la fièvre) pour s'entretenir avec Hugo Grotius (Hugo de Groot, 1583-1645), humaniste, diplomate et avocat hollandais, de son éventuel emploi par le roi de Pologne. Outre ses mémoires, Zawadzki est crédité d'être l'auteur d'un mémorandum daté de 1634, traitant de la campagne de Prusse contre les Suédois. Une gravure de Rembrandt de 1634 représentant un homme avec une verrue sous l'œil (Rijksmuseum Amsterdam, numéro d'inventaire RP-P-OB-42), bien qu'elle ne ressemble en rien, est fréquemment identifiée comme son autoportrait. La même année, l'artiste réalise effectivement son autoportrait en costume oriental tenant une épée orientale. Les deux gravures sont signées et datées : Rembrandt f. 1634. Rembrandt a également créé une autre version de la première gravure mentionnée en ovale (Rijksmuseum Amsterdam, RP-P-1961-990A), également signée et datée : Rembrandt f. 1634. Dans la version plus grande de l'estampe, l'homme tient une lourde épée ancienne, semblable aux épées de l'âge du bronze trouvées à Nowy Żmigród, dans le sud-est de la Pologne, identique à celle visible dans un portrait de Jerzy Sebastian Lubomirski (1616-1667) dans le North Carolina Museum of Art, créé par Rembrandt ou un disciple en 1633. Sa pose est également identique, comme si l'homme avait commandé un portrait similaire à Rembrandt dans la pose d'un ancien Sarmate (ancêtres légendaires de la noblesse polonaise), après quoi l'artiste a créé le gravure. Cette pose est similaire à celle visible dans un portrait de l'ami de Zawadzki, le prince Ladislas Sigismond Vasa (futur Ladislas IV), créé par l'atelier de Peter Paul Rubens, comme l'un des séries, lors de sa visite à Bruxelles et Anvers en 1624 (Château royal de Wawel). Pieter Claesz Soutman, peintre de la cour du roi de Pologne, a également été représenté dans une pose similaire dans son portrait par Anthony van Dyck (Musée du Louvre), tandis que Boaz dans son tableau de la Galerie nationale du Danemark (Ruth dans le champ de Boaz, attribué), porte la tenue d'un magnat polonais et a également une main sur sa hanche. Enfin, cette pose est également visible dans le célèbre Cavalier polonais de Rembrandt (The Frick Collection à New York). L'homme porte un béret de fourrure avec une décoration de chapeau (egreta) à plumes, semblable à celle visible sur un portrait d'homme en manteau de fourrure et chapeau à plumes par Isaac de Joudreville, qui travailla dans l'atelier de Rembrandt à partir de novembre 1629 (huile sur panneau, 62 x 50 cm, vendu chez Christie's Londres, vente 15497, 7 décembre 2018, lot 155), provenant d'une collection privée en Allemagne. Un chapeau similaire a également été représenté dans une effigie de noble polonais barbu créée dans le style de Rembrandt en 1644 (Rijksmuseum Amsterdam, RP-P-1882-A-6250) et plusieurs peintures de soldats et de nobles polono-lituaniens du livre de l'amitié (album amicorum/Stammbuch) de Michael Heidenreich, créé à Gdańsk dans les années 1600 par Anton Möller ou Isaak van den Blocke (Château de Kórnik). Une coiffe similaire peut être trouvée dans de nombreuses autres images de nobles polono-lituaniens, comme dans l'Allégorie du commerce de Gdańsk par Isaak van den Blocke dans la salle rouge de l'hôtel de ville principal de Gdańsk, créée en 1608, Vue de Gdańsk depuis le nord-ouest (La parabole de l'homme riche et de Lazare) de Hans Krieg, réalisé vers 1620 (Musée national de Gdańsk), ou dans un tableau intitulé Tête de Cyrus apporté à la reine Tomyris par Peter Paul Rubens, réalisé entre 1622-1623 (Museum of Fine Arts à Boston). Il porte également un pourpoint semblable au czamara, un manteau doublé de fourrure semblable au delia et une chaîne en or. Ce fier Sarmate doit donc être Jan Zawadzki, envoyé de Son Altesse Ladislas IV. En 2016, un tableau attribué à un suiveur de Rembrandt provenant d'une collection privée aux États-Unis et similaire à l'estampe ovale a été vendu aux enchères (huile sur toile, 70 x 58 cm, Doyle New York, 27 janvier 2016, lot 59). D'un point de vue stylistique, cette peinture est très proche de Peter Danckers de Rij, en particulier du portrait du chambellan de la cour Adam Kazanowski au château royal de Wawel et encore plus aux peintures d'Adolf Boy. Le tableau a été vendu avec un portrait de femme (huile sur toile, 81,3 x 68,5 cm, lot 60), peint dans le même style, mais légèrement plus grand et avec une composition non assortie. Il est possible que des effigies de ces importants courtisans de Ladislas IV aient été envoyées à leurs amis ou parents en Angleterre ou en Ecosse. Au début du XVIIe siècle, l'écossaise Eva Forbes était nourrice du prince Ladislas Sigismond. Une copie ancienne, peut-être réalisée pour Stanisław Koniecpolski (1591-1646), grand hetman de la couronne, se trouve aujourd'hui à la Galerie nationale d'art de Lviv. Il se trouvait auparavant dans le palais de l'hetman à Pidhirtsi, près de Lviv en Ukraine, accroché au-dessus du portail de la chambre jaune, comme le montre une photographie d'Edward Trzemeski prise vers 1880.
Portrait de Jan Zawadzki (décédé en 1645), ambassadeur du roi de Pologne avec une ancienne épée par Rembrandt, 1634, Rijksmuseum Amsterdam.
Portrait de Jan Zawadzki (décédé en 1645), ambassadeur du roi de Pologne en ovale par Rembrandt, 1634, Rijksmuseum Amsterdam.
Portrait de Jan Zawadzki (décédé en 1645), ambassadeur du roi de Pologne par un suiveur de Rembrandt, peut-être Adolf Boy, 1634-1645, Collection privée.
Portrait d'une dame en manteau de fourrure par un suiveur de Rembrandt, peut-être Adolf Boy, 1634-1645, Collection privée.
Portrait de noble polono-lituanien en manteau de fourrure et chapeau à plumes par Isaac de Joudreville, années 1630, Collection privée.
Portrait du prince Alexandre Charles Vasa par Rembrandt
« Il est tout selon vos coutumes et l'esprit polonais : il est audacieux, agile et vif d'esprit - pourquoi ne devriez-vous pas l'élire », a noté les paroles du roi Sigismond III Vasa qui faisait appel à la noblesse en 1626 en faveur de son plus jeune fils Alexandre Charles Vasa (1614-1634), le diplomate français Charles Ogier, qui visita la Pologne entre 1635-1636. Contrairement à ses frères, Alexandre était très sociable, de ce fait il ressemblait à son demi-frère Ladislas. Il était considéré comme un possible successeur de Ladislas et comme le plus doué des frères royaux. Alexandre était aussi talentueux artistiquement : comme son père, il savait dessiner, il a aussi appris à chanter. Son professeur de chant était le musicien et jésuite Szymon Berent, qui accompagna le prince lors de son voyage en Italie (juillet 1633 - juillet 1634).
Lors de l'élection de 1632, il soutint son frère aîné Ladislas, qui fut couronné roi de Pologne le 6 février 1633. Peu de temps après, Alexandre partit pour un voyage en Espagne. Le prince est chaleureusement accueilli à Rome, où le cardinal Antonio Barberini organise en son nom une grande manifestation équestre sur la place Navone. Pendant son séjour en Italie, il a décidé de ne pas se rendre à la cour royale de Madrid. L'une des raisons était probablement le rejet par le roi Philippe IV de ses tentatives d'épouser la belle Anna Carafa della Stadera (1607-1644), la princesse Stigliano, l'une des héritières les plus riches de tout le royaume de Naples à cette époque. Après un mois et demi à Rome, le prince se rendit à Florence, où il rencontra ses proches de la maison de Médicis qui avaient accueilli Ladislas neuf ans plus tôt. Lorenzo Médicis, frère de Cosme II, l'escorta à Livourne, d'où le prince devait s'embarquer pour Gênes. A Milan, fin mars 1634, il rencontra son cousin le cardinal-infant Ferdinand, frère de Philippe IV, qui fut gouverneur des Pays-Bas espagnols à partir de novembre 1634. Le prince se rendit également deux fois à Vienne, où il passa plus de trois mois au total. En mai 1634, juste avant de partir, il séjourne quelques jours chez son oncle à Laxenburg (d'après « Budowanie prestiżu królewskiego rodu » de Ryszard Skowron, p. 72). Alexandre retourna en Pologne en juillet 1634. Il se rendit à Lviv dans l'actuelle Ukraine, où il se préparait pour l'expédition turque et en octobre 1634, il rencontra le prince Jean Casimir. Là, il contracta probablement la variole de son frère et mourut le 19 novembre 1634 alors qu'il se rendait à Varsovie. Du 19 décembre 1634 au 2 janvier 1635, le roi Ladislas IV séjourna à Gdańsk, où il commanda une série de ses portraits, créés par le peintre silésien Bartholomeus Strobel de Wrocław, qui s'est installé à Gdańsk en 1634. A cette occasion, le roi a également commandé une série de cartes commémorant le soulagement de Smolensk et la reddition des forces moscovites, qui assiégeaient la garnison polonaise, en février 1634. Un grande carte, créée par Willem Hondius, un graveur hollandais de La Haye, qui s'est installé à Gdańsk vers 1636, se trouve dans le château de Skokloster en Suède (SKO 10693) et au Musée national de Cracovie (MNK III-ryc.-33883). Salomon Savery à Amsterdam a créé une estampe avec l'effigie du roi en costume polonais et Reddition de Mikhail Shein à Smolensk dans la base d'après une peinture de Pieter Claesz. Soutman (Rijksmuseum Amsterdam, numéro d'inventaire RP-P-OB-5592) et une estampe avec la libération de Smolensk (Musée national de Cracovie, MNK III-ryc.-150 et The Royal Collection Trust, RCIN 722074.a), d'après un peinture ou dessin du peintre de la cour de Ladislas Adolf Boy, publié par Willem Blaeu à Amsterdam en 1635. De plus, à cette époque, une vue de Cracovie depuis le nord-ouest par Nicolaes Visscher I d'après un dessin de Pieter Hendricksz. Schut a été publié à Amsterdam (MNK III-ryc.-29449). Il est très possible que des peintures aient également été commandées à Amsterdam en 1634. Certains portraits de cette période représentant Ladislas (au Musée national de Varsovie, 186555 et au Musée national de Poznań, MNP Mo 2184) sont attribués au peintre de cour de Sigismund III Vasa, Pieter Claesz Soutman, qui à partir de 1628 était actif dans la ville voisine de Haarlem, et qui a créé le tableau mentionné de Reddition de Mikhail Shein à Smolensk, gravé par Savery. L'Autoportrait dit aux yeux ombragés de Rembrandt provient de la collection de Christian Gottlob Frege (1715-1781), son fils ou petit-fils qui porte le même nom (d'après deux cachets de cire au revers). Frege était un banquier et marchand de Leipzig, qui a appris le commerce de change en 1728 auprès d'un épicier de Dresde (alors la capitale informelle de la République polono-lituanienne en tant que résidence principale des rois saxons) et avait des partenaires commerciaux à Varsovie, Wrocław et d'autres villes. Les rois saxons ont transféré de la collection royale de Varsovie des peintures conservées de Rembrandt ou de son entourage, toutes dans la Gemäldegalerie Alte Meister, comme Portrait d'un homme au chapeau orné de perles (numéro d'inventaire 1570), Portrait d'un homme barbu (1567) ou Portrait d'homme au kolpak rouge (1568). En 1763, la cour de Dresde nomme Frege conseiller de la chambre électorale. En 2008, l'œuvre a été acquise par la Leiden Collection à New York. Le tableau a été signé et daté par l'artiste : Rembrandt. F. / 1634 et a été repeint relativement peu de temps après son exécution originale. Le costume oriental de l'homme, retiré des années 1950 aux années 1980, était similaire à celui visible dans l'Autoportrait au sabre levé de Rembrandt daté « 1634 » (gravure dans le Cabinet des Estampes de la Bibliothèque de l'Université de Varsovie, numéro d'inventaire Inw.zb.d. 2891) portant un manteau de fourrure, semblable au manteau royal et un grand chapeau de style polonais/ruthène, un soi-disant kolpak ou kalpak, orné de bijoux, comme dans le portrait du noble inconnu de la collection de Jan Popławski (1860-1935) dans le Musée national de Varsovie (numéro d'inventaire M.Ob.1639 MNW) ou le portrait d'un ecclésiastique barbu par Helmich van Tweenhuysen (II) au Musée national de Wrocław (numéro d'inventaire VIII-489). L'homme est cependant beaucoup plus jeune que dans l'Autoportrait au sabre levé de Rembrandt. Il a un nez plus fin et une lèvre inférieure un peu saillante - la mâchoire des Habsbourg (de ducs de Masovie) et ressemble beaucoup à Alexandre Charles Vasa dans son portrait de l'Alte Pinakothek de Munich, peut-être par Peter Danckers de Rij, ou son effigie d'enfant d'environ 1619 (copie de 1885 au Musée national de Varsovie, Rys Pol.3269) ainsi que des effigies de ses frères Jean Casimir et Charles Ferdinand Vasa.
Portrait du prince Alexandre Charles Vasa (1614-1634) par Rembrandt, 1634, The Leiden Collection (version avec ajouts vers 1935).
Portrait du prince Alexandre Charles Vasa (1614-1634) par Rembrandt, 1634, The Leiden Collection.
Portraits d'Anna Catherine Constance Vasa par Rembrandt
Début septembre 1634, le jeune Jerzy Sebastian Lubomirski (1616-1667), fils de Stanisław, voïvode de Ruthénie, qui vient de terminer ses études à Leyde, part pour l'Espagne. L'année 1634 fut l'époque de l'intensification des contacts entre Ladislas IV et son cousin Philippe IV d'Espagne. Le roi, utilisant diverses méthodes, influença la cour de Madrid. En janvier, il défend les intérêts commerciaux de Jerzy Hewel (Höwel, Hövelius), marchand de Gdańsk et calviniste, qui se fait saisir son navire et ses marchandises aux Pays-Bas. Hewel était un parent du célèbre astronome Johannes Hevelius, qui en 1630 étudia la jurisprudence à Leyde. En 1634, sur son navire « Fortuna », il livra des armes au roi Philippe IV. A cette époque, le roi de Pologne crée une commission navale et, avec l'aide de Hewel, crée une flotte (11 navires, dont une galère) équipée de 200 canons et de 600 à 700 hommes d'équipage.
Trois mois plus tard, Ladislas demanda au roi d'Espagne : « Nous devons faire la guerre aux Suédois, ennemis de Notre Maison Royale après une trêve de six ans, nous aurons besoin de toutes sortes de personnes talentueuses et expérimentées, comme on en trouve surtout dans le Provinces belges de Votre Altesse Ducale. Ainsi, à cet effet, nous y envoyons quelqu'un pour appeler d'abord les maîtres habiles à construire des tranchées et nous les amener » (d'après le « Z dziejów stosunków Rzeczypospolitej Obojga Narodów ze Szwecją w XVII wieku » de Mirosław Nagielski , p. 47-49). Outre la politique, les émissaires polono-lituaniens en Espagne ont également parlé de questions personnelles. En 1633, l'Écossais Wilhelm (William) Forbes, fils d'Alexandre Forbes de Drumallachie (Drumlasie), demanda des salaires aux frères du roi de Pologne. Après la mort des deux parents, les jeunes frères et sœurs de Ladislaus ont été laissés à la merci de leur frère, car le système électif de la République ne leur prévoyait aucun revenu dû ni aucune fonction publique. En juin, Philippe IV promit d'accorder à Jean Albert et Charles Ferdinand (ses cousins) un salaire pour une période de deux ans, en 1634 il envisagea de décerner l'Ordre de la Toison d'or au prince Jean Casimir et en avril 1636 son envoyé proposa à l'empereur épouser sa fille Cécile-Renée avec Ladislas IV. La mission de Jerzy Sebastian Lubomirski à Madrid a dû être couronnée de succès car en octobre 1634, il a été râpé le riche comté de Spiš dans la Slovaquie d'aujourd'hui, obtenant le consentement du roi pour changer les domaines de Spiš de royal à privé et héréditaire. Le 7 mars 1632, Balthazar-Charles (1629-1646), fils unique du roi Philippe IV et de sa première épouse, Élisabeth de France, est assermenté devant la noblesse et les Cortès de Castille comme « Héritier de Sa Majesté ». Son père a rapidement commencé des efforts diplomatiques pour chercher une épouse. La cousine de Balthazar-Charles, Marie-Henriette Stuart, princesse royale (1631-1660), a été proposée comme épouse potentielle, mais il a été fiancé en 1646 à une autre cousine Marianne d'Autriche, fille de la sœur de Philippe IV, l'impératrice Marie-Anne d'Espagne (1606-1646). Marianne d'Autriche est née le 24 décembre 1634 et après la mort de Balthazar-Charles, âgée de 14 ans, elle épousa son oncle Philippe IV, veuf, âgé de 44 ans, en octobre 1649. Les contacts accrus de la diplomatie polono-lituanienne en 1634 ont laissé une marque significative dans la littérature espagnole (comparer « Clorilene, her son Segismundo and other Polish Princes and Princesses in the Spanish Golden Age Theater at 1634: Pedro Calderón de la Barca, Antonio Coello, Francisco de Rojas Zorrilla with Lope de Vega in the Background » de Beata Baczyńska). Il est fort possible qu'en 1634 Ladislas IV ait envisagé un mariage de sa seule sœur la princesse Anna Catherine Constance Vasa (1619-1651) avec l'héritier du trône d'Espagne. Plus tard, son mariage avec l'archiduc Ferdinand Charles d'Autriche-Tyrol (1628-1662) de 9 ans plus jeune a été envisagé. Philippe IV a sans doute reçu un portrait de cette importante mariée, sa cousine, dont la marraine était l'infante Isabelle-Claire-Eugénie (1566-1633), gouverneure des Pays-Bas espagnols, et le parrain l'archiduc Léopold V d'Autriche-Tyrol (1586-1632). Rembrandt était un peintre éminent et son style a influencé des générations de peintres. Certains auteurs du XIXe siècle, alors que la Pologne n'existait pas sur les cartes d'Europe, nous ont habitués à l'idée que la majorité des femmes qu'il a peintes doivent être sa femme Saskia van Uylenburgh : blondes, brunes, grosses ou minces, riches ou pauvre. Mais Saskia était-elle si exceptionnelle que tant de personnes étaient prêtes à payer pour son effigie ? D'autre part fabuleusement riche princesse Anna Catherine Constance Vasa, fille unique du monarque élu de la République polono-lituanienne et roi héréditaire de Suède Sigismond III Vasa, sœur de son successeur Ladislas IV, cousine du souverain de la moitié du monde connu, le roi Philippe IV d'Espagne, nièce de l'empereur germanique Ferdinand II et cousin de son successeur Ferdinand III, descendant des rois de Pologne et de Suède, ducs de Milan et rois de Naples, a pu être, avant mes découvertes, identifié sur quelques effigies. Rembrandt aurait rencontré Saskia chez son parent, Hendrick van Uylenburgh, peintre et marchand d'art du roi de Pologne. Jusqu'à son mariage avec Rembrandt, elle assista son beau-frère, le professeur de théologie polonais Jan Makowski (Johannes Maccovius, 1588-1644). Rembrandt et Saskia se sont mariés le 2 juillet 1634. Le tableau de Judith au banquet d'Holopherne (également connu sous le nom d'Artémise recevant les cendres de Mausole et Sophonisbe recevant la coupe empoisonnée) de Rembrandt au musée du Prado à Madrid (huile sur toile, 143 x 154,7 cm, P002132) faisait peut-être partie de la collection de Don Jerónimo de la Torre, secrétaire d'état de Philippe IV. Jerónimo mourut à Madrid en 1658, laissant son fils Don Diego de la Torre comme héritier universel, et l'œuvre équivaut probablement à la description dans l'évaluation des peintures de Don Diego réalisées le 3 septembre 1662 par le peintre Francisco Pérez Sierra : « Le belle Judit, évaluée sous le nom d'une femme vénitienne, originale, à quatre mille reais » (La bella Judit, tasada devajo del nombre de una mujer veneciana, original, en quatro mill rreales) (d'après « ¿Judit o Ester? El Rembrandt del Museo del Prado » de Juan María Cruz Yábar). Le titre de femme vénitienne est très probablement une référence aux cheveux décolorés de la femme. Les cheveux blonds étaient valorisés en tant qu'association avec la jeunesse et la divinité et les femmes vénitiennes du XVIème siècle ont créé les fameuses « blondes vénitiennes » en exposant leurs cheveux au soleil et en appliquant des mélanges décolorants (d'après « Being Beautiful: An inspiring anthology of wit and wisdom on what it means to be beautiful » par Helen Gordon, p. 81). Dans l'inventaire de la collection du roi Charles III de 1772 le sujet est également identifié comme Judith : « Un tableau montrant Judith à qui des servantes servent un gobelet et sur une table ronde un livre ouvert, des figures de plus de la moitié de la longueur, un original de Rembrandt, sept quarts de long et un varas et demi de haut » (Un quadro que representa a Judic, a quien unas doncellas sirven una copa, y en una mesa redonda tiene un libro abierto, figuras de más de medio cuerpo, original de Rembrandt, de siete quartas de largo y vara y media de caída). L'héroïne biblique Judith, exemplaire dans la vertu et dans la garde de sa chasteté, contrairement aux peintures montrant l'arrière-grand-mère d'Anna Catherine Constance Bona Sforza par Lucas Cranach, est représentée après son arrivée au camp d'Holopherne et avant de le tuer. L'artiste a signé et daté le tableau qui est bien visible sur la chaise sous la main de Judith : Rembrant. /f 1634. Vers 1634, Pieter Claesz Soutman et son atelier dans la ville voisine d'Amsterdam, Haarlem, ont créé deux effigies du roi Ladislas IV Vasa. L'un, en costume espagnol, se trouve au palais de Wilanów à Varsovie, l'autre a été publié par Claes Jansz. Visscher à Amsterdam (Österreichische Nationalbibliothek). La même femme a également été représentée dans d'autres peintures de Rembrandt. La plus ancienne d'entre elles la montre comme Bellone, déesse romaine de la guerre. L'œuvre est signée et datée : Rembrandt f:/ 1633 et il y a aussi une inscription sur l'écu : BELLOON[A]. La femme est légèrement plus jeune que dans la version madrilène et ses cheveux ne sont pas décolorés. En 1797, ce tableau faisait partie de la collection de George Nugent Temple Grenville, 1er marquis de Buckingham à Stowe House, Buckinghamshire en Angleterre, aujourd'hui au Metropolitan Museum of Art (huile sur toile, 127 x 97,5 cm, 32.100.23). En 1633, Jan Zawadzki (vers 1580-1645), un courtisan du roi Ladislas IV fut envoyé en mission aux Pays-Bas et en Angleterre pour discuter du mariage du roi avec Élisabeth de Bohême, princesse Palatine (1618-1680), la fille aînée de Frédéric V, l'électeur palatin (qui fut brièvement roi de Bohême) et Élisabeth Stuart. Le chancelier Jakub Zadzik, dans sa lettre de Varsovie, datée du 15 janvier 1633, recommanda Zawadzki aux soins d'un conseiller d'Amsterdam. Cette même année, Zadzik a commandé dans la ville voisine de Delft une série de portières en tapisserie héraldiques avec ses armoiries dans l'atelier de Maximiliaan van der Gucht (créé entre 1633 et 1636, Musée de la cathédrale de Wawel et Musée Czartoryski de Cracovie). Après son séjour à La Haye en mai 1633, Zawadzki se rend en Écosse et obtient une audience auprès de Charles Ier d'Angleterre le 26 juin à Édimbourg. Puis il parcourt l'Ecosse et l'Angleterre, au cours desquelles il rencontre Thomas Roe (d'après « Misja Jana Zawadzkiego na dwory Europy Północnej w 1633 roku… » de Marta Szymańska, p. 93). Indéniablement, il a apporté avec lui quelques cadeaux diplomatiques et des portraits de membres de la famille royale. Elle a également été représentée dans un portrait portant un collier de perles, associé à la pureté, la chasteté et l'innocence. La peinture, signée : Rembrandt f. 1634 et vendu à Lucerne (Fischer, 5-9-1922), se trouve aujourd'hui au Musée National des Beaux-Arts de Buenos Aires (huile sur toile, 62,5 x 55,6 cm, 8622). Un autre tableau de Rembrandt, à la National Gallery de Londres (huile sur toile, 123,5 x 97,5 cm, NG4930), la montre sous les traits de Flora, la déesse romaine de la fertilité, des fleurs et de la végétation. Il a été signé et daté par l'artiste Rem(b).a... / 1635 et avant 1756 il était dans la collection de Marie Joseph d'Hostun de La Baume-Tallard, duc d'Hostun, comte de Tallard à Paris. Son histoire antérieure est inconnue, nous ne pouvons donc pas exclure la possibilité qu'il ait été apporté à Paris par Jean Casimir Vasa, le frère d'Anna Catherine Constance, après son abdication en 1668 ou qu'il ait été envoyé en cadeau à la cousine d'Anna Catherine Constance, Anne d'Autriche (1601-1666), Reine de France. Un dessin du British Museum (numéro d'inventaire Oo,10.133), attribué à Ferdinand Bol, qui travaillait comme apprenti dans l'atelier de Rembrandt à Amsterdam, pourrait être un dessin préparatoire au tableau de Rembrandt. La même que dans le tableau représentant la même femme en Minerve, déesse romaine de la sagesse, de la justice et de la victoire, dans son cabinet de travail. Un dessin signé par Ferdinand Bol (F:bol.ft.) se trouve au Rijksmuseum d'Amsterdam (RP-T-1975-85), tandis que le tableau de la collection James, 13th Lord Somerville à Drum House, Gilmerton, signé par Rembrandt (Rembrandt. f. / 1635), se trouve aujourd'hui dans The Leiden Collection à New York (huile sur toile, 138 x 116,5 cm, RR-107). Apparemment, en 1635, Rembrandt et ses élèves ont travaillé sur une grande commande, peut-être liée à une autre mission diplomatique de Jan Zawadzki, qui a été envoyé à nouveau en Angleterre, à La Haye et aussi à Paris en 1636. Le même modèle, avec la lèvre saillante des Habsbourg et des ducs de Mazovie clairement visible et portant une couronne, était représenté dans le tableau de Rembrandt de 1638 (signé et daté : Rembrandt. f. 1638.) montrant la fête de mariage de Samson, aujourd'hui à la Gemäldegalerie Alte Meister à Dresde (huile sur toile, 125,6 x 174,7 cm, 1560). Il fut acquis par Auguste II, élu roi de Pologne et électeur de Saxe, avant 1722. Le 18 octobre 1641, le peintre Philips Angel commenta le tableau dans son discours aux peintres de Leyde le jour de la Saint-Luc. En 1654, l'œuvre se trouvait probablement dans la succession de Cathalijntje Bastiaens (1607-1654), veuve de Cornelis Cornelisz. Cras (décédé en 1652), mentionné comme « un mariage de Rembrandt » (een bruyloft van Rembrandt). Très probablement en 1777, alors qu'il travaillait pour Izabela Czartoryska à Voŭčyn (Wołczyn, Wolssin en Lituanie), Jean-Pierre Norblin de La Gourdaine réalisa un dessin d'après cette composition, aujourd'hui au Musée national de Varsovie. Il est possible qu'il l'ait vu à Dresde, cependant puisque son dessin n'est pas identique au tableau de Dresde, il est possible qu'une autre version ait également été dans la collection Czartoryski. Norblin était un grand admirateur de l'œuvre de Rembrandt et créait fréquemment des peintures, des dessins et des gravures dans son style. Il est également possible qu'il ait inclus dans son portfolio un dessin du maître ou de son atelier. Dans ce tableau, le héros biblique Samson pose une énigme aux invités, vêtu de costumes orientaux et polonais, lors de son festin de mariage. Ce n'est pourtant pas Samson qui est au centre de la composition, mais sa fiancée philistine, une autre femme fatale biblique qui a trahi son mari. Par conséquent, la peinture pourrait être un avertissement sur le type d'épouse que la femme ne devrait pas être et elle a très probablement été commandée par l'homme au turban, tenant une flûte et regardant le spectateur. Ce pourrait être aussi une subtile allusion à la politique, exactement comme Daniel et le roi Cyrus devant Bel (Prophète Daniel exposant la fraude des prêtres d'Idol Baal) par Bartholomeus Strobel au Musée National de Varsovie (M.Ob.1284), créé entre 1636 et 1637 et considérée comme une allégorie politique du règne de Ladislas IV Vasa. Elle était également représentée dans un petit tableau, portant un grand pendentif en rubis. Ce tableau, peint sur panneau de bois de chêne, provient très probablement de l'ancienne collection du Palais Royal sur l'Ile à Varsovie (huile sur panneau, 21,5 x 17 cm, M.Ob.2663 MNW, Dep 473). Il est attribué à un imitateur de Rembrandt du XVIIIe siècle et pourrait être une copie d'un original perdu des années 1630. Un tableau très similaire conservé au Musée d'Israël à Jérusalem (huile sur panneau, 11,5 x 9 cm, B86.0906), est attribué à un suiveur de Rembrandt et daté de la première moitié des années 1630 (1630-1635). Il provient de la collection du banquier et collectionneur d'art français Ernest May (1845-1925) à Strasbourg et Paris. Parmi les peintures appartenant au « Roi victorieux » Jean III Sobieski (1629-1696), qui pourraient provenir de collections royales antérieures et mentionnées dans l'inventaire du palais de Wilanów de 1696, on trouve « L'image de Pallas » (Obraz na ktorym Pallas, n° 243). Le tableau a été amené au palais royal de Marywil à Varsovie depuis d'autres résidences royales après la mort du roi. Cet inventaire comprenait plusieurs tableaux de Rembrandt (Rynbranta Malarza, n° 74, 75, 92, 93, 210) et d'autres peintres hollandais de la collection du roi. « Un tableau de Judith, dans un cadre sculpté et doré » (Obraz Judyty, wramach rzniętych złocistych, n° 77), qui est parfois identifié comme un autoportrait de Lavinia Fontana déguisée en Judith avec la tête d'Holopherne (Musée national de Cracovie, MNK XII-A-664), était accroché dans la chambre du roi parmi des portraits aux allures de tronie de l'agent artistique des Vasa polono-lituaniens Hendrick van Uylenburgh (appelé le rabbin portugais) et de sa fille Sara (une juive en biret) de Rembrandt (n° 74, 75, aujourd'hui au Château Royal de Varsovie). Le tableau de Judith était évalué à 200 thalers, tandis que les tableaux mentionnés de Rembrandt à 150 et 190. La valeur la plus élevée indique que ce tableau devait être comparable aux deux autres, voire mieux, et qu'il était peut-être aussi de Rembrandt ou un autre peintre hollandais. Les descriptions contenues dans ce registre sont généralement assez détaillées. Par exemple concernant un tableau d'Hérodiade, d'une valeur de 40 thalers, identifié avec le tableau conservé au palais de Wilanów (Wil.1519), étant un portrait déguisé de la princesse Elisabeth de Hesse (1502-1557), il est indiqué « Un tableau d'Hérodiade avec la tête de saint Jean sur un panneau dans un cadre noir » (Obraz Herodyady z głową Swiętego Iana na desce wramach czarnych, n° 217). « La tête d'Holopherne » est donc absente dans la description de Judith de Sobieski, comme dans le tableau du Prado, était-ce donc une copie de cette œuvre de Rembrandt ou sa version réduite ? Peut-être que nous ne le saurons jamais. Il existe également une grande image de Pallas (Athéna/Minerve) dans la collection de Radziwill au XVIIe siècle. L'inventaire des tableaux de la collection de la princesse Louise Charlotte Radziwill (1667-1695), dressé en 1671, recense plusieurs portraits de Sigismond III et de son successeur Ladislas IV, deux portraits de la reine Cécile-Renée (61/1, 110/9), un du prince Sigismond Casimir Vasa (52/2), un du prince Alexandre Charles Vasa (52/3) et un de la reine Marie-Louise de Gonzague (307/16). Il manque plusieurs effigies d'autres membres de la famille royale polono-lituanienne. Il est possible que leurs portraits aient été « déguisés » et que leur véritable identité ait été perdue après le déluge. L'inventaire mentionne « Deux grandes peintures similaires sur étain dans des cadres noirs, l'une de Pallas et l'autre d'une bataille » (Obrazów dwa wielkich jednakich na blasze w ramach czarnych, na jednym Pallas, a na drugim bitwa jakaś, 740-741) (comparer « Inwentarz galerii obrazów Radziwiłłów z XVII w. » de Teresa Sulerzyska). Bien qu'aucune peinture de Rembrandt ou de son école peinte sur étain ne soit connue, notamment en grand format, cela ne peut être exclu. Ce tableau a certainement été détruit pour réutiliser le matériel, soit par des envahisseurs, soit en raison de la paupérisation de la famille et du pays. La princesse Anna Catherine Constance, décédée sans enfant le 8 octobre 1651, âgée de 32 ans, fut oubliée peu après sa mort. Avant son mariage en 1642, l'atelier de Maximilian van der Gucht à Delft, non loin d'Amsterdam, créa une tapisserie avec ses armoiries et son monogramme A.C.C.P.P.S. (Anna Catharina Constantia Principissa Poloniae Sueciae), très probablement l'une des séries, qu'elle a amenée à Neuburg an der Donau (aujourd'hui à la Résidence de Munich). Le chancelier Zadzik a commandé ses tapisseries dans l'atelier van der Gucht ainsi que Mikołaj Wojciech Gniewosz, évêque de Włocławek, secrétaire des rois Sigismond III et Ladislas IV (aujourd'hui au château de Skokloster en Suède). La princesse a apporté avec elle à Neuburg les œuvres d'art les plus exquises créées non seulement en Europe, mais aussi en Perse (les kilims safavides avec les armoiries de son père se trouvent à la résidence de Munich et au Wittelsbacher Ausglechsfonds à Munich) et ses portraits ont été créés par Rembrandt.
Portrait de la princesse Anna Catherine Constance Vasa (1619-1651) en Bellone par Rembrandt, 1633, The Metropolitan Museum of Art.
Portrait de la princesse Anna Catherine Constance Vasa (1619-1651) en Judith au banquet d'Holopherne par Rembrandt, 1634, Musée du Prado à Madrid.
Portrait de la princesse Anna Catherine Constance Vasa (1619-1651) portant un collier de perles par Rembrandt, 1634, Musée National des Beaux-Arts de Buenos Aires.
Modello ou ricordo dessin pour un portrait de la princesse Anna Catherine Constance Vasa (1619-1651) en Flora par Ferdinand Bol, vers 1635, British Museum.
Portrait de la princesse Anna Catherine Constance Vasa (1619-1651) en Flora par Rembrandt, 1635, National Gallery de Londres.
Modello ou ricordo dessin pour un portrait de la princesse Anna Catherine Constance Vasa (1619-1651) en Minerve dans son étude par Ferdinand Bol, vers 1635, Rijksmuseum Amsterdam.
Portrait de la princesse Anna Catherine Constance Vasa (1619-1651) en Minerve dans son étude par Rembrandt, 1635, The Leiden Collection.
La fête de mariage de Samson avec portrait de la princesse Anna Catherine Constance Vasa (1619-1651) par Rembrandt, 1638, Gemäldegalerie Alte Meister à Dresde.
La fête de mariage de Samson par Jean-Pierre Norblin de La Gourdaine d'après Rembrandt ou l'élève de Rembrandt, 1777 (?), Musée national de Varsovie.
Portrait de la princesse Anna Catherine Constance Vasa (1619-1651) avec un pendentif en rubis par un suiveur de Rembrandt, peut-être Maerten van Couwenburgh, XVIIIe siècle (?) d'après l'original des années 1630, Palais sur l'Isle à Varsovie.
Portrait de la princesse Anna Catherine Constance Vasa (1619-1651) par un suiveur de Rembrandt, années 1630, Musée d'Israël à Jérusalem.
Portraits du prince Christophe Radziwill portant un bonnet à plumes par Rembrandt et atelier
Le portrait signé et daté de Rembrandt conservé au musée Jacquemart-André à Paris (RHL van Ryn 1632, numéro d'inventaire 423) fut longtemps considéré comme l'effigie de son épouse Saskia van Uylenburgh, parente d'Hendrick van Uylenburgh, agent artistique du roi Sigismond III Vasa. Il a été mentionné avec cette identification dans de nombreuses publications, comme « Treasures of Musee Jacquemart-Andre, Institute de France » (Numéro 8, p. 2), paru en 1956 ou les cartes postales du Musée de J.E. Bulloz, signées « Portrait de Saskia ». C'est après restauration en 1965 que le tableau fut identifié comme étant le pendant du portrait de Frédéric-Henri (1584-1647), prince d'Orange, signé par Gerard van Honthorst (GHonthorst fe 1631), autrefois conservé au palais Huis ten Bosch à La Haye. La femme est désormais identifiée comme étant l'épouse de Frédéric-Henri, Amélie de Solms-Braunfels (1602-1675), princesse d'Orange et cette identification fut confirmée dans l'inventaire des quartiers des stathouders de La Haye dressé en 1632, où « Un portait de Son Excellence de profil réalisée par Rembrants » (Een contrefeytsel van Haere Excie in profijl bij Rembrants gedaen) est mentionné.
La femme dans le tableau ressemble à beaucoup de femmes peintes par Rembrandt et plus à une dame patricienne qu'à l'épouse du stathouder et de son conseiller politique, donc probablement le portrait de Rembrandt a été remplacé par le portrait peint par Gerard van Honthorst dans lequel elle était représentée dans tenue plus aristocratique. Elle a les cheveux plus clairs que dans les autres portraits et la ressemblance est également très générale. Les auteurs du XIXe siècle, lorsque la République polono-lituanienne disparut des cartes de l’Europe après de nombreuses invasions finalement divisées par des voisins impérialistes insatiables, nous laissèrent croire que Rembrandt vivait de la peinture de lui-même et de sa famille, ce qui est évidemment absurde. Bien que nombre de ses œuvres soient en fait de véritables autoportraits, à une époque où il n'existait pas de subventions publiques ou autres pour les artistes, Rembrandt a créé une impressionnante collection de ses propres effigies. Certains d'entre eux pourraient être les tronies, si populaires au XVIIe siècle dans la République selon les inventaires conservés, une publicité de son talent, comme dans le cas des autoportraits de Sofonisba Anguissola, envoyés à différents mécènes en Europe, ou simplement créés pour la pratique, mais qui était ce mystérieux bienfaiteur, grâce auquel il a pu peindre lui-même si souvent ? Parmi les œuvres majeures de l'artiste entre 1628 et 1656 figurent environ 27 de ses autoportraits et plus de 40 de son vivant, ce qui est un nombre impressionnant pour un peintre du XVIIe siècle. Selon l'historiographie connue, Rembrandt n'était pas un peintre de cour ou un personnage important. Il a peint l'ambassadeur du roi de Pologne, mais il n'est pas considéré comme un peintre des monarques européens, comme Rubens qui a travaillé pour Sigismond III et son fils Ladislas IV, a peint les monarques d'Espagne, de France, d'Angleterre, les souverains de Flandre, Lorraine, Mantoue et Gênes ou Diego Velázquez, peintre de la cour du roi d'Espagne, souverain d'un immense empire. Si Rubens et Velázquez n'ont réalisé que quelques-uns de leurs autoportraits, si on les compare aux œuvres de Rembrandt trouvées dans de nombreuses collections différentes (à Rome, en Autriche, en France, en Pologne et en Suède), on aura l'impression que ce peintre des patriciens hollandais était un vrai prince voire le roi des portraitistes baroques. Dans certains « autoportraits » de Rembrandt, comme dans le cas de l'image d'Amélie de Solms-Braunfels, la ressemblance avec le peintre est assez générale. C'est le cas d'une série d'effigies coiffées d'un bonnet à plumes, créées par Rembrandt et ses suiveurs en 1635. Le « prince des peintres » était représenté dans une pose et une tenue véritablement princières. Il est étrange que tant d’experts veuillent croire que, dans l’Europe occidentale hautement hiérarchique du XVIIe siècle, Rembrandt se soit laissé représenter de cette manière dans une série qui semble être des portraits officiels. Le portrait, aujourd'hui conservé à l'abbaye de Buckland dans le Devon (huile sur panneau, 91,2 x 71,9 cm, NT 810136), a été signé et daté par le peintre (en bas à droite : Rembran(..) / f ... 1635) et provient de la collection des princes du Liechtenstein, mentionnée pour la première fois dans le catalogue de la collection du Liechtenstein à Vienne en 1767 (Descrizzione completa di tutto ciò che ritrovasi nella galleria di pittura e scultura di sua altezza Giuseppe Wenceslao ... de Vincenzo Fanti). Le « prince des peintres » aurait envoyé son portrait aux princes du Liechtenstein ou encore à l'empereur à Vienne. Une bonne copie du portrait, probablement peint par l'entourage de Rembrandt, se trouve au Palazzo Corsini à Rome (huile sur panneau, 82 x 71,5 cm, numéro d'inventaire 887). Ce palais a été construit à la fin du XVe siècle par la famille Riario, neveux du pape Sixte IV della Rovere et au XVIIe siècle, le palais était habité par la reine Christine de Suède, le portrait a donc probablement été offert au pape, aux cardinaux ou à la reine de Suède. Dans la même collection se trouve également le portrait du prince Jean Casimir Vasa (1609-1672) en chapeau de fourrure par suiveur de Rembrandt (numéro d'inventaire 305), identifié par mes soins. Un autre très bon exemplaire d'atelier, restauré par Marina Aarts à Amsterdam en 2020, a été vendu en 2017 en Suède (huile sur panneau, 77 x 63 cm, vendu chez Uppsala Auktions Kammare, 7 - 10 juin 2017, lot 1105). Le tableau provient du château de Viderup en Scanie, devenu province suédoise en 1658. Une copie ancienne du musée de Wiesbaden est mentionnée dans Iconographia Batavia d'Ernst Wilhelm Moes, tome 2 (article 34, p. 313) et une autre se trouve dans le Musée des Beaux-Arts de Budapest. Fait intéressant, outre le portrait de Wiesbaden, Moes mentionne deux portraits de Rembrandt portant un manteau polonais (op en Poolschen mantel aan, articles 35 et 36) - un autoportrait au Norton Simon Museum de Pasadena et un portrait d'homme de la collection Me Lellan à Glasgow. Dans une série de portraits d'homme au chapeau de fourrure, également identifiés comme des autoportraits de Rembrandt, son costume est également très oriental, pour ne pas dire polono-lituanien ou ruthène (par exemple de la collection de Michiel Onnes van Nijenrode, Kasteel Nijenrode). En 1914, une copie du portrait de Rembrandt provenant de la collection du prince de Liechtenstein à Vienne se trouvait dans la collection Cook, Doughty House, Richmond (huile sur toile, 87 x 66 cm). La même collection comprenait également un portrait du prince Ladislas Sigismond Vasa, futur Ladislas IV, à cheval par l'atelier de Pierre Paul Rubens (d'après « A catalogue of the paintings at Doughty House ... », articles 321 et 344, p. 79, 91), aujourd'hui au Château Royal du Wawel (numéro d'inventaire 6320). En 2017, une miniature attribuée au miniaturiste allemand Joseph Kaltner (né vers 1758 - décédé après 1824), probablement basée sur le tableau anciennement de la collection du Liechtenstein, a été vendue à Vienne (huile sur papier, marouflé sur métal, 18,2 x 14,8 cm, vendu chez Dorotheum, le 13 septembre 2017, lot 33). Au XVIIe siècle, comme à l’époque précédente, de nombreux éléments des portraits avaient une signification symbolique importante. L'homme de la série mentionnée de Rembrandt et de ses suiveurs, créée en 1635, porte un gorgerin de parade et la décoration de son chapeau ressemble à la szkofia orientale ou aigrette (egreta), populaire en Pologne-Lituanie et en Hongrie. Une szkofia quelque peu similaire peut être vue dans un portrait du prince Christophe II Radziwill (1585-1640), époux d'Anna Kiszczanka (1593-1644), conservé au Musée national d'art de Biélorussie à Minsk. Les plumes de son chapeau avaient également une signification symbolique : l'une est blanche et l'autre orange ou brune. Cependant, la nature morte Vanitas, attribuée à Abraham Susenier, indique que sa vraie couleur devrait être le rouge. Ce tableau, aujourd'hui conservé au Agnes Etherington Art Centre à Kingston (huile sur toile, 59,7 x 73,7 cm, 57-001.32), est daté de manière variable entre 1635-1668 ou 1669/1672. En 1932, il se trouvait dans la collection privée de B. Zimmermann en Suisse. Si ce collectionneur était Bernard Zimmermann (1885-1931) - architecte polonais d'origine juive, actif à Cracovie, ce tableau pourrait provenir d'une collection aristocratique polonaise. Dans cette nature morte comportant une statuette, un crâne, un roemer renversé et un portfolio de dessins, les deux plumes, blanche et rouge posées sur le crâne, symbolisent très probablement la mort d'un personnage important. Cet homme doit être identifié comme l'homme des peintures créées en 1635 par Rembrandt et son atelier, car un dessin d'étude avec la même image repose sur la table. Le gorgerin dans les portraits indique que l'homme est un soldat, sa riche tenue et sa pose qu'il est un prince, la décoration de son chapeau en forme de szkofia qu'il vient d'Europe orientale et les couleurs de plumes qu'il est un fonctionnaire important de la République polono-lituanienne. Bien qu'aujourd'hui ces couleurs soient principalement associées à la Pologne et non à la Lituanie, au XVIIe siècle, elles étaient les couleurs de la Sarmatie, c'est-à-dire la République de Pologne, de Lituanie, de Ruthénie, de Prusse, etc., comme en témoigne le soi-disant rouleau de Stockholm au Château Royal de Varsovie (ZKW/1528/1-39), montrant l'entrée du cortège nuptial de Sigismond III Vasa à Cracovie en 1605. De nombreux dignitaires, ainsi que des gardes, portent des vêtements blancs et rouges (cramoisis). Les chevaux sont également peints en blanc et rouge. Il s'agit donc du prince Christophe II Radziwill (1585-1640), dont le portrait de l'épouse par Rembrandt ou atelier se trouve au Metropolitan Museum of Art (14.40.625) et il a commandé cette série de ses splendides effigies à l'occasion de la réception de l'importante et position tant attendue de grand hetman de Lituanie, l'officier militaire le plus haut gradé du grand-duché, au début de 1635. Le roi Ladislas IV Vasa, dans le privilège du grand hetman publié le 1er janvier 1635 à Gdańsk, a déclaré que le grand hetman est le commandant de toute l'armée du grand-duché de Lituanie. Dans le privilège ultérieur accordé à Toruń, il nomma le beau-frère de Christophe Janusz Kiszka (1586-1654), hetman de champ de Lituanie (d'après « Rzeczpospolita Wazów II ... » de Henryk Wisner, p. 28). Les études pour les portraits ont donc très probablement été réalisées à Gdańsk. Comme mentionné plus haut, la ressemblance avec les traits de Rembrandt est très générale, l'homme a un nez plus petit et des joues plus plates que l'artiste dans son autoportrait au gorgerin d'environ 1629 (Musée national germanique de Nuremberg), effigie mentionnée en manteau polonais à Pasadena et autoportrait à 34 ans, peint en 1640 (National Gallery, Londres). Ses traits du visage ressemblent à ceux du portrait du grand hetman de Lituanie, comme le portrait de Minsk à l'âge de 51 ans, peint en 1635 (CHRISTOPHORVS RADZI/WIL DVX [...] ANNO. 1635. / ÆTATIS 51.) , gravure de Willem Jacobsz Delff d'après un tableau de Michiel Jansz. van Mierevelt, « Quel portrait a été peint et modifié par Michaele Johan Miereveldio d'après le modèle envoyé de Pologne » (Quam effigiem a Michaele Johan Miereveldio iusta exemplar e Polonia transmissum depictam et reformatam ...), créé en 1639 et un dessin conservé au Musée de l'Ermitage (ОР-45862), réalisé entre 1646 et 1653. Le prince, qui dans le portrait de Mierevelt est chauve, probablement comme le roi Ladislas IV portait des perruques avec une tenue plus courtoise (Ladislas dans son portrait au château de Kórnik datant d'environ 1625 est presque chauve, tandis que dans son portrait de couronnement au Musée national de Varsovie datant d'environ 1633, il a les cheveux luxuriants). Après le second mariage de Sigismond III Vasa en 1605 avec Constance d'Autriche (1588-1631), l'influence de catholiques parfois fanatiques s'est considérablement accrue à la cour royale et des temps difficiles ont commencé pour les personnes d'autres religions. L'engagement de Christophe envers le calvinisme fut la raison pour laquelle Sigismond III bloqua sa nomination au Sénat pendant des années. Il emmena avec lui plusieurs milliers de soldats armés à l'élection après sa mort (1632) et fit appel à l'aide de l'électeur de Brandebourg pour assurer la protection de ses coreligionnaires. Radziwill a étudié aux universités de Leipzig et Heidelberg. Le 20 décembre 1602 à Heidelberg, on proposa de l'élire recteur, mais cette idée fut rejetée (d'après « Studia z dziejów epoki Renesansu » de Henryk Zins, p. 44). Il voyage en Suisse, en France, en Angleterre et aux Pays-Bas. En 1603, il séjourne au camp de Maurice d'Orange (1567-1625) à Bois-le-Duc, où il apprend l'art de la guerre et de la fortification. Pour augmenter la rentabilité de ses domaines, il fit venir des colons des Pays-Bas et d'Angleterre, importa du bétail des Pays-Bas, créa des étangs piscicoles et des fermes équestres. Il a hérité de son père Christophe Nicolas Radziwill (1547-1603) la direction des calvinistes lituaniens. En tant que personne tolérante, il comptait parmi ses amis Eustachy Wollowicz (Eustachijus Valavičius ; 1572-1630), évêque catholique de Vilnius. Christophe avait ses portraits, mentionnés dans certains inventaires conservés. Wollowicz était un grand mécène et fit réaliser plusieurs de ses effigies par Lucas Kilian, graveur allemand actif à Augsbourg, en 1604, 1618, 1621. Kilian réalisa également une gravure (en 1604), peut-être d'après un tableau de Michel-Ange, représentant la Pietà avec les armoiries de Wollowicz (British Museum, V,2.41). Henryk Wisner, dans son ouvrage monographique, écrit que « le prince était un connaisseur de la peinture, ses évaluations étant bien en avance sur son époque » (d'après « Książka i literatura w kręgu Radziwiłłów birżańskich … » de Mariola Jarczykowa, p. 23). Avant 1629, l'hetman achetait des tableaux à Utrecht à Hendrick ter Brugghen, l'un des représentants les plus éminents du caravaggionisme aux Pays-Bas. Peut-être que le grand tableau de la bataille de Nieuport peint par Adriaen van de Venne, actif à La Haye, pour un prince polonais était associé à l'hetman (d'après « Galerie obrazów i "Gabinety Sztuki" Radziwiłłów w XVII w. » de Teresa Sulerzyska, p.88). L'inventaire du château de Radziwill à Lubcha en Biélorussie (Archives centrales des documents historiques de Varsovie, 1/354/0/26/45) recense de nombreux objets de valeur de la collection du prince. Il mentionne également plusieurs de ses vêtements qui pourraient être représentés dans les peintures, comme les décorations de chapeaux et les plumes (Kity y Piora), notamment : « Plume large indienne à taches », « Quatre plumes de perroquet rouges, Huit meilleures plumes de grue blanches », « Trois merveilleuses plumes de grue noires » (Pioro Indyiskie szerokie Pstre, [...] Pior Papuzych Czerwonych Cztery, Pior żorawich Białych Przednieyszych osm [...], Pior Czarnych żorawich Cudnych trzy), 10 bonnets magierka, dont 3 « poilus » noirs (kosmate - de velours ?) et 4 « lisses » (gładkie - de soie ?) ou 19 kurta différentes (une veste ou un caftan court), comme « kurta en satin jaune avec coutures » ou « kurta en cuir parfumé » (Kurta Atłasowa żótła Przeszywana [...] Kurta skurzana Perfomowana). Christophe a fortement soutenu les projets de Ladislas IV de mariage protestant avec la princesse Élisabeth de Bohême (1618-1680), la fille aînée de Frédéric V, électeur palatin (qui fut brièvement roi de Bohême) et d'Élisabeth Stuart. Des effigies de la princesse sont mentionnées dans plusieurs inventaires des collections Radziwill. Cependant, le roi, se sentant trompé lors des négociations de paix avec les Suédois en 1635 par les magnats protestants, change d'avis et décide de solliciter l'appui du camp catholique, notamment des Habsbourg, pour reconquérir la couronne suédoise. Au printemps 1636, l'empereur romain germanique Ferdinand II proposa un mariage entre Ladislas et l'archiduchesse Cécile-Renée d'Autriche. L'empereur a offert une dot substantielle, un soutien financier pour regagner le trône suédois, ainsi que des salaires et des titres pour les frères royaux (d'après « Projekt kalwińskiego małżeństwa ... » de Zofia Trawicka, p. 98-99). En 1636, Rembrandt place l'homme aux deux plumes dans sa célèbre estampe Ecce Homo (British Museum, F,4.182). La gravure porte la signature : Rembrandt f. 1636 cum privile et elle est considérée comme une œuvre conjointe avec un graveur de Leyde, Jan Gillisz. van Vliet (mort en 1668). Le tableau Ecce Homo en grisaille conservé à la National Gallery de Londres (NG1400), signé et daté : Rembrandt.f./1634, est souvent considéré comme la composition originale. L'artiste a modifié et ajouté plusieurs éléments, dont l'homme. « D'après l'Évangile de Jean (19 : 5), Ponce Pilate a montré Jésus à la foule pendant le procès avec les mots « Ecce homo » (Voici l'homme). Cependant, l'image de Rembrandt semble être dominée par le bâton noueux affiché en diagonale. On pourrait évidemment penser à un bâton de juge » (d'après « The Road to Justice: The Bible and the law ... », p. 109). La notion de justice divine semble être le message le plus important de cette œuvre d'art. Le buste sur un haut piédestal à gauche est considéré comme l'effigie de l'empereur romain Tibère César. Le dessin de Rembrandt représentant le buste de l'empereur Galba (Musée des estampes et dessins de Berlin) et d'autres études similaires (Albertina de Vienne et Bibliothèque royale de Turin) prouvent qu'il savait à quoi devait ressembler un empereur romain. Cependant, son Tibère César à la moustache touffue ressemble plus à un noble polono-lituanien qu'à un empereur romain et ressemble également à plusieurs effigies du roi Ladislas IV - en costume romain à cheval dans la Topografia practica de Friedrich Getkant (1638), comme un buste sculpté dans Speculum Saxonum de Paweł Szczerbicz (1646), avec couronne de laurier dans l'Arc de triomphe de Jeremias Falck Polonus (1646) ou, également sous la forme d'un buste sculpté, dans l'Apothéose de Jean II Casimir Vasa de Cornelis Bloemaert d'après Lazzaro Baldi (vers 1648). Un bon tableau daté de 1647 conservé au Musée national de Gdańsk, attribué au peintre hollandais actif à Gdańsk Helmich van Tweenhuysen (II) ou Johann Aken, est l'une des plus anciennes inspirations de l'estampe de Rembrandt et prouve sa popularité dans la République polono-lituanienne. Le tableau a été fondé par Adrian von der Linde (1610-1682), maire de Gdańsk et luthérien zélé, qui, nota bene, s'est opposé à l'influence calviniste croissante dans la ville. L'inscription allemande sur le panneau fait également référence au concept de justice – la justice de Dieu (2 Corinthiens 5 : 21). Une ancienne transposition peinte de l'estampe, réalisée entre 1640 et 1715, se trouve dans la cathédrale de Kołobrzeg. Selon l'inscription en latin, le tableau a été peint le 3 avril 1640 (IOACHIMUS. KNOCHENHOWERUS. pinxit. ANNO. 1640. / D: 3. APRIL.) et rénové en 1715 par le petit-fils Aegidius Knochenhauer. L'homme sur l'estampe tient ostensiblement une grande masse connue sous le nom d'étoile du matin (Morgenstern en allemand), qui était couramment utilisée du XIVe au XVIIe siècle, principalement dans les unités plébéiennes et paysannes (particulièrement populaire parmi les hussites et les insurgés paysans allemands de le XVIème siècle). Ils étaient également populaires en Pologne-Lituanie au XVIIe siècle (appelés nasiek, nasieka, nasiekaniec, siekaniec, siekanka, kropacz, palica, wekiera ou morgensztern), de sorte qu'« il était interdit aux paysans d'aller au marché avec des nasiek, des bâtons ou des massues » (d'après « Encyklopedja staropolska ... » de Zygmunt Gloger, tome 3, p. 255). L'étoile du matin est le plus souvent utilisée comme nom pour la planète Vénus lorsqu'elle apparaît à l'est avant le lever du soleil, tandis que dans la mythologie classique, le nom de la planète Vénus comme étoile du matin est Lucifer (« porteur de lumière » en latin). Les interprétations peuvent varier, cependant, la composition peut être comparée au tableau magistralement peint Daniel et le roi Cyrus devant l'idole Bel par Bartholomeus Strobel au Musée national de Varsovie (M.Ob.1284 MNW), peint à peu près à la même époque (1636-1637). Le tableau de Strobel est fréquemment interprété comme une allégorie politique du règne de Ladislas IV, lorsque le parti protestant était profondément déçu par l'échec du roi à solliciter la main de la princesse Élisabeth de Bohême. Le lien direct et explicite entre les peintures et gravures et les Radziwill ne sera peut-être jamais établi, mais compte tenu de toutes les informations présentées ainsi que de la quantité d'œuvres de Rembrandt et de ses élèves qui, malgré d'énormes destructions, pillages, confiscations et évacuations, peut être lié à la Pologne-Lituanie, cet homme peut sans aucun doute être identifié avec le merveilleux mécène Christophe Radziwill.
Portrait du prince Christophe Radziwill (1585-1640), grand hetman de Lituanie, portant un bonnet à plumes par Rembrandt et atelier, 1635, Abbaye de Buckland.
Portrait du prince Christophe Radziwill (1585-1640), grand hetman de Lituanie, portant un bonnet à plumes par un suiveur de Rembrandt, vers 1635, Palais Corsini à Rome.
Portrait du prince Christophe Radziwill (1585-1640), grand hetman de Lituanie, portant un bonnet à plumes par un suiveur de Rembrandt, vers 1635, Collection particulière.
Portrait du prince Christophe Radziwill (1585-1640), grand hetman de Lituanie, portant un bonnet à plumes par un suiveur de Rembrandt, vers 1635, Musée des Beaux-Arts de Budapest.
Portrait du prince Christophe Radziwill (1585-1640), grand hetman de Lituanie, portant un bonnet à plumes par Joseph Kaltner d'après Rembrandt, vers 1806, Collection particulière.
Ecce Homo avec portrait du prince Christophe Radziwill (1585-1640), grand hetman de Lituanie par Rembrandt et Jan Gillisz. van Vliet, 1636, British Museum.
Nature morte vanitas avec collection d'art du prince Christophe Radziwill (1585-1640), grand hetman de Lituanie par Abraham Susenier, vers 1640, Agnes Etherington Art Centre à Kingston.
Portraits d'Elżbieta Kazanowska par l'entourage de Rembrandt et Adolf Boy
Au printemps 1633, Adam Kazanowski, grâce au soutien du roi Ladislas IV, épousa Elżbieta (Halszka) Słuszczanka (1619-1671), alors âgée de 14 ans. Pour Kazanowski, le mariage signifiait non seulement une dot substantielle (50 000 zlotys), de nombreux biens mobiliers et immobiliers, mais aussi des relations précieuses. A l'occasion du mariage, Halszka a reçu une coupe en or pur et 20 000 zlotys du roi, la valeur des autres cadeaux s'élevant à 40 000 zlotys.
Plus tôt cette année-là, le 2 mars 1633, le père d'Elżbieta, Aleksander Słuszka ou Słuszko (1580-1647) devint le voïvode de Minsk. Il a été élevé comme calviniste, mais plus tard, vers 1621, il s'est converti au catholicisme avec sa femme Zofia Konstancja Zenowicz. Pour son favori, Adam Kazanowski, qui a déjà reçu un magnifique palais à Varsovie, plus tard connu sous le nom de Palais Kazanowski (ou Radziejowski), le roi a restauré le bureau de l'Intendant de la Couronne en 1633, et peu de temps après, il est devenu l'écuyer de la Couronne et a reçu d'autres offices. En 1634, il accompagna très probablement le roi à Gdańsk et en juin 1635, il vint avec lui à Toruń. En 1635, il réussit l'achat d'une flotte de navires pour Ladislas IV à Gdańsk (12 navires pour 379 500 zlotys). Kazanowski a également participé au commerce des céréales de la Vistule et l'un des plus grands greniers de Skaryszew à Varsovie lui appartenait. Słuszczanka et son mari accompagnèrent le roi en 1638 lors d'un voyage à Baden près de Vienne, et dans la capitale impériale, elle remporta le concours féminin de tir à la carabine, pour lequel elle reçut « un joli bijou ». La Lituanienne (Litewka), comme l'appelait Łukasz Opaliński, était célèbre pour sa conduite sexuelle frivole, tout comme son mari. Les années ont passé et elle n'est pas tombée enceinte. Peut-être at-elle contracté la syphilis de Kazanowski, qui, selon les rumeurs, a gagné des biens et des bureaux parce qu'il gardait un harem d'amants pour le souverain (d'après « Jak romans doprowadził do jednej z największych tragedii w dziejach Polski » de Jerzy Besala). Formé à Braniewo, Würzburg, Leiden et Padoue (d'après Marcin Broniarczyk « Wykształcenie świeckich Senatorów w Koronie za Władysława IV », p. 280), Kazanowski était un mécène des arts. Selon la « Brève description de Varsovie » d'Adam Jarzębski, il y avait dans son palais un atelier de peintres hollandais (lignes 1605-1608, Olandrowie, Nie Polacy). Son portrait à l'âge de 44 ans en tant que chambellan de la cour (château royal de Wawel), a été réalisé par le peintre néerlandais Peter Danckers de Rij, né à Amsterdam (signé : P Donckers fecit / AETATI[S) SVAE 44). D'autres effigies conservées de Kazanowski ont été créées par un autre Hollandais Willem Hondius : gravure avec un portrait contre la Vistule et ses domaines à Praga et Skaryszew, créée en 1646 et deux autres créées en 1648 d'après des peintures de Maerten van Couwenburgh, très probablement un parent de Christiaen van Couwenbergh de Delft. Une autre effigie des années 1640 (château royal de Varsovie) est attribuée au graveur Jeremias Falck Polonus de Gdańsk. En 1645, Hondius a également créé une série de vues de la mine de sel de Wieliczka, parrainée par Kazanowski, qui était un żupnik (directeur d'un district minier) à partir de 1642. « Jamais la Pologne n'a vu et ne verra jamais autant de richesses entre les mains d'un seul homme », a écrit à propos du chambellan de la cour Wawrzyniec Jan Rudawski (1617-1674). Kazanowski mourut sans enfant le 25 décembre 1649 et sa belle épouse Halszka devint l'héritière d'une grande fortune. Quelques mois plus tard, en mai 1650, elle épousa un autre courtisan royal, Hieronim Radziejowski (1612-1667). Ce mariage aurait été arrangé par son amant, le nouveau roi Jean II Casimir Vasa (demi-frère de Ladislas IV). Bientôt, cependant, les désaccords ont commencé. La raison était censée être le portrait du défunt Kazanowski, que la dame ne voulait pas retirer de sa chambre, d'autres ont dit que ce n'était pas le portrait, mais le jeune Jan Tyzenhaus, un beau valet royal, qui a brisé le couple. Violent Radziejowski est devenu très en colère lorsque la liaison de sa femme avec le roi a été révélée à la fin du printemps 1651. Elżbieta a quitté le camp militaire près de Sokal et s'est réfugié au couvent. Elle a également déposé une plainte pour annulation du mariage. Malgré des tentatives répétées, Radziejowski n'a pas réussi à pénétrer dans le palais Kazanowski, défendu par le frère d'Elżbieta, Bogusław Słuszka. À l'époque, Jean Casimir et la reine enceinte Marie-Louise de Gonzague séjournaient dans le château royal voisin. Lors de la session du Sejm, Radziejowski a été accusé d'avoir offensé la majesté et d'avoir violé la sécurité de la résidence royale et condamné à l'exil et à l'infamie. Słuszczanka et son frère Bogusław ont été condamnés à des peines beaucoup plus légères - une amende de 4 000 zlotys et un an et six semaines d'emprisonnement ferme dans la tour. Halszka se rendit à la prison du château dans la voiture tirée par six chevaux. Après douze semaines, elle a été pardonnée et son frère a quitté la prison plus tôt (d'après « Życie codzienne w Warszawie za Wazów » de Jerzy Lileyko, p. 270). Portrait d'une dame tenant un éventail de la collection de Jan Popławski a été offert au Musée national de Varsovie en 1935 (numéro d'inventaire 34661), très probablement perdu pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce petit tableau (28 x 22 cm) a été peint sur panneau de bois et attribué à un imitateur de la peinture hollandaise du XVIIIe siècle (d'après « Katalog wystawy obrazów ze zbiorów dr. Jana Popławskiego » de Jan Żarnowski, numéro 97, p. 53 ). La pose d'une femme avec sa main droite sur une table et tenant un éventail dans sa main gauche est très similaire aux portraits représentant la sœur du roi la princesse Anna Catherine Constance Vasa (château d'Ambras, GG 5611) et la reine Cécile-Renée d'Autriche (Musée national de Stockholm / Château de Gripsholm, NMGrh 1417), tous deux tenant des éventails et peints par Adolf Boy, peintre de la cour de Ladislas IV, à la fin des années 1630 ou au début des années 1640, comme l'indique le style. La main de la femme ressemble également beaucoup à la main d'Anna Catherine Constance dans la peinture d'Ambras. Si ce n'est le matériau et les dimensions, ce portrait pourrait être considéré comme un pendant au portrait mentionné de Kazanowski par Danckers de Rij (huile sur toile, 119,5 x 94,5 cm), car la composition correspond parfaitement. Étant donné que les portraits de notables ont été réalisés en série, dans différentes dimensions et par différents peintres de la cour (comme d'autres versions du portrait de Ladislas IV par Boy du Château royal de Varsovie, ZKW 559 dep.), cela ne peut être exclu. Peut-être qu'un portrait réduit de Kazanowski peint sur panneau par Boy a également été créé à cette époque. Le tableau de Wawel a été acquis en tant que cadeau de Julian Godlewski de Suisse en 1970. Par conséquent, le portrait d'une femme de la collection Popławski peut être daté d'environ 1643, comme le portrait de Kazanowski. Elle porte un étrange chapeau à larges bords avec un trou dans la couronne avec ses cheveux blonds répartis sur le large bord. La femme se décolore les cheveux comme les Vénitiennes dans les gravures de Cesare Vecellio ou Pietro Bertelli de la fin du XVIe siècle ou dans l'Album Amicorum de Burchard Grossmann, créé entre 1624-1645, et d'autres albums de voyageurs étrangers à Venise. Les femmes vénitiennes se décoloraient les cheveux à l'aide d'un solana (un chapeau à large bord avec un trou au centre) et s'asseyaient au soleil. Les cheveux, trempés dans un mélange de jus de citron et d'urine, étaient jetés hors de l'espace de la couronne et étalés sur le bord, ce qui ombrageait la personne du soleil (d'après « Venice: the Queen of the Adriatic » de Clara Erskine Clement Waters, p.224). Les Vénitiens, qui s'installèrent en grand nombre en Pologne-Lituanie dès le début du XVIe siècle, y introduisirent sans doute cette technique. Son manteau, doublé de fourrure, est très similaire au manteau visible sur une gravure représentant une noble polonaise (FOEMINA NOBILIS POLONICA), illustration de l' « Habitus Praecipuorum Populorum » de Hans Weigel, publié en 1577. La même femme, avec une boucle d'oreille identique à l'oreille gauche, a été représentée dans une série de peintures du cercle de Rembrandt. L'une signée et datée (en haut à droite : Rembrandt f. 1635 ou 1638, huile sur toile, 99,5 x 71 cm) se trouvait avant 1794 dans la collection de Louis-Marie Lebas de Courmont, marquis de Pomponne à Paris. En 1669, le roi Jean II Casimir Vasa a apporté de nombreuses peintures de la collection royale polonaise à Paris après son abdication. Un pastel d'après cette version, ou une autre peinture non conservée, très probablement d'un pastelliste français du XVIIIe siècle, a été vendu le 11 juin 2020 à Amsterdam. Une autre version (huile sur toile, 100,5 × 81 cm) a été mentionnée pour la première fois en 1854, lorsqu'elle était accrochée dans la collection du comte de Listowel, perdue. Un autre tableau plus petit (huile sur toile, 77 x 63 cm) a été vendu à New York (Doyle, 2016-01-27, lot 56). Le style de ce tableau peut être comparé aux Amoureux de Christiaen van Couwenbergh à la Kunsthalle Bremen, peint en 1632. Il est possible que cette copie d'après l'original de Rembrandt ait été réalisée par Maerten van Couwenburgh. D'autres versions plus simplifiées se trouvent au Kunstmuseum Basel (huile sur toile, 33 x 29,5 cm, numéro d'inventaire 501), acquise en 1859 de la collection Birmann et en collection privée (huile sur toile, 56 x 46 cm), vendue le 18 novembre 2020. Le « costume fantaisiste » d'une femme s'apparente à ceux visibles dans le Festin d'Hérode de Bartholomeus Strobel, peintre de la cour de Ladislas IV, créé dans les années 1630 (Musée du Prado à Madrid) et au costume de la reine de Saba du sarcophage en cuivre et argent de la reine Cécile-Renée d'Autriche (scène de la reine de Saba devant Salomon), créé par Johann Christian Bierpfaff avant 1648 (cathédrale de Wawel). Dans le portrait d'une dame aux myosotis conservé au Musée national de Varsovie (huile sur toile, 69 x 61 cm, M.Ob.2510), peint dans le style d'Adolf Boy, la femme ressemble beaucoup à celle qui porte un chapeau solana de la collection Popławski. Sa robe noire, très probablement une robe de deuil, est manifestement d'Europe centrale de l'époque et semblable à celle visible sur un portrait d'une dame de 26 ans, réalisé en 1645 (Musée national de Cracovie, numéro d'inventaire MNK I-689), sur l'épitaphe de Zofia Kochańska née Świerczewska, réalisé au milieu du XVIIe siècle (église Saint-Jacques de Sanka), ou dans un portrait de dame, dit-on membre de la famille Węsierski, peint par Danckers de Rij vers 1640 (Musée national à Gdańsk). En conséquence, le portrait représente Kazanowska en deuil après la mort de son premier mari (1649) ou l'emprisonnement dans la tour (1652) et était très probablement adressé à son ancien amant, le roi Jean Casimir Vasa. Ce tableau provient de la collection de la famille Krosnowski à Saint-Pétersbourg (constituée dans les années 1888-1917), donnée à l'État polonais et transportée en Pologne en vertu des règlements du traité de Riga (1921). La femme de tous les portraits mentionnés ressemble à un homme représenté dans un portrait, aujourd'hui au Musée national d'art de Lituanie à Vilnius, qui, selon l'inscription, représente Aleksander Słuszka, voïvode de Minsk et père d'Elżbieta. Le portrait de Słuszka à Vilnius est similaire au portrait en pied de Józef Bogusław Słuszka (1652-1701), hetman du champ de Lituanie, qui faisait partie de la collection de la famille Radziwill à Niasvij, perdu. Le costume est presque identique et plus typique de la fin du XVIIe siècle, l'homme tient une masse bulava (sorte de bâton militaire), typique des hetman du champ et autres effigies de Józef Bogusław, donc tous deux représentent le descendant d'Aleksander Słuszka (un petit-fils), cependant, une ressemblance familiale avec les portraits féminins décrits est toujours visible. Un homme à moustache en costume oriental, très semblable à la femme des portraits mentionnés, a été représenté dans un autre tableau de la collection du Musée national de Varsovie (huile sur panneau, 23,5 x 18,5 cm, numéro d'inventaire 131229 MNW). Il a été transféré par le Conseil central de la préservation des musées et des monuments en 1949 (d'après « Early Netherlandish, Dutch, Flemish and Belgian Paintings 1494–1983 » de Hanna Benesz et Maria Kluk, Vol. 2, article 923). Le style de cette petite effigie se rapproche de celui des portraits que l'on pourrait attribuer à Maerten van Couwenburgh. Par conséquent, l'homme doit être identifié comme étant le frère d'Elżbieta, Bogusław Jerzy Słuszka, décédé après le 9 janvier 1658. Avec son frère Eustachy Adam, qui devint très jeune un courtisan de Ladislas IV, il partit étudier à l'étranger. En 1637, il fut inscrit à l'Université d'Ingolstadt et, après son retour, il devint le staroste de Retchytsa (1639), le panetier de Lituanie (1643) et le trésorier de la cour de Lituanie (1645). La belle épithaphe en marbre d'Eustachy Adam Słuszka (1615-1639), frère d'Elżbieta et Bogusław Jerzy, dans l'église Saint-Stanislas-des-Polonais (Santo Stanislao dei Polacchi) à Rome, est le seul exemple conservé et connu jusqu'à présent d'un mécénat splendide de la famille à la fin des années 1630 et au début des années 1640. Eustachy Adam était un courtisan du roi Ladislas IV et il mourut à Rome le 27 août 1639 à l'âge de 24 ans. Le monument fut fondé par Bogusław Jerzy et créé après 1639 par Giovanni Francesco de Rossi ou atelier de Giuliano Finelli.
Portrait d'Elżbieta (Halszka) Kazanowska née Słuszczanka (1619-1671) de la collection du Marquis de Pomponne à Paris par l'entourage de Rembrandt, 1635-1638, Collection particulière.
Portrait au pastel d'Elżbieta (Halszka) Kazanowska née Słuszczanka (1619-1671) par le pastelliste français d'après l'original par l'entourage de Rembrandt, XVIIIe siècle, Collection particulière.
Portrait d'Elżbieta (Halszka) Kazanowska née Słuszczanka (1619-1671) de la collection du comte de Listowel par l'entourage de Rembrandt, 1635-1638, Collection particulière.
Portrait d'Elżbieta (Halszka) Kazanowska née Słuszczanka (1619-1671) par le peintre néerlandais, peut-être Maerten van Couwenburgh, 1635-1638, Collection particulière.
Portrait d'Elżbieta (Halszka) Kazanowska née Słuszczanka (1619-1671) par le peintre néerlandais, peut-être Maerten van Couwenburgh, 1635-1638, Kunstmuseum Basel.
Portrait d'Elżbieta (Halszka) Kazanowska née Słuszczanka (1619-1671) par le peintre néerlandais, peut-être Maerten van Couwenburgh, 1635-1638, Collection particulière.
Portrait d'Elżbieta (Halszka) Kazanowska née Słuszczanka (1619-1671) en chapeau solana par Adolf Boy, vers 1643, Musée national de Varsovie, perdu.
Portrait d'Elżbieta (Halszka) Kazanowska née Słuszczanka (1619-1671) avec myosotis par Adolf Boy, 1649-1652, Musée national de Varsovie.
Portrait de Bogusław Jerzy Słuszka par le peintre néerlandais, peut-être Maerten van Couwenburgh, années 1640, Musée national de Varsovie.
Portrait de Martin Opitz par Harmen Hals
En 1636, grâce à la recommandation de Gerard Denhoff (1589-1648), Martin Opitz von Boberfeld (1597-1639), considéré comme le « Père de la poésie allemande », débute sa carrière à la cour du monarque élu de la République polono-lituanienne - Ladislas IV Vasa comme agent royal et secretarius iuratus. Il rencontra le roi lors de son séjour à Toruń en janvier 1636 et Ladislas ordonna à Opitz de l'accompagner à Gdańsk. C'est alors qu'Opitz remit personnellement au roi son panégyrique en allemand - « À la Majesté royale de Pologne et de Suède » (An die Königliche Majestät zu Polen und Schweden), publié à Francfort-sur-le-Main dans Weltliche Poemata en 1644. Dans ce poème, il fait l'éloge du roi comme d'un monarque pacifique - « Oh héros ! Qui accorde plus d'importance à la paix qu'à quelque chose dans le monde qui périt avec le monde » (O Held! Den Frieden höher schätzt, als etwas in der Welt, Das mit der Welt vergeht), tandis que la dédicace en latin est conçue comme celle à un empereur romain : « Très serein et puissant roi de Pologne et de Suède Ladislas IV, dompteur des peuples barbares, initiateur de la sécurité publique ... » (SERENISSIMO POTENTISSIMOQVE / Polonia & Suecorum Regi / VLADISLAO IV. / DOMITORI GENTIVM / BARBARARVM: SEGVRITATIS / PVBLICÆ AVCTORI ...).
En 1636, il publia également à Toruń son Panegyricvs serenissimae Suecorum ..., dédié à la tante du roi, la princesse-infante luthérienne Anna Vasa (1568-1625) et des poèmes dédiés aux calvinistes notables de la République - Rafał Leszczyński (1579-1636), voïvode de Belz - Panegyricvs inscriptus honori et memoriae [...] Domini Raphaelis comitis Lesnensis ..., et Fabian Czema (d. 1636), châtelain de Chełmno - Laudatio funebris illustrissimi domini Fabiani Lib. Baronis a Cema ... Opitz était bien conscient qu'il gagnerait de puissants mécènes par la flatterie, et il y parvint effectivement, de sorte que Ladislas IV le nomma historiographe et secrétaire avec un salaire annuel de 1 000 thalers. Le 24 juin 1637, il reçut une nomination officielle à ce poste, approuvée par le Sejm (d'après « Zasłużeni ludzie Pomorza Nadwiślańskiego XVII wieku: szkice biograficzne », p. 160). C'est probablement à cette occasion qu'il commanda son magnifique portrait, aujourd'hui conservé à la bibliothèque de Gdańsk de l'Académie polonaise des sciences (inv. EM 2). Il a été peint par Bartholomeus Strobel, peintre de la cour de Ladislas IV et ami de Martin. Sa pose, son costume français à la mode et sa perruque ressemblent à ceux d'un chef-d'œuvre signé par Strobel, portrait du prince Vladislav Dominik Zaslavsky-Ostrogsky (décédé en 1656), également connu sous le nom de Władysław Dominik Zasławski-Ostrogski en polonais, au palais de Wilanów (huile sur toile, 112 x 84 cm, Wil.1654, signé et daté : B. Strobell / 1635), ainsi que celui du roi du peintre de Gdańsk Adolf Boy (Château royal de Varsovie, ZKW 559 dép.). Il est intéressant de noter que l'identité du modèle du portrait de Wilanów est restée longtemps inconnue et que ce prince ruthène fabuleusement riche a été correctement identifié par Elena Kamieniecka dans sa publication de 1971 (« W sprawie portretu nieznanego magnata Bartłomieja Strobla ») après probablement plusieurs siècles d'oubli. En 1637 à Gdańsk, le poète publie son Variarvm Lectionvm Liber: In quo præcipue Sarmatica, dédié au chancelier Tomasz Zamoyski (1594-1638). A l'occasion du mariage du roi et de l'archiduchesse Cécile-Renée d'Autriche en 1637, il créa un poème latin Felicitati augustae honorique nuptiar ... Comme Strobel, Opitz venait de Silésie, il est né à Bolesławiec (Bunzlau) en tant que fils de un boucher. Bien qu'il prône l'utilisation de la langue allemande dans la poésie, il écrivait fréquemment en latin et son drame « Judith » de 1635 était basé sur le livret de l'opéra italien d'Andrea Salvadori, tandis que son « Antigone », dédiée à Gérard Denhoff, était basé sur l'un des huit textes grecs de Démétrius Triclinius. Il se rend aux Pays-Bas en 1620 et en 1622 en Transylvanie pour enseigner la philosophie à Alba Iulia. De retour en Silésie, en 1624 il fut nommé conseiller du duc de Legnica et Brzeg et en 1630 il se rendit à Paris. Il s'installe à Toruń en 1635 avec le duc. En tant que secrétaire, Opitz était probablement chargé de gérer la correspondance étrangère. Il se voit confier de nombreuses affaires d'État, qui doivent être réglées avec les rois de France, d'Angleterre et du Danemark. Ladislas avait également l'intention d'envoyer Opitz à Stockholm. En raison de ses contacts ambigus avec le chancelier de Suède Axel Oxenstierna (1583-1654), il est soupçonné de déloyauté envers le roi de Pologne. Il mourut en 1639 à Gdańsk. Les portraits d'un poète et d'un fonctionnaire aussi important devaient également se trouver dans les résidences de la République à Varsovie, Cracovie et Vilnius. La communauté germanophone étant importante dans de nombreuses villes et régions du pays, il fallait aussi souligner son importance et rappeler à ses membres qu'ils doivent leur prospérité au sage règne de Ladislas IV qui emploie les meilleurs. Le portrait mentionné de Strobel à Gdańsk est considéré comme appartenant au poète, mais il est également possible qu'il provienne de la collection royale dans la ville, où la principale résidence représentative était la Porte Verte. Il fut offert à la Bibliothèque de la Mairie de Gdańsk avant 1701. Ce portrait fut reproduit dans une gravure de Johann Christoph Sysang réalisée vers 1739 confirmant à la fois l'identité du modèle et l'auteur du tableau (OPITIVM [...] Hac manus in tabula Se Lips STROBELIANA dedit ...). D'autres portraits d'Opitz sont inconnus. Cependant, ils devaient être nombreux étant donné le nombre de gravures différentes à son image conservées. Au Musée national de Varsovie, il y a un portrait d'un homme tenant la main sur une table (huile sur panneau, 106 x 80,5 cm, M.Ob.217, antérieur 494). Sur la table à côté de lui se trouvent des ustensiles d'écriture, de la cire à cacheter rouge pour sceller les lettres, indiquant que l'homme est secrétaire ou diplomate. Le tableau provient de la collection de Wojciech Kolasiński, acquise le 23 novembre 1881 pour 125 roubles par le Musée des Beaux-Arts de Varsovie, la provenance précédente n'est pas connue. En raison de son style et du monogramme de l'artiste FH en ligature, le tableau était considéré comme l'œuvre de Frans Hals (d'après « Wojciech Kolasiński (1852-1916) » de Maria Kluk, p. 107-108) et maintenant comme l'œuvre de son suiveur. Bien que l'influence du style de Hals avec des coups de pinceau lâches et une forte illumination soit indéniable, il diffère en effet des autres œuvres de l'artiste, qui semblent plus douces et plus légèrement peintes. Le tableau le plus similaire est Un joyeux couple, maintenant au Musée Frans Hals de Haarlem. Le tableau à Haarlem est signé et daté : H / 1648, donc considérée comme l'œuvre du fils de Frans, Harmen (1611-1669), qui avec ses frères, également peintres, travaillait dans l'atelier de son père. Le fait que le tableau de Varsovie ait été signé d'un monogramme indiquant que son père était l'auteur indique à son tour qu'il pourrait avoir fait partie d'une grande commande de peintures et qu'ils ne veulent pas révéler pleinement aux clients que le tableau a été réalisé par les assistants du maître et pas lui-même. De plus, la composition n'est pas typique de Hals et de son entourage et ressemble davantage à une copie d'un autre portrait officiel et présente une similitude frappante avec le portrait du prince Zaslavsky-Ostrogsky à Wilanów. Il ressemble également à d'autres portraits de personnes proches de la cour de Ladislas IV, comme le portrait du lieutenant Mikołaj Konstanty Giza (Nikolaus Konstantin Giese, décédé en 1663) par Franz Kessler ou le portrait de Guglielmo Orsetti de Lucques (mort en 1659) par Strobel, tous deux conservés au Musée national de Varsovie. Dans ce cas, il est fort probable que l'atelier de Hals ait reçu des peintures ou des dessins d'étude de Strobel à copier. Le modèle a une couleur d'yeux différente de celle du tableau de Strobel (marron et bleu respectivement), ce qui est une autre indication qu'il s'agit d'une copie d'une autre œuvre, car des colorants moins chers ont été utilisés pour préparer les copies, comme dans le cas des portraits de l'empereur Charles Quint, qui dans certains portraits a les yeux bleus et dans d'autres marrons. Un autre portrait peint de la même manière se trouve également au Musée national de Varsovie (huile sur toile, 86 x 50,5 cm, M.Ob.1645 MNW). Ce portrait d'homme en fraise porte une fausse inscription : Rembrand fe. / 1660 et il s'agit d'une version, vue miroir d'un tableau représentant le fabricant de meubles et d'encadrement Herman Doomer (mort en 1650), actif à Amsterdam, peint par Rembrandt en 1640 (Metropolitan Museum of Art, 29.100.1). En tant que fabricant de meubles, Doomer devait fortement dépendre des approvisionnements en bois de la République, c'est pourquoi son portrait réalisé dans l'atelier de Hals à Haarlem ainsi que ses meubles sont probablement arrivés en Pologne déjà au XVIIe siècle. D'après l'inscription dans le coin supérieur gauche, l'homme du portrait de la collection Kolasiński avait 39 ans en 1636 (Aetatis 39 / FH fecit A: 1636), tout comme Martin Opitz lorsqu'il entra au service de Ladislas IV et il ressemble beaucoup au poète d'après son portrait de Strobel ainsi que les gravures de Jacob van der Heyden, Peter Aubry II et Georg Walch.
Portrait du prince Vladislav Dominik Zaslavsky-Ostrogsky (décédé en 1656) par Bartholomeus Strobel, 1635, Palais de Wilanów à Varsovie.
Portrait de Martin Opitz von Boberfeld (1597-1639), secrétaire de Ladislas IV Vasa, âgé de 39 ans, par Harmen Hals, 1636, Musée national de Varsovie.
Portrait d'Herman Doomer (mort en 1650), fabricant de meubles et d'encadrement par le cercle de Frans Hals, années 1640, Musée national de Varsovie.
Portrait de Jerzy Sebastian Lubomirski par l'atelier de Frans Hals
Les voyageurs de la République polono-lituanienne qui visitaient les pays d'Europe occidentale apportaient fréquemment dans leur pays de nombreuses belles œuvres d'art et leurs effigies qu'ils avaient acquises ou commandées au cours de leur visite. La preuve la plus connue de cette pratique est un tableau réalisé, d'après la signature du peintre, à Varsovie en 1626 (Here. fecit / Warsa[...] 1626, au centre dans la gravure) et attribué à Étienne de La Hire, Willem van Haecht ou Jan Brueghel le Jeune (Château royal de Varsovie, huile sur panneau, 72,5 x 104 cm, ZKW/2123/ab). Il montre la collection d'art du prince Ladislas Sigismond Vasa, futur roi (élu Ladislas IV), qui a très probablement acquis la plupart des objets représentés dans ce tableau lors de sa visite aux Pays-Bas espagnols, en Italie, en Autriche et en Bohême entre 1624 et 1625, dont deux effigies du prince - l'une peinte et l'autre une médaille d'or à son profil, probablement réalisé par Alessandro Abondio.
Ce tableau fut oublié depuis longtemps et après avoir refait surface sur le marché de l'art à New York en 1940 (marchand d'art Mortimer Brandt), il fut acheté à Londres en 1988 par les collections de l'État pour le château royal nouvellement reconstruit (détruit par les envahisseurs allemands nazis pendant la Seconde Guerre mondiale). Les aristocrates qui voyageaient à l'étranger apportaient également leurs effigies, costumes à la mode, peintures et autres œuvres d'art. En 1564 Nicolas Christophe l'Orphelin Radziwill (1549-1616) envoya de Strasbourg à son père Nicolas Radziwill le Noir (1515-1565) en Lituanie, son portrait peint pendant ses études là-bas (d'après « Tylem się w Strazburku nauczył ... » par Zdzisław Pietrzyk, p. 164). Plus d'un demi-siècle plus tard, vers 1632, Janusz Radziwill (1612-1655), fut peint à Leyde par David Bailly (Musée national de Wrocław, VIII-578) et l'inventaire de 1633 du château de Radziwill à Lubcha en Biélorussie (Archives centrales des documents historiques de Varsovie, AGAD 1/354/0/26/45) répertorie sous le numéro 27 : « Portrait en pied du prince Sa Seigneurie Monsieur Chamberlain, vieux, en vêtements verts, peint à Leipzig » (Obraz Cały X: Je m Pana Podkomorzego Dawnieyszy w Ubierze zielonym w Lipsku Malowany), ainsi peint pendant les études de Janusz vers 1630. L'inventaire des peintures de 1661 appartenant à Aleksander Michał Lubomirski (1614-1677), frère de Jerzy Sebastian Lubomirski (1616-1667), qui ont survécu au déluge, comprend des peintures de Parmigianino, Jusepe de Ribera, Francesco Albani, des paysages vénitiens et deux de ses portraits réalisés à Venise par Nicolas Régnier (AGAD 1/357/0/-/7/12). Ils ont probablement été acquis en Italie lors de son séjour là-bas et les peintures de Ribera indiquent qu'Aleksander Michał a visité Naples, car le peintre espagnol s'y est installé en 1616. Parmi ses peintures, il y avait aussi « Image de Notre-Dame avec le Seigneur Jésus qu'elle a mis au monde. De Prague » (Obraz Nasw Panny z Panem Jezusem powitym. sPragi), très probablement acquis en Tchéquie. Parmi les peintures appartenant à son père Stanisław (1583-1649), il y avait « Un tableau avec deux femmes vêtues à la manière des Pays-Bas, tenant un panier plein de viande » (Obraz dwie białogłowie po Inderlansku ubrane koszyk zmięsem trzymaiące). Le beau-père d'Aleksander Michał, Jerzy Ossoliński, possédait des tableaux de Ribera, Raphaël, Titien, Paolo Veronese, Bassano, Guido Reni, Guercino, Daniel Seghers et Albrecht Dürer et sa belle-mère Izabela Daniłowicz possédait « Deux tableaux de Moscou » (Dwa obrazki Moskiewskie) et « Trois images de licorne sculptées à Moscou » (Trzy obrazki ziednorozca rzezane moskiewskie). De nombreuses icônes ruthènes et russes sont également mentionnées dans d'autres inventaires, comme l'inventaire de 1671 des peintures de la princesse calviniste Louise Charlotte Radziwill (articles 358/7, 365/14, 651/22 - 655/26, 660/31 - 661/32, 783/4, 801/3, 868/48, 966, comparer « Inwentarz galerii obrazów Radziwiłłów z XVII w. » par Teresa Sulerzyska). Jerzy Sebastian a dû également rapporter de nombreuses peintures exquises de ses nombreux voyages entre 1629 et 1636. En 1629, il se trouvait à Ingolstadt en Bavière, en 1631 à Louvain, en 1633 à Leyde, en 1634 il visita l'Espagne en tant qu'envoyé du roi. En Italie, il visita la bibliothèque de l'université de Bologne et la Bibliothèque Laurentienne de Florence ainsi que de nombreuses galeries de peintures et se rendit très probablement en France et en Angleterre, mais l'itinéraire précis n'est pas connu. S’il a voyagé depuis l’Italie vers l’Angleterre, il est très probablement retourné aux Pays-Bas. Peu après son retour en Pologne-Lituanie, en septembre 1636, le jeune Lubomirski, âgé d'à peine 20 ans, débute sa carrière politique en étant élu maréchal de l'assemblée parlementaire et en décembre de la même année il est élu député de Sejm. Parmi les peintures qui pourraient provenir de sa collection figurent deux chefs-d’œuvre de la peinture espagnole conservés dans d’anciens territoires de la République. L'une est l'Extase de saint François d'Assise du Greco, aujourd'hui conservée au Musée diocésain de Siedlce (huile sur toile, 106 x 79 cm, signée : Domenikos Theotokop ...). Selon Izabella Galicka et Hanna Sygietyńska, qui ont découvert le tableau en 1964 dans l'église paroissiale de Kosów Lacki, ce tableau pourrait provenir de la collection Lubomirski, éventuellement de la collection d'Eugeniusz Lubomirski (1825-1911) à Kruszyna. L'autre est sainte Marie-Madeleine pénitente de Francisco Jiménez (Ximénez) Maza conservé au Musée national d'art de Lituanie à Vilnius (huile sur toile, 150 x 116 cm, LNDM T 4010). Il a été offert au Musée de la Société des Amis de la Science à Vilnius en 1907 par le comte Władysław Tyszkiewicz (1865-1936) (comparer « Vilniaus senovės ir mokslo ... » de Henryka Ilgiewicz, p. 115). Tyszkiewicz était marié à Krystyna Maria Aleksandra Lubomirska (1871-1958), fille d'Eugeniusz Lubomirski mentionné, dont l'ancêtre était Jerzy Sebastian Lubomirski. En raison du manque de documentation, la provenance exacte de ces peintures ne sera probablement jamais établie avec certitude, mais certains éléments dans les peintures elles-mêmes indiquent qu'elles ont probablement été achetées au XVIIe siècle par des clients de Pologne-Lituanie, peut-être Lubomirski. El Greco, peintre gréco-espagnol originaire de Crète, reçut sa formation initiale de peintre d'icônes de l'école crétoise, puis poursuivit sa carrière à Venise, où il travailla probablement dans l'atelier du Titien. Le Tintoret, Paolo Véronèse et Jacopo Bassano ont également travaillé dans la ville et il semble que le Greco ait étudié le travail de chacun d'eux. La peinture d'icônes traditionnelle ainsi que celle de l'école vénitienne, toutes deux très populaires dans la République, ont eu une grande influence sur son style, visible également dans l'Extase de saint François d'Assise. Par conséquent, un tel tableau serait sans aucun doute du goût de tout voyageur de la République. La pénitente sainte Marie-Madeleine est également inhabituelle pour l'école espagnole, principalement en raison du caractère érotique du tableau. Dans la peinture espagnole de l'époque maniériste et baroque, y compris les peintures du Greco, elle est dans la majorité des cas entièrement habillée et ne montre aucun signe d'érotisme (comparer les peintures du Prado : P000608, P001309, P001103, P007621, P001008, P007736). Dans le tableau de Vilnius, très probablement inspiré de peintures italiennes ou à la demande du client, Marie-Madeleine est à moitié nue. En tant que propriétaires de domaines en Slovaquie, dont le château de Stara Lubovna qui faisait alors partie du royaume de Hongrie, les Lubomirski étaient également engagés dans les affaires des rois hongrois et bohèmes de la dynastie des Habsbourg. À la fin de 1621, le père de Jerzy Sebastian, Stanisław Lubomirski (1583-1649), tenta d'entrer au service de l'empereur et jusqu'en 1635 il prit une position pro-autrichienne. Il établit des contacts avec le commandant suprême de l'armée impériale Albrecht von Wallenstein (1583-1634), puis un peu plus tard, en août 1632, avec l'empereur lui-même, à qui il proposa sa participation à la guerre contre Rakoczi en Hongrie ou avec les Suédois en Allemagne (d'après « Mecenat kulturalny i dwór Stanisława Lubomirskiego ...» de Józef Długosz, p. 39, 127). L'architecte italien Andrea Spezza (mort en 1628), qui a conçu le célèbre palais Wallenstein à Prague, a également travaillé pour les Lubomirski. Il est intéressant de noter qu'Antoine van Dyck, actif à cette époque principalement à Anvers et à Londres, a peint un portrait de Wallenstein entre 1629 et 1634, même si, selon des sources connues, ils n'ont pas eu l'occasion de se rencontrer en personne. Le portrait original a été gravé par Pieter de Jode le Jeune après 1628 (signé : Pet. de Iode sculp. / Ant. Van Dÿck pinxit) et une copie d'atelier se trouve à la Galerie nationale de Neuburg (inv. 84). De même pour l'effigie du roi de Suède Gustave Adolphe (1594-1632), gravée par Paulus Pontius vers 1655 (Signé : Paul. Pontius sculp. / Ant. van Dÿck pinxit.) et la copie d'atelier se trouve également à Neuburg (inv. 86). Dans les deux cas, elles s’appuyaient sans doute sur d’autres images. Compte tenu de ce qui précède, les portraits des membres de la famille Lubomirski devaient également figurer dans les collections impériales ainsi que dans celles des membres de la noblesse bohème. À la Gemäldegalerie Alte Meister de Dresde se trouve un « Portrait d'un jeune homme en pourpoint noir » (Bildnis eines jungen Mannes in schwarzem Rock), attribué au cercle de Frans Hals (huile sur panneau, 24,5 x 20 cm, Gal.-Nr. 1359). Le tableau provient de la collection Wallenstein du château de Duchcov, propriété de l'héritier d'Albrecht, Maximilian von Wallenstein (1598-1655) de 1642, et a été acheté en 1741 avec 267 autres tableaux pour la collection du monarque élu de la République polono-lituanienne et électeur de Saxe Auguste III à Dresde pour un prix de 22 000 florins. Le tableau est généralement daté d'environ 1633, mais un costume similaire est visible dans le portrait de Cornelis de Graeff (1599-1664) par Nicolaes Pickenoy, peint en 1636 (Gemäldegalerie de Berlin, 753A). L'homme du portrait de Dresde présente une ressemblance frappante avec Jerzy Sebastian, d'après ses portraits de Rembrandt et Ferdinand Bol, que j'ai identifiés, et son effigie gravée par Johann Franck réalisée vers 1670 (Musée national de Cracovie, MNK III-ryc.-57315). Un exemplaire ancien de cette copie ou d'une autre version de ce tableau a été vendu à Cologne en 2004 (huile sur panneau, 23,5 x 19 cm, Van Ham Kunstauktionen, 3 juillet 2004, lot 1112). Une autre version ancienne présentant quelques différences par rapport à la peinture de Dresde se trouve au musée Siauliu Ausros à Siauliai, Lituanie (huile sur toile, 27 x 23 cm, ŠAM D–T 473).
Portrait de Jerzy Sebastian Lubomirski (1616-1667) par l'atelier de Frans Hals, vers 1636, Gemäldegalerie Alte Meister à Dresde.
Portrait de Jerzy Sebastian Lubomirski (1616-1667) par suiveur de Frans Hals, après 1636 (XVIIIe siècle ?), Collection particulière.
Portrait de Jerzy Sebastian Lubomirski (1616-1667) par suiveur de Frans Hals, après 1636 (XIXe siècle ?), Musée Siauliu Ausros.
Extase de saint François d'Assise par El Greco, vers 1580, Musée diocésain de Siedlce.
Sainte Marie-Madeleine pénitente par Francisco Jiménez (Ximénez) Maza, deuxième quart du XVIIe siècle, Musée national d'art de Lituanie à Vilnius.
Portrait du « Dernier Jagellon » portant les traits de Ladislas IV Vasa par Bartholomeus Strobel ou atelier
« Sigismond Auguste, dernier roi de Pologne de la dynastie Jagellonne » (SIGISM. AUGUSTUS REX / POLONIÆ IAGELLONIDARUM / ULTIMUS) est l'inscription latine sur un tableau aujourd'hui conservé au Musée national de Cracovie (huile sur cuivre, 62, 5 x 52,5 cm, numéro d'inventaire MNK I-21). Il est très significatif que cette effigie du dernier Jagellon mâle ait été acquise en Suède. L'histoire du tableau, peut-être pillé lors du déluge et acheté par Henryk Bukowski (1839-1900), très probablement à Stockholm, illustre parfaitement le sort des collections de portraits de l'ancienne République polono-lituanienne. Bukowski, qui a émigré en Suède en 1864 après l'effondrement du soulèvement de janvier (1863-1864), qui visait à mettre fin à l'occupation russe d'une partie de l'ancienne République, a fait don du tableau au musée de Cracovie en 1885.
Sous le règne de Sigismond Auguste, l'union de Lublin fut signée le 1er juillet 1569, créant un État unique, la République, comme une fusion des deux États, dirigé par un seul monarque élu et gouverné par un parlement commun, bien que chacun ont conservé une autonomie substantielle, avec leur propre armée, leur trésor, leurs lois et leur administration. L'héritage de l'État Jagellonne était également la Confédération de Varsovie de 1573, qui reconnaissait officiellement la liberté totale de religion dans la République, accordait aux dissidents la protection de l'État et l'égalité des droits avec les catholiques, et interdisait aux autorités laïques de soutenir le clergé dans la persécution religieuse. Bien que le patronage du dernier Jagellon mâle ait été comparable à celui des princes italiens et allemands, des rois de France, d'Espagne, d'Angleterre, des empereurs et des papes, en raison des guerres et des destructions jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, très peu de ses effigies ont été préservées. D’ailleurs, certains d’entre eux étaient considérés comme l’effigie de son ancêtre Jogaila de Lituanie, comme le tableau de Marcello Bacciarelli au Château royal de Varsovie (ZKW/2713/ab), tandis que le portrait du grand-père maternel de Ladislas IV Vasa - l'archiduc Charles II d'Autriche, issu de la même série de monarques polonais peints entre 1768 et 1771, était considéré comme l'effigie de Sigismond Auguste (ZKW/2719/ab). L'effigie la plus populaire du monarque, le portrait en miniature d'atelier de Lucas Cranach le Jeune conservé au musée Czartoryski (MNK XII-538), a été acheté au milieu du XIXe siècle à Londres par Adolf Cichowski. Le style du portrait du « Dernier Jagellon » ainsi que le matériau sur lequel il a été peint (cuivre) indiquent que le tableau a été réalisé dans la première moitié du XVIIe siècle. Bien qu'il soit évidemment basé sur la même effigie du roi que la miniature évoquée de Cranach, les traits du visage sont légèrement différents, le peintre a arrondi le nez et fait saillir la lèvre inférieure. Ceci est également mieux visible en comparaison avec d'autres effigies inscrites du roi, comme la miniature du Kunsthistorisches Museum de Vienne (GG 4697) ou la miniature de l'atelier de Dirck de Quade van Ravesteyn à Cracovie (MNK XII-146). De cette manière, le « Dernier Jagellon » ressemble davantage au descendant des Jagellon - Ladislas IV Vasa, notamment son portrait de Pieter Claesz. Soutman au palais de Wilanów (Wil.1134) ainsi qu'une gravure de Jonas Suyderhoef d'après un dessin de Claesz. Soutman au Musée national de Varsovie (79212 MNW). Ladislas, le nouvel Auguste, le monarque qui fera revivre l'esprit de tolérance du dernier Jagellon mâle, c'est ce que beaucoup de gens, notamment protestants, attendaient du roi nouvellement élu (novembre 1632), après de nombreuses années de règne de son père Sigismond III, qui penchait pour le catholicisme à l’espagnole. Cependant, lorsque Ladislas abandonna son projet d'épouser une princesse protestante et s'allia avec ses parents Habsbourg, beaucoup d'entre eux se sentirent trompés. Le magnifique tableau Daniel et Cyrus devant l'idole Bel, attribué au peintre de la cour de Ladislas - Bartholomeus Strobel, conservé au Musée national de Varsovie (huile sur cuivre, 39,5 × 30 cm, M.Ob.1284), est considéré comme une allégorie politique de la règne de Ladislas sous un « déguisement biblique ». Cette histoire dérive de la partie apocryphe du livre de Daniel et le tableau représente le prophète exposant la fraude des prêtres babyloniens d'Idol Bel (Baal) au roi Cyrus de Perse. Elle fut très probablement commandée par les élites protestantes du pays, peut-être par Gerard Denhoff (1589/90-1648), voïvode de Poméranie ou par son épouse Sibylle Marguerite de Legnica-Brzeg (1620-1657), originaire de Silésie comme Strobel. Si le portrait du « Dernier Jagellon » a été commandé par le roi, on peut supposer qu'il voulait convaincre ses sujets, notamment les non-catholiques, qu'il sera un dirigeant tolérant, ou si, comme Daniel et Cyrus par les protestants, cela pourrait être un message au roi auquel de ses prédécesseurs il doit se référer et qu'il doit prendre comme exemple. Non seulement le thème des deux tableaux décrits est lié, mais aussi leur style. Le visage du roi Cyrus est particulièrement similaire tant dans les caractéristiques du modèle que dans le style de peinture. Le portrait ressemble à l'œuvre signée de Strobel (Bartholo. / Strobel. / Pinxit:) - Notre-Dame du Rosaire avec saint Dominique et saint Nicolas dans l'église de Grodzisk Wielkopolski, peinte entre 1634 et 1635, et certaines des peintures attribuées ou d'atelier comme le portrait en demi corps de Jerzy Ossoliński (1595-1650) conservé au Musée national de Varsovie (déposé au Palais de Wilanów, 182280, 3020 Tc/72).
Portrait de Jerzy Ossoliński (1595-1650) par Bartholomeus Strobel ou atelier, vers 1635, Musée national de Varsovie.
Portrait du « Dernier Jagellon » Sigismond II Auguste (1520-1572), portant les traits de Ladislas IV Vasa (1595-1648) par Bartholomeus Strobel ou atelier, vers 1636-1637, Musée national de Cracovie.
Daniel et Cyrus devant l'idole Bel - Allégorie du règne de Ladislas IV Vasa (1595-1648) par Bartholomeus Strobel, vers 1636-1637, Musée national de Varsovie.
Portrait de Jan Stanisław Jabłonowski, maréchal de l'extraordinaire Sejm par Rembrandt
« Je suis un envoyé de toute la République, et si nous partons sans rien faire, vous ne pourrez pas m'empêcher de parler devant le Roi, afin que je ne me plains pas et ne proteste pas contre ceux qui laissent leur patrie sans aucune défense, dont moi aussi, vivant à la frontière, j'ai grandement besoin », a déclaré Jan Stanisław Jabłonowski (1600-1647), le grand porte-glaive de la Couronne le 23 mai 1647. Il l'a déclaré lors du Sejm (la Diète) extraordinaire face aux tentatives de perturber le parlement chargé des questions les plus brûlantes de la défense des frontières contre l'Empire ottoman et du paiement de l'armée. Connu pour son attitude civique, Jabłonowski gagna un tel respect parmi la noblesse que lors de deux sejm consécutifs en 1637 et 1640, il fut nommé maréchal (d'après « Szkice Historyczne » de Karol Szajnocha, tome 3, p. 4-5, 8, 11), c'est-à-dire le président de la Chambre des députés du Parlement de la République polono-lituanienne.
Il fut probablement l'un des meilleurs, sinon le meilleur, maréchal du Sejm sous le règne de Ladislas IV. Luttant pour une discussion efficace, il a menacé les députés qu'il les traiterait comme des cardinaux dans un conclave et ne les laisserait pas partir tant qu'ils ne seraient pas parvenus à un accord (d'après « Charakterystyka sejmów za Władysława IV » de Sybill Hołdys, p. 207). En vertu des articles henriciens, les sejm ordinaires étaient convoqués tous les deux ans et, si nécessaire (par exemple en cas de menace directe contre l'État), le roi pouvait convoquer un sejm extraordinaire pour une période ne dépassant pas deux semaines. Juste avant l'heureuse conclusion du Sejm extraordinaire de 1637, le Sejm ordinaire présidé par Casimir Léon Sapieha/Sapega (1609-1656) s'effondra au début de cette année - et les assemblées qui suivirent le Sejm de 1640 en 1642, 1643, 1645 et plus tard, ils ont également été généralement perturbés. Connu pour son style de vie somptueux et son splendide patronage, le roi Ladislas IV avait constamment besoin d'argent. En 1637, il se préparait également à se marier avec la fille de l'empereur, Cécile-Renée d'Autriche, et déjà au début de cette année-là, le trésor commença à se vider à nouveau. Conseillé par son entourage, le roi souhaite imposer un droit de douane maritime. Malgré l'opposition des envoyés de Prusse polonaise et de Lituanie, qui s'opposèrent presque immédiatement à cette idée, il fut décidé d'adopter une constitution imposant cet impôt lors du Sejm extraordinaire (Varsovie, 3-18 juin 1637). En octobre 1637, le souverain envoya à Gdańsk le voïvode de Sandomierz, Jerzy Ossoliński, et le staroste de Kościerzyna, Gerard Denhoff, qui annonça l'introduction des droits de douane, ainsi que les frères Abraham et Isaac Spiering (Spiring ou Spierincx), fils du tisserand flamand François Spiering, actif à Delft (qui réalisa des tapisseries pour Sigismond III), en tant que collectionneurs (comparer « Briefwisseling van Hugo Grotius », p. 675). Leur frère Pieter Spiering van Silvercroon (1595-1652) semble avoir eu une fabrique de tapisseries à Gdańsk entre 1614-1649. Le maréchal du Sejm était un poste purement honoraire et il était élu par tous les députés, au plus tard le troisième jour après l'ouverture du Sejm. À partir de ce moment, cependant, la carrière de Jabłonowski à la cour prend de l'ampleur. En 1638, ce député expérimenté, qui participa à tous les sejm depuis 1635 en tant que délégué du sejmik galicien (territoire galicien de la voïvodie de Ruthénie), devint échanson royal de la reine Cécile-Renée et plus tôt, le 18 novembre 1637, il reçut le village de Perehinske, dans l'ouest de l'Ukraine, du roi. Jan Stanisław est né à Lutcha, un village privé de la voïvodie de Ruthénie (aujourd'hui Ukraine), où se trouvait un château. Bien que la famille Jabłonowski des armoiries Prus III soit originaire de Mazovie (du village de Jabłonowa près de Mława - Jabłonowscii de Jabłonowa in palatinatu Płocensi, in districtu Mlavensi), au XVIIe siècle, leur « nid » est devenu la Ruthénie. Le maréchal du Sejm extraordinaire de 1637 fut le premier à obtenir une position importante dans la République et grâce à son mariage avec Anna Ostrorożanka (1610-1648), fille de Jan Ostroróg, voïvode de Poznań et de la princesse ruthène Sofia Zaslavska, en 1630, il entra en relations avec les maisons les plus distinguées de la République (d'après « O Jabłonowskich herbu Prus III » de Wojciech Kętrzyński, p. 3). Il était le fils de Maciej Jabłonowski (1569-1619), maître de cavalerie (rotmistrz), et de Katarzyna Kłomnicka. Il étudie au collège jésuite de Lviv, puis voyage quelque temps à l'étranger. Il a probablement visité la France, car la famille Jabłonowski a cultivé ses relations françaises tout au long du XVIIe siècle. Il participa aux guerres contre la Suède et les Tatars de Crimée en 1624-1629, ainsi qu'avec la Russie en 1632-1634. Bon orateur, connu pour ses discours aux Sejm en 1633-1642, il fut particulièrement actif pendant le Sejm d'hiver de 1637. Son fils Stanisław Jan Jabłonowski (1634-1702) éleva sa famille au premier plan et devint voïvode de la voïvodie de Ruthénie et grand hetman de la couronne. Ses petits-fils, fils de Stanisław Jan, ont étudié dans les écoles jésuites de Lviv et de Prague. Ils se sont rendus à Berlin, aux Pays-Bas, via Utrecht, Rotterdam, Leiden et Amsterdam, puis en Flandre, pour finalement atteindre Paris via Louvain et Bruxelles. La petite-fille de Jan Stanisław, Anna Leszczyńska (1660-1727), était la mère du roi élu de la République Stanislas Leszczyński et sa petite-fille Marie Leszczyńska fut reine de France à partir de 1725, après avoir épousé Louis XV. Il fut donc l'ancêtre des rois de France Louis XVI (1754-1793), Louis XVIII (1755-1824), Charles X (1757-1836), Marie-Clotilde de France (1759-1802), reine de Sardaigne et Marie-Louise de Parme (1751-1819), reine d'Espagne. Son petit-fils, Jan Stanisław Jabłonowski (1669-1731), fut peint par José García Hidalgo, peintre de la cour du roi Charles II d'Espagne, lors de son séjour à Madrid en 1687, portant un costume espagnol (Musée national de Varsovie, M.Ob. 813 MNW). Le grand porte-glaive de la Couronne a été enterré dans l'église des Jésuites de Lviv, où son arrière-petit-fils Stanisław Wincenty Jabłonowski (1694-1754) lui fonda une belle épitaphe du baroque tardif, portant une date incorrecte de sa mort - obiit Anno salutis 1659. Elle a été exécutée entre 1744 et 1754, probablement par Jerzy Markwart (Georg Marquard) (d'après « Nagrobek Jabłonowskich ... » d'Andrzej Betlej, p. 70, 84). Un noble polonais de Rembrandt conservé à la National Gallery of Art de Washington (huile sur panneau, 96,8 x 66 cm, 1937.1.78) a été signé et daté par le peintre en haut à droite : Rembrandt.f:. / 1637. Avant 1931, lorsque le tableau fut acheté par Andrew W. Mellon (1855-1937), le tableau fut conservé pendant plus de 100 ans au Musée de l'Ermitage à Saint-Pétersbourg. Le « Catalogue des tableaux qui se trouvent dans les Cabinets du Palais Impérial à Saint-Pétersbourg » de 1774, où il était répertorié comme « Portrait d'un Turc, vû à mi-corps, de grandeur naturelle, tenant un Bâton dans la main. Sur Bois, de 2. pieds de large et de 3. pieds de haut » (n° 44), est la plus ancienne provenance sûrement établie de ce tableau. L'homme ne peut pas être un ambassadeur de Moscovie (lié à une vente de Harman van Swol en 1707), car cela voudrait dire que les auteurs du Catalogue de 1774 se sont moqués de l'Impératrice de Russie (propriétaire du tableau) qui, deux ans plus tôt, en 1772, partagea la République polono-lituanienne, ne reconnaissant pas le représentant de la Russie peint par Rembrandt et le confondant avec un Turc. Ce qui est très intéressant, c'est qu'au XIXe siècle, à Lviv, où Jabłonowski a été enterré, et dans les environs, il y avait deux copies anciennes du tableau. L'un d'eux se trouvait au musée Lubomirski à Lviv et figurait dans le catalogue de 1877 (Katalog Muzeum imienia Lubomirskich) sous le titre « Portrait de l'hetman, copie de Rembrandt (l'original de l'Ermitage de Saint-Pétersbourg s'appelle Radziwill) » (article 445, p. 154). L'autre, provenant de la collection du comte Karol Lanckoroński (1848-1933) à Rozdil près de Lviv, a été exposé à Lviv en 1909, sous le titre « ancienne copie, Le connétable polonais [...] L'original se trouve à l'Ermitage de St. Pétersbourg » (d'après « Katalog ilustrowany ... » de Mieczysław Treter, article 105, p. 31). Lanckoroński a également prêté à cette exposition un ancien exemplaire du portrait du pape Jules II par Raphaël de sa collection (article 104, p. 30) et il possédait les portraits d'Hendrick van Uylenburgh, agent artistique du roi de Pologne, et de sa fille Sara de Rembrandt (Château Royal de Varsovie, ZKW/3905, ZKW/3906), identifiée par mes soins. À cette époque, on pensait également que le tableau de Saint-Pétersbourg représentait Jean Sobieski. L'homme tient un épais objet en forme de bâton en bois qui ressemble à un bâton de cérémonie d'un officier militaire de haut rang, semblable à celui vu dans de multiples portraits du roi victorieux Jean III Sobieski. Cependant, la façon dont il le tient indique que le bâton pourrait être beaucoup plus long qu'un bâton de cérémonie et qu'il s'agit en fait d'une canne. Dans la République polono-lituanienne, la canne était un attribut traditionnel d'un maréchal (Mareschalcus), le « ministre » le plus important du pays. Traditionnellement, depuis l'époque de Jogaila de Lituanie (mort en 1434), il y avait quatre maréchaux : le grand maréchal de la Couronne (Pologne et Ukraine), le grand maréchal de Lituanie, le maréchal de la cour de la Couronne et le maréchal de la cour de Lituanie. Comme il s'agissait d'un poste d'État plus permanent, leurs cannes étaient généralement très élaborées, faites de matériaux précieux et ornées de pierres précieuses, comme le bâton vu dans le portrait de Casimir Léon Sapieha/Sapega (1609-1656), maréchal de la cour de Lituanie (Château Royal du Wawel, 9149). Łukasz Opaliński, grand maréchal de la Couronne, dans son portrait de Stanisław Kostecki (Musée Czartoryski, XII-370), tient le bâton du maréchal décoré du monogramme royal - ST (Sigismundus Tertius) de Sigismond III Vasa. Le bâton du maréchal appartenant à Stanisław Herakliusz Lubomirski, grand maréchal de la Couronne dans les années 1676-1702, est décoré d'argent, d'or, de pierres précieuses (diamants et almadins) et d'émail avec des symboles de la Pologne et de la Lituanie et du roi Jean III Sobieski - ITR (Joannes Tertius Rex) (Musée Czartoryski, MNK XIII-3176). Dans plusieurs de ses portraits, Lubomirski était représenté tenant cette canne, comme le portrait du palais de l'île à Varsovie (ŁKr 947), qui provient de la collection du dernier monarque élu de la République - Stanislas Auguste Poniatowski. La pose de l'homme dans le tableau de Rembrandt est très similaire. Les maréchaux du Sejm possédaient également des cannes, mais comme leur fonction était temporaire, juste pour la durée de la session parlementaire, elles n'étaient pas aussi élaborées. En frappant le sol à plusieurs reprises avec le bâton du maréchal, le maréchal a ouvert la séance du Sejm. Ils furent également fréquemment endommagés pendant les séances, comme le confirment les journaux du Sejm de 1704 : « toute la journée fut malheureuse, car trois bâtons du maréchal se sont brisés lorsqu'il les frappait au sol pour les faire taire ». La perte n'était pas trop grande, car comme l'a remarqué Aleksander Łącki, envoyé de Łęczyca, pendant le Sejm (lors de la dispute sur le poste de maréchal), ce n'était qu'un bâton qu'il obtenait pour un ort (1 ort - 18 groszy) (d'après « Sejm Rzeczypospolitej ... » de Wojciech Kriegseisen, p. 180). Une de ces cannes, propriété de Stanisław Małachowski (1736-1809), maréchal du Sejm de quatre ans (le grand Sejm, tenu à Varsovie entre 1788 et 1792), conservée au Musée Czartoryski (chêne, 165 cm, MNK XIII-1300). Małachowski était également représenté la tenant dans son portrait de Józef Peszka (Château royal de Varsovie, dépôt du Musée national de Varsovie, 5754). Le portrait de Stanisław Marcin Badeni (1850-1912), maréchal de la diète de Galice, n'est pas sans rappeler les effigies des maréchaux de la République (Musée national de Cracovie, MNK II-a-524). Il a été peint par Kazimierz Pochwalski en 1903 et Badeni, issu d'une famille d'origine italienne, en costume traditionnel, tient le bâton du maréchal. L'homme du portrait de Rembrandt porte un chapeau de fourrure d'une forme typique de la noblesse ruthène et lituanienne, visible par exemple dans le portrait de Paul IV Sapieha/Sapega (mort en 1642) (Château royal du Wawel, 9164). Son costume - chapeau, manteau de fourrure, bijoux ressemble à ceux visibles dans un portrait d'un homme en costume oriental, très probablement un prince ruthène par suiveur d'Aert de Gelder, daté « 1639 » (Musée national de Varsovie, M.Ob.151 MNW). Des costumes similaires sont visibles dans la reddition de Mikhaïl Chéine à Smolensk en 1634 par Christian Melich (Château de Kórnik, MK 03271) avec le roi Ladislas IV et ses dignitaires. Le roi et ses serviteurs portent des costumes français à la mode, tandis que le reste des membres de sa suite sont habillés dans le style ruthène-lituanien ou polono-hongrois. Des costumes similaires ont également été représentés dans l'Allégorie de la Pologne de Stefano della Bella des années 1630 (Rijksmuseum Amsterdam, RP-P-OB-34.913) et à l'effigie de saint Casimir de HYMNUS QUEM IN B. VIRGINIS HONOREM COMPOSUIT ..., réalisé à Douai en 1638 (Musée national de Cracovie, MNK III-ryc.-28781). L'estampe a été fondée par le ruthène Mykola-Yuriy Chortoryski (1621-1692), prince de Klevan, qui a étudié à l'étranger. Avant la Contre-Réforme et l'influence croissante des Jésuites et des Habsbourg à la cour royale/grand-ducale, de nombreux Ruthènes professaient l'orthodoxie ou le calvinisme. Pour poursuivre une carrière à la cour et étudier à l'étranger, ils se convertissaient fréquemment au catholicisme. Les invasions étrangères ont aggravé cette situation, et d'une nation multireligieuse et multiculturelle, la Pologne-Lituanie est devenue majoritairement catholique et polonaise (notamment en ce qui concerne les élites). Mais avant cela, les rois étaient également représentés dans des costumes typiquement ruthènes. Par exemple, le portrait octogonal du roi Jean II Casimir Vasa, attribué à son peintre de cour Daniel Schultz, le représente portant un chapeau ruthène (Château royal de Varsovie, dépôt du Musée national de Varsovie, 474 MNW). Le style de cette effigie est évidemment inspiré de Rembrandt. Heureusement, il a été conservé en Pologne, sinon dans une collection étrangère il serait sans doute connu comme le portrait d'un homme (c'est-à-dire Néerlandais) en costume oriental réalisé par un suiveur de Rembrandt (mis à part la ressemblance évidente avec le monarque et l'histoire connue de ce tableau). Le roi élu Michel Korybut Wiśniowiecki (1640-1673), issu de la famille princière Vychnevetsky d'origine ruthène-lituanienne, a été représenté vers 1669 en costume manifestement ruthène dans une estampe de Nicolas de Larmessin I (Rijksmuseum Amsterdam, RP-P-OB -43.940). Le but de ces effigies était exactement le même que dans le cas des portraits d'empereurs du Saint-Empire romain germanique en costumes hongrois ou bohèmes, souligner que les monarques élus de la République polono-lituanienne sont également les dirigeants de la Ruthénie et qu'ils s'identifient aux principaux groupes ethniques du pays. Ces chapeaux de fourrure de forme conique étaient encore populaires au XIXe siècle parmi les Ruthènes de Podolie, comme le montrent une lithographie de 1836 (Przyjaciel Ludu) ou un portrait de Léon Sapieha (1803-1878), maréchal de la diète de Galice, peint par Léopold Horovitz en 1882 (Château royal du Wawel, 9068). Les origines du manteau à partie supérieure ronde recouverte de fourrure provenaient probablement des costumes médiévaux des princes de Ruthénie, probablement inspirés de la mode de la cour des empereurs byzantins de Constantinople (à comparer avec les effigies des empereurs byzantins Alexis Ier Comnène, Michel VIII Paléologue ou Manuel II Paléologue). Même Rembrandt, vers 1637, se représente dans un costume similaire dans son autoportrait signé de la Wallace Collection (huile sur panneau, 63 x 50,7 cm, P52). Il existe de nombreuses telles représentations du peintre. Les Néerlandais moyens préféraient la mode française ou hollandaise, visible dans de multiples portraits de l'âge d'or néerlandais. Dans son portrait signé et daté (Rembrandt / fe 1634) conservé au Musée national de Varsovie (M.Ob.2189), le jeune marchand Marten Soolmans (1613-1641) porte un costume typiquement français des années 1630. Les personnages de La Ronde de nuit de Rembrandt sont également habillés selon la mode principalement hollandaise ou française de l'époque. Le peintre des marchands et de l'aristocratie hollandaise doit s'identifier à ses clients par des vêtements appropriés, alors que dans beaucoup de ses effigies il ressemble à un prince oriental ou à un marchand de fourrures, comme Nicolaes Ruts, commerçant de fourrures d'Amsterdam (The Frick Collection, 1943.1.150). On dirait qu'il voulait se vanter dans ces autoportraits - regardez, gens d'Amsterdam, quelles belles fourrures et chaînes en or j'ai reçus de mes clients sarmates/ruthènes ou même pour paraphraser Jabłonowski, « Je suis un peintre de toute la République ». La technique picturale de Rembrandt, composée de coups de pinceau audacieux et d'empâtements épais, très probablement inspirée de la technique des grands vénitiens qui ont peint les monarques de Pologne-Lituanie, indique qu'il peignait vite et que des œuvres plus petites, notamment avec l'aide d'assistants fréquemment mentionnés, pouvaient ne prendre que quelques jours. Au cours d'environ 45 ans de sa carrière (1624-1669), il a réalisé environ 324 tableaux qui sont soit signés, soit qui lui sont attribués, ce qui représente environ 7 à 10 tableaux par an. Le peintre français du XIXe siècle Gustave Courbet, qui peignait également rapidement et sans l'aide d'assistants (dans deux cas avec l'aide d'Hector Hanoteau), estimait qu'il avait réalisé environ 1 000 tableaux jusqu'en 1867 (d'après « Country Life Illustrated », Volume 163, 1978, p. 260), ce qui fait environ 36 tableaux par an au cours d'une carrière de 28 ans débutée vers 1839 à Paris. Rembrandt a également réalisé des estampes, qu'il a également créées assez rapidement. Cependant, face à ces faits, soit il était paresseux, soit nombre de ses œuvres majeures furent détruites, comme lors du déluge (1655-1660). Aucune effigie confirmée de Jan Stanisław Jabłonowski n'a survécu, mais l'homme ressemble beaucoup aux effigies du fils du maréchal Stanisław Jan Jabłonowski (1634-1702), grand hetman de la Couronne de Jean Mariette d'environ 1682 (Musée national de Varsovie, 99334), son petit-fils Jan Stanisław Jabłonowski (1669-1731), voïvode de Ruthénie, peint par Adam Manyoki vers 1714 (Musée national de Varsovie, PM 4266 MNW) ou l'arrière-petit-fils de Jabłonowski, le roi Stanislas I Leszczyński par le cercle d'Adam Manyoki des années 1720 (vendu chez Desa Unicum à Varsovie, le 24 novembre 2021, lot 45). La boucle d'oreille à son oreille indique qu'habituellement, comme le roi, il préférait le costume français et qu'il ne s'habillait en costume ruthène que pour démontrer son attachement à sa région et à la République. En 1637, deux marchands protestants flamands, élevés à Delft aux Pays-Bas où leur père avait fui Anvers, devinrent collecteurs d'impôts de la République polono-lituanienne. De même, nous pouvons supposer que Rembrandt travaillait régulièrement comme peintre à distance pour les clients de la République, y compris le roi, mais aujourd'hui, nous ne pouvons qu'imaginer combien de belles peintures il a créées pour eux. La destruction du patrimoine de la République au cours de nombreuses guerres et invasions fut si considérable que de nombreux objets importants liés aux monarques de Pologne-Lituanie durent être acquis à l'étranger, comme une série de miniatures de la famille Jagellon par l'atelier de Lucas Cranach le Jeune achetée à Londres au milieu du XIXe siècle par Adolf Cichowski (Musée Czartoryski). Le tableau ou une série a donc été commandé par Jabłonowski ou le roi dans l'atelier de Rembrandt pour commémorer le mémorable Sejm extraordinaire de 1637.
Portrait de Jan Stanisław Jabłonowski (1600-1647), maréchal de l'extraordinaire Sejm, portant le costume ruthène par Rembrandt, 1637, National Gallery of Art de Washington.
Autoportrait portant le costume ruthène et deux chaînes par Rembrandt, vers 1637, Wallace Collection.
Portraits d'Helena Tekla Ossolińska et de son beau-père Stanisław Lubomirski par Simon Vouet et atelier
Le 7 juillet 1637, la jeune Helena Tekla Ossolińska (1622-1687), âgée de 15 ans, « comtesse de Tęczyn », fille du voïvode de Sandomierz Jerzy Ossoliński (1595-1650) et Izabela Daniłowiczówna épousa Aleksander Michał Lubomirski (1614-1677), fils de Stanisław (1583-1649), voïvode de Ruthénie, et frère de Jerzy Sebastian (1616-1667), « unissant ainsi la splendeur de la maison Ossoliński à la splendeur de la maison Lubomirski », deux puissantes familles de magnats de la République polono-lituanienne, comme le vantait l'union Andrzej Hązel Mokrski (1598-1649).
Le poète et courtisan Adam Gębkowski a également dédié son poème au jeune couple (Hymen gdy świętym przymierzem W. JMP. Pan Alexander Lubomirski bierze W. JM. Pannę Helenę Ossolińską ...). Les célébrations du mariage ont eu lieu dans le somptueux château du père d'Helena Tekla à Ossolin, en présence du roi Ladislas IV Vasa et de nombreux sénateurs. Lors de cette rencontre, la création de l'ordre chevaleresque polono-litunien dédié à la Vierge Marie (« bienheureuse et immaculée Mère de Dieu de tout le christianisme ») a probablement été évoquée (voir « Saeculum Christianum ... », 1995, tomes 1-2, p.280). La création de cet ordre, sur le modèle de l'ordre du Saint-Esprit fondé par Henri III (également élu monarque de la République) en 1578, fut suggérée au roi par Ossoliński. Cependant, en raison de l'opposition de magnats catholiques tels que Stanisław Koniecpolski et Stanisław Lubomirski, du primat Jan Wężyk et du grand hetman de Lituanie Christophe Radziwill, qui était calviniste, le roi confirma par écrit en 1638 qu'il n'établirait pas d'ordre sans le consentement du Sejm. De plus, après avoir remis en question le titre princier d'Ossolinski, reçu du pape et de l'empereur, le Sejm a également interdit l'utilisation de titres aristocratiques, car ils contredisaient l'égalité de la noblesse. Mademoiselle Ossolińska a dû recevoir une bonne éducation de la part de ses parents, car elle fut plus tard connue comme l'une des femmes les plus sages et les plus influentes de son âge. Elle était également une figure reconnue parmi les artistes et les écrivains. Son père et son mari étaient également des hommes instruits et voyageaient dans différents pays d'Europe. Jerzy Ossoliński a étudié à Graz (Autriche) et Louvain, en Angleterre, à Paris et Orléans, à Padoue, à Bologne, à Rome et à Naples. En 1621, il se rendit en Angleterre en tant qu'envoyé de la République. En 1633, en tant qu'ambassadeur, il fit la célèbre entrée à Rome et un an plus tard, en 1634, il se rendit à Vienne en mission diplomatique. En 1636, il visita la Diète impériale de Ratisbonne, où il assista à l'élection de Ferdinand III. Aleksander Michał et son frère Jerzy Sebastian séjournèrent à Ingolstadt (Bavière) en 1629 et plus tard à Louvain, Cologne et Leiden. Ensemble, ils se rendirent en France, Jerzy se rendit probablement en Espagne et certainement en Angleterre pendant une courte période, tandis qu'Aleksander Michał se rendit en Italie (Padoue, Rome), où il resta jusqu'en 1635. De retour en Pologne-Lituanie, il devint le courtisan du roi. Les résidences de ces hommes riches et instruits devaient refléter le goût le plus élevé de la classe supérieure européenne de l'époque. Le château d'Ossolin avait de riches sols en marbre, des fenêtres en cristal encastrées dans des cadres en plomb, des plafonds peints sur toile dans des cadres dorés « comme s'ils étaient d'or pur » (gzymsy złocone suto jakby szczerozłote), probablement de style vénitien, des portes en marqueterie et une bibliothèque avec des portraits. Dans l'une des pièces se trouvaient des peintures représentant des vues de villes européennes et une cheminée avec deux statues portant les armoiries des Ossoliński. Malheureusement, la résidence fut pillée et détruite par les troupes suédoises et transylvaniennes lors du déluge. En 1816, alors que le pays s'appauvrissait considérablement à la suite de nombreuses guerres, le propriétaire Antoni Ledóchowski, espérant retrouver les trésors légendaires des Ossoliński, cachés des envahisseurs, ordonna de faire sauter les ruines du château. Le château de Wiśnicz, qui appartenait à Aleksander Michał et à son épouse après la mort de son père en 1649, était également célèbre pour ses riches collections. Helena Tekla a contribué à leur expansion, car après la mort de son père, elle a hérité en 1651 d'une partie de sa collection de livres et d'œuvres d'art, qui se trouvaient dans les résidences du chancelier à Varsovie et Ossolin. Ces biens meubles, en l'absence d'héritier mâle, étaient répartis entre les trois filles de Jerzy Ossoliński. Pendant le déluge, entre 1655 et 1659, le château fut évacué à deux reprises par les hôtes et pillé à trois reprises par les troupes ennemies, qui transportèrent le butin de Wiśnicz sur 150 charrettes (d'après « Z dziejów polskiego mecenatu ... » de Władysław Tomkiewicz, p. 264). Ce qui est intéressant, c'est que le château, renforcé d'au moins 35 canons et défendu par un équipage de plus de 200 soldats, fut livré au « brigand de l'Europe » sans combat par crainte d'être détruit en octobre 1655 (comparer « Od Ujścia do Warki, 1655-1656 » par Henryk Wisner, p. 63). Malgré cela, après le pillage, le château a été détruit par les Suédois avec de la poudre à canon et le monastère des Carmélites voisin a été entièrement pillé (d'après « Szwedzi i siedmiogrodzianie ...» de Joźef Gollenhofer, Klemens Bąkowski, Ludwik Sikora, p. 43). Le château fut partiellement reconstruit en 1680-1686. L' « Inventaire des biens épargnés des Suédois et des évasions fait le 1er décembre 1661 à Wiśnicz » (Rejestr rzeczy po Szwedach i ucieczkach zostających spisany roku 1661 dnia 1 grudnia na Wiśniczu) aux Archives centrales des documents historiques de Varsovie (numéro 1/357/0/-/7/12), répertorie quelques-unes des peintures conservées de la collection, dont plusieurs peintures appartenant à Stanisław Lubomirski, comme un grand tableau de Diane avec des lévriers (Obraz wielki Dianna scharty) et Jerzy Ossoliński, comme le Vierge à l'Enfant avec saint Jean « de France » (ze Francyey), Léda et le cygne de l'empereur, Hérodiade avec la tête de saint Jean-Baptiste (Herodianna glowe sw. Jana trzymaiąca w Ramach Hebanowych), Cupidon faisant son arc « de Rome » (Kupido łuk struzący w Ramkach Hebanowych, z Rzymu), peut-être une copie d'un tableau de Parmigianino, un grand tableau de la Madone dans une guirlande de fruits tenue par des anges (Naśw. Panna wielka wieniec około niey z fruktow, ktory Anyeli trzymaia), peut-être de Pierre Paul Rubens et Jan Brueghel l'Ancien, peinture allégorique représentant le roi Louis XIII et le cardinal Richelieu « tenant le monde » (Król Francuzki z Kardinalem Ryszeli swiat trzymaiacy), le sacrifice d'Isaac par Titien (Abraam zabiiaiący Izaka. Ticyanow), le Suicide de Caton de Jusepe de Ribera (Kato przebiiający się puynałem. Spanioletow), l'empereur Titus (?) de Guido Reni (Tycyus Guidoroniego), Suzanne et les vieillards de Guercino (Zuzanna Gwercine da Cento), Le Portement de Croix sur marbre de Bassano (Baiulatio crucis na kamieniu Basana), peut-être de Jacopo Bassano, Tobie et l'Ange de Raphaël (Anyoł Tobiasza prowadzący Ramy czarne miescami złociste Raphael de Urbino), la Vierge à l'Enfant d'Albrecht Dürer (Naswietsza Panna z Panem Jezusem małym na drewnie Alberti Duri), l'Enfant Jésus et saint Jean-Baptiste dans une guirlande de fleurs de Daniel Seghers (Pan chrystus z swietym Janem Feston skwiatow trzymaiacy Jezuity Antuerpskiego), un grand tableau de sainte Cécile par Domenichino (Swięta Cecylia wielka Dominikinow) et les vertus cardinales de Paolo Veronese (Tres virtutes cardinales. Paulo Venorase). Certaines mentions telles que « mes tableaux offerts ou achetés » (Obrazy moie własne tak darowane iako y kupne), dans ce registre ainsi qu'un grand connaisseur des tableaux indiquent qu'Aleksander Michał peut avoir été l'auteur de ce registre ou avoir personnellement supervisé sa création. Parmi les tableaux reçus ou achetés, le registre répertorie une copie du tableau des déesses du bain (Obraz Bogin kompiących sie. Kopia), Sainte Marie-Madeleine (?) de Parmigianino, peint sur bois (Białagłowa sczaką Parmeganino na drewnie), un tableau d'un vieux mendiant de Jusepe de Ribera (Obraz ubogiego starego Spenioleti), Vénus et Adonis de Francesco Albani (Adon z Venerą w Ramach złocistych Albanow), un tondo représentant Hermaphrodite de Francesco Albani (Obraz Harmofredita okrągły Albanow), deux paysages vénitiens, l'un avec saint Jean-Baptiste à la source sur le deuxième un berger avec du bétail (Dwa Lanszafcikow z Wenecyiy na iednym sw. Jan biorący wodę zrzodla na drugim Pastyrz zbydłem) et de nombreux portraits de dirigeants et aristocrates polono-lituaniens, français et italiens. On ne sait pas qu'est-il arrivé à ces peintures, peut-être dispersées parmi d'autres résidences, elles ont été détruites lors d'autres guerres ou lors du grand incendie du château délabré de Wiśnicz en 1831. L'inventaire comprend également plusieurs effigies d'Aleksander Michał et d'Helena Tekla. Deux effigies majeures de Madame Lubomirska étaient des portraits déguisés - l'un répertorié comme « Portrait de Madame sous les traits de sainte Hélène par Mons feuen » (Konterfet JeyMci na kształt świętey Heleny ma miedzi Mons feuen) et l'autre comme « Portrait en entier de Madame sous les traits de Diane avec des lévriers » (Konterfet cały Jey Mci na kształt Dianny scharty). Dans le premier, elle était représentée comme sa patronne Hélène de Constantinople, mère de Constantin Ier, comme la reine Bona Sforza, dans son portrait de 1525 par Lucas Cranach l'Ancien (Cincinnati Art Museum, 1927.387), identifié par moi. Deux portraits d'Aleksander Michał mentionnés dans le registre ont été peints par Nicolas Régnier (1591-1667) - « un par M. Renierow » (ieden P. Renierow) et un autre « par Renieri de Venise en robe brodée d'argent » (ieden Renierego z Venecyey w hawtowanych srebrem sukniach). Régnier, peintre des Pays-Bas espagnols, connu en Italie sous le nom de Niccolò Renieri, était actif à Venise à partir de 1626. Il est possible que certains portraits de l'épouse d'Aleksander Michał aient également été commandés à Venise. Curieusement, sainte Catherine d'Alexandrie attribuée à l'atelier de Nicolas Régnier, aujourd'hui conservée au château des Sforza à Milan (huile sur toile, 70 x 57 cm, inv. 270), porte les traits de Vittoria Farnèse (1618-1649), duchesse de Modène et Reggio. La présence du peintre à Modène vers 1648, époque probable où le tableau a été réalisé, n'est pas confirmée, il doit donc l'avoir peint à Venise. En 1644, il est nommé « peintre du roi de France », sans doute pour l'aider à échapper aux exigences de la fraglia dei pittori, afin de pouvoir plus facilement fournir des tableaux au cardinal Mazarin. Semblable au portrait de la reine Bona, portrait de l'impératrice Éléonore de Gonzague (1598-1655), peint par Lucrina Fetti entre 1621-1625 (Palais ducal de Mantoue, Gen. 6864), portrait en miniature d'Anne d'Autriche (1601 -1666), reine douairière de France, peint par Joseph Werner vers 1660 (Musée Condé, OA 1375) ou portrait de Vittoria della Rovere (1622-1694), grande duchesse de Toscane, peint par Justus Sustermans en 1669 (Palazzo Corsini à Rome, 428), Helena Tekla était sans doute également représentée avec l'attribut traditionnel de cette sainte portant la vraie croix du Christ. À la fin des années 1660, la maîtresse de Louis XIV de France, Françoise Louise de La Vallière (1644-1710), duchesse de La Vallière, était très probablement également représentée en sainte Hélène, car une telle effigie était vendue à Stockholm (Bukowski Auktioner, vente 562, lot 426 / 124687). En 1952, Władysław Tomkiewicz, qui analysa cet inventaire, suggéra que l'auteur du portrait déguisé d'Helena Tekla pourrait être Simon Vouet (1590-1649), peintre français (comparer « Z dziejów polskiego mecenatu ... », p. 271). Vouet étudie à Rome, où il épouse la peintre Virginia da Vezzo ou Vezzi (décédée en 1638) en 1626. Un an plus tard, en 1627, il est appelé par Louis XIII pour devenir le premier peintre du roi à Paris, où son jeune frère Aubin Vouet (1595-1641) travaillait déjà comme peintre du roi depuis 1621. Il séjourna également à Venise, Gênes et Milan et visita Constantinople en 1611. Ce n'est pas seulement la similitude de Mons [Monseigneur/Monsignore] feuen qui le suggère, mais aussi le grand nombre de portraits des monarques et dignitaires français présents dans l'inventaire et le fait que le même peintre a créé d'autres tableaux de la collection Lubomirski. Le registre mentionne un tableau de « Saint Sébastien mourant par Mons ouet » (Swięty Sebastian, umierający. Mons ouet) et « Deux portraits sur cuivre, l'un de cette ambassadrice en rouge, l'autre de la duchesse de Lorraine en bleu par Mons Scheuet » (Dwa konterfety na miedzi ieden teyze Posłowey w czerwieni, drugi Xiezny Lotarynskiey w błękitni Mons Scheuet). Cette ambassadrice était Renée du Bec-Crespin (1613/14-1659), comtesse de Guébriant, nommée ambassadrice extraordinaire de France auprès de la République en 1646 et une entrée antérieure à l'inventaire mentionne un autre de ses portraits, peut-être du même peintre, en l'apparence de la Vierge : « Une image de l'ambassadrice de France, sous la forme de la Bienheureuse Vierge Marie » (Posłowey Francuzkiey obraz nakształt Nasw. Panny) et suivie de « Deux portraits sur cuivre du roi Ladislas et Cécile [Ladislas IV Vasa et sa première épouse Cécile-Renée d'Autriche] » (Dwa konterfety na miedzi krola Władisława z Cecyliją). Il est intéressant de noter que Renée est considérée comme la première femme ambassadrice de l'histoire de France et que sa mission était d'aider la seconde épouse de Ladislas IV, Marie-Louise de Gonzague, à acquérir de l'influence sur son mari. Il convient également de noter qu'aucune voix d'opposition à la première femme ambassadrice auprès du « Royaume de Vénus » n'est connue. Renée fut magnifiquement reçue à Varsovie, d'après le récit de son voyage par Jean Le Laboureur, publié à Paris en 1647 (« Relation du voyage de la Royne de Pologne, et du retour de Madame la Mareschalle de Guebriant, Ambassadrice Extraordinaire ... »), et « fut largement apprécié par le roi et les seigneurs polonais, reçut d'eux des honneurs extraordinaires » (d'après « Starożytności warszawskie ... » d'Aleksander Weinert, tome 2, p. 216). Si l'ambassadrice a offert son portrait aux Lubomirski lors de sa visite en Pologne, elle doit en avoir de nombreux exemplaires, car il y avait de nombreux dignitaires importants dignes de le recevoir. Le fait qu'il y ait deux de ses portraits dans la collection d'Helena Tekla et de son mari qui ont survécu au déluge indique qu'ils se sont probablement liés d'amitié avec l'ambassadrice. Commander de nombreux exemplaires d’une même effigie était alors une pratique courante parmi les élites. Le meilleur exemple sont les copies des portraits du prince Ladislas Sigismond Vasa par Rubens, les copies du portrait d'Henriette-Marie de France (1609-1669), reine d'Angleterre, d'Écosse et d'Irlande sous les traits de sainte Catherine d'Alexandrie, peints à l'origine par Antoine van Dyck vers 1637 (Christie's Londres, 24 janvier 2012, lot 261, Château de Versailles, MV 3425 ou Hatchlands Park, NT 1166715) ou une série de portraits de Lady Mary Villiers (1622-1685), duchesse de Richmond et Lennox en sainte Agnès par Antoine van Dyck et cercle, peints vers 1637 et après à l'occasion de son second mariage à l'âge de 15 ans (Château de Windsor, RCIN 404402, Lacock Abbey, 996277 et Christie's à Londres, vente 3475, lot 36). Ainsi, si quatre ou cinq tableaux - (1) portrait d'Helena Tekla en sainte Hélène, (2) saint Sébastien, (3) portrait de Madame de Guébriant, (4) portrait de la duchesse de Lorraine et, éventuellement, (5) portrait de Madame de Guébriant sous les traits de la Vierge Marie, étaient tous de Simon Vouet, très probablement aussi l'effigie d'Helena Tekla en Diane fut créée par lui. La représentation sous les traits de la déesse romaine de la chasse, de la fertilité et de l'accouchement indique que le tableau a été réalisé pour recevoir une « bénédiction » pour la jeune mariée, donc avant ou peu après le mariage. En ce sens il est comparable au portrait de la jeune Marie II (1662-1694), alors princesse, sous les traits de Diane, peint vers 1672 par Peter Lely (Hillsborough Castle, RCIN 404918). La future reine d'Angleterre est blonde sur ce portrait (dans ses effigies ultérieures, elle a les cheveux foncés). La description dans l'inventaire de Wiśnicz mentionne un portrait en pied, mais cela ne signifie pas que le tableau était vertical (debout, comme dans le portrait de la future reine d'Angleterre), mais qu'il pouvait aussi être horizontal (couché, comme dans les portraits peints par Cranach). Il est intéressant de noter qu'un tel tableau de Diane, peint par Simon Vouet en 1637, l'année du mariage d'Helena Tekla, se trouve aujourd'hui au palais de Hampton Court en Angleterre (huile sur toile, 104,3 x 147,5 cm, RCIN 403930). Le tableau a été enregistré pour la première fois dans la collection royale en 1710, décrit comme une « Diane par Vouet » (Diana of Vouet), au-dessus de la porte du salon de Somerset House – traditionnellement la résidence de la reine. Il n'y a aucune trace de cette œuvre dans les inventaires de Charles Ier ni dans la Vente du Commonwealth d'Angleterre (Sale Inventory, vers 1649-1651), cette dernière mentionne cependant : « Fait en Pologne, Roi de Pologne, en pied » à l'Armurerie de St James's (Done in Poland, King of Poland, full-length, WS 151, n° 10) et « Roi de France avec la Vierge à l'Enfant » (King of France with Madonna and Child, WS 60, n° 14). Le tableau a été inscrit par l'artiste, en bas à droite (sur le carquois) : Simon Vouet / F. [fecit] Paris 1637. Comme indiqué dans la description du tableau (Royal Collection Trust) « l'ajout du lieu d'exécution est inhabituel pour Vouet et peut indiquer que l'œuvre devait être envoyée à l'étranger ». Toute provenance antérieure à 1710 ne peut être que supposée pour le moment, aussi l'hypothèse selon laquelle Jerzy Ossoliński aurait envoyé en Angleterre (à ses amis rencontrés pendant ses études ou en 1621) un portrait déguisé de sa fille, commandé à Paris, est également possible. Une telle composition horizontale fait référence aux portraits nus de la reine Bona par Cranach en Diane-Égérie, peintures que j'ai identifiées. L'une des œuvres les plus célèbres de Simon Vouet ou de son entourage - le portrait allégorique d'Anne d'Autriche (1601-1666), cousine du roi Ladislas IV Vasa, aujourd'hui conservé au musée de l'Ermitage (ГЭ-7523), est aussi un portrait déguisé. La reine de France était représentée comme Minerve, déesse de la sagesse, victoire et stratégie. Seuls les traits du modèle, regardant le spectateur, indiquent qu'il s'agit d'un portrait, car l'inscription latine sur le socle est le début de la phrase des « Satires » de Juvénal : « La fortune ne manque jamais, [là où il y a de la prudence] » (Nullum numen abest, [si sit prudentia]). Le portrait déguisé d'Anne d'Autriche témoigne que l'artiste embellissait ses modèles ou adoptait leurs traits selon les canons classiques de beauté. Sainte Catherine d'une collection privée de Naples, attribuée à Vouet, est considérée comme un portrait déguisé de la belle-soeur de l'artiste Ursula da Vezzo (Sotheby's à New York, 25 janvier 2017, lot 39) et le tableau de Vouet conservé au Los Angeles County Museum of Art (M.83.201) est considéré comme un portrait de son épouse Virginia en sainte Marie-Madeleine. La femme du tableau du palais de Hampton Court ressemble beaucoup à Helena Tekla, comme le montrent ses portraits conservés en Pologne, tous réalisés après le déluge, en particulier les effigies en tant que religieuse, créées après 1681 - au palais de Wilanów (Wil.1340) et une copie dans l'église paroissiale Saint-Joseph de Klimontów. Un exemplaire d'atelier de « Diane au repos » a été vendu à Paris en 2019 (huile sur toile, 120 x 168 cm, Sotheby's, 26 juin 2019, lot 81). Comme les Lubomirski possédaient de nombreuses effigies de monarques et d'aristocrates français, les Français pouvaient également avoir le portrait de Madame Lubomirska, d'autant plus qu'il avait été commandé en France. Il est également possible que le tableau soit revenu dans son pays d'origine au XIXe siècle ou avant, avec l'installation de nombreux aristocrates polono-lituaniens en France. Une étude pour la tête de Diane par Vouet ou son atelier se trouve au Louvre (RF 28221, Recto). Il est possible que le tableau : « Une jeune personne avec un lévrier, à la française » (Osoba jakaś młoda z chartem tarantowatym, po francusku, 837/17), mentionné dans l'inventaire de la princesse Louise Charlotte Radziwill (1667-1695) qui a survécu le déluge (comparer « Inwentarz galerii obrazów Radziwiłłów z XVII w. » de Teresa Sulerzyska), était une autre effigie déguisée de Madame Lubomirska. Le tableau a également été reproduit dans plusieurs gravures. Ils ont une forme ovale, donc l’original aurait pu aussi être ovale. La version miroir, réalisée par Michel Dorigny à Paris en 1638, donc l'année suivante, est signée et datée : S. Vouet pinxit. / Cu priuilegio / M. Dorigny scul. / Parisi 1638 (Bibliothèques universitaires de Leyde, PK-P-144.428). La version de la Bibliothèque nationale de Pologne (G.31201) reproduit la disposition originale du tableau. Les peintures étaient généralement disponibles principalement aux clients qui les commandaient, c'est pourquoi l'artiste, probablement fier de son travail, souhaitait que sa composition soit accessible à un public plus large, c'est pourquoi les gravures ont été réalisées. Parfois aussi, les propriétaires des tableaux originaux souhaitaient une diffusion plus large. Par exemple, la Madone dite Hesselin ou La Vierge au rameau de chêne au Louvre (RF 2004 19), peinte par Simon Vouet pour la maison parisienne du secrétaire de Louis XIII Louis Hesselin vers 1640-1645, a été reproduite dans une estampe réalisée par Michel Dorigny en 1651 et portant les armoiries Hesselin en marge inférieure (British Museum, 1841,1211.39.54). Les traits de la Madone Hesselin sont assez particuliers, c'est pourquoi l'épouse du secrétaire, Renée d'Elbeuf, était probablement représentée comme la Vierge. La même femme était représentée dans un autre tableau attribué à Simon Vouet, vendu à Londres en 2019 (huile sur toile, 60,7 x 49,5 cm, Sotheby's, 5 décembre 2019, lot 115). Cette « Etude de jeune femme en Vierge » était auparavant considérée comme représentant l'épouse de l'artiste, Virginia, d'après un dessin de Marie Metézeau conservé au Musée des Beaux-Arts de Rennes (794.1.2691), signé : Virginia de Vezzo Sim.s Voüet Regis Christianissimj / Pictoris conjux charissima clarissima Inuentrix & Pinxit [...]. A partir de ce dessin, généralement daté de la seconde moitié du XVIIe siècle, donc plusieurs années après la mort de Virginia, une autre version du tableau de la Galleria Apolloni de Rome (huile sur toile, 60,3 x 50,2 cm, Bonhams à Londres, 11 juillet 2001, lot 122), est identifiée comme son autoportrait ou son effigie par un suiveur de Simon Vouet. De plus, l'inscription sur le dessin de Rennes est ambiguë et on peut également interpréter que Virginia a peint l'original ou une autre version du tableau. Le tableau vendu à Londres provient d'une collection privée en Autriche (jusque dans les années 1970, par héritage) et était traditionnellement attribué à Philippe de Champaigne. Il est donc fort possible qu'au XVIIe siècle déjà, un tableau ait envoyé au pape ou aux cardinaux à Rome et l'autre à l'empereur à Vienne. Une telle « distribution » d'effigies était typique de la haute aristocratie européenne. Les couleurs des vêtements - bleu et rouge - indiquent clairement que le sujet représente la Vierge (comparer avec Note du Catalogue - Catalogue Note). Le magnifique tableau attribué à Vouet, probablement peint en Italie, qui se trouve aujourd'hui au Musée national de Varsovie (huile sur toile, 100 x 75,5 cm, M.Ob.646, antérieur 128630), témoigne que son talent fut probablement reconnu par les des mécènes de la République polono-lituanienne peu après sa création. Ce tableau - vanité, inspiré du Caravage, est généralement daté d'environ 1621 et provient des collections d'art de l'État, peut-être du château royal de Varsovie. Il représente le couple mal assorti avec une jeune femme montrant un crâne (Vanitas). Enfin aussi certains portraits conservés dans les anciens territoires de la République sont proches du style distinctif de Vouet, de son atelier ou de son entourage. Il s'agit notamment d'un portrait du beau-père d'Helena Tekla, Stanisław Lubomirski, aujourd'hui dans l'ancienne résidence royale - le palais de Wilanów à Varsovie (huile sur toile, 81 x 65,8 cm, Wil.1258). Il porte une inscription ultérieure incorrecte identifiant le modèle comme étant le petit-fils de Stanisław, Stanisław Herakliusz Lubomirski (1642-1702). Le style de ce tableau est très similaire au portrait d'une femme, probablement Ursula da Vezzo, en sainte Agnès par l'entourage de Simon Vouet (Sotheby's à Londres, 24 avril 2008, lot 204). Le voïvode de Cracovie était très soucieux de la bonne diffusion de ses effigies, car malgré de nombreuses guerres et destructions, plusieurs ont survécu, comme le portrait en pied du château de Wiśnicz, peut-être peint par Stanisław Kostecki entre 1638-1649 et repeint au XVIIIe siècle (Musée national de Varsovie, 128870/2 MNW) ou effigie de la galerie de portraits des fondateurs et bienfaiteurs du monastère piariste de Varsovie, réalisée après 1647 (MP 3202 MNW). Dans chacun d'eux, il était représenté en costume national. Un autre portrait similaire de Stanisław Lubomirski, en forme ovale, se trouve aujourd'hui au Musée national d'art de Kaunas, en Lituanie (huile sur toile, 54 x 48 cm, ČDM Mt 1507). Il est également incorrectement identifié - comme l'effigie de Jan Karol Chodkiewicz ou Jonas Karolis Chodkevičius (mort en 1621), grand hetman de Lituanie, et provient de la collection de la comtesse Jadwiga Hutten-Czapska (1866-1943) au palais de Beržėnai. Il entre dans les collections du musée en 1940. Son style est comparable à Sainte Marguerite par l'atelier de Simon Vouet (Galerie Meier, Anticstore, Réf : 88152) et portrait de dame à la draperie rouge par entourage de Simon Vouet, peut-être Virginia da Vezzo (Artcurial, 22 mars 2023, lot 69). Outre le portrait du voïvode de Cracovie, la comtesse Hutten-Czapska possédait également le Mercure et les trois grâces de Michel Dorigny ou atelier de Simon Vouet, peint après 1642, aujourd'hui également conservé au Musée national d'art de Kaunas (huile sur toile, 172 x 137 cm, ČDM Mt 1445). Il s'agit d'une version d'un original perdu de Vouet reproduit dans une gravure de 1642 par Dorigny (Bibliothèques universitaires de Leiden, PK-P-144.488). Entre 1940 et 1941, les envahisseurs allemands nazis détruisirent la belle église des Carmes Déchaux de Nowy Wiśnicz, fondée par Stanisław Lubomirski en 1622, ainsi que son mobilier baroque. L'histoire après 1655 a toujours été très cruelle envers le Royaume de Vénus, et même si rien n'a été conservé des riches meubles, les visiteurs peuvent encore admirer la belle architecture de Wiśnicz et les institutions locales font beaucoup pour rénover, reconstruire et collecter autant de traces que possible de la splendeur passée.
Le Couple mal assorti (Vanitas) par Simon Vouet, vers 1621, Musée national de Varsovie.
Portrait d'Helena Tekla Ossolińska (1622-1687) en Diane par Simon Vouet, 1637, palais de Hampton Court.
Portrait d'Helena Tekla Ossolińska (1622-1687) en Diane par l'atelier ou l'entourage de Simon Vouet, vers 1637, Collection particulière.
Diane de Michel Dorigny d'après Simon Vouet, vers 1637, Bibliothèque nationale de Pologne.
Diane de Michel Dorigny d'après Simon Vouet, 1638, Bibliothèques universitaires de Leyde.
Portrait d'Helena Tekla Ossolińska (1622-1687) en Madone par Simon Vouet, vers 1637-1638, Collection particulière.
Portrait d'Helena Tekla Ossolińska (1622-1687) en Madone par l'atelier de Simon Vouet ou Virginia da Vezzo, vers 1637-1638, Collection particulière.
Portrait de Stanisław Lubomirski (1583-1649), voïvode de Cracovie par l'atelier ou l'entourage de Simon Vouet, vers 1638, palais de Wilanów à Varsovie.
Portrait de Stanisław Lubomirski (1583-1649), voïvode de Cracovie par l'atelier ou l'entourage de Simon Vouet, vers 1638, Musée national d'art de Kaunas.
Mercure et les trois grâces par Michel Dorigny ou atelier de Simon Vouet, après 1642, Musée national d'art de Kaunas.
Portrait de Vittoria Farnèse (1618-1649), duchesse de Modène et Reggio en sainte Catherine d'Alexandrie par l'atelier de Nicolas Régnier, vers 1648, Château des Sforza à Milan.
Portraits d'Anna Catherine Constance Vasa par Peter Danckers de Rij
Avec la nouvelle dynastie, les Vasa, le centre de la politique internationale de la République polono-lituanienne s'est déplacé du sud de l'Europe vers le nord. Sigismond III Vasa, monarque élu de la République est né en Suède et le 19 février 1594 il a été couronné roi de Suède et grand-duc de Finlande.
Curieusement, exactement à cette époque, les ateliers de peinture vénitienne ont commencé à décliner, il n'y a plus de grands peintres à Venise, originaires de la République, dans les décennies suivantes comme Giorgione, Lorenzo Lotto, Palma Vecchio, Sebastiano del Piombo, Titien, Tintoret, Jacopo Bassano ou Véronèse. Domenico Fetti est né à Rome et a ensuite travaillé à Mantoue pendant dix ans et Bernardo Strozzi est né et initialement principalement actif à Gênes. Les monarques de la République ont commencé à visiter plus souvent le principal centre économique du pays et son principal port maritime - Gdańsk au nord. Sigismond III s'y rendit plusieurs fois, pour la première fois lorsqu'il arriva de Suède en octobre 1587. Aussi son prédécesseur Sigismond II Auguste fut invité dans la ville en juillet 1552. Le 23 septembre 1561, le sommet de la tour de l'hôtel de ville principal de Gdańsk était orné d'une statue dorée du roi avec une braguette accentuée, conçue par le néerlandais Dirk Daniels. En 1564-1568, la Porte Verte dans le style du maniérisme flamand a été construite par l'architecte Regnier van Amsterdam comme résidence officielle des monarques de Pologne. Non seulement en architecture, mais aussi en peinture, les styles flamand et hollandais sont devenus les plus populaires à l'époque Vasa en Pologne, au moins dans le nord du pays. En 1624, le prince Ladislas Sigismond Vasa, futur Ladislas IV, visite l'atelier de Rubens et est peint par lui. Ladislas invita à Varsovie l'auteur de sa « Collection d'art » (Château royal de Varsovie), très probablement Étienne de La Hire, et Rubens recommanda Pieter Claesz Soutman, peintre hollandais né à Haarlem, qui fut nommé peintre de la cour royale, lui cependant, retourna à Haarlem en 1628. Tous les parents de Ladislas et d'autres monarques employèrent à leurs cours des peintres flamands et hollandais. Rubens a peint ses cousins espagnols, monarques de France et d'Angleterre, le peintre flamand Justus Sustermans a travaillé pour la famille Médicis à Florence et sa tante Marie-Madeleine d'Autriche (1589-1631), un autre peintre flamand, Frans Luycx, est devenu le principal portraitiste de la cour impériale de ses cousins à Vienne, Justus van Egmont, également flamand, travailla en France à la cour de sa cousine la reine Anne d'Autriche (1601-1666), Antoon van Dyck (Anthony van Dyck) en Angleterre, Karel van Mander III était actif à la cour royale danoise et de nombreux autres. Vers 1636-1637, dans le cadre des importants travaux de décoration des résidences royales en vue du mariage du roi, Ladislas employa Peter Danckers de Rij, qui était initialement actif à Gdańsk. Danckers de Rij est né à Amsterdam et y est probablement retourné pendant le déluge (1655-1660). Malgré ses qualités et sa richesse, comme dans le cas de sa grand-mère et de et la soeur de sa grand-mère Isabelle Jagellon, il n'a pas été facile de trouver un partenaire convenable pour Anna Catherine Constance Vasa (1619-1651), la sœur de Ladislas, qui a atteint l'âge adulte vers ce temps. Les dirigeants héréditaires d'Europe n'étaient pas intéressés à épouser une sœur du monarque électif. Après la mort de ses parents en 1631 et en 1632, le Parlement lui a accordé les comtés de Brodnica, Gołub et Tuchola. Les terres appartenaient auparavant à sa mère, mais Anna ne put exercer ses droits jusqu'à sa majorité en 1638. Frédéric-Guillaume, électeur de Brandebourg, et Gaston, duc d'Orléans (frère du roi Louis XIII de France), étaient parmi les candidats pour sa main. Malgré les accords de 1639 et 1642 pour l'épouser avec l'archiduc Ferdinand Charles d'Autriche-Tyrol (1628-1662), le mariage n'a jamais eu lieu, en raison de l'âge du marié qui avait 11 ans en 1639 et du désaccord sur le montant de sa dot. Le 8 juin 1642, à Varsovie, elle épousa Philippe Guillaume de Neubourg. Dans le château impérial de Nuremberg, il y a deux portraits déposés par le Germanisches Nationalmuseum (numéros d'inventaire NbgKbg.L-G0006, NbgKbg.L-G0007) qui, selon l'inscription en allemand sur le cadre, représentent l'empereur Léopold I (1640-1705) et son épouse Infante Marguerite Thérèse d'Espagne (1651-1673). Le costume d'homme, cependant, avec un pourpoint brodé surmonté d'un beau col de dentelle, une culotte assortie et une cadenette, est typique de la mode européenne des années 1630. Sa pose et les traits de son visage sont identiques à ceux visibles dans un portrait du prince Jean Casimir Vasa, frère de Ladislas IV, au château de Gripsholm en Suède et son portrait en miniature au Musée national bavarois, tous deux attribués à Peter Danckers de Rij. La femme du portrait en pendant, qui ne ressemble en rien aux effigies de l'infante Marguerite Thérèse, doit donc être sa seule sœur Anna Catherine Constance, car Jean Casimir n'était pas marié à cette époque (huile sur toile, 213 x 122 cm, Collection de peinture de l'État de Bavière 6996). Elle a été représentée dans une tenue démodée, une saya de style espagnol cramoisi et une grande fraise. Son visage et sa pose sont identiques à ceux du portrait du château d'Ambras à Innsbruck au Tyrol (probablement envoyé à l'archiduc Ferdinand Charles), identifié comme l'effigie de l'archiduchesse Cécile-Renée d'Autriche, reine de Pologne (Kunsthistorisches Museum de Vienne, GG 5611). Dans ce portrait, son costume est plus à la mode - en 1642, la reine Cécile-Renée a demandé à son jeune frère Léopold-Guillaume d'Autriche, par l'intermédiaire d'Estebanillo González qui s'est rendu à Varsovie la même année, de lui envoyer de la dentelle hollandaise et une poupée vêtue d'une tenue française à la mode. La reine et sa belle-sœur Anna Catherine Constance connaissaient bien les tendances de la mode. Cette femme ne ressemble en rien aux effigies de Cécile-Renée du château de Gripsholm (NMGrh 299, NMGrh 1417) et du Musée historique d'État à Moscou (И I 5922), peints par Peter Danckers de Rij. Elle tient un éventail oriental pliant dont le motif ressemble à une inscription en arabe, donc peut-être acquis à Venise, exactement comme dans les portraits de la grand-mère d'Anna Catherine Constance, Catherine Jagellon, par Moroni et Titien. La même femme a également été représentée dans une miniature du Château des Sforza à Milan (huile sur cuivre, 6 x 5 cm, numéro d'inventaire 863), également peinte dans le style de Peter Danckers de Rij. Ses somptueux vêtements et bijoux sont véritablement royaux, c'est pourquoi la miniature est parfois considérée comme représentant Élisabeth Stuart (1596-1662), reine de Bohême. L'œuvre fut offerte aux Collections Civiques en 1945 par Giorgio Nicodemi (1891-1967) qui, à son tour, avait reçu de la comtesse Lydia Morando Bolognini (d'après « Museo d'arte antica del Castello sforzesco: pinacoteca », tome 5, p. 332). Son costume est typique de l'Europe centrale, de l'Autriche et de la Bavière des années 1630, comme dans les portraits de Marie-Anne d'Autriche (1610-1665), électrice de Bavière, sœur de Cécile-Renée dans l'Alte Pinakothek de Munich d'environ 1635 ou dans le Kunsthistorisches Museum de Vienne d'environ 1643. Des costumes similaires sont également visibles dans les portraits d'Éva Forgách, épouse du comte István Csáky (1610-1639), daté « 1638 », au Musée national hongrois, la baronne Maria Laymann-Libenau, également daté « 1638 », au Musée régional de Ptuj Ormož, la comtesse Erzsébet Thurzó, épouse d'István Esterházy, daté « 1641 », au château de Forchtenstein ou sur la médaille d'argent avec le buste d'Anna Leszczyńska née Radzimińska de 1614 au Musée national de Lublin. Elle a également été représentée dans un portrait, également très dans le style de Danckers de Rij, bien qu'attribué à Govert Flinck, de la collection privée française (huile sur toile, 60 x 73 cm, vendue chez Vanderkindere à Bruxelles, 23 mars 2021, lot 67). Ce tableau représente « Vénus allongée » inspirée de la Vénus d'Urbino dans la Galerie des Offices à Florence, qui est un portrait d'une sœur de la grand-mère d'Anna Catherine Constance, Isabelle Jagellon. Une œuvre peinte dans un style très similaire se trouve au Musée national de Varsovie (huile sur toile, 91,5 x 130,5 cm, M.Ob.945, antérieur 215 Tc/70, 302/2/73). Il représente Cupidon endormi et provient de la collection d'Eugenia Kierbedziowa (1855-1946), décédée à Rome. Elle a légué le tableau en 1943 et il est entré au musée après la Seconde Guerre mondiale en 1970. La provenance antérieure est inconnue, on a donc supposé que Kierbedziowa l'avait probablement acquis en Italie et comparé à certaines œuvres de Francesco Albani ou de son entourage, comme Cupidon désarmée par les nymphes au Louvre (INV 34 ; MR 1607) ou le Triomphe de Diane (L'Hiver) à la Galerie Borghèse à Rome (numéro d'inventaire 049). Il est cependant fort possible qu'Eugenia, exilée en Italie à partir de 1909, ait acquis ce tableau plus tôt en Lituanie, à Varsovie ou à Saint-Pétersbourg, où elle est née. Cupidon était le dieu du désir, de l'amour érotique, de l'attraction et de l'affection et le fils de la déesse de l'amour Vénus et du dieu de la guerre Mars. La comparaison avec les œuvres mentionnées d'Albani et d'autres de ses putti est très générale, tandis que le style du tableau ressemble à une œuvre signée et datée de Danckerts de Rij - portrait de la reine Cécile-Renée au Musée national de Stockholm (Peter. Danckers fecit A:o 1643, NMGrh 299). La reine se tient dans une loggia du palais Villa Regia à Varsovie et en arrière-plan se trouve une fontaine avec une statue de Cupidon sur un dauphin.
Miniature de la princesse Anna Catherine Constance Vasa (1619-1651) par Peter Danckers de Rij, vers 1638, Château des Sforza à Milan.
Portrait de la princesse Anna Catherine Constance Vasa (1619-1651) avec un chien par Peter Danckers de Rij, vers 1638, Château impérial de Nuremberg.
Portrait de la princesse Anna Catherine Constance Vasa (1619-1651) nue par Peter Danckers de Rij, vers 1638-1642, Collection particulière.
Cupidon endormi par Peter Danckerts de Rij, vers 1640, Musée national de Varsovie.
Portraits d'Anna Catherine Constance Vasa en Danaé par des peintres italiens
La Villa Regia, qui signifie Villa Royale en latin, était la résidence de loisirs du roi élu Ladislas IV Vasa à Varsovie. Ce splendide palais, inspiré de la Villa Poggio Reale de Naples, a probablement été construit entre 1634 et 1641 selon les plans attribués à l'architecte italien Giovanni Trevano. Le roi, mécène renommé, l'emplit des œuvres d'art les plus raffinées réalisées par les artistes de sa cour, tels que Bartholomeus Strobel, Peter Danckerts de Rij et Giacinto Campana, et commandées à l'étranger, en Italie, en Flandre, aux Pays-Bas, en Allemagne, en Perse et en Turquie.
Les descriptions détaillées ou les inventaires du palais n'ont pas survécu. Mais il y avait sans aucun doute des œuvres de Peter Paul Rubens, Jan Brueghel l'Ancien, Peter Snayers, Daniel Seghers, Jacob Jordaens, Pieter Claesz Soutman, Frans Luycx, Justus van Egmont, Rembrandt, Guercino et Guido Reni, car leurs ateliers étaient visités par Ladislas lors de son voyage entre 1624-1625 ou les acquisitions de leurs peintures sont confirmées dans d'autres documents. Saint François en extase, peut-être par Guido Reni, a été décrit dans la chapelle de Villa Regia dans la « Brève description de Varsovie » d'Adam Jarzębski de 1643 (vers 1971-1976). Les sculptures étaient également très probablement toutes importées, y compris des sculptures anciennes comme le Pseudo-Sénèque de la collection de Ladislas, sculpté au IIe siècle (Collection archéologique de l'Université de Zurich). Les statues en bronze du soi-disant « jardin secret » (giardino secreto) ont très probablement été coulées par Adriaen de Vries à Prague, car leurs descriptions dans le poème d'Adam Jarzębski correspondent parfaitement à certaines statues du palais de Drottningholm en Suède. Des bustes en marbre de Jean II Casimir Vasa et de Marie-Louise de Gonzague, créés vers 1651 par le sculpteur romain Giovanni Francesco Rossi (Musée national de Stockholm), ornaient très probablement la salle de marbre du palais. Lors du déluge, les envahisseurs ont non seulement pillé tous les meubles, tableaux, sculptures, tapisseries et argenterie, mais ont également dévasté les intérieurs. Pierre des Noyers, secrétaire de la reine Marie-Louise, dans une lettre datée du 8 novembre 1655 de Głogów, décrit la dévastation des trois palais royaux (Château royal, Ujazdów et Villa Regia), notamment le pillage du dallage en marbre, destruction d'une colonnade composée de 32 belles colonnes de marbre et que le roi de Suède a même pillé les fenêtres (« Quant au roi de Suède [...] il n'a pas laissé, nonobstant cela, de faire dépaver les trois palais, et emporté ce pavé qui est de marbre; de faire rompre une loge qui était dans le jardin, composée de 32 belles colonnes de marbre qu'on a rompues en les défaisant. Ce n'est pas tout; il fait emporter les croisées et les vitres; ce ménage là m'a surpris »). Dans une lettre datée du 1er juin 1656 de Głogów, il ajoute que : « Dans une lettre que j'ai reçue de Varsovie, on me dit l'horrible dégat que les Suédois y ont faits; ils y ont brûlé la ville neuve et tous les faubourgs où étaient tous les palais; mais ce qui est de plus enragé, c'est qu'ils n'ont pas voulu permettre aux habitants de rien tirer de leurs maisons, de sorte que des gens qui étaient riches sont à l'aumône » (d'après « Lettres de Pierre Des Noyers ... », publiées en 1859, p. 10-11, 175). Les voleurs transportaient leur butin sur des barges destinées au transport des céréales. Certaines barges surchargées de lourds marbres ont coulé peu après avoir quitté Varsovie et le faible niveau de la Vistule en 2011, 2012 et 2015 les a révélées, notamment des éléments de la loggia en marbre de la Villa Regia. Le souvenir du splendide temple des arts de Sarmatie était encore vif après le déluge. Ainsi, lorsque la République renaît pendant la période Sobieski (1674-1696), le roi nouvellement élu (roi victorieux) Jean III Sobieski décide de la recréer en fondant sa Villa Nova, c'est-à-dire la Nouvelle Villa (Palais de Wilanów) à Varsovie. Ce palais a été créé par un architecte polono-italien Augustyn Wincenty Locci et partiellement inspiré de la Villa Doria Pamphili à Rome. Le peintre de la cour Jerzy Siemiginowski-Eleuter, formé à Rome, a créé de nombreuses peintures, notamment des peintures au plafond avec des portraits déguisés de l'épouse du roi, la reine Marie Casimire Louise de La Grange d'Arquien (1641-1716), également connue sous le diminutif « Marysieńka » Sobieska, arrivée de France dans la République alors qu'elle était enfant en tant que dame de la cour de Marie-Louise de Gonzague. La reine du royaume de Vénus était représentée comme Aurore-Astrée à moitié nue dans la chambre du roi et dans la chambre du miroir de la reine. Dans son portrait réalisé autour de son couronnement en 1676 par l'atelier de Daniel Schultz, peintre de la cour royale (Château royal de Varsovie, ZKW/65), la reine exhibe fièrement ses bijoux : une couronne et un sceptre royaux, d'énormes perles, des rubis (ou grenats) et diamants, ainsi qu'un mamelon. Plusieurs décennies plus tard, une autre femme influente qui a agrandi et reconstruit le palais, Elżbieta Sieniawska (1669-1729), a été représentée comme Flore à moitié nue, déesse romaine des fleurs et de la fertilité, dans une fresque de Giuseppe Rossi, peint entre 1726-1729 dans le vestibule inférieur du palais. Les principales peintures de Villa Nova ont été créées dans les Pays-Bas protestants - il y avait plusieurs peintures de Rembrandt, ainsi que des peintres flamands Antoine van Dyck et Jan van Kessel l'Ancien et très probablement des copies ou des originaux de Raphaël, des frères Caracci, de Guido Reni et Bernardo Strozzi. L'inventaire du palais de 1696 décrit des peintures qui peuvent être des originaux ou des copies de La Lettre d'amour (n° 156.) et de La Laitière (n° 180.) de Johannes Vermeer. Le palais était rempli de grandes quantités d'argenterie fabriquées à Paris et à Augsbourg, notamment une fontaine en argent à trois niveaux et un dais en soie dans la chambre du roi offert par le chah de Perse. Des sculptures furent commandées en Flandre à l'atelier d'Artus Quellinus II et de son fils Thomas II et des bustes aux Pays-Bas à l'atelier de Bartholomeus Eggers, dont les bustes du couple royal (Jardin d'été de Saint-Pétersbourg, pillés en 1707). Le jardin était décoré de sculptures en plomb doré réalisées à Gdańsk par Gaspar Richter et de vases sculptés en marbre cerise de Chęciny. Cela donne également une idée de la beauté de Villa Regia. Des poèmes érotiques, comme le poème en 12 parties « Les leçons de Cupidon » (Lekcyje Kupidynowe), avec lequel Kasper Twardowski fit ses débuts en 1617 ou bien d'autres compilés en 1675 par Jakub Teodor Trembecki, prouvent que la République n'était pas si prude, surtout avant le déluge, comme certains auteurs veulent le voir. Au Musée national de Stockholm se trouve un tableau de Danaé et la pluie d'or (huile sur toile, 111 x 150 cm, NM 1568), autrefois attribué à Giuseppe Salviati (1520-1575), également connu sous le nom de Giuseppe Porta. Le style général du tableau, des rideaux et de la table indique qu'il s'agit plutôt d'une peinture baroque et non de la fin de la Renaissance. Le style est vénitien, proche du Titien et inspiré de sa « Vénus d'Urbino », qui est un portrait de la sœur de la grand-mère d'Anna Catherine Constance - Isabelle Jagellon. Le tableau reproduit presque directement l'effigie nue similaire de la sœur de Ladislas IV par Peter Danckers de Rij de la collection privée en France (vendue chez Vanderkindere à Bruxelles, le 23 mars 2021, lot 67), identifiée par mes soins. Le tableau provient de la collection du comte Magnus Gabriel De la Gardie (1622-1686), probablement offerte par la reine Christine de Suède. Selon le catalogue de l'exposition de 1966 « Christina, Queen of Sweden - a Personality of European Civilisation », le tableau a été pillé par les forces suédoises du général Hans Christoff von Königsmarck à Prague en 1648 (p. 479). Les auteurs déterminent la provenance sur les mentions suivantes dans l'inventaire des collections impériales en 1621 : « Danaé et la pluie d'or de Hans von Aachen » (Danaae mit dem güldenen regen vom Hansen von Acha., n° 1021) (d'après « Das Inventar der Prager Schatz- und Kunstkammer vom 6. Dezember 1621 ...» par Heinrich Zimmermann, p. XLII) et inventaire de 1652 de la collection de la reine Christine : « Dito, representant une femme nue » (n° 190) ou « Dito, une femme eschevellée, sur de la toile » (n° 300). De telles références ne permettent pas de la déterminer avec certitude. Si le tableau vient de Prague, les Habsbourg ont probablement reçu le portrait de leur parente de Pologne-Lituanie sous un déguisement mythologique. Il est également possible qu'il ait été pillé par De la Gardie pendant le déluge, lorsqu'avec 9 000 soldats il pilla les domaines de la princesse en Prusse polonaise. Danaé était la fille et l'unique enfant du roi Acrisius d'Argos et mère du héros Persée par Jupiter, roi des dieux, qui lui vint sous la forme d'une pluie d'or. John Ridewall (Johannes Ridovalensis), moine franciscain anglais du XIVe siècle, dans son Fulgentius Metaforalis, interpréta Danaé comme une préfiguration de la Vierge Marie, car elle aussi conçut de manière virginale (Si Danae auri pluvia a Iove pregnans claret, cur Spiritu Sancto gravida Virgo non generaret?). Elle devint également un symbole de pudeur - Pudicitia et on lui attribua parfois la couleur bleue de la Vierge Marie comme dans le tableau de 1527 de Jan Gossaert (Alte Pinakothek de Munich, 38) ou dans la miniature de Danaé-Pudicitia dans le Fulgentius Metaforalis du Vatican d'environ 1420 (comparer « Art and Literature: Studies in Relationship » de William Sebastian Heckscher, Egon Verheyen, p. 170). Danaé est également représentée dans le portrait du frère de la princesse, le roi Ladislas IV Vasa, peint par Peter Danckerts de Rij vers 1640 (Alte Pinakothek de Munich, 6959). Il se tient dans la galerie de son palais, très probablement Villa Regia, et la frise peinte au-dessus de l'arcade est ornée d'une fresque représentant Danaé nue. Le fait que cette fresque ait été sélectionnée dans le portait indique qu'elle était probablement la plus importante ou la plus significative lors de la création de l'effigie du roi. Danaë et la pluie d'or comme talisman d'une jeune femme célibataire sont visibles dans plusieurs portraits de tantes de la princesse Anna Catherine Constance par Martin Kober au Germanisches Nationalmuseum de Nuremberg et à l'Alte Pinakothek de Munich, très probablement de la dot de la princesse et initialement de la dot de sa mère. De telles représentations de nus sous un déguisement mythologique n'étaient pas une nouveauté dans les années 1630, lorsque la peinture de Stockholm a probablement été créée. Parmi les plus anciennes, on trouve de nombreuses représentations de Diane de Poitiers, maîtresse du roi Henri II de France, par exemple son portrait en déesse Diane au repos par l'École de Fontainebleau, réalisé vers le milieu du XVIe siècle, aux Musées de Senlis (D.V. 2006.0.30.1) ou comme Vénus dans la fresque de la Tour de la Ligue du château de Tanlay, créée après 1568. En 1634, Rembrandt réalise une estampe avec une représentation très audacieuse de la scène biblique de Joseph et la femme de Putiphar (Rijksmuseum Amsterdam, RP-P-1961-999, de nombreux auteurs affirment qu'il a principalement peint sa femme Saskia, alors ici ils ont probablement raison) et plus tard, vers 1660, Sir Peter Lely créa probablement le seul portrait entièrement nu peint en Angleterre à ce siècle - portrait d'Elizabeth Trentham (1640-1713), vicomtesse Cullen, en Vénus (huile sur toile, 129 x 196 cm, vendu chez Sotheby's Londres, 15 février 2018, lot 55). Une image nue de la reine d'Angleterre est répertoriée dans l'inventaire du palais de Wilanów de 1696 sous le titre « Portrait de la reine d'Angleterre tête nue et déshabillée, dans un cadre modeste » (Kontrfekt Krolowey Angielskiey z gołą głową bez Stroju spodem ramka prosta, n° 289., à Marywil). Cet inventaire mentionne également « L'image de Daphna [Danaé], vers laquelle Jupiter descend sous une pluie d'or, dans des cadres noirs » (Obraz Dafny, do ktorey się Iupiter w złotym deszczu spuszcza, wramach czarnych, n° 95) dans le Cabinet néerlandais du roi, donc très probablement peint par un peintre hollandais. Les deux tableaux provenaient très probablement de collections royales plus anciennes, peut-être même de la Villa Regia (en 1655, le couple royal réussit à évacuer une petite partie de ses collections en Silésie). L'inventaire de 1696 de Villa Nova répertorie également « Une peinture d'Hélène [Henriette-Marie de France], reine d'Angleterre, dans des cadres dorés » (Obraz Heleny Krolowey Angielskiey wramkach złocistych, n° 122) (d'après « Inwentarz Generalny 1696 z opracowaniem » de Anna Kwiatkowska). L'adéquation de ce registre est généralement assez juste, c'est pourquoi la reine d'Angleterre s'est fait représenter nue, très probablement par van Dyck, spécialement pour les monarques du Royaume de Vénus - Sarmatie. L'indication de paternité du tableau de Stockholm donne une comparaison avec un tableau représentant Salomé avec la tête de saint Jean-Baptiste et des serviteurs, attribué à Alessandro Varotari (1588-1649), dit Il Padovanino (huile sur toile, 95,5 x 85,5 cm, vendu à la Casa d'Aste Babuino à Rome, le 18 juillet 2023, lot 169). Ce tableau est une copie de la Hérodiade de Raczyński du Titien, représentant la reine Catherine d'Autriche (1533-1572) comme la Salomé biblique, identifiée par moi. La manière dont les mains, les draperies et le visage de la vieille femme ont été peints sont très semblables. Varotari était actif à Venise à partir de 1614, où il quitta Padoue. De 1615 à 1639, il fut membre de la guilde des peintres vénitiens (Fraglia dei pittori) et fut fréquemment assisté par sa sœur Chiara Varotari (1584-1663). Le tableau présente certaines similitudes avec le portrait de dame, attribué à Chiara, conservé à la Galerie nationale finlandaise (A I 558). Qui sait, peut-être que tous deux ont visité la Pologne-Lituanie vers 1639. Une autre Danaé similaire avec Cupidon endormi a été vendue à Munich où de nombreux objets apportés par Anna Catherine Constance Vasa en Bavière sont conservés dans la Résidence de Munich (huile sur toile 119 x 179 cm, vendue chez Hampel, 22 septembre 2022, lot 313). Ce tableau est attribué à Giovanni Giacomo Sementi (1580-1640), élève de Denis Calvaert et Guido Reni, actif à Bologne et à Rome, où il trouva son mentor et admirateur en la personne du cardinal Maurice de Savoie (1593-1657), amateur d'art. Le professeur Daniele Benati suppose une collaboration avec le milanais Pier Francesco Cittadini, qui a travaillé à Rome dans les années 1630. Dans la seconde moitié des années 1630, les contacts de la cour royale polono-lituanienne avec l'Italie étaient intenses, comme en témoigne la lettre du roi Ladislas IV du 19 avril 1636 de Vilnius à Galilée demandant des lunettes pour un télescope. Dans une lettre datée du 11 juillet 1637 adressée au cardinal Barberini à Rome, le nonce Mario Filonardi (1594-1644) rapporte qu'à Varsovie les peintures et sculptures sont très demandées parce qu'elles sont « rares et chères » (rare e care). C'est pourquoi le nonce a même tenté, par l'intermédiaire de marchands italiens et de Gdańsk, de créer une liaison commerciale maritime permanente entre Gdańsk et Civitavecchia, près de Rome. Les navires de Gdańsk transporteraient des matières premières de Pologne, notamment de la cire, et des peintures et sculptures d'Italie (d'après « Z dziejów polskiego mecenatu ... » de Władysław Tomkiewicz, p. 41). A l'occasion du mariage du roi Carlo Possenti publia en 1638 à Bologne son « L'amitié de Vénus avec Diane » (L'Amicizia di Venere con Diana, Epitalamio per le Nozze reali di Polonia). Il doit y avoir de nombreuses représentations de la princesse par les peintres italiens. Ceux-ci ont probablement survécu en raison de leur nature érotique.
Portrait de la reine Catherine d'Autriche (1533-1572) en Hérodiade (ou Salomé) avec la tête de saint Jean-Baptiste et des serviteurs par Alessandro Varotari d'après Titien, deuxième quart du XVIIe siècle, Collection particulière.
Portrait de la princesse Anna Catherine Constance Vasa (1619-1651) en Danaé par Alessandro Varotari et sa sœur Chiara, vers 1638-1639, Musée national de Stockholm.
Portrait de la princesse Anna Catherine Constance Vasa (1619-1651) en Danaé par Giovanni Giacomo Sementi et Pier Francesco Cittadini, vers 1636-1640, Collection particulière.
Portraits de Ladislas IV Vasa, de son épouse et de sa sœur par Adolf Boy
« Que l'Hymen décore le palais, Voici, ils portent l'effigie de la Nymphe : Junon, Minerve, Vénus » (Hymen, decoretque palatia, Nymphæ Effigiem, ecce, ferunt Iuno, Minerva, Venus) est l'inscription en latin sous un tableau d'Adolf Boy placé sur la porte triomphale de Gdańsk en 1646 pour célébrer l'entrée cérémonielle de Marie-Louise de Gonzague le 11 février de la même année.
Ce tableau a été reproduit dans une estampe créée par le graveur hollandais Willem Hondius et représentait le jugement du roi Ladislas IV se voyant offrir le portrait de Marie-Louise, peint avec amour par Cupidon tenant une palette et recommandé par Junon, Vénus et Minerve en référence à la mythologie - Jugement de Pâris. Le tableau devait être vraiment magnifique car Hondius a clairement marqué l'auteur dans la partie inférieure droite du tableau - ABoy pinxit (Musée national de Varsovie, Gr.Pol.5091 MNW). Le deuxième grand arc de triomphe près de l'hôtel de ville était également décoré d'un tableau de Boy représentant le mariage du roi avec la princesse française, tous deux couronnés par une figure féminine ailée de Fama, la divinité de la renommée, et accompagnée d'un Amour agenouillé avec deux colombes (Gr.Pol.5090 MNW), également signé : ABoy pinxit. L'effigie de Marie-Louise dans cette composition était très probablement basée sur des peintures ou des dessins envoyés de Paris ou de Varsovie, car il est plutôt improbable que Boy se soit rendu dans la capitale française pour peindre la mariée. Le peintre a peut-être également participé à la décoration de deux autres arcs temporaires avec des statues mobiles d'Atlas et Hercule (Gr.Pol.12874 MNW) et d'Apollon et Diane (Bibliothèque nationale de Pologne, G.1518), puisqu'il est crédité comme l'auteur de la conception originale des estampes de Jeremias Falck Polonus. En 1649, Hondius immortalisa également dans une gravure une autre composition de Boy - Apothéose du roi Jean II Casimir Vasa, signée : Adolph Boy inventor (Bibliothèque nationale de Pologne, G.219/Sz.1). Vers 1650, Falck grava également six scènes des exploits d'Atlas et d'Hercule (Similitudines Emblematicæ), créées par Boy, signées du monogramme AB en ligature (Rijksmuseum Amsterdam, RP-P-2021-6074). Adolf ou Adolph Boy est né à Gdańsk en 1612, probablement le fils de Magnus Boy (1559-1632). Dans les années 1620-1626, il étudie la peinture avec Bartholomeus Milwitz. À partir de 1630, il fut membre de la guilde des peintres et à partir de 1636 maître, il reçut ensuite la citoyenneté de Gdańsk. Outre les Italiens Tommaso Dolabella et Giacinto Campana, le Silésien Bartholomeus Strobel, le Flamand Christian Melich, les Néerlandais Pieter Claesz. Soutman, Peter Danckerts de Rij et Gilles Schalken, les Polonais Krzysztof Gryniewski et Jakub Mieszkowski et deux autres peintres de Gdańsk Samuel Wegener et Daniel Schultz, il fut l'un des peintres de la cour royale qui se faisaient appeler « les peintres de Sa Majesté » (pictor S. R. M.). Comme Dolabella, Strobel et Gryniewski, pour lesquels les textes de privilèges servitoraux étaient conservés dans les archives de la Couronne, il disposait probablement aussi d'un servitorat royal formel. Toutes les œuvres peintes de Boy, y compris le cycle des douze Sibylles de l'ancien hôtel de ville de Gdańsk (provenant de la chapelle de la maison Fichtl), lui sont attribuées, car aucune œuvre signée du peintre n'a été conservée. Toutes ses œuvres sûres sont connues grâce aux gravures. Il peignait fréquemment des portraits et, outre le roi et la reine, il créait des effigies de Constantin Ferber III (1580-1654), maire et burgrave royal de Gdańsk (gravure de Jeremias Falck Polonus d'après un portrait original d'environ 1635 ou 1645, Bibliothèque nationale de Pologne, G.3057/I), Johannes Mochinger (1603-1652), professeur de rhétorique au gymnase académique de Gdańsk (gravure par Falck, d'après un portrait original d'environ 1646 ou 1656, G.57649/II) et Christian Schweikert, maire de Gdańsk (gravure par Johann Bensheimer de 1668, G.507/sz). En tant que peintre de la cour d'un mécène aussi renommé que le roi Ladislas IV, Boy devait être un peintre éminent, comparable à Strobel et Danckerts de Rij, qui créèrent également plusieurs effigies royales. Les gravures mentionnées pourraient donner une idée de son style. Alors que dans son imprimé Le Christ couronné d'épines (Bibliothèque nationale de Pologne, G.24580/Sz, signé : Ant. van dijck pinxit / J. falck fecit), réalisé entre 1639 et 1646, Falck tentait d'imiter le doux travail au pinceau d'Antoine van Dyck à travers des lignes croisées plus longues, dans les portraits de Ferber et Mochinger, il a utilisé plus de points et des lignes plus courtes, rendant les images légèrement irrégulières. Un portrait de vieillard très finement peint, attribué à Adolf Boy, aujourd'hui conservé au Musée de Gdańsk (huile sur toile, 114 x 87,5 cm, MMHG/S/129), donne la même impression. Le modèle est identifié comme étant le théologien et pasteur Aegidius Strauch (1632-1682), qui à partir de 1669 fut curé de l'église de la Sainte-Trinité et recteur du gymnase académique de Gdańsk, en raison de sa ressemblance étroite avec le portrait de Strauch, peint par Andreas Stech (élève de Boy), également reproduit dans une estampe d'Elias Hainzelmann. Cependant, si l'on considère l'inscription latine dans le coin supérieur droit comme originale et correcte, le modèle ne pourrait pas être Strauch, car l'homme est né en 1609 et avait 72 ans en 1681 (Jesus Christus / est Spes et vita mea / Ao 1609, Natus 1 Marty. / Ao 1681 Piet 1 Marty. / Ætatis 72.). Boy, décédé en 1682 ou 1683, fut actif jusqu'à la fin de ses jours puisqu'en 1680 il créa une vue signée de Gdańsk (d'après « Artificium extra ideam ...» de Maria Bartko, p. 34). Parmi les portraits royaux qui suivent la même convention et dont le style est très similaire au prétendu portrait de Strauch par Boy se trouve le portrait en pied de la reine Cécile-Renée d'Autriche au Nationalmuseum de Stockholm (huile sur toile, 218 x 138 cm, NMGrh 1417), portrait de son mari le roi Ladislas IV Vasa au Château royal de Varsovie (huile sur toile, 200 x 120 cm, ZKW 559 dép., dépôt du Musée national de Varsovie, 128758) et portrait de sa belle-sœur princesse Anna Catherine Constance Vasa au château d'Ambras (huile sur toile, 115 x 96,5 cm, GG 5611), identifié par mes soins. Le portrait de la reine est signé en latin dans le coin inférieur gauche (CÆCILIA RENATA REGINA / POLONIÆ ET SVECIÆ) tandis que la partie déclarant qu'elle est reine de Pologne et de Suède était partiellement recouverte d'un cadre, indiquant que la toile a été découpée. Il en était probablement de même pour le portrait de Ladislas, qui portait également une fausse inscription identifiant le modèle comme étant Gustave Adolphe, roi de Suède et attribué à Joachim von Sandrart (Gustavus Adolph / König von Schwed / Anno 1632 / Sandrart pinxit / Nürnberg). L'identification comme roi de Pologne aujourd'hui n'est pas contestée et l'attribution à Sandrart est rejetée (comparer « Portrait of Władysław IV from the Oval Gallery ...» de Monika Kuhnke, Jacek Żukowski, p. 61-67). Le portrait a été acheté à J. Jarocki en 1947 comme portrait de Ladislas IV et une autre version est conservée au Musée historique de Lviv (huile sur toile, 69 x 59 cm, Ж-645). Cet exemplaire provient de la collection de Władysław Łoziński, qui l'a acheté le 6 janvier 1912 chez l'antiquaire de Szymon Schwartz pour 370 couronnes. Bien qu'attribué à un peintre de la fin du XVIIIe siècle et inspiré d'un original perdu, le style de la peinture de Lviv est particulièrement proche des portraits de Christine Kiszczyna née Drutska-Sokolinska conservés au Musée national d'art de Vilnius (LNDM T 3990) et la reine Bona Sforza d'Aragona au Musée national de Lublin (S/Mal/609/ML), très probablement peints par Giacinto Campana. Les peintres de la cour avaient souvent besoin de coopérer et de copier les œuvres d'autres peintres, s'inspirant ainsi de leur style. Par exemple, pour son portrait de la reine Bona, peint pour la salle de marbre du château royal de Varsovie, Peter Danckerts de Rij a probablement copié une effigie de Cranach le Jeune. La grande diversité de la cour de Ladislas IV, la grande destruction et dispersion de leurs œuvres, ainsi que l'absence de signatures, sont un autre facteur entravant l'attribution de nombreuses œuvres d'art liées aux Vasa polono-lituaniens. Le portrait du roi à Varsovie et celui de la reine à Stockholm, ont des dimensions et une composition similaires, et ils ont évidemment été peints par le même peintre, il est donc possible qu'ils formaient à l'origine une paire ou qu'ils soient issus de la série des portraits royaux créées à la même époque. Dans le portrait de Varsovie, les couleurs pastel et la beauté du tableau contrastent fortement avec le manque d'idéalisation et la petite tête du roi, comme si le peintre opposait intentionnellement la beauté de son art, des bijoux et des tissus aux défauts du modèle. C'est devenu sa marque, comme on peut également le dire du portrait de l'épouse et de la sœur de Ladislas et d'autres œuvres similaires, comme les portraits d'Elżbieta (Halszka) Kazanowska née Słuszczanka (1619-1671) au chapeau solana (Musée national de Varsovie, 34661, perdu) et avec des myosotis (Musée national de Varsovie, M.Ob.2510), et le portrait d'Alexandre Louis Radziwill (1594-1654), grand maréchal de Lituanie (Palais de Nieborów, NB 974 MNW).
Portrait du roi Ladislas IV Vasa (1595-1648) par Giacinto Campana ou l'entourage, vers 1639-1642, Musée historique de Lviv.
Portrait du roi Ladislas IV Vasa (1595-1648) tenant une canne par Adolf Boy, vers 1639-1642, Château royal de Varsovie.
Portrait de la reine Cécile-Renée d'Autriche (1611-1644) tenant un éventail par Adolf Boy, vers 1639-1642, Nationalmuseum de Stockholm.
Portrait de la princesse Anna Catherine Constance Vasa (1619-1651) tenant un éventail par Adolf Boy, vers 1639-1642, Château d'Ambras à Innsbruck.
Portrait d'un vieil homme, peut-être le pasteur Aegidius Strauch (1632-1682) par Adolf Boy, vers 1681, Musée de Gdańsk.
Portraits du prince Jean Casimir Vasa
« Ses œuvres et célèbres témoignages d'artisanat [artis praeclara specimina] créés dans Notre royaume […], à tous ceux qui se sont approchés, donnent une agréable sensation de beauté et d'ornement qui découle des surfaces peintes par lui. Avec cette lettre, Nous faisons lui un peintre à notre cour », a déclaré dans la lettre servitoriale émise en 1639 au peintre silésien Bartholomeus Strobel le roi Ladislas IV Vasa (d'après « Portrait of Władysław IV from the Oval Gallery ... » par Monika Kuhnke, Jacek Żukowski, p. 68). Le roi rencontra Strobel à Gdańsk à la fin de 1634. Au cours des années suivantes, l'artiste vécut et travailla alternativement à Gdańsk, Toruń et Elbląg, étant simultanément employé à la décoration de l'intérieur de la chapelle royale de Saint-Casimir à Vilnius (1636-37).
Le 25 juin 1635, face à une nouvelle guerre avec la Suède, le demi-frère du roi Jean Casimir Vasa arrive à Toruń. Sous le commandement de l'hetman Stanisław Koniecpolski, environ 24 000 soldats sélectionnés avec une forte artillerie étaient concentrés en Poméranie dans le camp près de Sztum. De là, le prince se rendit à Vienne pour le mariage de sa parente l'archiduchesse Marie-Anne d'Autriche (1610-1665), fille de l'empereur Ferdinand II, et de Maximilien Ier (1573-1651), duc de Bavière (15 juillet 1635). Il reçut sous ses ordres un régiment de cuirassiers et de volontaires polonais, avec lequel il partit sur le front de la guerre de Trente Ans en Alsace. Il retourna au pays après que Ladislas IV eut conclu la trêve à Sztumska Wieś le 12 septembre 1635. Lorsque malgré les promesses impériales, il ne reçut pas de principauté féodale, et que le Sejm ne lui accorda pas le duché de Courlande, il accepta la proposition de son cousin Philippe IV d'Espagne de devenir vice-roi du Portugal, où il devait recevoir un salaire annuel et se marier. Lors de ce voyage, il séjourne en France, où il a été arrêté sur ordre du cardinal de Richelieu, soupçonné d'espionnage pour l'Espagne. Il fut prisonnier du 10 mai 1638 à février 1640, date à laquelle il fut libéré après l'intervention de la légation polonaise venue à Paris. Après sa libération, il se rendit à Paris, où il rencontra la princesse Marie-Louise de Gonzague-Nevers, avec qui il eut une liaison. En 1641, Jean Casimir décide de devenir jésuite. En 1642, il quitta à nouveau la République polono-lituanienne, accompagnant sa sœur en Allemagne. En 1643, il rejoint les jésuites malgré l'opposition du roi Ladislas, provoquant une rupture diplomatique entre la Pologne et le pape. Jean Casimir devint cardinal, mais en décembre 1646, se trouvant indigne de la vie spirituelle, il démissionna de son poste de cardinal et retourna en Pologne. Après la mort de Cécile-Renée d'Autriche, première épouse de Ladislas IV en 1644, le cardinal Jules Mazarin insista pour que Marie-Louise épouse le souverain veuf afin de détruire l'alliance entre la dynastie polonaise Vasa et la dynastie Habsbourg, rivales de l'État français. Elle épousa Ladislas par procuration le 5 novembre 1645. Deux ans plus tard, le 20 mai 1648, Marie-Louise était veuve par la mort subite de Ladislas IV. Jean Casimir a finalement été élu prochain roi de Pologne par la noblesse et l'a épousée le 30 mai 1649. Dans l'Alte Pinakothek de Munich, il y a le portrait d'un jeune homme dans un pourpoint français à la mode datant d'environ 1635 (huile sur toile, 224,5 x 135,5 cm, numéro d'inventaire 6969). Il a été transféré en 1804 de la collection du château palatin de Neuburg an der Donau. Ce tableau est très similaire dans le style, la pose du modèle et le costume au portrait du roi Ladislas IV Vasa avec une couronne par Bartholomeus Strobel (attribué), qui était avant 1939 au Palais Sandomierski/Brühl à Varsovie et daté d'environ 1635, ainsi qu'au portrait de Władysław Dominik Zasławski-Ostrogski, également par Strobel, d'environ 1635 au Musée national d'art de Biélorussie à Minsk (une copie du tableau du palais de Wilanów à Varsovie). Un costume très similaire est également visible dans le portrait du prince Janusz Radziwill (1612-1655), peint par David Bailly en 1632 (Musée national de Wrocław). L'homme a une ressemblance frappante avec le portrait du prince Jean Casimir Vasa lorsqu'il était cardinal, créé par un peintre à Rome vers 1646 (Pontificia Università Gregoriana) et plusieurs gravures représentant Jean Casimir, lorsqu'il était le roi de Pologne (par Willem Hondius, publié à Gdańsk en 1648, par Hugo Allard l'Ancien, publié à Amsterdam après 1648 et par Philipp Kilian, publié à Augsbourg après 1648). Par conséquent, la peinture décrite du château de Neuburg provient sans aucun doute d'une dot d'Anna Catherine Constance Vasa (1619-1651), comtesse palatine de Neuburg et sœur de Jean Casimir Vasa. Un autre portrait, probablement aussi de la dot d'Anna Catherine Constance Vasa, se trouve aujourd'hui au château impérial de Nuremberg (dépôt du Germanisches Nationalmuseum, huile sur toile, 210 x 137 cm, NbgKbg.L-G0006 / 6784). Il a été précédemment identifié comme effigie de l'empereur Léopold Ier (1640-1705) et en tant que tel publié sous forme de chromolithographie par Jakob Heinrich von Hefner-Alteneck en 1879. Ce tableau est très similaire au portrait du prince Jean Casimir au château de Gripsholm en Suède, une miniature au Musée national bavarois et un autre portrait, qui se trouvait avant la Seconde Guerre mondiale au palais Herzog-Max-Burg à Munich (une aquarelle d'après l'original d'Aleksander Lesser du milieu du XIXe siècle se trouve au Musée national de Varsovie). Toutes ces peintures ont été réalisées par Peter Danckers de Rij et son atelier vers 1638 à l'occasion de la réception de l'Ordre de la Toison d'or des mains du roi Philippe IV d'Espagne, chef de l'ordre à partir de 1621. Le même homme figurait également sur un portrait de l'ancienne collection du palais des rois de France au Louvre (huile sur toile, 65,3 x 54,5 cm, INV 20345). Il est attribué à un peintre français et daté d'environ 1635-1640 en se basant sur le style et le costume du modèle. Le tableau a probablement été créé dans l'atelier de Philippe de Champaigne (1602-1674), qui à partir de 1628, lorsqu'il entra au service de la reine mère Marie de Médicis, était un peintre de la cour des rois de France. Le prince Jean Casimir était prisonnier et en tant que tel ne peut être représenté avec l'Ordre de la Toison d'or, car la France était à cette époque en guerre avec l'Espagne. Son costume et sa coiffure sont très similaires à ceux représentés sur la médaille d'argent avec son buste, réalisée avant 1638 (Musée de Varsovie, MHW 24241). Il est également possible que le portrait ait été créé par un peintre italien ou flamand et apporté par le prince avec lui en France, car Jean Casimir a voyagé dans de nombreux pays européens entre 1635 et 1638. La gravure intitulée en français L'Hyver avec Proserpine et Pluton par Jeremias Falck Polonus et Jean Leblond I (Museum Boijmans Van Beuningen), a été publiée entre 1639-1645. Proserpine et Pluton, qui l'ont enlevée aux enfers, sous les traits à la fois de Marie-Louise et de Jean Casimir est sans doute une allusion à l'affaire secrète de la reine et du prince. Graveur né à Gdańsk qui se faisait appeler Polonais (Polonus) a créé cette estampe à Paris, où il a déménagé en 1639. Fragment de quatre lignes de vers français à gauche, et leur traduction latine à droite, se lit « Pluton d'un feu secret brusle pour Proserpine ».
Portrait du roi Ladislas IV Vasa avec une couronne par Bartholomeus Strobel, vers 1635, Palais Sandomierski à Varsovie, perdu pendant la Seconde Guerre mondiale. Reconstruction virtuelle, © Marcin Latka
Portrait du prince Jean Casimir Vasa par Bartholomeus Strobel ou atelier, vers 1635, Alte Pinakothek à Munich.
Portrait du prince Jean Casimir Vasa par Peter Danckers de Rij, vers 1638, Château impérial de Nuremberg.
Portrait du prince Jean Casimir Vasa par l'atelier de Philippe de Champaigne (?), 1635-1640, Musée du Louvre.
L'Hyver avec Proserpine et Pluton par Jeremias Falck Polonus et Jean Leblond I, 1639-1645, Musée Boijmans Van Beuningen.⠀⠀⠀
Portraits d'Anna Catherine Constance Vasa et Cécile-Renée d'Autriche par Frans Luycx
« Dès que le roi entra dans le château et descendit de voiture, l'archiduc s'avança vers le roi jusqu'à l'escalier, et avec lui un distingué seigneur autrichien Meggau, chevalier à la toison d'or, qui était en grande faveur auprès de père de l'empereur. L'archiduc s'excusa auprès du roi que l'impératrice n'était pas descendue, et cela à cause de sa santé pendant qu'elle était enceinte. Alors l'impératrice descendit et s'arrêta au milieu de l'escalier, toute parée de perles. Le roi du voyage, mais il était aussi habillé cher, tout comme la reine et la princesse. Le roi s'adressa à l'impératrice en italien, qui le reçut agréablement et lui répondit brièvement en espagnol. Elle embrassa alors la reine très agréablement, et elle serra si fort la princesse que ses boucles d'oreilles en perles avec les boucles d'oreilles de la princesse se sont emmêlées qu'elles ont dû être arrachées », a rappelé le salut du roi Ladislas IV Vasa, de son épouse la reine Cécile-Renée d'Autriche et de sa sœur la princesse Anna Catherine Constance Vasa avec leur cousine l'impératrice Marie-Anne d'Espagne (1606-1646) à Vienne le 1er septembre 1638, Jakub Sobieski (1591-1646), voïvode de Belz, dans son Journal.
Ladislas est allé en Autriche pour se faire soigner de la goutte à Baden près de Vienne. Le roi et sa suite de 1 300 personnes, « qui ont besoin de plus pendant un mois que toute la cour impériale pendant six mois », selon Sobieski, sont partis de Varsovie le 5 août 1638. Connu pour son goût artistique, lors d'un voyage aux Pays-Bas et l'Italie en 1624-1625, il visita, entre autres, les ateliers de Peter Paul Rubens, Guido Reni et Guercino, Ladislas visita probablement l'atelier du principal portraitiste de la cour impériale, Frans Luycx, lors de sa visite à Vienne. Bien plus tôt pourtant, il avait remarqué le grand talent du peintre flamand, car les récits conservés à Stockholm confirment les contacts de Ladislas avec un peintre nommé Luix dès 1637. Très probablement en 1637, lorsqu'elle devient impératrice, Luycx crée une série de portrait de Marie-Anne d'Espagne qui ont été envoyés à ses proches. Deux très similaires se trouvent au monastère des Visitandines à Varsovie (huile sur toile, 196 x 145 cm) et au château de Gripsholm près de Stockholm (numéro d'inventaire NMGrh 1221), tous deux probablement initialement envoyés à Varsovie en cadeau au roi et à sa sœur, comme les deux tableaux identiques à Madrid (Musée du Prado, numéro d'inventaire P04169 et P001272). Probablement au cours de cette visite, Ladislas a commandé une série de ses effigies et des portraits de sa femme et de sa sœur. Le règlement de 1640 parle du paiement par l'agent polonais à Vienne à « Leic, peintre, pour trois effigies » (d'après « Obrazy z warsztatu Fransa Luycxa w kolekcji wilanowskiej » de Jacek Żukowski). Les portraits conservés du roi par Luycx se trouvent au Kunsthistorisches Museum de Vienne (huile sur toile, 203,5 x 140,5 cm, GG 7150), à la Alte Pinakothek de Munich et en version réduite au palais de Wilanów à Varsovie (huile sur toile, 106 x 86 cm, Wil.1143). Le portrait de Cécile-Renée d'Autriche se trouve également à Wilanów (pendant au portrait du roi, huile sur toile, 100,8 x 90 cm, Wil.1144) et à Vienne (inscription au dos en italien : LA REGINA CECILIA RENATA DI POLONIA 1642, numéro d'inventaire GG 8291). L'inventaire de la collection de Léopold-Guillaume d'Autriche de 1659 répertorie deux effigies de sa sœur la reine de Pologne par Luycx, l'une en tant qu'archiduchesse avec un perroquet (indianischer raab, numéro 813), la seconde en tant que reine avec une couronne et un sceptre sur une table (numéro 811), tous deux probablement perdus. À leur tour, Cécile-Renée et le roi de Pologne possédaient également sans doute des portraits de Léopold-Guillaume de cette période et une miniature du musée Czartoryski de Cracovie (huile sur cuivre, 5,4 x 4,3 cm, XII-71), peints dans le style de Luycx et similaires au portrait de l'archiduc du Kunsthistorisches Museum (GG 2754) et son portrait en pied par Luycx dans le château de Gripsholm (NMGrh 1876), peuvent être considérés comme tels. Comme à Vienne ou à Madrid, de nombreuses œuvres de Luycx se trouvaient sans aucun doute dans les collections royales et grand-ducales polono-lituaniennes, mais avant la Seconde Guerre mondiale, à Varsovie, il n'y en avait que deux qui pouvaient être considérées comme appartenant au maître lui-même - le portrait mentionné de l'impératrice Marie-Anne et portrait du roi Ladislas IV, achetés cependant en 1936 à Vienne. Le portrait du roi fut conservé jusqu'en 1945 au palais de Brühl (Sandomierski) à Varsovie et fut perdu pendant la guerre (huile sur toile, 202 x 140 cm). Luycx et son atelier ont dû réaliser de multiples versions de cette effigie du roi car l'inventaire de la galerie impériale de Prague datant de 1718 mentionne un portrait de Ladislas IV par Luycx en « bottes blanches » (weiszen stiefeln). Le portrait de Prague mesurait environ 251 x 144 cm, il était donc plus grand que ceux de Vienne (qui est désormais considéré comme ce tableau de Prague) et de Varsovie, probablement coupé dans la partie supérieure, et comparable au tableau de Munich (Alte Pinakothek, huile sur toile, 250 x 160 cm, 4197, inscription : VLADISLAVS IIII. REX POLONIÆ). Le tableau munichois provient du château de Neubourg et appartenait donc probablement à l'origine à la dot de la sœur du roi Anna Catherine Constance. Le portrait en miniature d'une femme attribué au peintre espagnol au Victoria and Albert Museum de Londres (huile sur cuivre, 5,7 x 5,1 cm, P.57-1929) est stylistiquement très similaire à la miniature décrite de l'archiduc Léopold-Guillaume au musée Czartoryski. La femme ressemble beaucoup aux portraits de la sœur de l'archiduc, Cécile-Renée, notamment le portrait mentionné à Vienne par l'atelier de Frans Luycx (GG 8291). Les éléments de style espagnol de sa tenue, comme les boucles d'oreilles, peuvent être l'influence de l'entourage espagnol de sa belle-sœur, l'impératrice Marie-Anne d'Espagne. L'archiduc Léopold-Guillaume possédait également un portrait de la princesse Anna Catherine Constance décrit dans l'inventaire de sa collection sous le numéro 812 : « Une effigie grandeur nature à l'huile sur toile de la princesse de Pologne, qui était mariée au duc de Neubourg, cadre lisse noir, 11 pieds 3 doigts de haut et 7 pieds de large. Par Francisco Leüx Original » (Ein Contrafait lebensgrosz von Öhlfarb auf Leinwaeth der Princessin ausz Pohlen, welche mit dem Herzogen von Neüburg verheürath gewest. In einer schwartz glatten Ramen, hoch 11 Spann 3 Finger unndt 7 Spann braith. Von Francisco Leüx Original). Le portrait en pied de Frans Luycx au Kunsthistorisches Museum de Vienne (huile sur toile, 222 x 111 cm, GG 1732) est identifié comme l'effigie de la reine Cécile-Renée, cependant, comme dans les portraits de Ladislas IV, l'impératrice Marie-Anne ou un portrait de Cécile-Renée mentionné dans l'inventaire de l'archiduc, il n'y a pas d'insigne (couronne et sceptre) dans ce portrait et la femme ne ressemble en rien aux autres effigies de la reine. Par contre la dame ressemble beaucoup aux effigies de la princesse Anna Catherine Constance, notamment son portrait en robe rouge au château d'Ambras. Cette image peut donc équivaloir à une inscription dans l'inventaire de l'archiduc. Une copie réduite de ce tableau de l'atelier de Luycx se trouve également au Kunsthistorisches Museum (huile sur toile, 90 x 50 cm, GG 7944).
Portrait du roi Ladislas IV Vasa (1595-1648) par Frans Luycx, vers 1638-1642, Kunsthistorisches Museum de Vienne.
Portrait du roi Ladislas IV Vasa (1595-1648) par Frans Luycx, vers 1638-1642, Palais Sandomierski à Varsovie, perdu.
Portrait du roi Ladislas IV Vasa (1595-1648) par Frans Luycx, vers 1638-1642, Alte Pinakothek de Munich.
Portrait du roi Ladislas IV Vasa (1595-1648) par l'atelier de Frans Luycx, vers 1638-1642, Palais de Wilanów à Varsovie.
Portrait de la reine Cécile-Renée d'Autriche (1611-1644) par l'atelier de Frans Luycx, vers 1638-1642, Palais de Wilanów à Varsovie.
Portrait de l'impératrice Marie-Anne d'Espagne (1606-1646) par Frans Luycx, vers 1638-1642, Monastère des Visitandines à Varsovie.
Portrait de la princesse Anna Catherine Constance Vasa (1619-1651) par Frans Luycx, 1638-1642, Kunsthistorisches Museum de Vienne.
Portrait de la princesse Anna Catherine Constance Vasa (1619-1651) par l'atelier de Frans Luycx, 1638-1642, Kunsthistorisches Museum de Vienne.
Portrait en miniature de la reine Cécile-Renée d'Autriche (1611-1644) par Frans Luycx, 1638-1642, Victoria and Albert Museum à Londres.
Portrait en miniature de l'archiduc Léopold-Guillaume d'Autriche (1614-1662) par Frans Luycx, 1638-1642, Musée Czartoryski à Cracovie.
Portraits d'Anna Catherine Constance Vasa et Cécile-Renée d'Autriche en Vénus Verticordia par Giacinto Campana
En 1625, lors de son séjour à Bologne, le prince Ladislas Sigismond Vasa visite les ateliers des peintres locaux, Guido Reni et Guercino. De ce voyage, il apporta en Pologne, outre des œuvres d'art achetées aux Pays-Bas et en Italie, des cadeaux précieux, notamment des peintures de maîtres italiens de la célèbre galerie de Mantoue, offertes par le prince Gonzaga. Devenu roi, il continue d'acheter des tableaux à l'étranger, principalement aux Pays-Bas, mais aussi en Italie, par l'intermédiaire de son secrétaire Virgilio Puccitelli, compositeur et chanteur castrat. C'est Puccitelli, qui acquit les services de plusieurs chanteurs à Venise pour le roi entre septembre 1638 et février 1640, qui apporta à Varsovie « L'Enlèvement d'Europe » de Guido Reni pour lequel le roi exprima sa gratitude dans une lettre à Reni datée de mars 3, 1640. « C'est pourquoi, nous vous rendons compte de tout cela et joignons l'expression de nos intentions les plus obligeantes, afin que vous sachiez combien en attendre et combien nous respectons votre brillant talent », écrit le roi. Ce tableau se trouve aujourd'hui à la National Gallery de Londres.
En 1637, Ladislas invita en Pologne Giacinto Campana de Bologne, qui travailla à la cour polonaise jusqu'en 1646 au moins. Recommandé par l'ancien nonce apostolique auprès de la République polono-lituanienne, l'évêque Antonio Santacroce (1599-1641) et le nouveau nonce Mario Filonardi (1594-1644), le peintre est venu à Varsovie de Rome via Venise au printemps 1637. Il fut employé pour décorer différentes résidences royales et la chapelle Saint Casimir de la cathédrale de Vilnius en juillet 1639, ainsi que, avec Giovanni Battista Gisleni et Christian Melich, dans des décorations de scène pour l'Opéra Royal de Varsovie et de Vilnius. Campana, formé d'abord avec Francesco Brizio, puis avec Francesco Albani, travaille comme assistant de Guido Reni et peint la copie de l'Enlèvement d'Hélène de Guido en 1631 pour le cardinal Bernardino Spada avec les retouches de son maître (Galleria Spada à Rome). Avant la Seconde Guerre mondiale au Bode-Museum de Berlin, il y avait la peinture du Miracle de nourrir la multitude, qui dans l'inventaire de la collection de Vincenzo Giustiniani de 1638 est attribuée à Campana (Un quadro grande col miracolo di Christo della distribuzione di cinque pani, e dui pesci dipinto in tela, alta palmi 12 lar. 7 -in circa di mano del Campana senza cornice). Deux peintures du Palazzo Malvezzi de 'Medici à Bologne représentant la Mort de saint Joseph et le Martyre de sainte Ursule provenant de l'Hôpital des petits bâtards (Ospedale dei Bastardini), lui sont également attribuées. En Pologne, l'œuvre qui pourrait être attribuée à l'entourage de Guido Reni est un portrait de Ladislas IV Vasa en cuirasse de la collection du château royal de Wawel à Cracovie, acheté en 2013 en Italie. C'est très probablement Campana qui a créé une copie de Cupidons combattant des putti de Guido Reni de la collection Czartoryski (numéro d'inventaire MNK XII-228). L'original de Reni, aujourd'hui dans la Galleria Doria Pamphilj à Rome, a été créé vers 1625. Parmi les autres œuvres pouvant être attribuées à Campana, citons la Tentation de saint Benoît (Saint Benoît se jetant dans le buisson épineux) conservée au Musée national d'art de Lituanie (huile sur toile, 145 x 173 cm, LNDM T 927), semblable à un tableau attribués à Felice Ficherelli à la Galerie nationale slovaque (O 5476) et deux tableaux du palais de Wilanów à Varsovie - La Nuit (huile sur toile, 166,5 x 219,5 cm, Wil.1060), inspirée de La Notte du Guerchin, et Sainte Marie-Madeleine (huile sur toile, 68,5 x 58 cm, Wil.1732), proche de certaines œuvres du Guerchin et de son atelier, comme Saint Jean-Baptiste (Musées du Vatican) ou Madeleine pénitente (Musées du Capitole). Cupidon tenant son arc, fragment de la plus grande composition de Campana représentant l'Enlèvement d'Hélène, se trouve aujourd'hui au palais de Nieborów (huile sur toile, 75 x 65 cm, NB 964). Il provient de la collection de la branche catholique de la famille Radziwill et est considéré comme une œuvre d'un peintre polonais du XIXe siècle. Campana utilisait évidemment fréquemment des modèles de composition d'autres peintres. Dans le palais royal de Wilanów, il y a un tableau intitulé Éducation de Cupidon (huile sur toile, 134 x 166 cm, Wil.1548), qui provient très probablement de l'ancienne collection du palais. Cette peinture est une copie de la Vénus bandant les yeux de l'Amour de Titien à la National Gallery of Art de Washington (avant que la peinture ne soit coupée), qui est un portrait de la reine Catherine d'Autriche (1533-1572) en Vénus Verticordia (qui change les coeurs). Il ne s'agit cependant pas d'une copie exacte, le peintre n'a fait qu'emprunter la composition, mais la femme représentée en Vénus est différente. Elle ressemble beaucoup aux effigies de la sœur de Ladislas IV, la princesse Anna Catherine Constance Vasa (1619-1651). Le style de ce tableau est très similaire au tableau susmentionné de la Mort de Saint Joseph de Giacinto Campana. Une composition très similaire, peinte dans le même style, se trouve au Kunsthistorisches Museum de Vienne. Comme dans la version de Varsovie, la femme a la poitrine découverte, mais son visage est également différent des deux peintures mentionnées, l'original de Titien et la copie du palais de Wilanów. Son image avec un nez allongé et crochu et de grandes lèvres est très similaire au portrait de la reine Cécile-Renée d'Autriche à Vienne (numéro d'inventaire 8291) et aux effigies gravées de la reine. Ce tableau, représentant Cécile-Renée en Vénus Verticordia, réalisé à Varsovie, fut donc envoyé aux parents de la reine à Vienne. Ce qui est intéressant Fortuna Virilis (ou son assistante), un aspect ou une manifestation de la déesse Fortuna, qui avait le pouvoir de dissimuler les imperfections physiques des femmes aux yeux des hommes et associée à Vénus Verticordia, a des traits similaires à la princesse et à la reine respectivement.
Allégorie avec portrait de la princesse Anna Catherine Constance Vasa (1619-1651) en Vénus Verticordia (qui change les coeurs) par Giacinto Campana, 1637-1642, Palais Wilanów à Varsovie.
Allégorie avec portrait de la reine Cécile-Renée d'Autriche (1611-1644) en Vénus Verticordia (qui change les coeurs) par Giacinto Campana, 1637-1642, Kunsthistorisches Museum de Vienne.
Cupidons combattant des putti par Giacinto Campana d'après Guido Reni, vers 1637-1650, Musée Czartoryski.
Cupidon tenant son arc par Giacinto Campana ou suiveur, après 1637, Palais de Nieborów.
Portrait de Ladislas IV Vasa dans une cuirasse par Simone Cantarini
L'opéra « Saint Alexius » (Il S. Alessio : dramma musicale : dall'eminentissimo, et reverendissimo signore card. Barberino, fatto rappresentare al serenissimo prencipe Alessandro Carlo di Polonia), joué le 19 janvier 1634 au Palazzo Canceleria de Rome, a été l'un des splendides événements honorant la visite du prince Alexandre Charles Vasa, demi-frère du roi élu Ladislas IV Vasa, lors du carnaval de la Ville éternelle. Cet opéra en trois actes a été composé par Stefano Landi en 1631 sur un livret de Giulio Rospigliosi (le futur pape Clément IX), et la scénographie est probablement l'œuvre de Gianlorenzo Bernini.
Elle fut suivie d'un autre événement splendide sur la Piazza Navona - la Fête Saracino ou Giostra del Saracino (joute ou tournoi « sarrasin »), organisée le 25 février 1634. Les célébrations furent préparées sous les auspices du cardinal Antonio Barberini le Jeune (1607-1671) ou Antonio Barberini iuniore pour le distinguer de son oncle Antonio Marcello Barberini (1569-1646). Les Barberini n'ont pas épargné d'argent pour honorer le prince polono-lituanien (la joute sarrasine a coûté la fabuleuse somme de 60 000 écus). Ils voulaient probablement montrer à l'hôte la splendeur de leur règne dans les États pontificaux ou même éclipser l'entrée solennelle de la légation de la République de Jerzy Ossoliński dans la Ville éternelle, qui a eu lieu quelques mois plus tôt, le 27 novembre 1633. Jan Sobieski, futur roi, rappela la mission d'Ossoliński auprès du pape Urbain VIII Barberini, estimant que Rome n'avait jamais rien vu de plus célèbre et de plus glorieux. Les peintres Andrea Sacchi (1599-1661) et Simone Cantarini (1612-1648), clients de la maison Barberini, exercèrent sans doute de nombreux emplois, tout comme l'amant d'Antonio Barberini le Jeune, le chanteur castrat Marc'Antonio Pasqualini (1614- 1691). La célèbre soprano, en tant que castrato en travesti, joua des rôles majeurs dans Sant'Alessio en 1631, 1632 et 1634, dont Sposa (l'épouse d'Alexius). Comme les revenus de la papauté provenant de la République étaient considérables, de bonnes relations avec la maison régnante de Pologne-Lituanie étaient importantes. Ossoliński a offert au pape de nombreux cadeaux précieux, notamment des tapisseries flamandes réalisées pour le roi Sigismond II Auguste. Les Barberini ont sans aucun doute également rendu la pareille en leur offrant des cadeaux, mais aujourd'hui, nous ne pouvons qu'imaginer combien de belles œuvres du baroque romain ont trouvé leur chemin vers la Pologne-Lituanie à cette époque. En octobre 1643, ils honorèrent également l'autre demi-frère du roi, le prince Jean Casimir Vasa (futur roi), qui décida de devenir cardinal. En 1641, Sacchi, qui décora l'église des Capucins de Rome et le palais Barberini pour le cardinal Antonio Barberini le Jeune, créa un magnifique portrait de Pasqualini couronné par le dieu nu de la musique et des arts Apollon. Cantarini est à son tour crédité de la création de plusieurs portraits d'Antonio le Jeune vers 1633. Les deux peintres sont fréquemment liés à Guido Reni (1575-1642), actif à Bologne dans les États pontificaux, dont Ladislas Vasa visita l'atelier en 1625. Vraisemblablement vers 1634 Cantarini rejoint l'atelier de Reni et vers 1639 retourne à Rome. Il existe en Pologne une belle allégorie de la peinture de Cantarini (Musée national de Varsovie, 126263), acquise en 1938 dans la collection Boschi de Bologne (un exemplaire se trouve à la Fondazione Cavallini Sgarbi). Un tableau de Cantarini est mentionné dans le catalogue des peintures de la collection Radziwll de 1835 : « 99. Vénus plaisante avec Cupidon, après avoir pris son arc, elle le tient ; Cupidon l'attrape avec impatience. - Peint sur cuivre » (d'après « Katalog galeryi obrazow sławnych mistrzów ... » d'Antoni Blank, p. 34). Des peintures proches du style de Cantarini et Sacchi se trouvaient avant la Seconde Guerre mondiale dans la collection du comte Juliusz Tarnowski dans le magnifique palais de la Renaissance de Sucha Beskidzka (huile sur toile, 99 x 74 cm). Ils étaient attribués à un autre élève de Reni Francesco Albani ou à son atelier et représentaient la Toilette de Vénus et la Toilette de Diane. Une autre œuvre proche de Cantarini se trouve dans l'ancien palais royal de Wilanów à Varsovie. Elle est attribuée à l'école bolognaise du XVIIe siècle et représente saint Sébastien (huile sur toile, 53 x 35 cm, Wil.1033). En plus d'être considéré comme le troisième saint patron de Rome, depuis la renaissance, ce saint est un symbole durable de l'expression des sentiments homosexuels et des « fantasmes homosexuels généralement réprimés » (d'après « Lesbian and Gay Writing » de Mark Lilly, p. 206). Le cardinal Antonio le Jeune possédait le Mariage mystique de sainte Catherine avec saint Sébastien du Corrège (Musée du Louvre, INV 41 ; MR 162), offert au cardinal Mazarin lors de son exil à Paris. Le jeune homme nu d'un dessin attribué à Cantarini (Metropolitan Museum of Art, 69.1), pourrait être une étude pour un portrait déguisé du cardinal Antonio en saint Jean-Baptiste ou en saint Sébastien, car il ressemble beaucoup aux effigies du cardinal de ce peintre. Le tableau de Wilanów est comparable au très sensuel Saint Sébastien et un ange de Cantarini, peint entre 1632 et 1648 (vendu chez Cambi Casa d'Aste à Gênes, 13 décembre 2019, lot 170), et à ses dessins - Saint Sébastien (Cornell College, Edward Sonnenschein Collection, 48) et Saint Sébastien nu couronné par un ange, étude pour une eau-forte (Nationalmuseum de Stockholm, NMH 1252/1863), tous deux datant de la fin des années 1630. Malheureusement, son histoire antérieure n'est pas connue, mais cela n'exclut pas que le tableau ait été transféré en Pologne avant le déluge (1655-1660). L'histoire de l'art dans la plupart des pays européens commémore le génie des artistes et la générosité de leurs mécènes. En Pologne, cependant, elle est souvent liée aux périodes les plus sombres de l’histoire de l’humanité et suscite parfois des controverses. Le merveilleux héritage du Royaume de Vénus a péri à chaque guerre et invasion. Les Italiens ont oublié depuis longtemps combien de profits leur apportaient un commerce fructueux avec la République et combien de portraits de monarques et d'aristocrates polono-lituaniens ils possédaient, comme le portrait d'un jeune homme en costume oriental, très probablement un noble ruthène (Pinacothèque Ambrosienne de Milan), identifié par moi. En raison de la destruction massive de leur patrimoine, les Sarmates ont également oublié combien leur culture doit à la lointaine Italie (notamment en matière de portrait). Lorsque la République s'est appauvrie après les guerres, l'afflux de nouveaux arrivants en provenance d'Italie a été stoppé et les membres de la communauté italienne qui ont survécu à l'invasion ont été rapidement polonisés, et même les noms de famille à consonance étrangère ont été transformés, effaçant les traces d'origine italienne. Par exemple, dans les registres municipaux de Lublin du XVIIe siècle, sont mentionnés des noms de famille tels que : Gilberti, Grimaldi, Mureni, Mineto, Negroni, Simi. Rudgier de Sacellis, son frère Daniel de Sacellis, Jerzy Cyboni, Krzysztof Cyboni, Michał Pelikan-Klimuntowicz (Climunta), Flawiusz Marchetti et Antoni Nosadyni étaient maires de Lublin. Il y avait des barbiers (Franciszek Grimaldi, Franciszek Raymundi), des médecins (Castelli), des peintres (Jakub Tebaldi) et des tailleurs de pierre (Florian Dydzudes de Saltre) italiens. Les Italiens étaient également engagés dans la pharmacie (Marian de Catane), l'orfèvrerie (Gilbertii Georgius) et la couture (Joanes Dziano Olsan) (d'après « Lublin w dziejach i kulturze Polski » de Tadeusz Radzik, p. 259). L'une de ces effigies royales oubliées depuis longtemps était le portrait du roi Ladislas IV Vasa avec l'Ordre de la Toison d'Or, portant une cuirasse et tenant le bâton. Le portrait a été acheté par le château royal de Wawel en Italie en 2013 auprès d'un collectionneur privé. Les influences de l'œuvre de Reni sont perceptibles, mais le style de ce tableau présente une ressemblance frappante avec celui du portrait du cardinal Antonio iuniore avec pentimento (image antérieure d'une jeune femme) visible sur la mozzetta du cardinal, peint par Simone Cantarini vers 1633 (vendu chez Sotheby's Londres, 4 juillet 1990, lot 74). Il ressemble également à d'autres portraits du cardinal de Cantarini (Palazzo Barberini à Rome, inv. 1068), ainsi qu'à l'Allégorie de la peinture mentionnée. Il est fort possible qu'Antonio, qui partageait avec Ladislas IV une passion pour l'art et l'opéra, ait commandé ce portrait ou reçu une copie d'un tableau envoyé en Pologne-Lituanie. Le style de l'effigie du demi-frère du roi, Jean Casimir, qui se trouve toujours à Rome à l'hospice polonais (huile sur toile, 98 x 73 cm), est très similaire. Il s'agit d'une copie ou d'une version d'un portrait de Jean Casimir en cardinal réalisé par l'atelier de Giovanni Antonio Galli, dit lo Spadarino (attribué par moi), aujourd'hui à l'Université pontificale grégorienne de Rome. Il porte une inscription latine dans la partie inférieure (CASIMIRVS SOC[ietatis] IESU S[anctae] R[omanae] E[cclesiae] CARDINALIS ET / POLONIE REX) et, avant la Seconde Guerre mondiale, ce tableau se trouvait dans l'église du Gesù (Il Gesù), prototype d'église jésuite, consacrée en 1584 (comparer « Kościół polski w Rzymie ... » de Józef Skrabski, p. 299). Cantarini et Spadarino se copiaient mutuellement leurs œuvres ou recevaient le même ensemble de dessins d'étude pour créer leurs peintures.
Portrait de Ladislas IV Vasa dans une cuirasse par Simone Cantarini, 1637-1644, Château royal de Wawel à Cracovie.
Portrait du prince-cardinal Jean Casimir Vasa (1609-1672) par Simone Cantarini, vers 1648, Hospice polonais à Rome.
Saint Sébastien de Simone Cantarini, années 1630, Palais de Wilanów à Varsovie.
La Toilette de Vénus d'Andrea Sacchi ou Simone Cantarini, années 1630, Château de Sucha Beskidzka, perdu.
La Toilette de Diane par Andrea Sacchi ou Simone Cantarini, années 1630, Château de Sucha Beskidzka, perdu.
Portrait du prince Christophe Radziwill tenant une canne par Govert Flinck
Après 1637, le prince Christophe II Radziwill (1585-1640), grand hetman de Lituanie transforma sa résidence principale, le château de Birzai, en une forteresse bastionnée de style hollandais. Ce palais fortifié, initialement de style italien (palazzo in fortezza), construit pour son père par l'architecte Franceso Mineto (Franciszek Minet) entre 1586-1589, fut détruit en 1625 par les troupes suédoises dirigées par le roi Gustave Adolphe. Les Suédois ont volé tous les biens et 60 canons. Lorsque le château fut restitué aux Radziwill en 1627, la structure fut gravement endommagée et ne pouvait plus être habitée. Christophe a donc construit un palais temporaire en bois à Birzai.
La reconstruction a été supervisée par Cornelius Keyzer de Vilnius, peut-être un parent du sculpteur et architecte néerlandais Hendrick de Keyser (1565-1621), et l'architecte principal était Cornelius Retenburg de Tartu (Dorpat). De nombreux matériaux pour les travaux de construction ont été importés, comme le ciment apporté via Riga, probablement des Pays-Bas, ainsi que les tuiles fabriquées à Haarlem (Keyser a insisté sur les tuiles harlimskie lors des travaux de reconstruction en 1612) (d'après « Jak Krzysztof Radziwiłł (1585–1640) dwory i zbory budował ...» de Jarosław Zawadzki, p. 28, 38, 41). Malheureusement, à l'automne 1655, la forteresse de Birzai tomba de nouveau aux mains des Suédois et après une nouvelle reconstruction après le déluge, en 1704 lors d'une autre invasion suédoise, les troupes du général Adam Ludwig Lewenhaupt (1659-1719) firent sauter le palais et la forteresse. L'hetman avait également plusieurs résidences à Vilnius. Le plus important et le plus ancien était le palais hérité par son neveu Boguslas (Christophe fut son tuteur jusqu'en 1636), connu plus tard sous le nom de palais de Boguslas. Il était situé à proximité du Palais des grands-gucs de Lituanie et de la cathédrale. En 1506, Nicolas II Radziwill (mort en 1509) fonda une église gothique dédiée à saint Georges et à Notre-Dame des Neiges à proximité du palais. Le beau-frère de Christophe, Janusz Kiszka (1586-1654), voïvode de Polotsk, avait également son manoir à proximité. Il est très significatif que le palais du duc de Birzai (Domus Jllmi Principis Radzivilli in Birze ducis) soit mentionné comme le premier (et non le palais des grands-ducs) dans la légende de la vue de Vilnius de Tomasz Makowski (Tomašas Makovskis), créé vers 1600, ainsi que l'emplacement de l'école calviniste (d'après « Książęcy splendor w stolicy ... » de Tadeusz Bernatowicz, p. 22). Les Radziwill achetaient de nombreux articles de luxe du monde entier dans le principal port du pays, Gdańsk, en Prusse polonaise. « Le registre des objets envoyés de Gdańsk à Vilnius par Szczęsny Żydowicz [Szczęsny le Juif] » (Rejestr rzeczy, które się ze Gdańska do Wilna posyłają przez Szczęsnego Żydowicza), juin 1620, énumère de nombreux objets de valeur acquis par eux, notamment : « Huit tableaux peints sur panneau ; Deux tableaux peints sur toile, parmi lesquels un portrait de Gabriel Bethlen [Prince de Transylvanie] [...] Trente-quatre verres à vin vénitiens ; Deux verres vénitiens avec couvercles [...] Cinq noyers indiens ; Table ronde espagnole en ébène et ivoire à damiers [...] Vins rouges français, un tonneau ; vins blancs français, un tonneau » (Obrazow na drzewie malowanych osm; Obrazow na plotnie malowanych dwa, Miedzy ktoremi conterfet Bethlem Gabore [...] Kieliszkow weneckich sztuk trzydziesci y cztery; Szklenic weneckich z nakrywkami dwie [...] Drzewa Indyiskie orzechowe sztuk pięc; Stoł okrągły Hebanowy y zwarcabami kością sadzony Hiszpansky [...] Wina Francuskie czyrwone beczka iedna; Wina Francuskie białe beczka iedna) (Archives centrales des documents historiques à Varsovie, AGAD 1/354/0/26/22). Les peintures ont probablement été réalisées aux Pays-Bas, en Flandre ou à Venise. D'anciens inventaires confirment également que leurs nombreuses demeures étaient remplies de nombreux tableaux, malheureusement les descriptions sont très générales et les noms des peintres ne sont pas mentionnés. Rien que dans le « Manoir en brique de Vilnius », environ 125 peintures ont été enregistrées dans les années 1621-1628. On sait cependant que dans l'une des pièces de Birzai, il y avait au plafond une peinture représentant la rencontre du prince Christophe avec Gustave Adolphe. La victoire antérieure de Christophe Radziwill et Jan Karol Chodkiewicz sur les Suédois en 1601 était illustrée par un grand tableau de la bataille de Kokenhausen, répertorié entre autres peintures (portraits, chasses, « cuisines ») dans le manoir de Koïdanov (aujourd'hui Dziarjynsk en Biélorussie) en 1627. De nombreux tableaux et portraits sont mentionnés dans le registre réalisé avant 1636 (AGAD 1/354/0/26/50), comme dans un hôtel particulier en brique à Vilnius - « Dans une salle à manger en bois, peintures sur les murs ... 19, Ci-contre dans la pièce, peintures ... 2 » (W Drzewnianej stołowej izbie nascianach obrazow ... 19, NAprzeciwko wpokoiu obrazow ... 2) ou des peintures du manoir de Vilnius de Janusz Radziwill (1579-1620) - « de l'alcôve deux grands tableaux ; de la grande maison des pièces deux grands tableaux ; différents portraits, dont le père de Madame Margrave Jean Georges [Électeur de Brandebourg] et roi d'Angleterre » (Z Alkowy obrazow dwa wielkich; Z wielkiej kamienice spokoiow obrazow wielkich dwa, Conterfetow Roznych, Toiest Conterfet ojca Xiezny jej mosci Margrafa Jana Jerzego i krola Angielskiego 3), ainsi que des miniatures de la maison Radziwill à Toruń - portrait de feu le prince Henri d'Angleterre (Henri-Frédéric, prince de Galles) dans un cadre en diamant, portrait de la princesse anglaise dans un cadre en diamant, portrait recto-verso de l'électeur de Saxe et de son épouse dans un cadre en diamant, portrait de l'électeur de Brandebourg et de son épouse dans un cadre en diamant, portrait de la princesse anglaise, portrait du roi et de la reine de France, portrait de princesse Radziwill (Anna Kiszczanka ?), femme de voïvode de Vilnius et portrait du roi d'Angleterre. Les reçus des bijoux inscrits dans ce registre sont signés par Daniel von der Rennen, très probablement un marchand néerlandais actif à Gdańsk (peut-être un parent de l'orfèvre de Gdańsk Peter van der Rennen). Inventaire du château de Niasvij en 1636 (AGAD 1/354/0/26/52), répertorie le portrait de l'hetman Jan Karol Chodkiewicz (mort en 1621), voïvode de Vilnius (Konterfert Pana Wileńskiego Chodkiewicza), portrait en pied du roi Sigismond III Vasa (Konterfet Zupełny Zygmunta Króla Je M polskiego) et autres portraits (Konterfetów Roznych). « J'espère que V.M.P. [Votre Majesté princière] enverra au Kunstkamer [cabinet d'art] de mon père un cadeau spécial », écrivit Janusz à son cousin Boguslas Radziwill, en lui envoyant « de l'art en argent », peut-être scythe, trouvé en Volhynie (et reçu du prince Vychnevetsky) pour évaluation par des antiquaires étrangers. Dans une autre lettre, Janusz le remercie pour un portrait envoyé de France. Au cours de ses voyages éducatifs, le prince Janusz informait son père des ouvrages militaires et autres nouveautés sur le marché de la librairie. Dans sa correspondance, il informa Christophe II de l'intention d'imprimer à Anvers l'ouvrage Icones et elogia illustrorum virorum, qui devait comprendre des biographies de magnats polonais. Il a demandé qu'on lui envoie des portraits de son grand-père, de son oncle et de son père, car il n'avait avec lui que l'image de « l'orphelin » (Nicolas Christophe Radziwill). Il a ajouté qu'à cet égard, « les coûts ne devraient pas être évalués ». Le prince Christophe a également demandé aux tuteurs de veiller à ce que des portraits de Janusz soient réalisés lors des voyages de son fils à l'étranger - « dans le costume qui lui convient le mieux, envoyez-le-moi » (w habicie, który mu będzie naprzystojniejszy, przysyłać mi), tandis que Janusz a remercié son cousin pour son portrait « parce que de cette effigie j'ai pris le modèle du costume français actuel » (bom z niego modeliusz wziął teraźniejszego stroju francuskiego) (d'après « Książka i literatura … » de Mariola Jarczykowa, p. 24-28, 32, 34-36, 47). Lors de son séjour aux Pays-Bas, Boguslas noue des relations avec Lucas Vorsterman, graveur anversois issu du cercle de Rubens et van Dyck, qui accompagna Radziwill pendant la guerre de 1640/41 et peignit ensuite son portrait. A Anvers, Boguslas entre en contact avec un peintre et marchand d'art - Matthijs Musson, élève de Rubens. Il est confirmé qu'en 1646 Musson livra de nombreuses œuvres d'art au prince à Amsterdam, dont deux tableaux pour 63 florins et une copie de l'Assomption de la Vierge Marie de Rubens pour 80 florins. En 1645-1647, van den Wouwer, cousin de Musson, propriétaire de la « Galerie des antiquités », livra au prince 6 tableaux avec des chasses pour 56 florins chacun (d'après « Galerie obrazów i "Gabinety Sztuki" Radziwiłłów w XVII w. » de Teresa Sulerzyska, p. 88-89, 91). L'inventaire des tableaux de la collection de la princesse Louise Charlotte Radziwill (1667-1695), arrière-petite-fille de Christophe, dressé en 1671, recense 5 tableaux qui pourraient être des effigies de l'hetman à différents âges (29/9, 35/5, 38/8, 85/4, 86/5) et un dessin avec « Les funérailles du prince Christophe » (876/6) (d'après « Inwentarz galerii obrazów Radziwiłłów z XVII w. » de Teresa Sulerzyska). L'inventaire comprend également un tableau des « Nymphes endormies en chassant » (350/3), tandis qu'un dessin représentant des femmes endormies, étant une étude pour « Le reste de Diane et ses nymphes » de Pierre Paul Rubens (figures) et Jan Brueghel l'Ancien (paysage et animaux), est visible dans la nature morte attribuée à Abraham Susenier (Agnes Etherington Art Centre). La personne qui a commandé la nature morte possédait le dessin d'étude pour les portraits de Rembrandt, ce mécène pourrait donc également posséder le tableau original de Rubens et Brueghel. La composition de « Le reste de Diane et ses nymphes » est connue grâce à de multiples versions et copies, comme la copie du Kunsthistorisches Museum de Vienne (GG 1707) ou une autre version de l'Alte Pinakothek de Munich (344). La version conservée au Musée de la Chasse et de la Nature à Paris (huile sur panneau, 61 x 98 cm, 68-3-2) est considérée comme l'originale. Ce tableau comprend un pendant (pièce d'accompagnement) représentant « Diane et ses nymphes partant à la chasse » (huile sur panneau, 57 x 98 cm, 68-3-1). Bien que les deux tableaux semblent former une paire, leur provenance est déterminée différemment : le premier (nymphes endormies) est considéré comme provenant de la collection de Frédéric II de Prusse, dont l'accomplissement douteux fut le premier partage de la Pologne, dans son palais de Sanssouci près de Berlin, tandis que le deuxième tableau serait resté quelque temps dans la collection personnelle de Rubens et aurait été acquis par Matthijs Musson après la mort du peintre. Les deux tableaux sont datés d'environ 1623-1624, donc de l'époque où le prince Ladislas Sigismond Vasa visitait l'atelier de Rubens. L'inventaire de 1633 du château de Radziwill à Lubcha en Biélorussie (Archives centrales des documents historiques à Varsovie, 1/354/0/26/45) répertorie « Un grand tableau représentant Diane et ses jeunes filles dont les faunes se moquent, offert par le roi actuel », c'est-à-dire Ladislas IV (article 37) et « Un tableau dans des cadres en ébène représentant Diane avec des nymphes se lavant près de la source » (38). En 1560, Krzysztof Krupski, staroste de Horodło, commanda une grande tapisserie du trône avec les armoiries du roi Sigismond Auguste dans l'atelier d'Anton Leyniers à Bruxelles (Château Royal du Wawel), il se pourrait donc aussi que le roi commande en Flandre une œuvre d'art glorifiant la famille la plus puissante du grand-duché de Lituanie, dont les ambitions étaient parfois véritablement royales. Nous ne pouvons pas exclure que des copies ou des originaux des deux tableaux de Paris se trouvent à Lubcha, d'autant plus que le motif principal des deux compositions est une corne noire, exactement comme dans les armoiries de la famille Radziwill - Trąby, comme le montre « Kryształ Z Popiołv » de Wojciech Cieciszewski, publié à Vilnius en 1643, dédié au fils de Christophe, Janusz. Vers 1652, les graveurs flamands Pierre Rucholle et Pieter de Jode II créèrent un portrait gravé du prince Christophe Radziwill, probablement d'après un tableau ou un dessin du peintre hollandais Michiel Jansz. van Mierevelt. Les peintures appartenant à l'hetman étaient parfois décrites dans les poèmes de ses poètes de cour, comme dans certaines œuvres de Daniel Naborowski (1573-1640), dont le plus célèbre poème érotique « Sur les yeux de la princesse anglaise » (Na oczy królewny angielskiej), qui correspondraient aux portraits de la princesse anglaise mentionnés dans les inventaires. Les épigrammes de ce poète « Sur des images de nus dans les bains » (Na nagie obrazy w łaźni) auraient pu être un commentaire sur les peintures décorant les bains de la résidence de Vilnius, également mentionnées dans les inventaires. Dans l'un des poèmes occasionnels, Naborowski mentionne à propos de la galerie du prince : « Mon Seigneur, vous avez des Bacchus magnifiquement peint » (Panie mój, masz Bachusów malowanych siła) et dans d'autres, il fait référence aux portraits de l'évêque Eustachy Wollowicz et du prince Ladislas Sigismond Vasa en costume national tenant une masse buzdygan. Christophe possédait également un grand cabinet de curiosités. Outre des peintures, l'hetman a également reçu diverses curiosités pour sa collection et des sculptures comme « Adam et Ève en bois, délicatement sculptés, où tous les membres bougent » offerts par Ladislas IV. Il collectionnait également des numismates rares, comme en témoigne un document dans lequel Christophe demandait à M. Kłosowski d'acheter une bibliothèque et des pièces de monnaie rares de la famille Gorajski, dont « quelques vieilles pièces de monnaie romaines et grecques » (jakieś numizmata staroświeckie rzymskie i greckie). Ses intérêts scientifiques se manifestent également par le maintien de contacts par le biais de lettres avec d'anciens tuteurs de Leipzig, Heidelberg et Bâle, ainsi que par le recrutement de « personnes érudites à l'étranger » à sa cour. Radziwill soutient également l'installation de protestants dans ses domaines, accueillant des réfugiés venus des pays allemands ravagés par la guerre de Trente Ans. L'immigration fut si grande que selon Janusz Tazbir la République est devenue un véritable refugium Germaniae (d'après « Korespondencja i literatura okolicznościowa ... » de Mariola Jarczykowa, p. 81, 117). Dans une lettre datée du 2 juin 1629 de Kedainiai, le staroste local Piotr Kochlewski rapporta à Christophe que « de plus en plus d'Allemands viennent chaque jour de Prusse » (Z Prus co dzień Niemców przybywa). Dans son palais, il y avait aussi un théâtre temporaire ou permanent - « Le lendemain, vendredi, après le déjeuner, il y avait une comédie, en présence des envoyés de Moscou et de Florence », comme Janusz Radziwiłł l'a informé son père dans une lettre. Christophe était considéré comme un bon orateur - « Le voïvode a également prononcé un discours élégant à l'archiduchesse, qui a répondu en italien », se souvient Albert Stanislas Radziwill (1593-1656) à propos de l'accueil de Cécile-Renée d'Autriche en 1637. L'inventaire mentionné du château de Lubcha répertorie également de nombreux autres objets de valeur de la collection du prince. Parmi eux, on peut distinguer du verre vénitien (Szklanic weneckich), des articles de luxe achetés aux Français (Rzeczy Nowe Rozne od Francuzów Kupione), dont un oreiller brodé d'or et d'argent, un étui à peigne (Grzebieniarz) en soie cerise brodé d'or et d'argent et cinq paires de bas de soie brodés d'or et d'argent, des « nappes hollandaises et toiles diverses » (Obrusy Olenderskie y Płotna Rożne), des images et des portraits, principalement brodés sur satin, en papier découpé ainsi que des portraits peints de Gustave Adolphe, roi de Suède (dit duc de Sodermanland), Gabriel Bethlen, prince de Transylvanie, Eustachy Wollowicz, évêque de Vilnius, peints sur satin blanc, portraits du prince Radziwill et de son épouse Anna Kiszczanka, peints sur cuivre, estampes, cartes et sculptures en cire, plaque d'argent avec l'image de l'empereur Ferdinand II, trois tableaux de grands chiens et un grand tableau d'un ours, tapis et moquettes persans et orientaux - 142 au total (16, 38, 17, 10, 8, 22, 30, 1), 11 tapisseries vertes hollandaises en soie avec personnages, 9 tapisseries hollandaises vertes avec personnages sans soie, « une tapisserie hollandaise sur la table avec différentes armoiries des princes, Leurs Altesses » (opona Olenderska na stol z Herbami Roznemi Xiąząt Ich mosci), 18 tapisseries blanches fabriquées localement et tentes turques. La Bible évangélique en polonais - Biblia swięta, publiée à Gdańsk en 1632, parrainée et dédiée au prince Christophe, est l'une des réalisations les plus importantes de Radziwill. La page de titre de Cornelis Claesz. Duysend a très probablement été créé à Amsterdam (Bibliothèque nationale de Pologne, SD XVII.3.4795). En tant que meneur des calvinistes lituaniens, Christophe a fondé des églises et des écoles, mais a également soutenu et imposé des politiques favorables à ses co-croyants. Avec l'influence croissante des Jésuites et des Habsbourg à la cour royale, les temps devinrent de plus en plus difficiles pour les non-catholiques dans une nation multireligieuse. Constance d'Autriche, seconde épouse du roi Sigismond III, dont les proches en Espagne ont participé aux auto-da-fé publics (le neveu de Constance, Philippe IV d'Espagne, a demandé qu'un auto-da-fé ait lieu à la cour en 1632 pour célébrer la guérison de sa femme, Élisabeth de Bourbon) et dont le beau-frère le roi Philippe III d'Espagne expulsa les Morisques en 1609, était célèbre pour son intolérance. De nombreux nobles et dignitaires commencèrent à suivre l'exemple de la reine. Les Polonais succombaient souvent aux modes occidentales, mais la mode du fanatisme religieux ne pouvait qu'apporter de mauvais résultats. La mode au XVIIe siècle était fréquemment utilisée pour des raisons politiques, comme en témoignent les portraits du roi Ladislas IV en costumes français, espagnols et nationaux, mais aussi pour démontrer des liens ou des croyances, ou simplement pour montrer la splendeur et la richesse. Par exemple, la série de portraits des Sapieha/Sapega au château royal de Wawel présente une grande variété de mode non seulement lituanienne mais aussi européenne (y compris espagnole et néerlandaise) du XVIIe siècle. La diversité en la matière était vraiment remarquable - Georges Radziwill (1578-1613), châtelain de Trakai, fervent calviniste formé à Leipzig, Strasbourg et Bâle, laissa dans son testament des chevaux et des vêtements à ses beaux-frères : italiens - à Dorohostajski et hussard - à Gorajski. Étant donné que les catholiques de la cour royale-ducale de Vilnius et de Varsovie manifestaient parfois leurs croyances à travers la mode espagnole, italienne ou flamande, le chef des calvinistes portait sans doute des costumes protestants. Le portrait d'un homme devant un paysage par Govert Flinck, élève de Rembrandt vivant habituellement dans la maison d'Hendrick Uylenburgh, agent artistique de Sigismond III Vasa, à Amsterdam, aujourd'hui conservé au Musée national de Varsovie, est daté d'environ 1640 (huile sur panneau, 92 x 69 cm, M.Ob.2584 MNW). Le tableau provient de la collection de Karol Radziwill en Argentine et a été acheté en 2005. Il est identifié avec un tableau appartenant au roi Stanislas Auguste Poniatowski à Varsovie et mentionné dans le « Catalogue des tableaux Appartenant à Sa Majesté le Roi de Pologne » en 1795 comme « Viellard debout, tenant un bâton, vêtu a la hollandoise, avec une petite barbe blanche, le fond est un paysage, sur bois » (article 162). Le nom du peintre n'est pas mentionné, il est donc possible que le roi possédait une copie ou un autre tableau ou que les Radziwill ont réacquis le portrait de leur ancêtre de la collection royale. Le tableau a été vendu à Paris en 1933 (Hôtel Drouot, 8 mars 1933, lot 11, « FLINCK (attribué à GOVAERT) / 11. Portrait d'un seigneur hollandais. / Debout dans la campagne, appuyé sur une canne, il est vêtu de noir. Bois. Haut., 92 cent.; larg., 70 cent. »), ainsi que le portrait de la princesse Christine-Madeleine Radziwill (1776-1796) dans un paysage boisé, peint à Vienne en 1795 par Giuseppe Maria Grassi, bien qu'à cette époque la princesse était à Nieborów et plus tard à Saint-Pétersbourg (donc très probablement réalisés à partir de dessins d'étude envoyés à Vienne). Les deux tableaux faisaient partie de la collection Radziwill au Château d'Ermenonville et selon Tadeusz Mańkowski (1878-1956), le tableau de Flinck représentait Radziwill « l'Orphelin » (?) (d'après « Rembrandt w Polsce » de Michał Walicki, p. 331). L'homme présenté comme un vagabond armé d'une canne manifeste « le choix d'une attitude active dans le cheminement de la vie, conforme aux idéaux du calvinisme » (selon la description du musée). L'église en arrière-plan ressemble beaucoup à l'église Saint-Georges de Vilnius, près du palais du duc de Birzai, représentée sur l'estampe de Makowski, comme si l'homme se tenait dans le jardin de cette résidence. Elle ressemble également à l'église de la gravure de Duysend Biblia swięta, publiée en 1632. Le modèle ressemble à son tour à l'homme aux deux plumes des portraits de Rembrandt et de son entourage, notamment la version du château de Viderup. Un « errant avec une canne » similaire a également été représenté dans la nature morte Vanitas, attribuée à Susenier, comprenant l'étude pour le portrait de Rembrandt aux deux plumes. L'inventaire de Lubcha mentionne également plusieurs vêtements de Christophe qui pourraient être représentés dans le tableau, comme 19 kurta différentes (une veste ou un caftan court), dont une « kurta en cuir noir cousu avec des boutons noirs et argentés » et une autre « kurta en cuir noir cousu avec des boutons en soie blanche » (Kurta Czarna skurzana Przeszywana z guzikami Czarnemi srebrem Przetykanemi [...] Kurta skurzana Czarna Przeszywana z guzikami białemi Jedwabnemi), 4 chapeaux, 3 en fourrure de castor feutré, dont un noir avec une plume noire (Kapelusz Czarny Bobrowy z Piorem Czarnym) et 8 cannes, sauf 1, toutes fabriquées en Inde, dont la première sertie d'argent (Laska Czarna Indyska srebrem oprawna z sikawką). Christophe est décédé le 19 novembre 1640 à l'âge de 55 ans, selon ses contemporains, dévasté par la tournure des événements après l'attaque de l'église calviniste de Vilnius, lorsque le roi non seulement n'a pas puni les coupables de l'attaque, mais aussi a ordonné le déplacement de l'église hors des murs de la ville et a interdit aux pasteurs d'exercer des activités pastorales dans la ville.
Portrait du prince Christophe Radziwill (1585-1640), grand hetman de Lituanie, tenant une canne par Govert Flinck, vers 1640, Musée national de Varsovie.
Le reste de Diane et ses nymphes par Peter Paul Rubens et Jan Brueghel l'Ancien, vers 1623-1624, Musée de la Chasse et de la Nature à Paris.
Diane et ses nymphes partant à la chasse par Pierre Paul Rubens et Jan Brueghel l'Ancien, vers 1623-1624, Musée de la Chasse et de la Nature à Paris.
Portrait de la reine Cécile-Renée d'Autriche tenant une tulipe par l'atelier de Frans Luycx
Le 7 octobre 1649, à Navalcarnero, près de Madrid, l'archiduchesse Marie-Anne d'Autriche (1634-1696), 14 ans, épousa son oncle, 44 ans, le roi Philippe IV d'Espagne. Le couple passe sa nuit de noces au monastère royal de l'Escurial. L'archiduchesse était la nièce de la reine Cécile-Renée d'Autriche (1611-1644) et elle était également apparentée à son mari, le roi Ladislas IV Vasa (1595-1648).
Marie-Anne (ou Mariana en espagnol) était la fille de l'empereur Ferdinand III et de l'infante Marie-Anne d'Espagne (fille du roi Philippe III d'Espagne et nièce de deux épouses de Sigismond III Vasa). Depuis son enfance, elle était fiancée à son cousin Balthazar-Charles, prince des Asturies, mais lorsque celui-ci mourut subitement en 1646, le roi Philippe IV, devenu veuf après la mort de sa première épouse, Élisabeth de France, décida d'épouser le jeune archiduchesse. La situation politique obligea le roi à se remarier afin d'obtenir un héritier mâle pour le grand empire espagnol, car il n'avait qu'une seule fille légitime - l'infante Marie-Thérèse d'Espagne, future reine de France. Avant le mariage, de nombreux portraits de la mariée sont arrivés en Espagne, principalement réalisés par le célèbre portraitiste de la cour impériale Frans Luycx. Citons notamment le portrait à l'âge de 5 ans environ, ainsi réalisé vers 1639 (Prado, P002871) et le portrait en deuil après la mort de sa mère d'environ 1646 (P006194). Vers 1646, un autre portrait de Marie-Anne, avec des tulipes dans un vase, attribué à Frans Luycx, fut envoyé en Espagne (P002441). Sur ce portrait, elle apparaît âgée de plus de 11 ans, ce qui n'est pas passé inaperçu en Espagne. Après la mort de la mère de l'archiduchesse, il devint nécessaire de renforcer à nouveau les liens familiaux et politiques entre les deux branches de la maison des Habsbourg, alors que la fertilité et la bonne santé de la candidate étaient les plus importantes en Espagne. C'est peut-être à ce portrait que se réfère le rapport qui évalue l'archiduchesse comme candidate : « Un portrait d'elle vient d'arriver qui la représente à l'âge de 11 ans et deux mois [...] très adulte, mais avec son véritable âge, son effigie peinte est discréditée, a-t-elle été peinte fidèlement ? » (Un retrato solo ha venido que la representa con edad de 11 años y dos meses [...] muy crecida pero con su edad verdadera se desacredita su altura pintada, mas si es pintar como ver?) (d'après « Entre Viena y Madrid ... » par Gemma Cobo Delgado, p. 155-158). Il est désormais difficile de déterminer s'il a été manipulé afin de convaincre la cour royale espagnole de sa bonne santé. Cela donne également une idée du rôle politique important que jouaient parfois les images peintes, et du fait qu'elles n'étaient pas toujours exactes, intentionnellement ou non. Bien que le tableau soit attribué à Luycx, il diffère des autres œuvres de ce peintre, notamment des deux autres portraits mentionnés de l'archiduchesse au Prado. Il est fort possible qu'il ait été entièrement réalisée par l'atelier du peintre ou même d'un autre peintre proche de lui, ce qui pourrait aussi expliquer en partie ce manque de fidélité du portrait. Luycx était un peintre très occupé. En plus de travailler pour les Habsbourg, la noblesse de Bohême, d'Autriche et d'Allemagne, il réalise également de nombreuses peintures pour la cour polono-lituanienne. L'Alte Pinakothek de Munich a conservé plusieurs tableaux de Frans provenant du château de Neuburg. Le château était la résidence de la princesse Anna Catherine Constance Vasa, sœur de Ladislas IV Vasa qui, le 9 juin 1642 à Varsovie, épousa Philippe Guillaume de Neubourg. Elle apporta au mariage un trousseau important : 243 333 thalers en espèces, des bijoux d'une valeur d'environ 300 000 thalers, des objets de valeur en or, en argent, des meubles, des tapisseries et des tapis persans. Il est fort possible que les peintures proviennent de sa dot puisqu'elles représentent le frère de la princesse - Ladislas IV (huile sur toile, 250 x 160 cm, 4197) et les frères de sa belle-sœur la reine Cécile-Renée - l'empereur Ferdinand III (1608-1657) (huile sur toile, 206 x 137 cm, 6779) et l'archiduc Léopold Guillaume d'Autriche (1614-1662) en tant qu'ecclésiastique (huile sur toile, 208 x 119 cm, 6819). Les tableaux proviennent probablement d'une série commandée à l'atelier Luycx, cependant le portrait de Cécile-Renée manque. Dans l'Alte Pinakothek se trouve un tableau de la princesse inconnue (Unbekannte Fürstin), qui provient également du château de Neubourg (huile sur toile, 209 x 104 cm, 6781/7244). Déjà en 1969, Janina Ruszczyc identifiait ce tableau comme l'effigie de la reine de Pologne et de la grande-duchesse de Lituanie (« Portrety Zygmunta III i jego rodziny », p. 212-213, fig. 39). Ses traits du visage et son costume ressemblent beaucoup à ceux du portrait de Cécile-Renée conservé au Nationalmuseum de Stockholm (NMGrh 299). La reine tient une tulipe, symbole de l'amour et de la vanité des choses terrestres (d'après « Nature and Its Symbols » de Lucia Impelluso, p. 82). Elle porte une broche avec un aigle polonais, semblable à celle du Louvre (MR 418). Le style de ce portrait est très similaire à celui de l'archiduchesse Marie-Anne avec des tulipes au Prado (P002441). Un autre portrait d'un membre de la famille royale-grand-ducale de Pologne-Lituanie, peint dans un style similaire, se trouve également à l'Alte Pinakothek (huile sur toile, 227,8 x 142 cm, 6961). Cette image en pied représente le prince Charles Ferdinand Vasa (1613-1655), demi-frère du roi Ladislas IV, évêque de Wrocław à partir de 1625 et évêque de Płock à partir de 1640. Ce tableau provient également du château de Neubourg. Le portrait du prince-évêque en prélat, proche du style de Frans Luycx, se trouve au Musée archidiocésain de Wrocław (huile sur toile, 98 x 78 cm, 1377).
Portrait de la reine Cécile-Renée d'Autriche (1611-1644) tenant une tulipe par l'atelier de Frans Luycx, vers 1640, Alte Pinakothek de Munich.
Portrait du prince Charles Ferdinand Vasa (1613-1655), évêque de Wrocław et Płock par l'atelier de Frans Luycx, vers 1640, Alte Pinakothek de Munich.
Portrait du prince Charles Ferdinand Vasa (1613-1655), évêque de Wrocław et Płock par l'atelier de Frans Luycx, années 1640, Musée archidiocésain de Wrocław.
Portraits d'Hendrick van Uylenburgh et de sa fille Sara par Rembrandt et atelier
« Portrait d'un rabbin portugais, peint par Rembrandt, en cadre noir » (Portret Rabina Portugalskiego, malowania Rynbranta, w ramach czarnych, n°74.), évalué à 150 thalers et « Un tableau de dimensions similaires, une femme juive dans un béret, par Rembrandt peintre, en cadre noir » (Obraz takieyze wielkosci, Zydowki w Birlecie, Rynbranta Malarza, wramach czarnych, No.75.), d'une valeur de 190 thalers, dans la Chambre du Roi du Palais de Wilanów en 1696 est probablement le plus ancien description conservée des peintures de Rembrandt, aujourd'hui dans la collection du château royal de Varsovie et connue sous les titres L'érudit à sa table de travail et La Jeune fille au cadre.
L'inventaire général du palais de Wilanów du 10 novembre 1696 répertorie également d'autres œuvres de Rembrandt, comme « Un grand tableau d'un vieil homme de Rembrandt dans un cadre doré et un sommet arrondi » (Obraz Rynbranta Malarza, Na ktorym Starzec wymalowany, wielki, wramach złocistych, u wierzchu okrągły, n° 210.), d'une valeur de 80 thalers, dans le Trésor supérieur avec des peintures de la galerie inférieure et de la bibliothèque, « Une peinture avec trois rois de Rembrandt dans un cadre noir » (Obraz Trzech Krolow, Rynbranta malarza, w ramach czarnych, n° 92.), d'une valeur de 100 thalers (probablement l'Adoration des Mages de 1632, aujourd'hui au Musée de l'Ermitage) et « Une peinture avec Abraham et Agar de Rembrandt dans un cadre noir » (Obraz Abrahama Z Agar Rynbranta malarza w ramach czarnych, n ° 93.), d'une valeur de 100 thalers (peut-être Abraham renvoyant Agar et Ismaël d'environ 1640, aujourd'hui au Victoria and Albert Museum), dans le Cabinet hollandais du roi. L'inventaire répertorie de nombreuses autres peintures hollandaises, dont très probablement La Lettre d'amour de Johannes Vermeer : « Une peinture d'une dame en robe d'or jouant du luth, une fille lui donnant une lettre, dans un cadre noir » (Obraz Damy graiącey na Lutni, w złotey Szacie, a dziewczyna list iey oddaie w ramach czarnych, n° 156.), d'une valeur de 35 thalers, et une copie (?) de La Laitière également de Vermeer : « Un tableau représentant une habitation hollandaise avec une cuisinière versant du lait, en cadre en cuivre » (Obrazek na ktorym Domostwo Holenderskie, a kucharka mleko zlewa, wramach miedzią złoconych, n° 180.), évalué à 20 thalers, au Trésor supérieur. Les peintures du « rabbin portugais » et « une femme juive » étaient toujours ensemble depuis. En 1720, Konstanty Sobieski, fils du roi Jean III Sobieski, vendit le palais à Elżbieta Sieniawska, et après sa mort en 1729, sa fille, Maria Zofia, offrit un bail à vie sur le palais au successeur de Jean III, le roi Auguste II le Fort (1670-1733), électeur de Saxe. Maria Zofia ou sa fille Izabela Lubomirska, ont très probablement vendu les peintures, mais ont commandé une copie d' « une femme juive », qui se trouve toujours au palais de Wilanów (Wil.1656). Avant 1769, les tableaux furent transportés à Berlin et acquis par Friedrich Paul von Kameke (1711-1769), marié à Marie Golovkin (1718-1757), fille de l'ambassadeur de Russie en Prusse. Georg Friedrich Schmidt a créé des estampes d'après les tableaux intitulés en français: « Le Pere de la fiancée reglant sa dot » et « La Juive Fiancée ». Sous ces titres, les œuvres retournées en Pologne acquises par le roi Stanislas Auguste Poniatowski en 1777 et les numéros d'inventaire de sa collection 207 et 208 ont été peints dans les coins supérieurs gauches des deux tableaux, encore visibles aujourd'hui. Revendus après la mort du roi, ils furent transportés à Vienne et en 1994, Karolina Lanckorońska les offrit au peuple polonais. Copie d'atelier de « La Juive Fiancée » apparaît dans l'inventaire du cabinet d'art royal danois (Kunstkammer) de 1737, aujourd'hui à la Galerie nationale du Danemark (numéro d'inventaire KMSsp406). Bien qu'elles n'aient pas une composition similaire, les peintures doivent être considérées comme des pendants (généralement des peintures de couples mariés ou de parents), car selon la tradition, elles représentent un père et sa fille. Ils ont également des dimensions similaires (105,7 x 76,4 cm / 105,5 x 76 cm), les deux sont peints sur des panneaux de bois de chêne, ils ont des cadres noirs baroques similaires, très probablement d'origine ou recréés d'après l'original, exactement comme dans la description de l'inventaire du Palais de Wilanów. Ils furent finalement peints la même année et signés par l'auteur (Rembrandt f. 1641 sur les deux). À la fin de 1631, Rembrandt a déménagé de Leyde à Amsterdam. Il est d'abord resté chez un marchand d'art, Hendrick van Uylenburgh, qui à partir de 1628 a peut-être été un intermédiaire pour la vente des œuvres de Rembrandt sur le marché d'Amsterdam. De 1631 à 1635, Rembrandt devint le peintre en chef de l'atelier d'Uylenburgh et réalisa un nombre considérable de portraits pour des amstellodamois riches et importants, comme l'importateur de fourrures Nicolaes Ruts. En 1634, il épousa la parente d'Hendrick, Saskia. Uylenburgh, né vers 1587, est issu d'une famille mennonite, originaire de la Frise, qui a émigré en Pologne et s'est installée à Cracovie, où le père d'Hendrick travaillait comme ébéniste royal. Son frère Rombout devient peintre de cour. Hendrick a également reçu une formation de peintre, mais il était principalement actif en tant qu'agent artistique du roi Sigismond III Vasa. Il n'a probablement jamais exercé le métier de peintre, du moins aucune œuvre n'a survécu. Vers 1612, il s'installe à Gdańsk. Hendrick a organisé de grands transports d'art vers la Pologne au nom du roi, y compris des peintures des Pays-Bas et des produits de luxe, avant de fonder son marchand d'art et son atelier à Amsterdam vers 1625. En décembre 1637, Hendrick a chargé Rembrandt de peindre le diplomate polonais Andrzej Rej, qui était en mission secrète à la cour d'Angleterre pour le roi Ladislas IV et, de passage à Amsterdam. Van Uylenburgh a reçu 50 florins comme commission (d'après « Saskia, de vrouw van Rembrandt » de Ben Broos, p. 80). Vers 1624, Hendrick épousa Maria van Eyck (décédée en 1638). Le couple a eu trois fils, dont Gerrit (né vers 1625), qui a repris l'entreprise de son père, et au moins quatre filles, Sara, Anna, Susanna et Lyntgen, dont au moins une était une dessinatrice bien connue. Sara Hendricksdr (décédée en 1696) devait être la plus âgée car elle est mentionnée en premier dans le testament de ses parents de 1634 et un acte du 3 février 1668 concernant l'héritage de son frère Abraham. Elle est née vers 1626 ou 1627, elle avait donc 14/15 ans en 1641. Son nom biblique d'épouse d'Abraham correspond parfaitement à l'ancien titre du tableau de Varsovie « une femme juive » ou « La Juive Fiancée ». La jeune fille entourée d'artistes, a sans doute aussi été initiée à la peinture par son père. Jouant peut-être dans l'atelier de son père, elle aurait pu avoir l'idée d'être représentée dans le cadre d'un tableau, dans le style trompe-l'œil. Son père Hendrick qui avait environ 54 ans en 1641 était donc représenté en érudit à sa table de travail, très semblable à l'eau-forte de Rembrandt représentant Cornelis Claesz Anslo, prédicateur mennonite d'Amsterdam, réalisée en 1641 (The Metropolitan Museum of Art), la même année que les peintures de Varsovie, ou effigie de Menno Simons (1496-1561), prédicateur et théologien, dont les fidèles formèrent l'église mennonite, par Jacob Burghart, publiées en 1683 (Museum Boijmans Van Beuningen). « Uylenburgh venait d'une famille de mennonites (une branche conservatrice des anabaptistes), qui mettait l'accent sur l'étude et l'interprétation personnelle des Écritures et la responsabilité individuelle de son propre salut » (d'après « Rembrandt/not Rembrandt in the Metropolitan Museum of Art » par Hubertus von Sonnenburg, p. 15). Cela explique pourquoi il était représenté comme un érudit. Une importante communauté mennonite s'est établie au milieu du XVIe siècle dans le delta de la Vistule en Pologne et près de Varsovie, en 1624, dans des zones auparavant inhabitées, donnant lieu à la soi-disant colonisation d'Olęder. Le 22 décembre 1642, le roi Ladislas IV accorda le premier privilège aux mennonites. Il est fort possible qu'en 1641 déjà le roi ait reçu un portrait de son agent artistique et de sa fille, qui pourraient également trouver un mari convenable parmi les mennonites polonais. Le même vieil homme en costume riche a également été représenté dans une série de peintures de Rembrandt et de son atelier, assis et tenant une canne. L'une datée « 1645 » de la collection de Pierre Crozat à Paris se trouve à Lisbonne (Musée Calouste Gulbenkian), l'autre, qui était dans la collection ducale de Munich se trouve aujourd'hui à Amsterdam (Museum het Rembrandthuis) et une autre au Philadelphia Museum of Art. Une version des collections princières du Liechtenstein est attribuée à Salomon Koninck (1609-1656), membre de l'académie van Uylenburgh. Il est possible que Stanisław Koniecpolski (1591-1646), grand hetman de la couronne, ait commandé ou reçu les copies des portraits de la collection royale, car deux de ces tableaux sont visibles sur une photographie d'Edward Trzemeski prise vers 1880 et montrant la chambre jaune de son palais de Pidhirtsi près de Lviv en Ukraine. Ils étaient accrochés face au portrait de Jakub Ludwik Sobieski (1667-1737), fils de Jean III, peint à Paris en 1699 par François de Troy (Château du Wawel, 10385, inscrit au dos : « Peint à Paris par François de Troy en 1699 »). Il est donc également possible que les copies aient été réalisées pour Sobieski, qui, fait intéressant, se trouvait très probablement à Oława en Silésie en 1699, où son fils Jan est né et non à Paris, son portrait a donc peut-être été réalisé à partir de dessins d'étude. Une copie ancienne du portrait de Sara, peut-être réalisée par un peintre vénitien, se trouve au Musée Correr de Venise (Cl. I n. 0910).
Portrait de Sara van Uylenburgh (1626/27-1696) dans le cadre d'un tableau par Rembrandt, 1641, Château Royal de Varsovie.
Portrait de Sara van Uylenburgh (1626/27-1696) dans le cadre d'un tableau par l'atelier de Rembrandt, vers 1641, Galerie nationale du Danemark.
Portrait de Sara van Uylenburgh (1626/27-1696) par un peintre inconnu d'après Rembrandt, milieu du XVIIIe siècle, Palais de Wilanów à Varsovie.
Portrait de Hendrick van Uylenburgh (ca. 1587-1661) à sa table de travail par Rembrandt, 1641, Château Royal de Varsovie.
Portrait de Hendrick van Uylenburgh (vers 1587-1661) avec une canne par Rembrandt, 1645, Musée Calouste Gulbenkian.
Portrait de Hendrick van Uylenburgh (ca. 1587-1661) tenant une canne par l'atelier de Rembrandt, vers 1645, Museum het Rembrandthuis.
Portrait de Hendrick van Uylenburgh (ca. 1587-1661) tenant une canne par l'atelier de Rembrandt, vers 1645, Musée d'art de Philadelphie.
Portrait de Hendrick van Uylenburgh (ca. 1587-1661) tenant une canne par Salomon Koninck, vers 1645, Musée du Liechtenstein à Vienne.
Portraits de Hieronim Radziejowski et de ses deux épouses par Ferdinand Bol, Rembrandt et suiveurs
« Nommé Radziejowski, tu resteras au conseil, les mauvaises trahisons sont tes conseils » (Radziejowskim nazwany zostajesz od rady, A Twe w ojczyźnie rady są złośliwe zdrady), dépeint le vice-chancelier de la Couronne Hieronim Radziejowski (1612-1667) le poème satirique anonyme de 1651.
En octobre 1632, grâce au soutien de son père, Stanisław Radziejowski (1575-1637), courtisan de la reine Anna Jagellon, Hieronim devint courtisan du roi nouvellement élu Ladislas IV Vasa. Il acquit rapidement une influence significative, en 1634 devint le staroste de Sochaczew et en 1637 staroste de Łomża et Grand maître d'hôtel de la cour de la reine. Vers 1637, il épousa une riche veuve Katarzyna Woyna née Męcińska (vers 1608-1641), épouse de Piotr Woyna (décédé en 1633), intendant de Lituanie et après sa mort, en juin 1642, grâce au soutien du roi, il épousa une autre riche veuve Eufrozyna Eulalia Wiśniowiecka née Tarnowska (décédée en 1645). Eufrozyna était l'héritière d'une fortune considérable de son premier mari, le prince Jerzy Wiśniowiecki (Iouri Vychnivetsky), staroste de Kamianka, et la garde légale d'elle et de ses biens appartenait au prince Jeremi Wiśniowiecki (Yarema Vychnivetsky), fils de Raina Movila (ca. 1589-1619). Par décision du roi, Hieronim devint son principal héritier. En mai 1650, Radziejowski épousa une troisième fois la veuve la plus riche du pays, Elżbieta Kazanowska née Słuszczanka (1619-1671), dont le mari était décédé quatre mois plus tôt. Le scandale personnel a toujours accompagné la carrière politique de Radziejowski. En 1640, il fut élu député au Sejm, bien qu'il y ait eu des demandes pour son retrait de la chambre. Lors de la première session du parlement, il a été publiquement accusé par un noble d'avoir kidnappé sa fille dans l'un des monastères de Varsovie et de l'avoir violée (d'après « Hieronim Radziejowski : studium władzy i opozycji » d'Adam Kersten, p. 60). Deux ans plus tard, il épousa sa deuxième épouse Eufrozyna dans une atmosphère de scandale car la jeune veuve avait déjà accepté une autre relation, elle devait épouser Stanisław Denhoff. Il aurait versé un pot-de-vin important de 25 000 ducats au couple royal, Jean II Casimir et Marie-Louise de Gonzague, pour avoir reçu la charge de vice-chancelier en 1650 et un an plus tard, lors d'une campagne contre les Cosaques, lorsque le roi a ordonné l'ouverture de sa correspondance, une lettre a été trouvée à la reine critiquant Jean Casimir et se plaignant que le roi avait une histoire d'amour avec la femme de Radziejowski, qui l'accompagnait dans la campagne. La femme de Hieronim, qui a quitté le camp après la révélation de la correspondance, a demandé le divorce. En 1652, accusé d'insulte au nom royal, il est condamné à mort, mais s'enfuit à Vienne puis en Suède. En 1655, il accompagna les forces suédoises envahissant la République polono-lituanienne. Avant la Seconde Guerre mondiale, dans le vestiaire du palais royal sur l'île à Varsovie, il y avait deux petites peintures attribuées à l'élève de Rembrandt Ferdinand Bol ou à un imitateur du XVIIIe siècle de Rembrandt Christian Wilhelm Ernst Dietrich. Les catalogues de la galerie royale les décrivaient comme un « Homme à mi corps avec des moustaches vêtu de brun et coëffé de noir » (numéro 43) et « Femme à mi corps vetu de brun avec une chaîne enrichie des pierreries ayant des perles au col et aux oreilles, ainsi que sur la tête » (numéro 54). Les peintures avaient des dimensions similaires (30,3 x 25,3 cm / 35,5 x 24 cm) et une composition similaire, comparable au portrait de Hendrick van Uylenburgh et sa fille Sara par Rembrandt (Château Royal de Varsovie), tous deux créés en 1641. Le portrait d'une femme du Palais sur l'île était signé et daté à droite : Bol. f. 1641. Cette signature a été publiée dans un catalogue de la collection de 1931 (« Katalog galerji obrazów Pałacu w Łazienkach w Warszawie » de Stanisław Iskierski, p. 53). D'autres versions de ces portraits avec de légères différences (chapeau d'homme et visage de femme), attribuées à Rembrandt, appartenaient en 1763 au comte Friedrich Paul von Kameke (1711-1769), membre de la famille noble de Poméranie, qui possédait également le portrait mentionné de Hendrick van Uylenburgh et sa fille. Un graveur allemand, Georg Friedrich Schmidt, a réalisé des gravures d'après ces peintures signées en latin et en français (Rembrandt pinx./ G.F. Schmidt fecit aqua forti 1763. Du Cabinet de Monsieur le Comte de Kameke). Quelques années plus tôt, en 1735, Schmidt réalise également une autre gravure d'après un tableau attribué à Rembrandt (signé en latin : Rembrandt Inv. e. pin: / Schmidt fec: 1735), portrait d'un homme barbu en costume oriental. Son haut chapeau de fourrure et son manteau doublé de fourrure sont très proches de ceux visibles sur un portrait d'homme, très probablement un prince ruthène, par disciple d'Aert de Gelder, aujourd'hui au Musée national de Varsovie (numéro d'inventaire M.Ob. 151 MNW). Ce dernier tableau est signé et daté : AV.Gelder.f/1639 et provient de la collection de Piotr Fiorentini (1791-1858) à Varsovie. Des costumes similaires sont visibles dans la reddition de Mikhail Shein à Smolensk en 1634 par Christian Melich (château de Kórnik) avec le roi Ladislas IV et ses dignitaires et dans le portrait d'un noble polonais par Rembrandt, signé et daté : Rembrandt.f / 1637 (National Gallery of Art de Washington), des chapeaux similaires figurent dans un portrait du roi Jean II Casimir par Daniel Schultz (château royal de Varsovie), des portraits des membres de la famille Sapieha de Kodeń (château royal de Wawel) et des manteaux de fourrure similaires avec des chaînes en or sont dans l'autoportrait de Rembrandt ou atelier (The Wallace Collection), un portrait d'un jeune de Pieter de Grebber (Musée du Liechtenstein à Vienne) et un portrait d'homme en toque et manteau de fourrure de Pieter de Grebber (Collection privée). En 1641, Radziejowski et d'autres fonctionnaires de la voïvodie de Mazovie deviennent membre d'une commission chargée d'examiner les problèmes frontaliers avec le duché de Prusse. La même année, le 7 octobre 1641, le sixième et dernier Hommage prussien eut lieu à Varsovie. Le 13 juillet, le nonce apostolique informe le pape que le roi a ordonné la préparation de ballets et d'une comédie musicale. La venaison et les fruits ont été apportés de Cracovie le long de la Vistule et d'excellents vins français, italiens et rhénans de Vienne. Le château d'Ujazdów, récemment achevé, était prêt à accueillir Frédéric-Guillaume, électeur de Brandebourg et sa cour (d'après « Ostatni hołd pruski » de Jacek Żukowski). L'électeur a eu l'occasion d'admirer la grande richesse de la cour polono-lituanienne, dont il s'est approprié une partie pendant le déluge quelques années plus tard (selon Wawrzyniec Jan Rudawski, il « emporta en Prusse comme butin, les peintures les plus précieuses et l'argenterie de la table royale »). La manchette de la tenue d'homme du tableau perdu du Palais sur l'île est très similaire aux manchettes des costumes des nobles polonais, visibles, entre autres, dans le couronnement de la Vierge Marie par Herman Han (cathédrale d'Oliwa à Gdańsk), créé entre 1624-1627, épitaphe d'Andrzej Czarnecki (mort en 1649), burgrave de Cracovie et courtisan royal (église Saints Pierre et Paul à Cracovie) ou costumes de deux garçons au Festin d'Hérode par Bartholomeus Strobel, créés dans les années 1630 (Musée du Prado à Madrid). Un costume similaire avec un manteau doublé de fourrure, une chemise brodée et un chapeau orné de bijoux est également visible dans le Festin d'Hérode de Strobel, dans le tableau intitulé Le prophète Nathan réprimande le roi David de l'atelier de Strobel (Collection privée) et dans la scène d'Esther devant Assuérus du sarcophage en cuivre-argent de la reine Cécile-Renée d'Autriche, réalisé avant 1648 (cathédrale de Wawel), sans doute inspiré des costumes de la cour de Ladislas IV. Le costume d'une femme d'une peinture pendante ressemble également aux vêtements des peintures de Strobel, y compris le Festin d'Hérode au Prado et la tenue de deux femmes de Lapidation de saint Étienne, créée par Strobel en 1618 pour Stanisław Ostroróg (Musée national de Poznań). Son costume est également très similaire à ceux visibles dans le portrait de Jadwiga Rogalińska (Musée national de Poznań), peint dans les années 1640, ou dans le portrait d'Helena Opalińska née Zebrzydowska, réalisé dans les années 1650 (Monastère de Kalwaria Zebrzydowska). Quelques éléments similaires (chaînes, manteau) sont également visibles dans une gravure à l'effigie d'une dame au chapeau de fourrure, dite princesse Owka Praxedis de Vitebsk (Bibliothèque de l'Université de Vilnius), réalisée en 1758 d'après un original du milieu du XVIIe siècle. Jadwiga Wypyska née Łuszkowska (ca. 1616- après 1648), maîtresse de Ladislas IV, était représentée dans une robe similaire dans son portrait par Rembrandt et atelier (Collection privée), peint en 1643, identifiée par moi, ainsi qu'une dame dans un portrait attribué à un disciple de Rembrandt ou éventuellement à Jan Victors (Metropolitan Museum of Art de New York, 29.100.103), signé et daté : Rembrandt f / 1643. Dans les trois portraits de Rembrandt et de ses disciples, les femmes tiennent un éventail, un symbole de chasteté, porté par des femmes fiancées ou mariées à Venise et à Padoue. Le portrait du Metropolitan Museum a un pendant représentant un jeune homme avec une cuirasse et un chapeau à plumes (MMA 29.100.102), il a une ressemblance frappante avec l'homme du portrait perdu du Palais sur l'île de Varsovie, de la gravure de Georg Friedrich Schmidt, la seule effigie signée conservée de Hieronim Radziejowski, créée en 1652 par Jeremias Falck Polonus (Bibliothèque nationale de Pologne) et à un portrait au pastel de son fils le cardinal Michał Stefan Radziejowski par Jan Reisner (Musée national de Varsovie). En 1643, le premier fils de Radziejowski, Stanisław, est né. Ce serait une bonne occasion de commander des images de ses parents. La femme blonde devrait donc être identifiée comme étant la seconde épouse de Radziejowski, Eufrozyna Eulalia Tarnowska. Par conséquent, la femme du portrait en pendant du Palais sur l'île est sa première épouse Katarzyna Męcińska, décédée en 1641. Avant 1861 les deux portraits du Met de New York se trouvaient dans la collection du baron Florentin-Achille Seillière (1813-1873) à Paris, dont la fille Jeanne-Marguerite (1839-1905) épousa en 1858 Boson de Talleyrand-Périgord (1832-1910 ), prince de Sagan (aujourd'hui Żagań en Pologne) à partir de 1845. Le duché de Silésie de Żagań était un arrêt fréquent pour les rois Auguste II le Fort et Auguste III de Pologne, car l'une des deux routes principales reliant Varsovie et Dresde traversait la ville au XVIIIème siècle. Il ne peut être exclu que l'un d'eux ait offert les tableaux aux ducs de Żagań. Avant 1667, Radziejowski acheta une série de tapisseries avec l'histoire de Jacob, tissées dans l'atelier de Jacob van Zeunen à Bruxelles vers 1650 (acquises plus tard par Jan Małachowski et offertes à la cathédrale de Wawel), tandis que son fils Michał Stefan, qui commanda la œuvres d'art dans l'atelier de Guillaume Jacob à Paris, employait à sa cour un architecte et ingénieur d'origine néerlandaise Tylman Gamerski (qui a conçu pour lui la chapelle du séminaire de Łowicz et palais de Nieborów).
Portrait de Hieronim Radziejowski (1612-1667), Grand maître d'hôtel de la cour de la reine par Ferdinand Bol, vers 1641, Palais de l'Isle à Varsovie, perdu.
Portrait de Katarzyna Radziejowska née Męcińska (vers 1608-1641) tenant un éventail par Ferdinand Bol, 1641, Palais sur l'île à Varsovie, perdu.
Portrait de Hieronim Radziejowski (1612-1667), Grand maître d'hôtel de la cour de la reine par Georg Friedrich Schmidt d'après Rembrandt, 1763 d'après l'original d'environ 1641, Philadelphia Museum of Art.
Portrait de Katarzyna Radziejowska née Męcińska (vers 1608-1641) tenant un éventail par Georg Friedrich Schmidt d'après Rembrandt, 1763 d'après l'original d'environ 1641, Philadelphia Museum of Art.
Portrait de Hieronim Radziejowski (1612-1667), Grand maître d'hôtel de la cour de la reine par suiveur de Rembrandt, vers 1643, Metropolitan Museum of Art.
Portrait d'Eufrozyna Eulalia Radziejowska née Tarnowska (décédée en 1645) tenant un éventail par un suiveur de Rembrandt, 1643, Metropolitan Museum of Art.
Portrait d'un homme en costume oriental, très probablement un noble polono-lituanien par Georg Friedrich Schmidt d'après Rembrandt, 1735 d'après l'original du deuxième quart du XVIIe siècle, Philadelphia Museum of Art.
Portrait d'un homme en costume oriental, très probablement un prince ruthène par un suiveur d'Aert de Gelder, 1639, Musée national de Varsovie.
Portraits de la reine Cécile-Renée d'Autriche et de Kasper Denhoff par Gonzales Coques
En juillet 1637, les envoyés de la République polono-lituanienne Kasper Denhoff (1588-1645), voïvode de Sieradz, Jan Lipski (1589-1641), évêque de Chełmno et Jean Casimir Vasa (1609-1672), prince de la couronne, vinrent à Vienne pour négocier le mariage du roi Ladislas IV Vasa avec l'archiduchesse Cécile-Renée, fille de l'empereur Ferdinand II.
Denhoff, entouré d'une suite nombreuse, entra dans la capitale de l'Autriche en grande pompe. Les gens de la cour impériale remarquèrent que la suite du voïvode de Sieradz et de l'évêque de Chełmno était plus riche et plus splendide que celle du demi-frère du roi Jean Casimir, qu'ils « attribuaient à la renommée de la patrie et au privilège de liberté ». Les pourparlers avec l'empereur ont dû être difficiles et les négociations ont été si longues que la date du mariage convenue avec le châtelain Maksymilian Przerębski a été reportée du 2 au 9 septembre. Les envoyés - parmi lesquels Kasper Denhoff était particulièrement actif - ont exigé, conformément à la demande du roi, que le duché d'Opole et Racibórz lui soit transféré sous forme de dépôt, que Ladislas IV tentait depuis longtemps d'obtenir pour sa famille. Il exigea que non seulement la dot de Cécile-Renée soit assurée dans cette principauté, mais aussi les sommes que les Habsbourg devaient depuis longtemps aux Vasa (d'après « Wjazd, koronacja, wesele ... » d'Alicja Falniowska-Gradowska, p. 11). Les envoyés espagnols ont participé aux négociations en cours. Le 31 juillet, Mgr Lipski bénit les fiançailles et le 9 août, il bénit le mariage per procuram (le mari était représenté par le prince Jean Casimir). L'empereur récompense les deux envoyés avec des titres impériaux, Denhoff, qui était déjà comte du Saint-Empire romain germanique, devient prince et Lipski reçoit le titre de comte pour lui et toute sa famille. Kasper ou Kacper Denhoff (Kaspar Dönhoff en allemand) est issu d'une famille noble allemande qui s'est installée au XIVème siècle sur les terres livoniennes de l'Ordre Teutonique (ordre de Livonie). Il était fils de Gerhard von Dönhoff, voïvode de Dorpat (Tartu en Estonie) et de Margarethe von Zweiffel et frère d'Ernest Magnus Denhoff (1581-1642), voïvode de Parnawa (Pärnu) et de Gerard Denhoff (1589/90-1648), voïvode de Poméranie. En tant que courtisan de Sigismond III Vasa, après sa conversion du calvinisme au catholicisme, Kasper acquit une influence considérable sur le roi en tant que proche conseiller. En 1627, il reçut le poste de voïvode de Dorpat et en 1634 il fut nommé voïvode de Sieradz. Il obtient également de nombreuses autres fonctions, ce qui lui permet d'asseoir la puissance financière de la famille. Le 11 janvier 1633 à Vienne, avec ses frères Ernest Magnus et Gerard, restés calvinistes, il fut élevé par l'empereur Ferdinand II au rang de comte impérial. Dans les années 1640-1641, il tenta de mettre en œuvre le traité militaire polono-espagnol. Il joua un rôle important à la cour du successeur de Sigismond, Ladislas IV Vasa. En 1638, il se rendit avec Ladislas à Baden près de Vienne et en 1639 à Szczytno pour une rencontre avec l'électeur de Brandebourg. Afin d'obtenir une présence permanente à la cour, il postule finalement au poste de maréchal de la cour de la Reine. Il finit par prendre ce poste en 1639 malgré la résistance de la reine Cécile-Renée, qui le considérait comme un partisan du favori du roi Adam Kazanowski. Dès lors, il est presque constamment à la cour, participant souvent aux réunions du Sénat. Malgré le fait qu'il restait en bonnes relations avec Kazanowski, l'adversaire du chancelier Jerzy Ossoliński, il maria en 1645 son fils Zygmunt à la fille du puissant chancelier - Anna Teresa. Peu de temps après, il tomba gravement malade et mourut le 4 juillet 1645. Denhoff était également un mécène bien connu. À Kruszyna près de Częstochowa, qu'il reçut en dot de son épouse Anna Aleksandra Koniecpolska (décédée en 1651), l'architecte vénitien au service royal Tommaso Poncino fit construire dans les années 1630-1632 un beau palais pour le voïvode, sa résidence principale. La splendeur du palais peut être prouvée par le fait qu'il a été visité par les rois Sigismond III, Ladislas IV et Jean Casimir. Le mariage d'Anna, la fille de Kasper, avec Bogusław Leszczyński (décédé en 1659), qui eut lieu le 12 août 1638 à Kruszyna, en présence de Ladislas IV et de son épouse Cécile-Renée, devint l'un des événements politiques et sociaux les plus importants de son époque. Plus tôt, entre 1625 et 1628, Kasper reconstruisit le château médiéval de Bolesławiec dans le style Renaissance, qui fut cependant détruit par les Suédois en 1704, pendant la grande guerre du Nord. En 1636, Denhoff acheta Ujazd près de Tomaszów Mazowiecki et le château à la famille Szczawiński, qu'il reconstruisit entièrement. Cela le rapprocha de Varsovie, où il possédait également une demeure en bois, construite avant 1643, probablement selon les plans de l'architecte royal Giovanni Battista Gisleni. Ce manoir fut incendié lors du déluge (1655-1660) et vers 1669 un manoir en brique fut construit pour Ernest Denhoff (aujourd'hui palais Potocki). On ne sait presque rien de ses autres mécénats, mais en tant que prince impérial, proche de la splendide cour de Ladislas IV et de sa première épouse, ses collections artistiques étaient sans aucun doute exquises. En 1633, Ill.mi et excell.mi D. D. Georgii Ossolinii ... de Jerzy Ossoliński, Domenico Roncalli et Kasper Denhoff fut publié à Rome et Marcin Małachowski dédia ses Normae logicae tribvs mentis hvmanae ..., publiées à Cracovie en 1638, au voïvode de Sieradz. Kasper a été enterré dans la chapelle Saint-Paul de Thèbes (chapelle Denhoff) du monastère de Jasna Góra, qu'il a fondé en 1644. En 2002, un portrait en miniature d'un homme, mi-long, en costume vert avec une cape doublée de fourrure et un chapeau de fourrure par cercle de Gonzales Coques a été vendu à Amsterdam (huile sur cuivre, 15,9 x 13 cm, Christie's, vente 2546, 14 mai 2002, lot 27). Coques, né vers 1614 à Anvers, devient apprenti dans l'atelier de Pieter Brueghel le Jeune, puis apprenti chez David Rijckaert II. Il est surtout connu pour ses petits portraits et ses peintures de cabinet. L'influence d'Antoine van Dyck lui a valu le surnom de « Petit Van Dyck ». Il s'est probablement rendu en Angleterre, où van Dyck était actif. En 1640-41, il rejoint la guilde de Saint-Luc à Anvers et en 1643 il épouse Catharina Ryckaert, la fille de David Rijckaert II. Il jouit de la faveur des mécènes tant catholiques que protestants, comme Don Juan José de Austria (1629-1679), fils illégitime du roi Philippe IV d'Espagne (cousin de Ladislas IV), ainsi que de la cour hollandaise de La Haye. Au Musée national de Varsovie se trouve son portrait d'homme avec une cythare (M.Ob.1701 MNW). Le costume de l'homme est évidemment polonais ou hongrois de la première moitié du XVIIe siècle et un chapeau similaire peut être vu dans un portrait équestre d'un noble polono-lituanien (dit Jean III Sobieski), dans la Goodwood House (huile sur toile, 62,9 x 47,6 cm). L'apparence de « Sobieski » avec une boucle d'oreille en perle rappelle le portrait de Jan Stanisław Jabłonowski (1600-1647) par Rembrandt (National Gallery of Art, 1937.1.78), identifié par moi. Il porte le costume espagnol de la cour impériale. À partir de 1638, Jabłonowski fut échanson à la cour de la reine et à partir de 1642, il fut le porte-claive de la couronne. Des costumes très similaires sont visibles sur une gravure représentant le banquet en l'honneur de Marie-Louise de Gonzague et l'entrée solennelle de l'ambassade de la République polono-lituanienne avec Gerard Denhoff, voïvode de Poméranie - « Le festin nuptial du roy et de la reine de Pologne » et « La magnifique entrée des ambassadeurs de Pologne le 19 septembre 1645 dans la ville de Paris ». Elle a été créée par François Campion à Paris et probablement parrainée par le roi de Pologne. Gerard, qui en tant que voïvode de Poméranie à majorité protestante, portait généralement des vêtements à la française comme dans son effigie devant le château de Malbork par Willem Hondius de 1643 (collier et armure). Dans son portrait du peintre de Gdańsk, peint peu avant sa mort vers 1648 (Musée national de Cracovie, MNK I-902), il porte un tel costume à la mode de la fin des années 1640. En 1645, cependant, il était le représentant du roi et de l'ensemble de la République, et pas seulement de la Poméranie, c'est pourquoi il était représenté portant un costume national. Son frère Kasper était un voïvode des territoires à prédominance catholique près de Sieradz, où la majorité de la noblesse porte des costumes traditionnels - caftan żupan et manteau delia. Coques utilisait fréquemment des dessins d'étude ou peut-être même des toiles toutes faites comme modèles. Dans le portrait équestre mentionné de Goodwood House, il a réutilisé la composition très probablement introduite par Peter Paul Rubens dans son portrait de Don Rodrigo Calderón, comte d'Oliva à cheval, ministre préféré du duc de Lerma, peint vers 1615 (Château de Windsor, RCIN 404393). Cela a été repris dans les portraits de Sigismond III par Cornelis de Vos (Musée national de Stockholm, NMGrh 2012) et de son fils le prince Ladislas Sigismond par l'atelier de Rubens (Château royal du Wawel, 6320), ainsi que dans le portrait de Don Diego Felipez de Guzmán (1580-1655), 1er marquis de Leganés par Gaspar de Crayer (Kunsthistorisches Museum de Vienne, GG 9112) et Albert VII, archiduc d'Autriche devant la vue d'Ostende par l'entourage de Rubens (collection particulière). Le portrait de Béatrice de Cusance (1614-1663), princesse de Cantecroix par Antoine van Dyck vers 1635 (Château de Windsor, RCIN 404404) Coques répéte dans son portrait de dames non identifiées du Musée Czartoryski (XII-262) et collection privée (vendu à Lempertz Cologne, le 17 mai 2008). La composition tirée du portrait d'Anne d'Autriche, reine de France par l'atelier de Pierre Paul Rubens (Musée du Louvre, INV 1794 ; MR 984) il a utilisé dans son portrait de femme assise dans un intérieur (collection particulière, huile sur cuivre, 15,2 x 11,4 cm). Il est difficile d’imaginer que d’importants dignitaires ou monarques resteraient debout pendant plusieurs heures pour un portrait, comme certains le croient, c'était la pratique dans le passé. Ces effigies étaient donc basées sur des dessins d'étude (ou autres effigies comme des miniatures) préparés par des artistes de la cour ou des agents de différents ateliers, puis envoyés à l'étranger aux meilleurs artistes. Même s'il y avait des peintres et autres artisans talentueux en Pologne-Lituanie, leur nombre n'était pas aussi grand qu'à l'étranger et les ateliers étrangers, comme aujourd'hui, offraient sans aucun doute des prix plus bas, une meilleure qualité ou d'autres facteurs tels qu'une distribution plus facile des effigies en Europe ou une rapidité d'exécution de travail. Au XIXe et au début du XXe siècle, certains, qui n'avaient généralement aucune idée de la tolérance, de la diversité et du commerce polono-lituaniens, pensaient que le recours à des ateliers étrangers était un signe d'infériorité de la nation, incapable de produire de tels biens par elle-même. Ils penseraient probablement la même chose des pays du XXIe siècle qui dépendent fortement de l’externalisation. L'homme en costume polono-hongrois ressemble à Ernest Magnus Denhoff, voïvode de Parnawa, d'après son portrait créé par l'entourage de Daniel Rose à Königsberg vers 1640 (Musée de Warmie et Mazurie à Olsztyn, MNO 120 OMO), ainsi qu'à l'effigie de Gerard Denhoff devant le château de Malbork par Willem Hondius, frères de Kasper. Il doit être identifié comme le voïvode de Sieradz qui, en 1642, s'unit à la famille la plus puissante du Grand-Duché de Lituanie - les Radziwill, en mariant son fils Stanisław (décédé en 1653) à la princesse Anne Euphémie (1628- 1663), fille d'Alexandre Louis Radziwill (1594-1654), grand maréchal de Lituanie. A noter également la ressemblance avec l'effigie de Jean-Michel, vicomte de Cigala d'après une estampe réalisée par Nicolas de Larmessin Ier à Paris vers 1690 (Bibliothèque nationale de Pologne, G.21943/II). Selon la description en français sous son effigie, Jean-Michel était un notable important de la cour ottomane de Constantinople, mais il décida de se convertir au christianisme et après avoir affranchi plusieurs esclaves chrétiens, il se rendit en Pologne en 1651. Là, à Varsovie, vers 1654, il fut baptisé et nommé Jean-Michel par la reine Marie-Louise de Gonzague. Plus tard, il servit comme capitaine d'artillerie dans l'armée impériale et en 1662 il se rendit en France, où il fut reçu par Louis XIV. Dans les deux cas, les liens avec la cour royale de Pologne-Lituanie sont indéniables. Puisque les principaux dignitaires de la cour de la reine commandaient leurs effigies à l'atelier de Coques vers 1642, la reine Cécile-Renée d'Autriche devrait également faire réaliser au moins un de ses portraits par ce peintre. Vers 1642 Jan van den Hoecke, peintre flamand actif à Anvers, réalise une série d'effigies du frère de la reine, l'archiduc Léopold-Guillaume, en armure (Kunsthistorisches Museum, GG 3284 et vendu chez Sotheby's Londres, 30 avril 2014, lot 743). Plus tôt, vers 1634-1635, probablement également à Anvers, un portrait en pied du roi Ferdinand de Bohême et de Hongrie (1608-1657) en costume national (Kunsthistorisches Museum, GG 697) a été réalisé. Les Habsbourg utilisaient évidemment la même pratique que les monarques de Pologne-Lituanie, de sorte que les efforts de certains historiens de l'art essayant de trouver la confirmation que l'artiste et le modèle se sont rencontrés en personne au moment de la création du portrait sont parfois vains. En 2014, un portrait de dame en robe noire de l'école flamande du XVIIe siècle a été mis en vente à Vienne, Autriche (huile sur toile, 95 x 74 cm, Dorotheum, 24 juin 2014, lot 121). Ses riches bijoux et ses étoles en fourrure de martre drapées sur les épaules de la femme indiquent qu'elle est une riche aristocrate. Il a été suggéré que le zibellino, c'est-à-dire la peau de zibeline dont la Pologne-Lituanie étaient un exportateur majeur au XVIIe siècle (sauf la Russie), était un symbole de fertilité ou était associé à la grossesse et à l'accouchement. Le 7 février 1642, une tragédie frappe le couple royal de la République : leur fille Marie-Anne Isabelle, née un mois plus tôt (8 janvier 1642), décède. Le parrain de la princesse était le cousin de Ladislas, le roi Philippe IV d'Espagne, qui fut remplacé par un envoyé inconnu lors de la cérémonie de baptême du 11 janvier 1642 au château royal de Varsovie. Le corps de Marie-Anne Isabelle fut transporté à Cracovie, où ses funérailles eurent lieu le 13 avril 1642 à la cathédrale du Wawel. Un livre, probablement un livre de prières, repose sur une table à côté de la femme. Son costume ressemble à celui vu dans un portrait d'une inconnue appelée Mary Hawtrey (1598-1661), Lady Bankes par le peintre flamand (Sudbury Hall, Derbyshire, NT 653181), généralement daté des années 1640, ainsi qu'un portrait de la maîtresse du roi Jadwiga Wypyska née Łuszkowska tenant un éventail par Rembrandt et atelier, daté « 1643 » (collection privée), identifié par moi. Ces vêtements rappellent très probablement la mode de la Renaissance italienne, visible dans le portrait d'une jeune femme, plus connue sous le nom d'Antea, par Parmigianino (Museo di Capodimonte de Naples, Q 108). Le style du tableau est très proche de celui d'un portrait de femme tenant un éventail, attribué à Gonzales Coques (vendu chez Millon & Associés, Hôtel Drouot, 22 juin 2022, lot 35) et du portrait de l'archiduc Léopold-Guillaume par Coques (Kunsthistorisches Museum, GG 5461). Les traits de la femme à la lèvre inférieure saillante sont clairement ceux des Habsbourg et elle ressemble beaucoup à Cécile-Renée d'après ses effigies de l'atelier de Frans Luycx (Palais de Wilanów, Wil.1144 et Alte Pinakothek de Munich, 6781), ainsi que des portraits du peintre de la cour Peter Danckerts de Rij.
Portrait de la reine Cécile-Renée d'Autriche (1611-1644) par Gonzales Coques, vers 1642, Collection particulière.
Portrait de Kasper Denhoff (1588-1645), voïvode de Sieradz ou Jean-Michel, vicomte de Cigala par Gonzales Coques, vers 1642 ou après 1651, Collection particulière.
Portrait équestre d'un noble polono-lituanien, peut-être Jan Stanisław Jabłonowski (1600-1647) par Gonzales Coques, vers 1642, Goodwood House.
Portraits du roi Ladislas IV Vasa et de sa sœur l'infante Anna Catherine Constance Vasa par Gaspar de Crayer
Le 6 octobre 1641, dans la cour du château royal de Varsovie, Frédéric-Guillaume (1620-1688), margrave héréditaire de Brandebourg, électeur de Brandebourg et duc de Prusse, rendit hommage au monarque élu de la République polono-lituanienne Ladislas IV Vasa. Il l'a fait en personne et non, comme il l'avait demandé, par l'intermédiaire d'un représentant autorisé, en raison des objections soulevées en Pologne. Le parlement a voulu durcir les conditions d'octroi du fief, soulignant que le père de Frédéric-Guillaume se soustrayait à l'accomplissement de ses devoirs de fief (d'après « Warmia i Mazury » de Stanisława Zajchowska, Maria Kiełczewska-Zaleska, tome 1, p. 140).
« Bien qu'électeurs du Saint Empire romain germanique, les prédécesseurs de Frédéric-Guillaume étaient extrêmement prudents et n'ont pas joué un rôle influent dans la politique allemande, restant parmi le deuxième rang des princes allemands. Leurs territoires étaient relativement petits et pauvres, dispersés dans la plaine du nord de l'Allemagne, sans défenses naturelles. Le Brandebourg était connu comme « le bac à sable de l'Europe » en raison de la pauvreté de son sol. Au total, ces territoires avaient une population d'environ 1,5 million d'habitants en 1648, et la capitale électorale de Berlin était une petite ville d'environ 12 000 habitants. La Prusse était un territoire un peu plus prometteur, car elle possédait plusieurs grandes villes prospères, dont la richesse était générée par le commerce lucratif du blé polonais expédié par les rivières jusqu'à la côte baltique où il était chargé sur des navires à destination de l'Europe occidentale » (d'après « Kings and Their Sons in Early Modern Europe » par Mark Konnert, p. 168). Cependant, en tant que dirigeant héréditaire et de plus en plus autoritaire, il disposait d'un certain avantage sur les monarques électifs de la République, dont le pouvoir était limité par le Sejm. Le duc allemand, qui rêvait d'unifier les pays germanophones et de créer un empire, était visiblement dégoûté par la diversité, le laxisme et l'apparent « désordre » de la cour royale de la République lors de sa visite à Varsovie. Le festin qui suivit l'hommage fut gâché par un grand nombre d'invités, dont beaucoup n'avaient pas d'invitation, et une mauvaise organisation, de sorte que même la table du roi était servie avec des plats à peine chauds et en petites quantités. Ainsi, lorsque le lendemain (8 octobre 1641), l'électeur reçut la cour royale dans son quartier général d'Ujazdów, il voulut faire preuve d'une bonne organisation. « Un festin assez convenable et copieux a été servi. Cette atmosphère agréable a été perturbée par la nouvelle du vol de 20 assiettes d'argent à l'électeur ». Les jours suivants, d’autres fêtes et festivités eurent lieu. Une magnifique favola drammatica sur Énée (L'Enea) de Virgilio Puccitelli a été jouée en italien et il y a eu un feu d'artifice sur la Vistule, qui cependant « n'a pas vraiment plu au roi ». Le 10 octobre, des bals ont eu lieu au château de Varsovie, auxquels a également participé Frédéric-Guillaume. « L'infante [Anna Catherine Constance] était également présente, ravie et trompée par l'espoir que l'électeur lui demanderait d'être sa compagne de vie », selon Albert Stanislas Radziwill. Cependant, les espoirs de l'infante se révélèrent illusoires. L'électeur est parti sans rien dire de ses intentions matrimoniales (d'après « Polityka pruska ... » de Józef Włodarski, p. 24). La demi-sœur de Ladislas pourrait offrir une dot substantielle, mais aucune revendication territoriale héréditaire significative. Anna Catherine Constance était également catholique, mais apparemment, du côté polonais, la religion n'était pas un gros problème. Le 7 décembre 1646, à La Haye, Frédéric-Guillaume conclut un mariage plus avantageux politiquement et territorialement, proposé par le diplomate brandebourgeois Joachim Friedrich von Blumenthal, comme solution partielle à la question de Juliers-Clèves-Berg, avec la princesse protestante Louise Henriette de Nassau (1627-1667), fille de Frédéric-Henri, prince d'Orange. Après la guerre de succession de Juliers (1609-1610), les territoires protestants (Clèves, Marc et Ravensbourg) passèrent au Brandebourg et les territoires catholiques (Juliers et Berg) furent attribués au Palatinat-Neubourg. En 1636, les ducs de Wittelsbach du Palatinat-Neuburg installèrent leur siège à Düsseldorf, car Juliers-Berg était nettement plus grand et plus important que Neubourg. Lorsqu'après la fin de la guerre de Trente Ans en 1648, Clèves passa officiellement aux mains de l'électeur de Brandebourg, devenant ainsi une enclave du margraviat de Brandebourg, Frédéric-Guillaume y résida également avec son épouse. A cette époque, Anna Catherine Constance, qui épousa à Varsovie en 1642 Philippe Guillaume de Neubourg (1615-1690), fils et successeur de Wolfgang Guillaume (1578-1653), comte palatin de Neubourg et duc de Juliers et Berg, résidait fréquemment dans la ville voisine de Düsseldorf (elle a été enterrée dans l'église des Jésuites de Düsseldorf). L'électeur et sa fiancée polono-lituanienne potentielle vivaient donc non loin l'un de l'autre. Les effigies d'une si riche princesse, sœur de deux monarques élus polono-lituaniens, cousine du roi d'Espagne et de l'empereur devaient être multiples avant le déluge, c'est l'une des « réalisations » douteuses du « Grand Électeur » et ses alliés, il en reste très peu aujourd’hui. Au Philadelphia Museum of Art se trouve un portrait de femme tenant un éventail de plumes blanches, attribué à l'école flamande ou hollandaise des années 1630 (huile sur toile, 200 x 117,8 cm, W1899-1-2). Le tableau a été acheté grâce au fonds W. P. Wilstach en 1899 et provient de la collection du baron français, collectionneur d'art et écrivain Jean-Charles Davillier (1823-1883). Dans le catalogue de peintures de 1899 des galeries Blakeslee, le tableau était répertorié comme « Portrait de la princesse Palatine » (Portrait of Princess Palatine), ce qui était très probablement le titre traditionnel de ce tableau, et avec attribution au peintre hollandais Pieter Codde (n° 34, p. 60-61), qui est désormais rejetée. Dans le même catalogue, on trouvait un portrait du beau-père d'Anna Catherine Constance, Wolfgang Guillaume, en costume espagnol, provenant de la collection du prince de Turn et de Saxe, peint par Antoine van Dyck ou son atelier (n° 48). Il s'agit d'une copie d'un portrait peint par van Dyck vers 1628, probablement à Anvers, qui provient de la galerie de Düsseldorf, aujourd'hui conservée à la Galerie nationale de Neuburg (402). Bien que le comte Palatin voyageait fréquemment, notamment à plusieurs reprises à Bruxelles, le tableau était très probablement réalisé à partir de dessins d'étude ou d'autres effigies. Le style du portrait en pied de Philadelphie ressemble beaucoup aux peintures attribuées à Gaspar de Crayer (1584-1669), peintre de la cour du gouverneur des Pays-Bas espagnols, le cardinal-infant Ferdinand d'Autriche, cousin d'Anna Catherine Constance. Parmi les œuvres analogues les plus proches figurent le portrait en pied de l'évêque Antoine Triest (1576-1657) datant d'environ 1627-1630 (Musée des Beaux-Arts de Gand, 1948-Z) et le Christ en croix entouré de donateurs, peint entre 1630-1658 (Collections du Centre Public d'Action Sociale de Bruxelles, T 20). La femme du tableau ressemble beaucoup à la princesse polono-lituanienne des portraits du Kunsthistorisches Museum de Vienne (GG 1732, GG 5611) et de l'Alte Pinakothek de Munich (6728). Son costume et sa pose sont également similaires à ceux des peintures mentionnées. Un autre portrait en pied peint de manière très similaire, tant en termes de style que de composition, est le portrait du demi-frère d'Anna Catherine Constance, le roi Ladislas IV, avec un lévrier, aujourd'hui conservé à l'Institut national de la culture populaire de Strážnice (huile sur toile, 224 x 148 cm, 771093). Il provient de la collection du seigneur de Strážnice - Francesco Magni (Franz Magnis von Straßnitz, 1598-1652), noble tchéco-morave issu d'une famille de marchands milanais, frère aîné de Valeriano Magni (Valerian von Magnis, 1586-1661), le moine capucin et diplomate à la cour de Ladislas IV. De 1646 à 1649, Francesco fut gouverneur du duché d'Opole et Racibórz, qui avait été promis à Ladislas IV en 1645 en échange des dots impayées de sa mère, de sa belle-mère et de son épouse, et du prêt qu'il avait consenti au empereur. En 1646, il s'installa à Varsovie et probablement à cette époque il reçut le portrait du roi, mentionné plus tard dans l'inventaire posthume de ses biens à Strážnice le 12 mars 1654. Dans ce portrait, le roi porte un costume français à la mode de l'époque - un chapeau de castor de style parisien (chapeau à la mousquetaire), un pourpoint avec un certain nombre de rubans avec des aiguillettes et des bottes d'équitation de le type « à revers épanoui » (d'après « Portrait of Władysław IV from the Oval Gallery ... » de Monika Kuhnke, Jacek Żukowski, p. 64, 66, 76). Le tableau a probablement été réalisé en même temps que le portrait de Ladislas au Château royal de Varsovie (ZKW 559 dép.) ou le peintre a utilisé le même ensemble de dessins d'étude ou d'effigies d'autres peintres de la cour. Le roi et sa sœur la princesse Palatine (Serenissima Principi ac Domina D. ANNÆ CATHARINÆ CONSTANTIÆ Comiti Palatina Rheni ..., comme l'appelle une gravure à son effigie du graveur néerlandais Theodor Matham) portent des costumes noirs, ce qui pourrait indiquer un deuil dans la famille, peut-être après la mort de la fille du roi Marie-Anne Isabelle (7 février 1642) ou de l'épouse du roi Cécile-Renée d'Autriche (24 mars 1644). Les traits du visage de Ladislas diffèrent légèrement des autres effigies du roi, ce qui est une autre indication que le portrait était basé sur des dessins d'étude. Le style de l'image du roi est similaire à celui de sa sœur et à d'autres peintures mentionnées de de Crayer. Certains éléments, comme les plumes ou le chien, ressemblent beaucoup au style d'un grand tableau d'autel de Gaspar, réalisé vers 1638 pour l'église Notre-Dame-Saint-Pierre de Gand et représentant saint Benoît recevant Totila, roi des Ostrogoths. Dans ce tableau, l'homme de gauche devant, tenant un marteau de guerre nadziak, est vêtu d'un costume typique des nobles polono-lituaniens ou hongrois-croates. Le tableau de Strážnice rappelle également le portrait de l'agent artistique de Ladislas, Jan Bierens (1591-1641), par de Crayer ou son atelier (Arnot Art Museum). Outre les agents permanents aux Pays-Bas espagnols comme Bierens et Georges Deschamps, de nombreux envoyés de la République étaient engagés dans différentes tâches de commande ou d'achat d'œuvres d'art pour le roi. En 1640, Bierens accueille Krzysztof Korwin Gosiewski (mort en 1643), voïvode de Smolensk et ambassadeur en France (« Sérénissime Xristophorus Corvinus Gosiewski, palatin de Smolenskouw etc., ambassadeur extraordinaire du Roy de Poloigne et de Suède vers le Roy de France »), qui a laissé avec lui plusieurs cartons destinés au transport vers la Pologne. Lors de son séjour à Anvers, Korwin Gosiewski présenta une demande auprès du cardinal-infant Ferdinand pour obtenir des exonérations des droits de douane et autres taxes communales. Le 12 mai 1640, le régent des Pays-Bas méridionaux accepta la sortie libre de ces objets d'Anvers (d'après « Liber memorialis Erik Duverger », p. 361).
Portrait du roi Ladislas IV Vasa (1595-1648) avec un lévrier par Gaspar de Crayer, vers 1642-1644, Institut national de la culture populaire de Strážnice.
Portrait de l'infante Anna Catherine Constance Vasa (1619-1651), princesse Palatine par Gaspar de Crayer, vers 1642-1644, Philadelphia Museum of Art.
Portraits de Jadwiga Łuszkowska et Jan Wypyski par Rembrandt et atelier
Ladislas IV Vasa a rencontré Jadwiga Łuszkowska lorsqu'il était à Lviv en 1634 avec ses demi-frères, Jean Casimir et Alexandre Charles Vasa. Le roi est venu dans la ville en raison de la situation polono-ottomane incertaine et de la menace de guerre.
Jadwiga est née vers 1616 à Lviv, en tant que fille d'un marchand Jan Łuszkowski (décédé en 1627) et de sa femme Anna (décédée après 1635). Elle et sa mère étaient alors dans de graves problèmes financiers, elles ont hérité des dettes du défunt Łuszkowski. Les tissus que lui et son partenaire ont achetés à crédit ont brûlé à Jarosław et les barges qui lui appartenaient et qui descendaient la Vistule jusqu'à Gdańsk ont coulé. Quelques jours après l'arrivée du roi à Lviv, Anna Łuszkowska lui a rendu visite, emmenant sa belle fille avec elle. Elle a dû faire une grande impression sur le roi, car peu de temps après la rencontre, la belle Jadwiga a quitté la maison dans laquelle elle avait vécu jusqu'à présent et a déménagé dans les appartements royaux et sa mère Anna a commencé à apporter de grosses sommes d'argent à la mairie, remboursant les créanciers, et bientôt elle acheta toute la maison, dont seule une partie lui avait appartenu jusqu'alors. Anna a également reçu, entre autres, le droit d'abattre du bois de chauffage dans les forêts royales et l'exonération des taxes municipales. Diverses rumeurs circulaient dans la ville et de gens envieux, comme Rafał Jączyński a décrit Jadwiga comme : femina formosa sed vitiata (une femme belle mais gâtée). Le grand chancelier de Lituanie, Albert Stanislas Radziwill, a écrit sur elle plusieurs années plus tard en tant que femme célèbre pour sa honte et son infamie. Ladislas emmena sa maîtresse avec lui à Varsovie et lui donna des chambres au deuxième étage du château royal. Quelques années plus tard, des chambres identiques, sauf celle du premier étage, seront occupées par sa femme Cécile-Renée d'Autriche. En 1635, Jadwiga donna naissance au fils du roi, Władysław Konstanty (Ladislas Constantin Vasa), et accompagna bientôt le monarque lors de son voyage en Prusse et Gdańsk, étant présent lors de la signature de la trêve polono-suédoise à Sztumska Wieś. L'envoyé français Charles Ogier qui l'a vue à Gdańsk a écrit dans son journal le 1er février 1636 : « Après le petit déjeuner, j'ai pu assister confortablement au départ de la maîtresse du roi, que j'avais bien envie de voir. Elle est très belle, et aussi pleine de charme, avec des yeux et des cheveux noirs, et un teint très lisse et frais. Mais elle n'a pas la pleine liberté, car elle est constamment gardée par des hommes et des femmes ». La position de Jadwiga offensait la noblesse polonaise conservatrice, on parlait de débauche au château royal et Ladislas était appelé publicus concubinariusi (adultère public). Les sénateurs ont exprimé ouvertement leur mécontentement, et même l'Église a été impliquée dans l'affaire. Le nonce papal Honorato Visconti a déclaré que la belle Jadwiga avait pris le roi au piège de la magie et le primat Jan Wężyk la soupçonnait également de pouvoirs obscurs. Le roi, cependant, continua à vivre avec sa favorite. L'idylle a été détruite par le mariage du roi avec l'archiduchesse Cécile-Renée en 1637. La nouvelle reine, placée dans les chambres du premier étage juste en dessous des chambres de Jadwiga, a fait pression sur Ladislas pour qu'il se débarrasse de sa belle maîtresse de la cour. Il ne voulait pourtant pas la perdre. Elle s'installe d'abord au château royal d'Ujazdów à Varsovie. Lorsque la reine furieuse apprend la romance toujours en cours, ordonne à Łuszkowska d'être renvoyée à Lviv. Bientôt, le château d'Ujazdów devait être décoré de grandes toiles glorifiant la reine, décrites dans la « Brève description de Varsovie » d'Adam Jarzębski de 1643, qui sait, peut-être créées par Rembrandt. Économiquement, la République polono-lituanienne était fortement associé à la République des Provinces-Unies, mais politiquement, en raison des liens familiaux des Vasa et des Habsbourg, ils étaient des opposants, par conséquent, aucun monarque polonais ne pouvait ouvertement patronner un artiste en Pays-Bas. En 1637, Jadwiga épousa Jan de Wypych Wypyski des armoiries de Grabie, l'un des courtisans du roi, à qui le roi donna la terre de Merkine dans les forêts de Niémen en Lituanie, son lieu de chasse préféré. Ce don a donné lieu à une blague de cour en latin selon laquelle le roi n'a pas donné à Wypyski la terre de Merkine (merecensem) mais la terre de la prostituée (meretricensem). Wypyski, qui entre 1626 et 1628 était notaire à la cour, devint également porte-étendard de Nur et écuyer royal en charge des écuries du roi et il reçut des terres à Varsovie. Les secrétaires et les notaires étaient des gens instruits qui connaissaient les langues étrangères, tout comme Wypyski. Il n'y a aucune information s'il avait des enfants, il est possible qu'il ait préféré les hommes aux femmes, par conséquent, épouser la favorite du roi ne serait pas un grand sacrifice pour lui. Même si la belle Jadwiga a quitté la cour et la capitale avec son mari, elle a été visitée par le roi chaque fois que possible. Il y est resté plusieurs mois. Ladislas IV aimait particulièrement la chasse et organisait des chasses à l'épervier et au faucon pour les hérons blancs afin d'obtenir des rajer (longues plumes sur la tête d'un héron), comme élément de décoration du chapeau. Si le héron n'était pas gravement blessé, l'oiseau était relâché. Une fois, le roi a ordonné un anneau d'or pour le héron libéré à porter autour du cou de l'oiseau portant la date du 18 mai 1647. Le même héron fut capturé avec un faucon par le roi Jean III Sobieski en juillet 1677. Łuszkowska était encore en vie le 20 mai 1648, lorsque le roi Ladislas IV mourut à Merkine. Une légende romantique raconte que le roi mourut dans les bras de sa bien-aimée Jadwiga. Wypyski mourut avant le 18 décembre 1647, et il fut remplacé comme staroste de Merkine en 1651 par Krzysztof Buchowiecki, donc la terre de Merkine a été gouvernée par Jadwiga après la mort de Wypyski. Vers 1650, Władysław Konstanty, agé de quinze ans, le fils de Jadwiga, partit, suivant la coutume des adolescents de l'époque issus de familles riches, pour un voyage à travers l'Europe. Il n'est jamais retourné en Pologne. En Europe, il était connu sous le nom de comte de Wasenau. L'estampe de Jean Michel Moreau, créée en 1763 (copie à la Galerie Nationale Slovaque, numéro d'inventaire G 2402), est peut-être la confirmation la plus ancienne et la plus précise de la propriété du tableau de Rembrandt, connu sous le nom de La toilette de Bethsabée, aujourd'hui au Metropolitan Museum of Art. Des tableaux similaires sont également mentionnés dans les inventaires de la collection de Willem Six à Amsterdam en 1734 (catalogue de vente : « L'Histoire de Bethsabée, de Rembrandt van Rijn ») et dans la collection de Gerard Bicker van Zwieten à La Haye en 1741 (catalogue de vente : « Bethsabée dont les cheveux ont été coupés et dont les pieds ont été lavés, par deux femmes, très inhabituel [Rembrand van Ryn] »), cependant ils pourraient équivaloir à un autre tableau attribué à Rembrandt ou à son atelier aux dimensions et composition similaires, qui est aujourd'hui aux Pays-Bas (Museum Catharijneconvent à Utrecht, RMCC s172). Ce dernier tableau, à Utrecht, est daté d'environ 1645 et et intitulé « Bethsabée à sa toilette espionnée par David » (Batseba bij haar toilet door David bespied, d'après « De schilderijen van Museum Catharijneconvent », 2002, p. 249). La peinture du Metropolitan Museum of Art, selon l'estampe de Moreau, était en 1763 dans la galerie du comte Bruhl, Premier ministre de Sa Majesté le roi de Pologne et électeur de Saxe (« D'après le tableau de Rembrandt, qui est dans la Gallerie de S.E.M.gr Le Comte de Bruhl, Premier Ministre de S.M. Le Roi de Pologne, Electr. de Saxe »). Pendant la guerre de Sept Ans (1756-1763), lorsque l'armée prussienne envahit la Saxe, il vécut principalement en Pologne, où à Varsovie il avait trois palais - un près du champ électoral à Wola, construit vers 1750, un à Młociny, construit entre 1752-1758, et le plus grand, l'ancien palais Sandomierski, au centre. Le palais Sandomierski a été construit entre 1639 et 1642 par Lorenzo de Sent pour le grand chancelier Jerzy Ossoliński, un ami de Ladislas IV. Il ne peut être exclu que Bruhl ait acquis le tableau en Pologne. De telles peintures sont documentées dans les collections des magnats de la République au XVIIe siècle. Par exemple, l'inventaire de la collection de la princesse Louise Charlotte Radziwill (1667-1695), dressé en 1671, recense deux tableaux de David et Bethsabée : « Le roi David voyant la femme d'Urie depuis le palais » (348/1) et « Le roi David avec la femme d'Urie, cadres dorés » (811/3). L'une des œuvres les plus importantes du peintre de la cour de Ladislas IV, Bartholomeus Strobel, dès les débuts de son œuvre, est également « David et Bethsabée ». Le tableau de Strobel, aujourd'hui conservé au château de Mnichovo Hradiště en Tchéquie, a été peint pour le chanoine de Wrocław Philipp Jakob von Jerin et signé par l'artiste (B. Strobel pinxit et d.d.Phil.Iac. / a Ierin Canonico Wratislauiensi. / Kal.Maij.Anno 1630). Comme le tableau du Prado, il était rempli d'effigies déguisées de dames de la cour impériale de Prague ou de riches patriciennes de Wrocław. Le roi David est presque invisible debout sur la haute terrasse à gauche. Les ruines de l'amphithéâtre et l'obélisque devant ressemblent étroitement aux structures montrées dans le portrait du joaillier royal Giovanni Jacopo Caraglio par Paris Bordone (Château royal de Wawel). Au centre de la composition, au milieu de la forêt dense se trouve Bethsabée, nue, tandis que ses servantes lui brossent les cheveux « blond vénitien » et lui coupent les ongles, exactement comme dans le tableau représentant Zuzanna Orłowska, maîtresse du roi Sigismond II Auguste, en Suzanne au bain par Jacopo Tintoretto (Musée du Louvre). Une perdrix aux pieds de Suzanne, symbole du désir sexuel, est dans la peinture de Rembrandt remplacée par un paon, symbole de l'immortalité (d'après « Signs & Symbols in Christian Art » de George Ferguson, p. 23). Puisque l'oiseau est assis sur le nid avec son partenaire, c'est un symbole d'amour éternel et de partenariat. La vieille femme aux lunettes coupant les ongles de Bethsabée ressemble beaucoup à celle représentée dans un dessin de Rembrandt de la collection du prince Henryk Lubomirski (1777-1850) à Lviv, aujourd'hui à l'Ossolineum (Musée Lubomirski) à Wrocław. Il s'agit très probablement de la mère de la femme représentée en Bethsabée. Fait intéressant, la même collection comprend également un autre dessin de Rembrandt, montrant une femme tenant un enfant et daté d'environ 1635, lorsque Jadwiga a donné naissance à un fils. Ces dessins étaient-ils donc des travaux préparatoires aux images de la maîtresse royale, de son fils nouveau-né et de sa mère envoyés en Pologne pour approbation ? Selon la Bible, le roi David, alors qu'il se promenait sur le toit du palais, aperçoit par hasard la belle Bethsabée, la femme d'un soldat loyal de son armée, se baignant. Il l'a désirée et l'a mise enceinte. Le tableau est une allusion, exactement à l'effigie de Katarzyna Telniczanka, maîtresse du roi Sigismond Ier, en Bethsabée par Lucas Cranach l'Ancien (Gemäldegalerie à Berlin) et a une composition similaire. Łuszkowska, qui vivait dans des résidences royales, connaissait parfaitement les peintures de la collection royale, qui étaient souvent réalisées en série pour divers parents. Le tableau de la collection Bruhl a été signé et daté par l'artiste : Rembrandt. ft/1643. La femme, bien que les cheveux non décolorés, a également été représentée dans un portrait de Rembrandt, également créé en 1643 (Rembrandt f. 1643), qui se trouve aujourd'hui à la Gemäldegalerie de Berlin. L'œuvre est probablement entrée dans la collection de Frédéric III de Prusse au palais de la ville de Potsdam entre 1689 et 1698. Le palais de Potsdam a été construit sur le site d'un édifice antérieur de 1662 à 1669 construit pour le père de Frédéric, Frédéric-Guillaume (1620-1688) , électeur de Brandebourg et duc de Prusse, qui en 1656, pendant le déluge, selon Wawrzyniec Jan Rudawski, « emporta en Prusse comme butin, les peintures les plus précieuses et l'argenterie de la table royale ». La femme ne peut pas être l'épouse de Rembrandt car elle est décédée le 14 juin 1642. Elle porte un chapeau, très probablement un chapeau de fourrure, orné de bijoux, très similaire au kołpaczek du costume féminin traditionnel polonais. Sa pose est identique à celle du tableau de la collection Bruhl. Elle était également représentée dans un autre tableau de Rembrandt et son atelier, également créé en 1643 (Rembrandt f/1643), aujourd'hui dans la collection privée. Ses cheveux sont décolorés, elle tient un éventail et sa tenue est similaire à celle du tableau de Berlin. Elle porte une toque brodée d'or, semblable au balzo italien visible sur le portrait de la reine Bona Sforza par Titien, identifié par moi (collection particulière), une décoration de chapeau (egreta) avec une plume, un manteau d'étoffe chère doublé de fourrure et bijoux. La tenue dans les deux tableaux est très similaire au costume de Raina Movila (Regina Mohylanka) de Moldavie (vers 1589-1619), la princesse Vychnivetska (portrait au Musée historique national d'Ukraine), décédée à Vychnivets (environ 150 km à l'est de Lviv) ou aux costumes de dames dans le tableau « La découverte de la croix » de Tomasz Muszyński à Lublin (sud-est de la Pologne), créé entre 1654-1658. Alors qu'en 1642, la reine de Pologne, Cécile-Renée d'Autriche, demanda à son frère de lui envoyer de la dentelle néerlandaise et une poupée vêtue d'une tenue française à la mode et des portraits de la reine et de sa belle-sœur Anna Catherine Constance par le peintre néerlandais Peter Danckers de Rij montre l'abondance de dentelles et de costumes français, la femme des peintures de Rembrandt a opté pour le costume oriental. Le modèle des trois tableaux mentionnés ressemble au portrait d'un garçon, identifié comme étant le portrait de Władysław Konstanty, à la Galerie nationale de Prague (O 8675). Un pendant au portrait tenant un éventail est un portrait d'homme tenant un épervier (Le fauconnier), également en collection privée et également signé et daté par l'artiste ([Re]mbrandt f 1643). C'est le mari de la femme. Si Wypyski débuta sa carrière à la cour en 1626 vers l'âge de 20 ans, il avait environ 37 ans en 1643. L'épervier de haut vol est un symbole de royauté (et donc d'autorité, de souveraineté). L'homme invite à la chasse et pointe la femme dans le portrait en pendant.
Vieille dame à lunettes par Rembrandt, vers 1635, Ossolineum à Wrocław.
Femme tenant un enfant par Rembrandt, vers 1635, Ossolineum à Wrocław.
Portrait de Jadwiga Wypyska née Łuszkowska (vers 1616 - après 1648) dans un chapeau noir par Rembrandt, 1643, Gemäldegalerie à Berlin.
Portrait de Jadwiga Wypyska née Łuszkowska (vers 1616 - après 1648) en Bethsabée au bain par Rembrandt, 1643, Metropolitan Museum of Art.
Portrait de Jan Wypyski, staroste de Merkine tenant un épervier par Rembrandt et atelier, 1643, Collection particulière.
Portrait de Jadwiga Wypyska née Łuszkowska (vers 1616 - après 1648) tenant un éventail par Rembrandt et atelier, 1643, Collection particulière.
Portrait de Constantia Kerschenstein née Czirenberg par Pieter Claesz. Soutman
« Vous demandez pourquoi Constantia est entourée de la gloire de ce siècle ? Elle est la plus grande parmi les Muses, ainsi que la plus grande parmi les Charites [Grâces], Elle est supérieure aux hommes et fait taire les dieux. Par sa parole, sa fidélité, voix, et charme extraordinaire, elle est louée par Gdańsk et toute la Pologne l'admire. C'est ainsi que les mortels peuvent s'élever au-dessus des dieux » (AN quæ sit CONSTANTIA secli gloriæ quæris? / Maxima Musarum, Maxima & est Charitum. / Hæc homines vincit, contrabit ora Deorum / Eloquio, fidibus, voce, lepore sibi; / Suspicit hanc Gedanum, celebratqe; Polonia tota, / Hoc est mortales, hoc superare Deos) (en partie d'après la traduction polonaise d'Andrzej Januszajtis dans « Kwiaty dla Konstancji »), fait l'éloge de la célèbre chanteuse Constantia Czirenberg (1605-1653), le prêtre Lorenzo Frissone (Laurentius Frissone). Cette dédicace fut publiée à Milan en 1626 dans « Les Fleurs des hommes les plus illustres » (Flores praestantissimorum virorum) de Filippo Lomazzo (Philippo Lomacio).
Constantia, fille de Johann Czirenberg (Zierenberg), maire et burgrave royal de Gdańsk, principal port de la République polono-lituanienne, et d'Anna Kerl, a reçu une excellente éducation. Elle parlait couramment l'allemand, le polonais, le français, l'italien et le latin, jouait du clavicorde et s'accompagnait au chant. Elle dessinait, peignait et brodait magnifiquement. Son père, qui a étudié à Gdańsk, Cracovie et Leipzig, était l'un des dirigeants calvinistes les plus actifs et était l'auteur des écrits théologiques polémiques contre les dirigeants des luthériens de Gdańsk. En 1628, Constantia épousa Sigismund Kerschenstein (également Siegmund, Zygmunt Kirszensztein ou Kerssenstein ; 1583-1644) avec qui elle eut trois enfants : Ludwig (né en 1629, qui épousa à Amsterdam le 20 octobre 1656 Maria von Rote), Constantia (1631) et Anna (1633). Connue pour sa beauté et son talent musical, Czirenbergówna ou Kerschensteinowa, comme on l'appelle également en Pologne, a rapidement attiré l'attention d'un célèbre mécène et connaisseur de musique et d'opéra italien, le prince Ladislas Sigismond Vasa. Ils se sont probablement rencontrés pour la première fois lors de sa visite à Gdańsk en 1623, peu avant son départ pour les Pays-Bas espagnols et l'Italie (1624-1625), et c'est sans doute le prince qui la recommanda en Italie. La dédicace de Lomazzo dans l'œuvre mentionnée semble le confirmer, ainsi que le fait qu'elle s'est également produite à Varsovie ou à Cracovie, à la cour de Sigismond III, avant de partir pour l'Italie : « La gloire de vos vertus ne pouvait être contenue dans le frontières de la Pologne, même les plus larges, ainsi ici, avec la renommée et la recommandation la plus fidèle de ton nom, a atteint l'Italie et Milan. [...] Que tu as les mains les plus habiles, les doigts les plus adroits pour jouer, une gorge de rossignol pour chanter, afin qu'en chantant avec les artistes et maîtres les plus éminents de l'Invincible Roi de Pologne et de Suède et maîtres de sa cour, comme le Prince lui-même le jugeait avec délice, vous n'hésitiez pas à rivaliser ». Elle divertit probablement Ladislas, déjà roi, avec sa musique lorsqu'il était l'invité de son père lors de sa visite à Gdańsk en 1634. Au cours de ce séjour, le roi commanda de nombreux portraits et autres œuvres d'art à des artistes locaux, ainsi qu'aux Pays-Bas (comprenant très probablement une estampe de Claes Jansz. Visscher basée sur un dessin ou une peinture de Pieter Claesz. Soutman). Charles Ogier (1595-1654), secrétaire de l'envoyé français Claude de Mesmes, comte d'Avaux, qui la rencontra en novembre 1635, écrit dans son journal qu' « elle a une voix extrêmement belle et chante à l'italienne ». Dans ses Caroli Ogerii Ephemerides ..., publiés à Paris en 1656, il inclut également un poème qui lui est dédié - Sireni Balthicæ Constantia Sirenbergiæ, dans lequel il l'appelle la Sirène de la Baltique et de la Sarmatie (Siren Baltica, Sarmaticas ; Sirenberg - montagne de sirène en allemand), qui séduisit le roi par sa voix (Quin ipsum, spiraret adhuc cum pectore Martem, VLADISLAVM carmine distinuit. Ille tuis pronam, CONSTANTIA, cantibus aurem Præbuit, ad laudes obstupuitque suas, p. 506-507). Lors de la visite du roi dans la ville en 1636, lors d'une fête chez Brigida Schwartzwald le 7 février, Ladislas lui témoigna une attention particulière « et souhaita que seule Constantia soit assise en bout de table ». Ogier et l'envoyé français étaient des invités chez elle, et dans une note du 29 avril 1636, il ajoute : « J'ai passé l'après-midi avec Mme Constantia, qui, comme d'habitude, était assise avec son mari malade. Pendant qu'il me disait des choses intéressantes, elle me montrait ses ornements féminins, tels que des chaînes, des bracelets, des diadèmes et beaucoup de perles blanches, mais pas rondes; elle m'a informé des différents costumes d'elle et de la nation polonaise. Et quand elle a placé devant mes yeux les bonnets, les gants, les ceintures et autres choses de celles qu'elle avait elle-même tissées et décorées de broderie, il semblait que je suis tombé sur Pallada elle-même » (d'après la traduction polonaise de Zenon Gołaszewski). Comme la majorité des dames de Gdańsk, elle préférait probablement la mode locale avec une collerette et un bonnet perlé ou orné de bijoux, mais comme les influences néerlandaises étaient alors importantes à Gdańsk, elle s'habillait probablement aussi dans le style hollandais ou flamand. Sa famille vivait dans une maison construite ou reconstruite vers 1620 par Abraham van den Blocke, architecte et sculpteur d'origine flamande. Une belle épithaphe en marbre de style hollandais-flamand du grand-père et de la grand-mère de Constantia dans l'église Sainte-Marie de Gdańsk, réalisée en 1616, est également attribuée à Abraham van den Blocke. Elle mourut en 1653, pendant la peste, et fut également enterrée dans l'église Sainte-Marie. Il devait y avoir de multiples effigies d'une telle star de la musique du XVIIe siècle. A cette époque, les portraits de chanteurs étaient réalisés par les meilleurs artistes, comme Andrea Sacchi à Rome, qui peignit en 1641 le chanteur castrat Marc'Antonio Pasqualini (1614-1691), qui se produisit en 1634 devant le frère du roi Alexandre Charles. Le roi possédait sans doute plusieurs portraits de Czirenbergówna, mais aujourd'hui aucun n'est connu. Même si les collections royales ont été en grande partie dispersées ou détruites, comme la magnifique salle d'opéra construite vers 1635 au château royal de Varsovie par l'architecte, ingénieur et scénographe italien Agostino Locci, certains vestiges ont dû survivre. Au Musée national de Varsovie se trouve un portrait de femme attribué à Pieter Claesz. Soutman, qui travailla fréquemment pour Ladislas IV (huile sur panneau, 69 x 58,7 cm, M.Ob.528 MNW, déposée au Palais-sur-l'Île à Varsovie, Dep 928). Le tableau provient de la collection du dernier monarque élu de la République Stanislas Auguste Poniatowski et en bas à droite, le numéro d'inventaire rouge de sa galerie - 1374, est encore visible. Dans le catalogue de 1795 de la collection du roi, il figurait comme « Portrait de femme a mi corps, costume ancien, large fraise au col, sur bois », sans attribution. Son histoire antérieure est inconnue, on ne peut donc pas exclure qu'il provienne de collections royales historiques qui ont survécu au déluge (1655-1660) et aux invasions ultérieures. La femme affiche fièrement son riche costume, comprenant un bonnet et des manchettes en dentelle qu'elle a probablement confectionnés elle-même. Un voile noir transparent et une robe sombre indiquent qu'elle est probablement en deuil. Selon une inscription latine originale au centre droit, à peine visible aujourd'hui, la femme avait 38 ans en 1644 (Ætatis / suæ 38 / 1644), exactement comme Kerschensteinowa, qui, à la mort de son mari le 22 mai 1644, pouvait encore prétendre avoir 38 ans (né le 6 octobre 1605). Son costume est de style nordique, mais des costumes similaires étaient populaires dans toute la République polono-lituanienne dans la première moitié du XVIIe siècle, comme le montre par exemple le portrait du peintre de Cracovie représentant une famille noble comme donateurs datant d'environ 1620 (Musée national de Cracovie). Comme beaucoup d'autres œuvres, le tableau a été commandé aux Pays-Bas, soit par le roi, soit par Constantia, en raison de la bonne liaison maritime entre Gdańsk et Amsterdam (transport régulier de céréales) et des prix très probablement compétitifs proposés par les peintres et autres artisans qualifiés. Comme bon exemple d'une telle pratique, on peut citer qu'avant 1643 la page de titre du Tratado dela artilleria yuso della platicado ... de Diego Ufano, traduit de l'allemand vers le polonais par Abraham Ciświcki, à l'effigie de Ladislas IV Vasa et vue de Smolensk (Archelia albo Artilleria, to iest Fvndamentalna Y Doskonała Informacya o Strzelbie, publié à Leszno en 1643), a été créé par Crispijn van de Passe le Jeune (signé : C. de Pas Inventer), actif à Amsterdam à partir de 1639, où il fonda sa propre entreprise d'imprimerie et d'édition (comparer « Printmaking in the Age of Rembrandt » par Clifford S. Ackley, p. 94).
Portrait de la chanteuse Constantia Kerschenstein née Czirenberg (1605-1653), âgée de 38 ans, en deuil par Pieter Claesz. Soutman, 1644, Musée national de Varsovie.
Cartouche avec fleurs et portrait de la reine Cécile-Renée d'Autriche par Daniel Seghers et Gaspar de Crayer
« Les chambres sont grandes, mais elles contiennent toutes sortes de richesses. Meubles, métiers de maître, arts d'or des Pays-Bas; d'un côté et de l'autre, chez la plus glorieuse patronne, il y a l'union de sainte Cécile, lys céleste, où la capella [orchestre] chante les vêpres, royalement : gioia bella ! [belle joie]" (Pokoje pomiernie wielkie, / Ale w nich dostatki wszelkie, / Ochędóstwa, kunszty pańskie, / Złote sztuki niderlandzkie; / Po tej i po drugiej stronie, / Przy najaśniejszej patronie, / Tam jest świętej Cecylijej / Związek, niebieskiej lilijej, / Gdzie śpiewa nieszpór capella / Pokrólewsku: gioia bella!), décrit la salle du palais Villa Regia à Varsovie, Adam Jarzębski dans son « La route principale ou un court description de Varsovie » (Gościniec abo krótkie opisanie Warszawy) de 1643 (vers 1953-1962).
Le tableau, probablement une peinture au plafond sur toile ou une fresque, représentait le mariage du saint patron des chanteurs et des musiciens. Cette scène doit avoir été commandée par Ladislas IV Vasa, grand mécène des arts et connaisseur de musique et d'opéra, également pour honorer la nouvelle reine Cécile-Renée d'Autriche Il est possible que la sainte ait les traits de la reine, mais on ne sait rien d'autre de ce tableau. À cette époque, même la reine d'Angleterre était représentée par van Dyck sous les traits d'un saint chrétien. Parmi les auteurs possibles figuraient des peintres de la cour du roi, représentant les principales écoles de peinture baroque – d'Europe centrale, italienne, flamande et hollandaise. S'il s'agissait d'une peinture sur toile, il est possible qu'elle ait été réalisée à l'étranger, en Flandre, aux Pays-Bas ou en Italie. C'est avant le mariage avec sa cousine en 1637 (Cécile-Renée était une fille de l'oncle de Ladislas et ils étaient liés par Anna Jagellon, reine d'Allemagne, de Bohême et de Hongrie), que le roi décida de reconstruire le palais. A l'occasion de l'arrivée, du mariage et du couronnement de Cécile-Renée, Ladislas ordonna également de monter un opéra dédié à son épouse et faisant référence à sa patronne, « Sainte Cécile » (La S. Cecilia : Dramma Mvsicale, Con Gl'Intermedii Favolosi Rapresentato Nelle Reali Nozze, Delle Maesta Di Polonia E Svezia Vladislao IV E Cecilia Renata). Le livret a été écrit par Virgilio Puccitelli, secrétaire royal, la musique a été composée par Marco Scacchi, chef d'orchestre royal et la scénographie et la construction des machines scéniques ont été confiées à Agostino Locci. Le roi et la reine partageaient l'amour de la musique et à une autre occasion, en 1638, il y eut un concert pour violon et douze trompettes. Cécile-Renée et Ladislas, naviguant sur la Vistule en bateau, pouvaient écouter de la musique venant des deux rives du fleuve. Il y avait des violonistes d'un côté et des trompettistes de l'autre (d'après « Wkład królowej Cecylii Renaty ... » d'Anna Burkietowicz, p. 19). À cette époque, des portraits et autres peintures étaient fréquemment envoyés à différents membres de la famille, de sorte que les Habsbourg autrichiens et espagnols recevaient très probablement de nombreuses effigies de Cécile-Renée. L'inventaire (Inventarium) de 1659 des collections de l'archiduc Léopold Guillaume au Stallburg à Vienne répertorie deux portraits en pied de sa sœur, lorsqu'elle était reine (n° 811) et lorsqu'elle était archiduchesse (n° 813), tous deux réalisés par Frans Luycx et le portrait en pied de sa cousine l'infante Anna Catherine Constance Vasa (n° 812), également de Luycx, aujourd'hui conservé au Kunsthistorisches Museum (GG 1732). L'inventaire répertorie également un portrait de « Pierre le long », le peintre du roi de Pologne (langen Peter, Königs in Pohlen Mahlers, n° 722), très probablement Pieter Claesz. Soutman, par Antoine van Dyck, probablement le tableau aujourd'hui conservé au Louvre (INV 1248 ; MR 671) ou une copie de celui-ci, et une copie d'une image miraculeuse de la Vierge à l'Enfant de Pologne, peinte sur cuivre, par un peintre inconnu (n° 281) (comparer « Inventar und Kunstsammlung des Erzherzogs Leopold Wilhelm ... » d'Adolf Berger). Il est intéressant de noter que le Kunsthistorisches Museum de Vienne n'a conservé qu'une seule image de la reine de Pologne, qui peut sûrement être considérée comme son portrait, portant au dos une inscription en italien : LA REGINA CECILIA RENATA DI POLONIA 1642 (GG 8291), probablement peinte par atelier de Frans Luycx, les trois autres sont des effigies de sa belle-sœur Anna Catherine Constance (GG 1732, GG 5611, GG 7944), identifiée par mes soins. Dans le musée viennois se trouve une effigie semblable à d'autres effigies de Cécile-Renée - Portrait féminin dans une couronne de fleurs (huile sur panneau, 76,5 x 58 cm, GG 9105). Il provient de la collection de l'archiduc Léopold Guillaume et dans l'inventaire de 1659 il était répertorié sous la référence « 48. Une effigie en peinture à l'huile sur bois d'une dame, autour d'elle trois festons avec des fleurs différentes. [...] Le portrait est d'un peintre inconnu, mais les fleurs sont de F. Segers, jésuite » (48. Ein Contrafäit von Öhlfarb auff Holcz einer Damen, darumben drey Festonen mitt vnderschiedtlichen Blumen. [...] Das Contrafäit von einem vnbekhandten Mahler, die Blumen aber vom F. Segers, Jesuitter.), soit Daniel Seghers (1590-1661), principalement actif à Anvers. Seghers s'est spécialisé dans les natures mortes de fleurs, c'est pourquoi il a fréquemment coopéré avec d'autres peintres, tels que Cornelis Schut, Pierre Paul Rubens, Gonzales Coques et d'autres, qui ont peint la scène figurative centrale ou le portrait. Un portrait assez comparable du frère de la reine réalisé par Seghers de 1647 à 1651, sous forme de buste (peint par Jan van den Hoecke), se trouve aujourd'hui à la Galerie des Offices à Florence (Inv. 1890, 1085). Il fut légué à l'empereur Léopold Ier en 1662. La femme de ce portrait est également identifiée comme la sœur de Cécile-Renée, l'archiduchesse Marie-Anne (1610-1665), électrice de Bavière, mais elle était le plus souvent représentée dans un costume d'Europe centrale inspiré de la mode espagnole ou italienne (par exemple, peintures de Joachim von Sandrart de 1643 et après - Kunsthistorisches Museum, GG 8034 et Alte Pinakothek de Munich, 3093) et non française, comme la femme de ce tableau. Son costume ressemble particulièrement à celui représenté dans un portrait de la cousine de Ladislas IV, Anne d'Autriche (1601-1666), reine de France au monastère des Visitandines à Varsovie. Le portrait de la reine de France a très probablement été peint par Charles Beaubrun à la fin des années 1630 ou au début des années 1640, comme des tableaux similaires d'Anne de 1638 et 1639. Près de son cœur, comme dans de nombreuses effigies du mari de Cécile-Renée, par exemple au palais de Wilanów (Wil.1143) et au château royal de Varsovie (ZKW 559 dép.) ou le portrait de la reine au musée national de Stockholm (château de Gripsholm, NMGrh 1417), on voit un bijou sur un ruban. C'est une « faveur » censée indiquer un nœud d'amour et 14 objets de bijoux évoquant des faveurs sont mentionnés dans l'inventaire du roi de 1646. « Les faveurs au sens plus large, les gioie da petto, bijoux d'amour élaborés portés sur le sein gauche ou sur l'épaule gauche, ont été promues pour la première fois dans la Rzeczpospolita [République] par les reines Anna et Constance d'Autriche » (d'après « Favors and love locks ... » de Jacek Żukowski, p. 46). La femme dans ce portrait ressemble beaucoup à la reine de Pologne dans le portrait mentionné à Stockholm, dans un tableau de Wilanów (Wil.1144), ainsi que dans des effigies du Victoria and Albert Museum (P.57-1929) et du château de Gripsholm (Nationalmuseum, NMGrh 299). L'ensemble de la composition avec des fleurs peut faire référence à la sainte patronne de Cécile-Renée - sainte Cécile. « Dans la Legenda Aurea de Jacobus de Voragine et son dérivé, le Conte de la deuxième nonne de Chaucer, des couronnes de lys et de roses sont apportées par un ange aux futurs martyrs Cécile et à son mari après qu'elle l'ait converti au christianisme et à la continence » (d'après « St. Cecilia's Garlands and Their Roman Origin » par John S. P. Tatlock, p. 169). On peut voir des couronnes florales similaires avec des roses dans plusieurs tableaux représentant la sainte, comme Sainte Cécile dans une bordure de fleurs de Michel Bouillon, milieu du XVIIe siècle (Maison de ventes Setdart à Barcelone, 7 septembre 2022, lot 79), Sainte Cécile portant une couronne de fleurs de Cesare Dandini, années 1640 (Dorotheum à Vienne, 18 avril 2012, lot 743), Sainte Cécile portant une couronne de fleurs (Personnification de la musique) d'Antonio Franchi, vers 1650 (Sotheby's à Londres, 8 juillet 2004, lot 159), Sainte Cécile portant une couronne de fleurs et jouant de l'orgue d'Onorio Marinari ou cercle, vers 1686 (Dorotheum à Vienne, 14 décembre 2010, lot 189) ou Sainte Cécile jouant de l'orgue de Sebastiano Conca, 1735-1745 (Sotheby's à New York, 7 juillet 2016, lot 189). Les contacts de Daniel Seghers avec des clients de Pologne-Lituanie sont bien documentés. En 1637 Jan Zawadzki (mort en 1645), envoyé de Ladislas IV de retour de Paris, achète le tableau représentant : « Une guirlande de roses avec Jésus et saint Jean [le Baptiste] par M. [Cornelis] Schut pour l'ambassadeur Sawaski, qui l'a présenté au roi de Pologne » (Een feston van Roosen met Jezus en S. Jan van Sr. Schut voor den Ambassadeur Sawaski die het heeft geschonken aen den koning van Polen). Seghers a créé un cartouche pour la reine Marie-Louise de Gonzague dans lequel se trouvait sainte Anne de Quellinus (17-20 décembre 1645), très probablement le tableau du Worcester Art Museum (1966.37), peint avec Erasmus Quellinus le Jeune. En 1645, l'autre envoyé du roi, Krzysztof Opaliński (1609-1655), voïvode de Poznań, acheta à Anvers de nombreux tableaux, originaux et copies « des maîtres eux-mêmes. Les jésuites m'ont aidé en cela », comme il l'écrivait dans une lettre à son frère daté du 9 octobre (comparer « Rubens w Polsce » de Juliusz A. Chrościcki, p. 181). À cette occasion, Opaliński a commandé une estampe à Lucas Vorsterman (Musée national de Cracovie, MNK III-ryc.-40483), dont une étude a été réalisée par Abraham van Diepenbeeck (Musée Czartoryski, MNK XV-R.1111). À cette époque, van Diepenbeeck a créé une autre étude pour une estampe ou une peinture d'autel représentant la Vierge à l'Enfant intronisée vénérée par trois saints (Rijksmuseum Amsterdam, RP-T-1985-118). Le premier personnage de gauche tenant un crucifix est identifié comme représentant peut-être saint Henri d'Allemagne, mais un lys et un chapeau oriental à ses genoux indiquent qu'il s'agit de saint Casimir Jagellon (à comparer avec l'effigie de ce saint publiée à Douai en 1638, MNK III-ryc.-28781). L'auteur du portrait de la reine Cécile-Renée à Vienne n'était pas mentionné dans l'inventaire de 1659 de la collection de son frère, ce qui est une autre indication que l'auteur de cet inventaire était son « valet et trésorier » autrichien (Kammerdiener und Schatzmeister) Christian Wasserfass von Hohenbrunn. Il connaissait probablement Seghers, qui était un peintre populaire à cette époque. Si le tableau représentait l'électrice de Bavière, encore vivante au moment de la création du document (décédée en 1665), il devrait également la reconnaître (Cécile-Renée est décédée 15 ans plus tôt). Cette image subtilement peinte n'est pas sans rappeler le portrait de Marie de Raet peint par Antoine van Dyck en 1631 (The Wallace Collection, P79). Il est donc possible qu'il ait été réalisé par Abraham van Diepenbeeck, dont le travail a été influencé par Rubens et van Dyck, cependant, les œuvres d'un autre peintre qui s'inspire du style de van Dyck semblent plus proches - Gaspar de Crayer, qui était un peintre des parents espagnols de la reine. Parmi les plus proches, on peut citer le portrait équestre du roi Philippe IV d'Espagne, de 1628-1632 (Musée du Prado à Madrid, P001553) et surtout l'œuvre signée - Saint Ambroise d'environ 1655 (Prado, P005198). La manière dont le peintre a peint la dentelle et les cheveux est très similaire. Les nobles de la République jouissaient d’une réputation bien méritée de bons mécènes. Le « Prince Samaske » (Zamoyski ?), probablement issu de l'entourage de la reine Marie-Louise, négocia avec Matthijs Musson, peintre et marchand d'art basé à Anvers, et Gillis van Habbeke, actif comme tisserand à Bruxelles depuis au moins 1643, pour des tapisseries. Alors que de Crayer écrivait à Musson de Bruxelles en décembre 1645 qu'ils y attendaient des Polonais, qui avaient déjà vu son tableau de l'Assomption de la Vierge Marie à Lier et en avaient demandé une copie, il prépara également d'autres choses (d'après « Galerie obrazów ... » par Teresa Sulerzyska, p. 96). Ce sont probablement des clients de Pologne-Lituanie qui ont commandé vers 1643 une série de trois petites gravures en tondo représentant trois déesses du Jugement de Pâris - Vénus, Junon et Minerve, provenant de la collection Krasiński de Varsovie (Bibliothèque nationale de Pologne, G.2693/Sz, G.2694/Sz, G.2691/Sz). Elles ont été réalisées par Clement de Jonghe (1624-1677), ami de Rembrandt, actif à Amsterdam à partir de 1643. Le style des gravures est comparable aux dessins signés ou attribués à Hans Krieg (mort entre 1643 et 1647), peintre et dessinateur actif à Gdańsk, probablement fils de réfugiés mennonites des Pays-Bas ou d'Allemagne. L'estampe représentant Vénus est particulièrement intéressante car elle représente la déesse de l'amour en reine (Venus Regina), tenant un sceptre, très probablement inspirée des effigies baroques de Marie, reine du ciel (Regina Cæli) (à comparer avec l'estampe de Cornelis Galle l'Ancien de la première moitié du XVIIe siècle). Accompagnés de son fils Cupidon, ils admirent tous deux leurs vastes terres : le Royaume de Vénus.
La reine Vénus (Venus Regina) par Clement de Jonghe d'après Hans Krieg, vers 1643, Bibliothèque nationale de Pologne.
Cartouche avec fleurs et portrait de la reine Cécile-Renée d'Autriche (1611-1644) par Daniel Seghers et Gaspar de Crayer, vers 1642-1645, Kunsthistorisches Museum de Vienne.
Cartouche avec des fleurs et l'Éducation de la Vierge par Daniel Seghers et Erasmus Quellinus II, vers 1645, Worcester Art Museum.
Vierge à l'Enfant trônant avec saint Casimir par Abraham van Diepenbeeck, milieu du XVIIe siècle, Rijksmuseum Amsterdam.
Portrait allégorique de Stanisław Lubomirski par Gregorio Preti ou atelier
Les principaux fondements architecturaux de Stanisław Lubomirski (1583-1649), voïvode de Cracovie, sont liés à la culture italienne. L'architecte au service du voïvode était l'Italien Matteo Trapola (mort en 1637), qui conçut de nombreux bâtiments à Nowy Wiśnicz, dont l'église du monastère des Carmélites fondée par Stanisław en 1621 pour commémorer la victoire sur l'Empire ottoman lors de la bataille de Khotine (construit entre 1622 et 1630). Trapola reconstruisit également le château de Wiśnicz (1615-1621) et d'autres résidences du magnat comme le château de Łańcut (1629-1641) et la villa Decius à Wola Justowska près de Cracovie (1630). Giovanni Battista Falconi (mort en 1660) a décoré les résidences de Lubomirski à Wiśnicz et Łańcut, ainsi que la chapelle familiale à Niepołomice avec de belles décorations en stuc. L'architecte italien Andrea Spezza (mort en 1628), qui a conçu le palais Wallenstein à Prague, est considéré comme l'auteur du projet de l'église paroissiale de Wiśnicz, fondée par Stanisław en 1620 et consacrée en 1647 (comparer « Baroque architecture ... » par Piotr S. Szlezynger, p. 113).
En mai 1649, le voïvode, qui entretenait des contacts avec la famille Rakoczi, intervint auprès de Sebastiano Sala (mort en 1652), sculpteur de Lugano opérant à Cracovie, pour que le maître, qui était au service royal, acceptât l'ordre de réaliser la pierre tombale de Georges Ier Rakoczi (1593-1648), prince de Transylvanie, à Alba Iulia. Les liens avec la culture italienne sont également présents dans les peintures commandées par Lubomirski. Par exemple, le grand portrait allégorique de Stanisław comme triomphateur de la guerre de 1621 contre l'Empire ottoman, est évidemment de style italien, mais aucun peintre italien travaillant à Wiśnicz ou dans d'autres domaines du voïvode n'est connu. Ce tableau est aujourd'hui conservé au palais de Wilanów à Varsovie (huile sur toile, 292 x 176 cm, Wil.1565). Un autre portrait en pied de Stanisław, attribué à Stanisław Kostecki (Musée national de Varsovie, 128870/2 MNW), n'est pas similaire et aucun peintre actif dans la République polono-lituanienne à cette époque ne semble être l'auteur de l'œuvre. La peinture est plus proche de l'école romaine, inspirée du Caravage, avec de forts contrastes d'ombre et de lumière, qui excluent Tommaso Dolabella, formé à Venise, et son atelier comme auteurs potentiels. Les Lubomirski, en tant que fervents catholiques, entretenaient des relations avec Rome. En 1634, le pape Urbain VIII offrit à l'église des sœurs dominicaines de Cracovie, fondée en 1621 par la mère de Stanisław, Anna Lubomirska née Branicka (1562-1639), un tableau de Notre-Dame des Neiges (Salus Populi Romani) et l'année suivante les reliques de saint Alexandre et la tête d'une des compagnes de sainte Ursule furent offertes par le pape et rapportées de Rome par les Carmes déchaussés. Semblables au roi Sigismond III et à Ladislas IV, les Lubomirski ont sans aucun doute également commandé des peintures à Rome. Le tableau de Wilanów ressemble le plus aux œuvres attribuées à Gregorio Preti (1603-1672), peintre actif à Rome à partir de 1624 et qui, entre 1632 et 1636, fut le maître de son célèbre frère cadet Mattia (1613-1699). Parmi les plus proches, on peut citer le Dépouillement du Christ avec un homme en costume polono-lituanien ou hongrois-croate (Hôtel Drouot à Paris, 28 mars 2023, lot 18), la Rencontre de saint Dominique et saint François d'Assise (Quadri e Lanzi à Rome, 27 février 2018, lot 167) et le pape Célestin V (1215-1296) refusent la tiare papale (Wannenes Art Auctions à Gênes, 21 décembre 2020, lot 1230), ainsi que l'autoportrait du peintre dans l'Allégorie des cinq sens, peinte entre 1641-1642 (Palazzo Barberini à Rome, inv. 4660). Cette allégorie véritablement princière peut être datée d'environ 1647, lorsque Stanisław reçut le titre princier de l'empereur Ferdinand III. De tels portraits étaient généralement commandés en plusieurs exemplaires pour différentes résidences. De bons exemples de cette pratique sont les portraits de Mikołaj Hieronim Sieniawski (1645-1683), peints vers 1682 et attribués à Mateusz Domaradzki (palais de Wilanów et château d'Olesko).
Portrait allégorique de Stanisław Lubomirski (1583-1649), voïvode de Cracovie par Gregorio Preti ou atelier, vers 1647, palais de Wilanów à Varsovie.
Portraits du roi Ladislas IV Vasa et de la reine Marie-Louise de Gonzague par l'atelier de Giovanni Antonio Galli
Malgré ses origines nord-européennes, la branche polono-lituanienne de la dynastie Vasa, semblable aux Jagellon, entretenait des relations étroites avec la péninsule italienne. Les aristocrates de la République possédaient de nombreux portraits d'Italiens célèbres. L'inventaire des tableaux de la collection de la princesse Louise Charlotte Radziwill (1667-1695), dressé en 1671, recense les portraits du cardinal Charles Borromée (188), du maréchal Ottavio Piccolomini (243) et du cardinal Jules Mazarin (244) (d'après « Inwentarz galerii obrazów Radziwiłłów z XVII w. » par Teresa Sulerzyska). Bien qu'en raison de l'origine française de la reine Marie-Louise de Gonzague (de la branche de Nevers de la famille italienne), les effigies d'aristocrates français ou probablement peintes à la française, dominent dans cet inventaire (pièces 276-291 et pièces 307-311).
Dans la collection du cardinal Antonio Barberini (1607-1671), neveu du pape Urbain VIII, au palais Barberini à Rome se trouvait un portrait de l'ambassadeur du roi Sigismond de Pologne (il ritratto del Sig. re. Ambasciatore di Polonia, inventaire de 1644, article 108) et l'inventaire de 1649 de la collection du cardinal Francesco Barberini (1597-1679), autre neveu du pape, contient un grand nombre d'effigies polono-lituaniennes, car en tant que secrétaire d'État, il dirigeait la politique étrangère de la papauté. Il possédait très probablement un portrait du chancelier Jerzy Ossoliński (article 819), probablement du peintre Antonelli, ainsi qu'un portrait gravé de Sigismond III (209) et son grand portrait ou plutôt de son successeur, Ladislas IV (782) en żupan polono-lituanien rouge, qui semblait pour l'auteur de l'inventaire « habillé comme Dante » (del Re di Polonia vestiti tutto di Dante). Une autre note mentionne un portrait du roi de Pologne en demi-figure (822). Une gravure représentant la victoire du monarque nouvellement élu sur les troupes moscovites qui assiégeaient Smolensk (l'espugnatione dell esercito de Moscoviti dal Re di Polonia, 192) était probablement aussi un cadeau de Ladislas. Dans les collections de Don Taddeo Barberini (1603-1647), prince de Palestrina et gonfalonier de l'Église, frère des cardinaux Francesco et Antonio, inventoriées dans les années 1648-1649, se trouve le portrait d'une reine polonaise non identifiée (Hedagres [Edvige-Hedwige ?] Regina di Polonia, 305), tandis que l'inventaire du cardinal Francesco de 1679 mentionne « un portrait d'une reine de Pologne » (il ritratto d'una Regina di Polonia, 112) (d'après « Biuletyn historii sztuki », tome 47, p. 153 -154). Le portrait de Ladislas IV Vasa en robe de couronnement et une grande couronne, attribué à Jan Chrysostom Proszowski, se trouve dans le Palais des grands maitres à La Valette, à Malte. Au XVIIe siècle, comme aujourd'hui où les riches commandent des objets très personnalisés dans des endroits lointains en raison de leur caractère unique et de leur qualité, les portraits étaient commandés aux meilleurs ateliers d'Europe. En 1646, Pierre Des Noyers, secrétaire de la reine Marie Louise, écrivait que la chapelle du Château royal de Varsovie était « ornée de nombreux tableaux des peintres les plus célèbres ». Quatre ans plus tard, en 1650, la reine commande à Paris, par l'intermédiaire de Des Noyers, un grand tableau la représentant elle et ses deux époux. Le concept du tableau, exécuté par Justus van Egmont, a été développé par l'abbé Michel de Marolles - la reine en tant que déesse romaine Junon assise entre deux Jupiters, l'un céleste (Ladislas IV Vasa) et l'autre terrestre (Jean Casimir Vasa) - « Une Junon représentée assise entre deux Jupiters, l'un céleste et l'autre terrestre. Cette Déesse plus belle qu'elle ne fut jamais sous le visage de la Reine » (d'après « Bulletin de la Société de l'histoire de l'art français », p. 34). Cette pratique était également très bénéfique d'un point de vue logistique pour un monarque souhaitant glorifier sa dynastie et son pays. Les portraits commandés à Paris pouvaient être offerts à la reine de France (qui était une cousine des Vasa), ou envoyés plus loin à Madrid, Florence, Rome ou Londres. Les monarques de Pologne-Lituanie envoyaient fréquemment des cadeaux précieux et riches à des personnes à l'étranger, comme Michel de Marolles, mentionné, qui en 1649 reçut de la reine des vases dorés et une boîte en argent doré et sculpté. Les Vasa possédaient également une importante collection de sculptures antiques, dont la majorité fut sans doute acquise à Rome. Les sculptures de Varsovie et de Łobzów furent détruites lors du déluge (1655-1660) et certaines furent pillées par Frédéric-Guillaume (1620-1688), électeur de Brandebourg et duc de Prusse (d'après « Świat polskich Wazów: eseje », p. 56, 299, 316). En 2022, deux portraits d'un noble et de son épouse (Ritratto di nobile, Ritratto di gentildonna), attribués à un peintre romain du XVIIe siècle, ont été vendus à Rome (huile sur toile, 84 x 67 et 84 x 68 cm, vendue à Bolli & Romiti, 18 mai 2022, lot 61-62). Les deux viennent « d’un palais romain ». Ces peintures reproduisent des effigies bien connues du roi Ladislas IV Vasa et de sa seconde épouse Marie-Louise de Gonzague. Le portrait du roi est une version de l'effigie datant d'environ 1647, semblable à la miniature du Musée national de Varsovie (Min.726 MNW) et le portrait de la reine est une copie d'un tableau de Justus van Egmont dans le château royal de Varsovie (ZKW/2283/ab). Dans la miniature mentionnée, Ladislas a les cheveux blonds et une moustache blonde aussi, et dans le portrait romain, il a les cheveux foncés, ce qui indique que le peintre a copié certaines effigies générales du roi - dessins ou gravures. Il est également possible que Ladislas chauve portait des perruques de différentes couleurs ou se teignait les cheveux et la barbe, comme le vice-roi de Naples en 1625. Le style des deux tableaux rappelle étroitement les œuvres attribuées à Giovanni Antonio Galli, dit lo Spadarino, membre des Caravagesti, qui a peint le portrait de Ladislas de la collection Gundulić, aujourd'hui au château de Kórnik (MK 03369). Parmi les plus proches figurent le très sombre portrait de Geronima Giustiniani (1520/30 - vers 1600) en veuve conservé au Musée des Beaux-Arts de Nancy (inv. 606), peint à titre posthume avant 1637, Ecce Homo de collection particulière à Madrid (vendu chez Christie's Londres, 7 juillet 2009, lot 22) et un Chérubin vendu en 2022 (Lucas Aste à Milan, 20 septembre 2022, lot 90). Les portraits ne sont pas aussi finement peints que le portrait mentionné de Ladislas à Kórnik, il est donc possible qu'ils fassent partie d'une série d'effigies commandées vers 1647 et peintes par l'atelier de Spadarino. Très proche du style de Spadarino et de son atelier est également le portrait du prince-cardinal Jean Casimir Vasa avec une couronne princière, également créé à cette époque, aujourd'hui à l'Université pontificale grégorienne de Rome. En 1641, le prince décide de devenir jésuite et arrive à Rome en 1643. Il est nommé cardinal par Innocent X le 28 mars 1646. En octobre 1647, il démissionne pour se présenter aux élections au trône polono-lituanien a épousé sa belle-sœur veuve Marie-Louise de Gonzague. Peut-être peu de temps après l'élection, le 20 novembre 1648, une inscription pertinente en latin fut ajoutée au portrait (CASIMIRVS SOC. IESV S.R.E. CARDINALIS ET POLONIE REX). Deux autres exemplaires de cette effigie sont connus, tous deux réalisés par des artistes différents. L'une, conservée à l'hospice polonais à Rome, est proche du style de Simone Cantarini, et l'autre, attribuée à l'école romaine, se trouve à la Pinacothèque nationale de Ferrare (huile sur toile, 98 x 74 cm, PNFe 251). Les coups de pinceau audacieux de ce tableau rappellent également les chérubins de l'atelier de Galli, comme celui vendu en 2020 (vendu chez Cambi Casa d'Aste à Gênes, le 11 décembre 2020, lot 332), ainsi que des vagues dans la Naissance de Vénus, plus finement peinte, peut-être créée pour un cardinal ou un riche noble (vendu chez Christie's Londres, 6 juillet 2018, lot 214). Un portrait similaire de la reine, attribué à un suiveur de Pierre Mignard (école française du XVIIIe siècle), a été vendu à Neuilly-sur-Seine en 2013 (huile sur toile, 50 x 42 cm, vendue chez Aguttes, 24 septembre 2013, lot 12). Sa robe est noire, ce qui pourrait indiquer qu'il a été créé vers 1648, lorsque la reine était en deuil après la mort de Ladislas IV. Il est intéressant de noter que ce portrait de la reine ressemble au style du portrait de Jean Casimir à Ferrare. Les deux œuvres peuvent être comparées à des peintures attribuées à Francesco Cairo (1607-1665), également connu sous le nom de Francesco del Cairo, peintre italien actif en Lombardie et dans le Piémont. Cairo est né et mort à Milan. En 1633, il s'installe à Turin pour travailler comme peintre de cour pour la Maison de Savoie et entre 1637 et 1638, il se rend à Rome. Entre 1646 et 1649, il revient à Turin. Sainte Christine de Bolsena de Cairo au Palais des grands-ducs de Lituanie à Vilnius, généralement datée entre 1644 et 1648, est particulièrement similaire.
Portrait du roi Ladislas IV Vasa (1595-1648) par l'atelier de Giovanni Antonio Galli, dit lo Spadarino, vers 1647, Collection particulière.
Portrait de la reine Marie-Louise de Gonzague (1611-1667) par l'atelier de Giovanni Antonio Galli, dit lo Spadarino, vers 1647, Collection particulière.
Portrait du prince-cardinal Jean Casimir Vasa (1609-1672) par l'atelier de Giovanni Antonio Galli, dit lo Spadarino, vers 1647, Université pontificale grégorienne.
Portrait du prince-cardinal Jean Casimir Vasa (1609-1672) par l'atelier de Francesco Cairo, vers 1648, Pinacothèque nationale de Ferrare.
Portrait de la reine Marie-Louise de Gonzague (1611-1667) par l'atelier de Francesco Cairo, après 1648, Collection particulière.
Portraits de Marie-Louise de Gonzague par Justus van Egmont et l'atelier des Beaubrun
L'une des meilleures œuvres signées du peintre flamand Justus van Egmont (né à Leyde aux Pays-Bas), est un portrait en pied de Marie-Louise de Gonzague (1611-1667), duchesse de Nevers, créé à Paris en 1645 (légende, signature, lieu et date verso : MARIAE PRINCIPI MANTUANAE, DUCISSAE NVERNENSI.&.Justus d'Egmont Pinxit a. 1645. Parisi), une année où la délégation polono-lithianienne est arrivée à Paris (19 septembre) pour signer un contrat de mariage du roi veuf Ladislas IV avec Marie-Louise. On pense qu'elle a apporté le portrait avec elle à Varsovie (aujourd'hui au Musée national de Varsovie), mais il est également possible qu'il ait été envoyé en Pologne peu de temps avant la signature du contrat. Vers cette même année également Jeremias Falck Polonus, un graveur de Gdańsk qui s'installa à Paris en 1639, réalisa une gravure à l'effigie de Marie-Louise en duchesse de Nevers (Herzog Anton Ulrich-Museum), puis il modifia cette estampe, changea l'inscription, le couronne ducale en couronne royale (corona clausa) et a remplacé les fleurs et l'éventail dans ses mains par un orbe et un sceptre et a ajouté la date « 1645 » (Collection nationale des arts graphiques à Munich). D'après l'inscription au bas de cette gravure l'original (peinture ou dessin) a été réalisé par Justus van Egmont (Justus d'Egmont fecit Cum Privilegio...). Pieter de Jode le Jeune publia vers 1646 à Anvers une autre version de cette estampe (Kunstsammlungen der Veste Coburg).
Portrait d'une noble dame au château de Weissenstein à Pommersfelden, Bavière (huile sur toile, 75 x 60 cm) montre une jeune femme dans une pose presque identique à celle des gravures mentionnées représentant Marie-Louise de Gonzague. Ce tableau est attribué à Jacob Adriaensz Backer, mais son style est également très proche de Justus van Egmont et la femme représentée ressemble étroitement à Marie-Louise d'après les gravures mentionnées et d'autres portraits. La même femme a également été représentée dans un autre tableau de Justus van Egmont montrant une dame comme Diane la chasseresse, la déesse de la chasse, de la nature, de la végétation, de l'accouchement et de la chasteté, aujourd'hui au château de Versailles (numéro d'inventaire MNR 41). Elle a été identifiée comme étant l'effigie de Madame de Montespan (1640-1707), mais le style de sa coiffure indique que la peinture a été créée dans les années 1640. Ce portrait en pied a été acquis par Hermann Göring auprès de Joseph Schmid, son ami proche, le 12 janvier 1943 pour son domaine de chasse à Carinhall, au nord-est de Berlin. Son histoire antérieure est inconnue, il ne peut donc être exclu que le tableau ait été confisqué en Pologne ou dans d'autres pays formant la République polono-lituanienne. Après la guerre, la toile a été transférée en France en 1950 depuis le Central Collecting Point de Munich. Une effigie similaire de la déesse Diane de la même période est visible dans une estampe montrant l'arc de triomphe Pyramides ante fores Regii Hospitii (Bibliothèque nationale de Varsovie), troisième décoration éphémère à Gdańsk pour célébrer l'entrée solennelle de Marie-Louise de Gonzague dans la ville. Dans cette porte triomphale, l'aigle polonais est placé entre deux obélisques avec les figures d'Apollon et de Diane sous les monogrammes royaux symbolisant les épouses - L4 pour Ladislas IV et ML pour Marie-Louise. Cette estampe a été créée en 1646 par Jeremias Falck Polonus d'après un dessin ou une peinture du peintre de Gdańsk Adolf Boy. Les deux obélisques sont enlacés par des vignes et autres lianes, symbole d'attachement. Des feuilles de vigne, comme dans l'obélisque d'Apollon, ou plus vraisemblablement un chêne, sont visibles dans un autre tableau de Justus van Egmont de la même époque (vendu chez Christie's, le 18 mai 2022, lot 193). Il provient d'une collection privée en France et selon une inscription manuscrite au dos de la toile, il a été attribué à Pierre Mignard et aurait été créé à Paris en 1677. La femme représentée a été identifiée comme étant Françoise-Marguerite de Sévigné, comtesse de Grignan (1646-1705), cependant, comme dans le cas du tableau de Versailles, sa coiffure indique qu'il a été créé dans les années 1640. La femme ressemble beaucoup à Marie-Louise d'après d'autres portraits de van Egmont (identification suggérée par Wladyslaw Maximowicz), elle tient sa main droite sur les feuilles, sa main gauche sur son cœur et son regard est dirigé vers la personne (très probablement un homme) de un portrait en pendant qui ne s'est probablement pas conservé. Le chêne fait allusion à un roi puissant, les Grecs et les Romains associant l'arbre à leur dieu le plus élevé, Zeus ou Jupiter, roi des dieux dans la religion et la mythologie romaines antiques. Un portrait de convention similaire au tableau de Varsovie de van Egmont représente la même femme assise sous l'arbre dans un parc au crépuscule et tenant un petit livre (collection privée). Elle porte une robe noire, très probablement une robe de deuil après la mort de Louis XIII de France (décédé le 14 mai 1643) ou après la mort de Ladislas IV Vasa (décédé le 20 mai 1648), premier mari de Marie-Louise. La reine de Pologne était représentée dans une tenue très similaire dans l'estampe montrant la cérémonie de passation du contrat de mariage à Fontainebleau, créée par Abraham Bosse en 1645. Une structure avec des obélisques en arrière-plan lointain ressemble à un arc de triomphe à Elbląg pour célébrer l'entrée cérémonielle de Marie-Louise le 23 février 1646 (Archives d'État à Gdańsk). Obélisque, symbole phallique qui représentait le dieu égyptien de la lumière et des morts, le souverain des enfers, le dieu de la résurrection et de la fertilité, Osiris, après avoir été transporté à Rome, est devenu un symbole du pouvoir impérial et du triomphe militaire. Différentes plantes symboliques sont visibles dans les gravures de Jeremias Falck Polonus, représentant la reine, comme un lys, un tournesol, un œillet et une rose, entre autres. Marie-Louise agrandit les jardins royaux de Varsovie et Simon Paulli en parle dans sa Viridaria varia regia, publiée en 1653, catalogue des plantes des jardins botaniques de Copenhague, Paris et Varsovie. La reine a établi deux jardins botaniques à Varsovie en 1650, l'un à côté de la Villa Regia (plus tard le palais Casimir) et l'autre - à côté du château royal. Catalogus Plantarum Tum exoticarum quam indigenatum quae Anno M.DC.LI in hortis Regiis Warsaviae ... de Martinus Bernhardus (Marcin Bernhardi), botaniste et chirurgien de la cour du roi Jean II Casimir Vasa, publié à Gdańsk en 1652, décrit les plantes dans ces jardins, une grande partie fut importée de Hongrie (d'après « Rys historyczno-statystyczny wzrostu i stanu miasta Warszawy... » de Franciszek Maksymilian Sobieszczański, p. 475). Un portrait d'une reine assise sur une chaise avec la couronne royale sur la table à côté d'elle, vendu à Lisbonne en 2015 (Veritas Art Auctioneers, 10 décembre 2015, lot 585), ressemble beaucoup à d'autres effigies de Marie-Louise de Gonzague. Ce tableau a été identifié comme un portrait de D. Luísa de Gusmão (Luisa de Guzmán, 1613-1666), reine du Portugal ou de sa fille Catherine de Bragance (1638-1705), reine d'Angleterre, cependant, aucune similitude avec leurs représentations ne peut être trouvé. La gravure sur cuivre de Willem Hondius au Musée national de Cracovie (numéro d'inventaire MNK III-ryc.-37107), une étude de l'arc de triomphe Porta tempore regiarum nuptiarum à Gdańsk pour célébrer l'entrée solennelle de Marie-Louise en 1646, montre la reine assis sur une chaise similaire, ainsi que la médaille d'or de mariage créée cette année-là à Gdańsk par Johann Höhn (collection privée). Stylistiquement, le portrait de Lisbonne est très proche de l'effigie d'Anne d'Autriche (1601-1666), reine de France, cousine de Ladislas IV et de Jean II Casimir, au monastère des Visitandines à Varsovie. Ce portrait a très probablement été apporté en Pologne par Marie-Louise ou envoyé à Varsovie par la reine de France à ses cousins et ressemble beaucoup aux autres portraits d'Anne par l'atelier d'Henri et de son cousin Charles Beaubrun. Il est fort possible que le portrait de Lisbonne ait été commandé vers 1650 à l'atelier des Beaubrun à Paris comme l'un des séries et envoyé au Portugal.
Portrait de Marie-Louise de Gonzague (1611-1667) dans un ovale par Justus van Egmont, vers 1645, château de Weissenstein à Pommersfelden.
Portrait de Marie-Louise de Gonzague (1611-1667) assise dans un parc au crépuscule par Justus van Egmont, 1643-1648, Collection particulière.
Portrait de Marie-Louise de Gonzague (1611-1667) en Diane chasseresse par Justus van Egmont, 1645-1650, Château de Versailles.
Portrait de Marie-Louise de Gonzague (1611-1667) tenant une branche par Justus van Egmont, 1645-1650, Collection particulière.
Portrait de Marie-Louise de Gonzague (1611-1667) avec la couronne royale par l'atelier d'Henri et Charles Beaubrun, vers 1650, Collection particulière.
Portraits de Louise Charlotte de Brandebourg, duchesse de Courlande par Justus van Egmont
Le 9 octobre 1645 à Königsberg, la princesse calviniste Louise Charlotte de Brandebourg (1617-1676) épouse Jacob Kettler (1610-1682), duc de Courlande, qui faisait partie de la République polono-lituanienne, un luthérien.
La fille aînée de Georges-Guillaume, électeur de Brandebourg et d'Élisabeth-Charlotte du Palatinat était une descendante de Casimir IV Jagellon (1427-1492), roi de Pologne tant du côté paternel (par Madeleine de Saxe et Sophie de Legnica) que maternel (par Albert de Prusse). Elle était candidate pour devenir l'épouse de Ladislas IV, qui décida cependant d'épouser la princesse française Marie-Louise de Gonzague - le 26 septembre 1645 à Paris, Gerard Denhoff, voïvode de Poméranie, qui représentait le roi de Pologne, conclut un accord prénuptial avec le Cour de France. La famille de Louise s'installe à Königsberg (Królewiec en polonais), capitale du duché de Prusse, fief de Pologne, en 1638. Après le mariage, le couple s'installe à Kuldiga puis à Jelgava dans le duché de Courlande. Louise Charlotte a aidé le duc Jacob dans la gouvernance, à la fois en prêtant de l'argent et en entretenant une correspondance avec de nombreuses personnalités politiques, comme le roi Jean II Casimir Vasa, la reine Christine de Suède ou le chancelier suédois Axel Oxenstierna, entre autres. Elle a eu une influence significative sur la politique de Courlande, dont la capitale Jelgava est devenue le centre des négociations entre la Pologne, la Russie, le Brandebourg et la Suède pendant le déluge (1655-1660). Le mari de Louise Charlotte, le duc Jacob, fit ses études à Rostock et à Leipzig et se rendit fréquemment à Szczecin pour rendre visite à son ami Bogislaw XIV (1580-1637), duc de Poméranie. Il a également rendu visite à ses proches à Cieszyn. Vers 1629, Kettler se rendit à Birzai en Lituanie, qui appartenait à la famille Radziwill, afin de trouver une épouse. En 1634, il fait un grand tour d'Europe et après avoir passé plusieurs mois aux Pays-Bas, en juin 1635 il arrive à Paris. Jacob est resté en France pendant plus d'un an, puis est allé en Italie, mais il est possible qu'il ait également visité l'Angleterre ou l'Espagne pendant cette période. Il revient en Courlande au printemps 1637. Sous le règne de Kettler, le duché faisait du commerce avec la France, Venise et le Danemark (des accords commerciaux furent conclus en 1643), le Portugal (1648), les Pays-Bas (1653), l'Angleterre (1654), l'Espagne (1656) et de nombreux autres pays, dont l'Empire ottoman. En 1642, il envoya quelques centaines de colons de Zélande sous la direction de Cornelius Caroon pour établir une colonie à Tobago. Lorsque cette colonie a été attaquée et que les survivants ont été évacués, une nouvelle colonie a été établie dans la baie de Great Courland en 1654. Le 16 février 1639 à Vilnius, Jacob reçut l'investiture du roi Ladislas IV et prêta serment d'allégeance au roi lors d'une cérémonie solennelle au château de Vilnius. Le 20 avril 1646, Ladislas IV confirme le contrat de mariage entre le duc de Courlande et la fille de l'électeur de Brandebourg concernant la dot de la mariée en bijoux et terres de sa dot. Dans le Trésor ecclésiastique de Vienne, il y a un grand autel d'ambre (190 cm de haut, numéro d'inventaire GS Kap 274) en forme de pyramide pointue, créé à Königsberg ou Gdańsk. Il est daté d'environ 1645-1650 et selon l'inscription latine au dos (Lovysa Charlotta D.: G: Princ: Brandenb.: Livoniae Curlandiae et Semigaliae Ducissa) il appartenait à Louise Charlotte de Brandebourg, duchesse de Courlande. Selon certaines théories, il aurait pu être offert par Andrzej Chryzostom Załuski (1650-1711), évêque de Varmie à l'Empereur vers 1700 (d'après « Bernstein, das “Preußische Gold” » de Kerstin Hinrichs, p. 142), bien que il ne peut être exclu que la Duchesse l'ait présenté à l'Empereur pendant le déluge ou avant. Dans le palais impérial de Schönbrunn à Vienne, d'autre part, se trouve un portrait d'une dame avec un chien par Justus van Egmont, qui est identifié comme étant l'effigie d'Anne d'Autriche (1601-1666), reine de France (huile sur toile, 115 x 96 cm). La dame est assise dans un fauteuil doré en robe de satin gris-vert. Sur la base du costume et de la coiffure de la femme, ce portrait devrait être daté du début des années 1650, très similaire à ceux visibles dans un portrait de Marie-Henriette d’Angleterre (1631-1660) par Bartholomeus van der Helst au Rijksmuseum Amsterdam, signé et daté en haut à gauche : Bartholomeus van der helst 1652 f. Derrière une draperie vert foncé, il y a une vue d'un paysage montagneux, qui ressemble à la vue d'une baie sur Eylandt Tabago (île de Tobago), gravure sur cuivre de Romeyn de Hooghe, publiée avant 1690 (Bibliothèque royale des Pays-Bas). Ce tableau provient de la collection de l'archiduc Léopold-Guillaume (d'après « Die Denkmale der Stadt Wien (XI. - XXI. Bezirk) » de Hans Tietze, p. 166, pièce 192). La jeune femme ne ressemble en rien aux effigies de la reine de France, qui en 1650 avait 49 ans, et sa physionomie s'inspire clairement des images de la reine de Pologne, Marie-Louise de Gonzague - par exemple dans la gravure de Willem Hondius au Musée national à Cracovie (numéro d'inventaire MNK III-ryc.-37107). À cette époque, le style de la reine de Pologne est évidemment devenu emblématique en Europe centrale, car dans le palais Lobkowicz au château de Prague se trouve un portrait de Maria Anna Freiin von Breuner née Khevenhüller, une dame d'honneur de l'impératrice Éléonore de Gonzague (1630-1686), nièce de Marie-Louise, probablement du début des années 1650 (I. 4575). Le portrait est quasiment identique à plusieurs effigies de la reine de Pologne, considérée comme la beauté idéale de l'époque. La même femme figurait également dans un autre tableau dans le goût de Justus van Egmont (huile sur toile, 62,5 x 79 cm, vendu chez Proantic, référence : 798554, XVIIIe siècle, style Louis XV). Les traits de son visage ressemblent beaucoup à Louise Charlotte de Brandebourg d'après son portrait au musée du palais de Rundale et à la sœur de Louise Charlotte Edwige-Sophie de Brandebourg (1623-1683), Landgravine de Hesse-Kassel d'après une gravure de Philipp Kilian, créée en 1663 (Bibliothèque nationale d'Autriche à Vienne). Dans la collection de la maison Hohenzollern, anciennement au musée Hohenzollern, se trouve un tableau intéressant du peintre bohème Matthias Czwiczek, qui à partir d'avril 1628 était peintre de la cour de Königsberg. Ce petit tableau (huile sur bois, 33 x 44,5 cm), peint vers 1649, représente les membres de la famille du duc de Prusse et électeur de Brandebourg et son épouse sous les traits de personnages de l'Ancien Testament. Frédéric-Guillaume (1620-1688) a été représenté comme le roi biblique Salomon et derrière lui se trouvent sa sœur Louise Charlotte, duchesse de Courlande et son mari Jacob Kettler. La mère de l'électeur, Élisabeth-Charlotte du Palatinat, couronnée par sa fille cadette Edwige-Sophie, landgravine de Hesse-Kassel, est la reine de Saba. Elle reçoit la grappe de raisin des mains de l'épouse de l'électeur Louise-Henriette d'Orange (1627-1667), symbole du vin eucharistique et donc du sacrifice du Christ. Le groupe de gauche de la composition montre des membres de la famille décédés, dont le père de Frédéric-Guillaume, Georges-Guillaume (1595-1640) (comparer « Die Frau an Jakobs Seite ... » d'Ulrich Schoenborn, p. 4-5, 7). Pour créer son tableau, Czwiczek a dû utiliser différents dessins d'étude ou d'autres peintures, qui ont sans doute également été utilisées par van Egmont et son atelier pour créer des portraits de la duchesse de Courlande.
Portrait de Louise Charlotte de Brandebourg (1617-1676), duchesse de Courlande par Justus van Egmont, 1650-1654, Collection particulière.
Portrait de Louise Charlotte de Brandebourg (1617-1676), duchesse de Courlande avec un chien et une vue sur l'île de Tobago par Justus van Egmont, vers 1654, château de Schönbrunn à Vienne.
Portrait d'un membre de la famille Sollogub par Ferdinand Bol
En 2014, un « Portrait de jeune homme, mi-long, en chemise blanche, manteau doré et bonnet à plumes rouge, devant un rideau drapé », attribué à l'école de Rembrandt et daté vers 1650, est vendu à Londres (huile sur toile, 69,5 x 57 cm, vente 1576, 3 décembre 2014, lot 136). Le tableau a également été vendu aux enchères avec une attribution à Ferdinand Bol, élève de Rembrandt (Daphne Alazraki Fine Art à New York), et cette attribution semble être la plus pertinente au style du tableau. Selon une ancienne inscription au revers du châssis, le tableau appartenait au comte Sollogub dont l'acquis par V.Th. Levchine, Russie.
La famille Sollogub, connue sous le nom de Sołłohubowie en polonais, Sologubai en lituanien et Salaguby en ruthène, était une famille noble des armoiries de Prawdzic. Ils sont probablement issus de la noblesse ruthène du grand-duché de Lituanie et ont pris de l'importance au début du XVIe siècle lorsqu'un certain Youri Sollogub (mort en 1514) fut nommé au poste de voïvode de Smolensk. Au XVIe siècle, nombre d’entre eux devinrent calvinistes. Pendant le déluge, plusieurs membres de la famille ont trahi le monarque légitimement élu de la République polono-lituanienne Jean II Casimir et se sont rangés, aux côtés de Janusz Radziwill (1612-1655), voïvode de Vilnius, du côté du « Brigand de l'Europe ». Leurs noms figurent parmi les signataires du traité de Kedainiai du 20 octobre 1655 reconnaissant l'autorité du roi suédois, comme Raphael Sołłohub, Konstanty Dowoynia Sołłohub, woyski Upitski, Andrzey Sołohub, Stefan Dowoina Sołlohub et Mikołai Dowoina Sołohub. C'est sans doute pour cette raison qu'aucun d'entre eux n'a accédé à des postes importants et que leurs biographies n'ont pas été élaborées par des historiens. La famille reconstruit son statut dans la République lorsque Jan Michał Sołłohub (décédé en 1748), qui, par son mariage avec Helena Szamowska en 1706, commença sa brillante carrière politique, accéda au poste de grand trésorier de Lituanie puis de voïvode de Brest. En 1861, les membres de la famille installés dans l'empire russe reçurent la confirmation du titre de comte. En tant que partisans des Radziwill au XVIIe siècle, les Sollogub ont sans doute également suivi leur exemple en matière de mécénat, et en tant que calvinistes, certains membres ont probablement étudié aux Pays-Bas. Un tableau quelque peu similaire de Rembrandt est mentionné dans le catalogue de tableaux de 1835 de la collection Radziwill : « 18. Portrait d'un homme en robe violet foncé avec de la fourrure et un béret sur la tête, une image pleine d'expression, des tons forts lui donnent un effet charmant. Peint sur toile ». Ce catalogue répertorie également trois tableaux de Ferdinand Bol : « 4. Portrait d'un homme à la barbe sombre vêtu de riches vêtements orientaux, les bras croisés ; rendu dans une couleur forte. - Peint sur toile », « 356. Un homme et une dame en vêtements orientaux. Peint sur cuivre » et « 363. Portrait d'un homme avec une barbe, une casquette noire et une robe sombre, avec une chaîne en or accrochée à sa poitrine. Peint sur toile » (d'après « Katalog galeryi obrazow sławnych mistrzów ... » par Antoni Blank, p. 3, 8, 105, 107). Avant 1909, dans la collection de la comtesse Sollogub (W. Sologoube) à Saint-Pétersbourg, existait un portrait de jeune garçon identifié comme étant le portrait de Titus, le fils de Rembrandt, par Nicolaes Maes (« Les Anciennes écoles de peinture dans les palais et collections privées russes, représentées à l'exposition organisée à St.- Pétersbourg en 1909 par la revue d'art ancien "Staryé gody" », n° 398), aujourd'hui au Cincinnati Art Museum (1946.95). Bien que nous ne confirmerons probablement jamais l'identité de l'homme représenté dans le tableau de Sollogub avec des documents fiables, il ressemble à un membre notable de la famille, qui vécut plus d'un siècle plus tard - le général Jan Michał Sołłohub (1747-1812), peint par Józef Pitschmann en 1792 (Château d'Oporów). Puisque certains gènes réapparaissent dans les générations futures et que certaines personnes sont même comparées à leurs arrière-grands-pères ou à des ancêtres encore plus lointains, il faut supposer que l'homme du portrait était un membre de la famille Sollogub.
Portrait d'un homme au manteau doré, très probablement membre de la famille Sollogub, par Ferdinand Bol, vers 1650, Collection privée.
Portrait d'Alexandre Louis Radziwill par Adolf Boy
En 1642, après la mort de son frère aîné Sigismond Charles Radziwill (1591-1642), chevalier hospitalier, Alexandre Louis Radziwill (1594-1654), grand maréchal de Lituanie, hérité d'ordynacja (fidei commissum) de Niasvij, devenant le 5e ordynat. Alexandre Louis était le plus jeune fils de Nicolas Christophe Radziwill « l'Orphelin » (1549-1616). Il a étudié à Niasvij et en Allemagne, puis a parcouru la France et l'Italie. La résidence préférée d'ordynat et de sa femme, Tekla née Wołłowicz, était le palais de Biała Radziwiłłowska (Podlaska), où après 1622 il construisit un somptueux palais conçu par l'architecte de Lublin Paolo Negroni (Paweł de Szate), appelé Murzyn (l'Homme Noir). A Niasvij, vers 1650, Alexandre Louis ajouta deux ailes de galerie reliant les ailes du palais.
Des inventaires de 1650 et 1658 présentent le mobilier du château de Radziwill. Selon l'inventaire le plus complet de 1658, les portraits constituaient la plus grande collection de peintures de Niasvij. Dans la salle à manger du palais, il y avait 31 portraits de « vieux princes leurs Altesses les Radziwill, Szydłowiecki, Wołłowicz et d'autres sénateurs qui avaient l'habitude de visiter cette salle », dont un portrait en pied de Nicolas Christophe « l'Orphelin ». La deuxième galerie de portraits était située dans la « grande salle », dans le deuxième bâtiment de l'ensemble du château. Il se composait de 14 « peintures debout des comtes Szydłowiecki, diverses figures rendues à l'huile » (d'après « Monumenta variis Radivillorum ...» de Tadeusz Bernatowicz, p. 18). L'inventaire de 1650 répertorie un portrait d'un « seigneur de Vilnius », probablement Janusz I Radziwill (1579-1620), et des portraits royaux placés derrière un rideau à la porte de la chapelle, c'est-à-dire dans le cercle du sacrum. Des collections similaires se trouvaient dans d'autres résidences des Radziwill - les châteaux de Mir, Olyka et Szydłowiec, des palais et des maisons à Varsovie, Vilnius, Grodno, Cracovie, Lviv et Gdańsk. Alexandre Louis mourut à Bologne en 1654, où il alla se faire soigner. Son fils, Michel Casimir, a déplacé le cercueil avec le corps du prince à Niasvij et l'a enterré dans la crypte ancestrale de l'église des Jésuites. Dans l'ancien palais Radziwill à Nieborów, entre Varsovie et Łódź, se trouve un portrait d'homme, attribué à l'école hollandaise et daté d'environ 1640-1660, incorporé dans la collection du Musée national de Varsovie en 1945 (huile sur toile, 75 x 64,5 cm, numéro d'inventaire NB 974 MNW). Il est mentionné dans le catalogue de la collection du descendant d'Alexandre Louis Michał Hieronim Radziwiłł (1744-1831), exposé à Królikarnia près de Varsovie en 1835, comme par l'école flamande : « 310. Portrait d'un homme à la barbe blanche espagnole, portant un collier blanc, chaîne autour du cou. Peint sur toile ». Le style de la peinture ressemble beaucoup aux œuvres d'Adolf Boy, peintre de la cour du roi Ladislas IV Vasa, en particulier le portrait d'Elżbieta (Halszka) Kazanowska née Słuszczanka (1619-1671) avec des myosotis (Musée national de Varsovie), créé entre 1649-1652. Le tableau est également particulièrement similaire, tant par le style que par la physionomie du modèle, au portrait du roi Ladislas IV Vasa au Château Royal de Varsovie (ZKW 559 dép., dépôt du Musée national de Varsovie, 128758). En 1649, Boy créa une composition, très probablement une peinture, représentant l'Apothéose du roi Jean II Casimir Vasa, gravée par Willem Hondius (Bibliothèque nationale de Pologne, G.219/Sz.1). Cela indique qu'avec un autre peintre de Gdańsk, Daniel Schultz, qui était alors revenu des Pays-Bas dans la République, Adolf est devenu le principal peintre de la cour du nouveau roi. La gravure ainsi que la peinture de Nieborów suivent le même schéma : des traits du visage exagérés, une image légèrement irrégulière et de belles couleurs pastel, typiques de Boy. Le costume et la pose du modèle ressemblent aux effigies du cousin d'Alexandre Louis, Albert Stanislas Radziwill (1593-1656) des années 1640 (Musée national d'art de Biélorussie), portrait de Nikolaus Hübner, conseiller de Toruń, daté « 1644 » (Musée du district à Toruń) et portrait de Giovanni Ambrogio Rosate (1557-1651), marchand de soie milanais, daté « 1650 » (Ospedale Maggiore à Milan). L'homme représenté ressemble fortement à Alexandre Louis d'après ses effigies au Musée national de Varsovie (MP 4771 MNW, Gr.Pol.10095/102 MNW), créé au XVIIIe siècle d'après l'original des années 1630, et au musée d'État de l'Ermitage (ОР-45869), créé entre 1646 et 1653.
Portrait d'Alexandre Louis Radziwill (1594-1654), grand maréchal de Lituanie par Adolf Boy, vers 1650, Palais de Nieborów.
Portrait de Christophe Sigismond Pac
En 1837, Louis Philippe (1773-1850), roi des Français, fonde au château de Versailles un musée dédié « à toutes les gloires de la France », aujourd'hui Musée de l'Histoire de France. Le musée présentait des artefacts appartenant autrefois à d'autres collections nationales ainsi que des œuvres spécialement commandées pour le musée.
Auguste de Creuse, un portraitiste français, a été chargé de créer plusieurs copies d'effigies d'individus historiquement importants. Les originaux ont probablement été perdus ou endommagés lors des révolutions passées et du délabrement de certains des palais royaux. Il réalise une copie d'un portrait de Louis Philippe alors duc de Chartres par Jean-Antoine-Théodore Giroust des années 1790 et un portrait de La Grande Mademoiselle (Anne Marie Louise d'Orléans, duchesse de Montpensier) en bergère par Gilbert de Sève des années 1660 (les originaux sont considérés comme perdus), entre autres. Le 14 août 1838, il fut également payé 150 francs pour créer un portrait de Jean Bart ou Jan Baert (1650-1702), un commandant de marine et corsaire franco-flamand, inscrit « Jean Bart / Chef D'escadre » (huile sur toile, 39 x 29 cm, MV 4307). De Creuse a probablement copié un tableau conservé dans la collection royale française. L'homme porte un costume en soie semblable au żupan polono-lituanien et un pardessus doublé de fourrure semblable au kontusz, tous deux boutonnés avec de gros boutons en or sertis de pierres précieuses de style oriental, semblables au guzy du costume national polonais. Le modèle n'a aucune ressemblance avec l'effigie de Jean Bart publiée par Pierre Blin en 1789, estampe réalisée par Antoine François Sergent-Marceau, alors qu'il a une ressemblance frappante avec les effigies de Christophe Sigismond Pac (1621-1684). Bien que dans un portrait, par Mathieu Elias, Jean Bart soit représenté coiffé d'un chapeau de fourrure ressemblant à un kołpak polonais (Musée national de la Marine à Paris, numéro d'inventaire OA 49), son costume est d'europe de l'ouest. Le costume du portrait de Versailles est presque identique à celui visible sur l'effigie de Christophe Sigismond par Johann Franck, estampe publiée en 1659 (Bibliothèque de l'Université de Vilnius). Christophe Sigismond Pac a fait ses études à Cracovie, Padoue et Pérouse, puis à Graz et Leyde et a servi dans les armées française, espagnole et hollandaise. En 1646, il devient grand porte-étendard de Lituanie. Il jouissait de la grande confiance du roi Jean Casimir Vasa et de son épouse française Marie-Louise de Gonzague. Il a adhéré à l'orientation française et a soutenu les projets de la reine Marie-Louise d'organiser une élection vivente rege (élection d'un roi du vivant de son prédécesseur). En 1654, il épouse une noble française Claire Isabelle Eugénie de Mailly-Lespine (mieux connue en Pologne-Lituanie sous le nom de Klara Izabella Pacowa), descendante d'Anne Lascaris, dame d'honneur et confidente de la reine Marie-Louise. Un an plus tard, en 1655, il reçut le poste de vice-chancelier de Lituanie. En 1662, en plus des 30 000 livres reçues du trésor français en 1661, il reçoit un salaire de 15 000 francs de l'ambassadeur de France auprès de la République polono-lituanienne, Antoine de Lumbres, pour avoir soutenu le candidat français lors de l'élection vivente rege. Ceci explique clairement la présence de son portrait dans la collection royale française. Comme le portrait portant le grand sceau lituanien au Musée national d'art de Kaunas créé vers 1670, l'original a très probablement été créé par le peintre de la cour royale Daniel Schultz. Le modèle, cependant, est beaucoup plus jeune dans le portrait de Versailles que dans la version de Kaunas, donc le tableau doit être daté du début des années 1650, lorsque Schultz a commencé sa carrière à la cour après son retour de France et des Pays-Bas.
Portrait de Christophe Sigismond Pac (1621-1684) par Auguste de Creuse, 1838-1840, d'après l'original du début des années 1650 par Daniel Schultz (?), Château de Versailles.
Portrait de Johann Georg Franz Wisendo von Wiesenburg par Frans Luycx et atelier
Même si, selon des sources connues, le peintre flamand et portraitiste de la cour impériale de Vienne, Frans Luycx ou Luyckx (mort en 1668), élève de Pierre Paul Rubens, n'a jamais visité la République, ses œuvres et celles de son atelier liées à la Pologne-Lituanie sont nombreux. Certaines effigies de membres de la famille royale-grand-ducale de Pologne-Lituanie, le peintre a pu réaliser lors de leur visite à Vienne en 1638 ou peu après. Avant 1643, Luycx travaillait très probablement pour le prince Jean Casimir puisque, selon l'inventaire des travaux de son palais en bois à Nieporęt près de Varsovie, 160 florins furent payés à un peintre de Vienne pour les autels (P. Von Sorgen zapłacieł w Wiedniu według recognicy K.J.M. Malarzowy ad rationem ołtarzów do Nieporęta) (d'après « Zbiory artystyczne ... » de Ryszard Szmydki, p. 43).
La composition du portrait de Jean Casimir en costume français à la mode, créé après son élection, peut-être vers 1648-1654, était similaire au portrait de son frère Ladislas IV en « bottes blanches », créé par Luycx environ une décennie plus tôt, surtout lorsque il s’agit de la représentation étrange, presque surréaliste, de la pièce derrière le monarque. Cependant, ce portrait, probablement perdu pendant la Première Guerre mondiale, n'est connu que par des photographies très anciennes (Musée national de Varsovie, DI 40131 MNW), on ne peut donc rien dire avec certitude sur son style. De nombreuses peintures de Frans faisaient également partie de la collection du roi avant le déluge, mais une seule est conservée à Varsovie. Il s'agit du portrait de la cousine de Jean Casimir, Marie-Anne d'Espagne (1606-1646), impératrice du Saint Empire romain germanique, au monastère des Visitandines à Varsovie (inscrit en latin : MARIA HISPANA IMPERATRIX / FERDINANDI III VXOR.). Le tableau a été donné au monastère très probablement après l'abdication du roi, car les comptes font état d'un paiement de 6 zloty et 20 groszy pour le déplacement de certains objets du château (septembre 1668) - meubles, tableaux, argenterie, instruments de musique, tissus et livres (d'après « Portrety infantek ... » de Jerzy T. Petrus, p. 31, 33). Ce tableau a été commandé ou reçu en cadeau de Vienne entre 1638 et 1642. Au Nationalmuseum de Stockholm se trouve un autre portrait de l'impératrice romaine réalisé par Luycx, qui provient très probablement de la collection de Jean Casimir (huile sur toile, 226 x 126 cm, NMGrh 75). Il s'agit du portrait d'Éléonore de Gonzague (1630-1686), fille de Charles II de Gonzague, duc de Nevers et nièce de l'épouse du roi Marie-Louise de Gonzague. En avril 1651, Éléonore épousa le cousin du roi, l'empereur Ferdinand III, et elle fut couronnée dans la cathédrale de Ratisbonne le 4 août 1653. Le portrait a donc probablement été réalisé entre 1651 et 1653 dans le cadre de la série, car il en existe un similaire au Musée Cheb en République tchèque (numéro d'inventaire č. O 177) et à la Villa del Poggio Imperiale (une version réduite, Poggio Imperiale 431 / 1860), très probablement offerte aux Médicis. Le tableau de Stockholm est signé et daté en bas en latin : ELEONORA GONZAGA ROM. IMP. AN. 16. / Lux Pinxit. / M, cependant, la date exacte était probablement obscurcie, tout comme d'autres signes de sa provenance originale. Il est donc très probable que le tableau ait été pillé à Varsovie en 1656 ou pendant la grande guerre du Nord (1700-1721), comme le portrait de l'abbesse Euphemie Radziwill (1598-1658) par Johann Schretter des années 1640 (NMGrh 1576). Un autre cadeau de Vienne pour Jean Casimir ou sa femme peint par Luycx pourrait être le portrait d'un homme de la collection de Jan Popławski (1860-1935), aujourd'hui conservé au Musée de Varsovie (huile sur toile, 80 x 63 cm, MHW 522). Ce tableau fut initialement attribué à un suiveur de Hans von Aachen (1552-1615) et désormais à un peintre du XVIIIe siècle. Il est très proche du style du peintre flamand et de son atelier, notamment le portrait de Ladislas IV à Wilanów (Wil.1143). La manière dont la main était peinte est particulièrement caractéristique de Luycx. Ce tableau représente Johann Georg Franz Wisendo von Wiesenburg (1622-1666), commis (Hofkammerkonzipist) à la cour de l'empereur Ferdinand III à partir de 1648. Il a été peint par Luycx et son atelier en 1653 et l'inscription au dos le confirme : Johan Georg Fran.s. / Wisendo VW. / M 1653. L. P. pinx.
Portrait du roi Jean II Casimir Vasa (1609-1672) avec une couronne par l'atelier de Frans Luycx (?), vers 1648-1654, localisation actuelle inconnue.
Portrait de l'impératrice Éléonore de Gonzague (1630-1686) par Frans Luycx, vers 1651-1653, Musée national de Stockholm.
Portrait de Johann Georg Franz Wisendo von Wiesenburg (1622-1666) par Frans Luycx et atelier, 1653, Musée de Varsovie.
Tronies du roi Jean II Casimir Vasa
Les études de tête hollandaises en costume, connues sous le nom de tronies (qui signifient « têtes » ou « visages »), sont devenues populaires en Pologne-Lituanie dès le XVIIe siècle et de nombreuses peintures de ce type faisaient partie des collections royales et des magnats. Deux tableaux de suiveurs de Rembrandt - portrait d'un homme barbu (huile sur acajou, 102 x 78 cm, Gal.-Nr. 1567, signé : Rembrandt. f. 1654.) et portrait d'un homme au chapeau orné de perles (huile sur toile, 82 x 71 cm, Gal.-Nr. 1570), et un de Willem Drost - portrait d'homme au kolpak rouge (huile sur toile, 89,5 x 68,5 cm, Gal.-Nr. 1568), tous de la galerie de Dresde (Gemäldegalerie Alte Meister), sont généralement considérés comme provenant de la collection de Jean II Casimir Vasa.
Le « Catalogue des tableaux de la Galerie royale de Dresde » (Catalogue of the pictures in the Royal Gallery at Dresden), publié en 1912, répertorie également le « Portrait d'une jeune femme mariée » (huile sur toile, 67,5 x 60,5 cm, Gal.-Nr. 1584) et « Un vieil homme avec une tête chauve » (huile sur toile, 63,5 x 53 cm, Gal.-Nr. 1585), peints dans les années 1630, tous deux par Jacob Adriaensz. Backer, comme « acquis en Pologne » selon l'inventaire de 1722. Il mentionne également « Mardochée et Esther écrivent des lettres au nom du roi Assuérus » (« Un document important », Gal.-Nr. 1792 A) par Aert de Gelder, cependant ce tableau est généralement daté vers 1685, il a donc très probablement été acheté pendant la période de Sobieski. Portrait d'une jeune femme mettant un bracelet de perles (huile sur toile sur bois, 78 x 62,5 cm, Gal.-Nr. 1591), attribué à Willem Drost, a également été transféré de Pologne avant 1722, selon le registre de Hübner (n° 1235). Il est intéressant de noter que bon nombre de ces peintures sont datées d'environ 1654. Il est donc possible que Jean Casimir les ait acquises peu avant le déluge et les ait évacuées vers la Silésie. Apparemment, ce type de peintures a également gagné en popularité en Pologne-Lituanie parmi les peintres locaux, car au Musée des Beaux-Arts de Bordeaux se trouve un portrait en forme de tronie montrant un homme en costume oriental (huile sur toile, 68,5 x 55 cm, Bx E 10). Il provient de la collection du roi Louis XIV à Versailles (Cabinet des tableaux), qui a reçu et acheté plusieurs objets de la collection de Jean Casimir comme une broche à l'aigle polonais (Louvre, MR 418) ou des tapisseries aux Triomphes de les dieux de Frans Geubels. Son chapeau de fourrure et ses traits asiatiques indiquent qu'il est tatar. Les hommes de cette ethnie musulmane de la République étaient fréquemment membres de la garde royale depuis le moyen âge, confirmé depuis l'époque du roi Casimir IV Jagellon (1427-1492) (d'après « Tatarzy w dawnej Rzeczypospolitej » de Piotr Borawski, p. 98). Son gorgerin indique qu'il est bien un soldat. Ce tableau était autrefois attribué à Guido Reni et maintenant à l'école de Rembrandt, mais le plus proche semble être les œuvres du peintre de la cour de Jean Casimir - Daniel Schultz, comme le portrait du roi au château royal de Varsovie (ZKW 1175), le prétendu autoportrait de Schultz au Musée national de Varsovie (MP 2447) ou le portrait de famille, censé représenter le fauconnier tatar de Crimée de Jean Casimir, au Musée de l'Ermitage (ГЭ-8540). Un autre portrait en forme de tronie peint par Schultz pour le roi pourrait être un nain avec un chien du palais de Wilanów (huile sur toile, 56 x 50 cm, inv. 270), qui, selon la photographie conservée, était comparable aux peintures mentionnées. Ce tableau est considéré comme perdu depuis la Seconde Guerre mondiale et comme on ne sait rien de lui hormis le fait qu'il provenait de la collection royale du dernier monarque élu Stanislas Auguste, il était considéré comme l'œuvre d'un peintre espagnol du XVIIe siècle, car ils peignaient fréquemment des nains. Même pendant le déluge, Jean Casimir a maintenu un style de vie luxueux, comparable à celui de son cousin le roi Philippe IV d'Espagne. Pierre des Noyers, secrétaire de la reine qui ne lui était apparemment pas favorable, a déclaré : « Il a autour de lui des nains en quantité, des chiens, des petits oiseaux et guenons. On ne parle dans sa chambre que de luxure ; c'est l'entretien ordinaire. Le vendredi saint, comme un autre jour, il conduit toujours avec lui cinq ou six jésuites, va souvent à la confesse, mais celá ne produit rien » (lettre du 1er octobre 1658 du camp militaire près de Toruń, d'après « Lettres de Pierre Des Noyers ...», publiés en 1859, p. 446). Parmi de nombreux nains, le roi avait à sa cour deux frères Kuczkowski, Stanisław et Kazimierz, qu'il appelait affectueusement Kuczkosie. Dans les dépenses de la cour royale de Jean Casimir de 1650 à 1652, les éléments suivants ont été répétés : « au nain Barthelek - 75 zloty », « au nain Januszek - 50 zloty », « au nain Kuczkoś - 50 zloty », « au deuxième Kuczkoś - 50 zloty » et il y a aussi un paiement « à M. Vinderhenn pour un pot en argent et une coupe en vermeil pour les nains de Sa Majesté le Roi - 70 zloty » (d'après « Niziołki, łokietki, karlikowie ... » de Bożena Fabiani, p. 5). Une naine de la reine nommée Resia, ainsi que le nain Bonarowski, furent envoyées à Chantilly dans les années 1660, à la cour de Louis II de Bourbon, prince de Condé. De plus, les Néerlandais souhaitaient évidemment aussi avoir des tronies avec les « Polonais » (comme on le simplifie souvent lorsqu'on parle de personnes de la République), car il existe de nombreux portraits de ce type de personnes portant des costumes similaires à ceux connus de Pologne-Lituanie et Ruthénie, peinte par Rembrandt et cercle. A titre d'exemple, on peut citer le portrait d'un garçon avec un chapeau de fourrure à plumes de Jacob Backer au Musée Boijmans Van Beuningen (2483 (OK)), le portrait d'un jeune en costume ruthène de Pieter de Grebber au Musée du Liechtenstein à Vienne (GE 89), portrait d'un homme au chapeau kolpak en apôtre Paul par Willem Bartsius au musée du couvent Sainte-Catherine à Utrecht (StCC s35) ou portrait d'un homme au chapeau de fourrure et au manteau de fourrure par Isaac de Jouderville (signé et daté : Rembrandt f / 1641, vendu chez Christie's, vente 21643, 31 janvier 2023, lot 337). De nombreux tronies et peintures de genre qui ont survécu au déluge ou acquis plus tard se trouvaient dans les collections du « Roi victorieux » Jean III Sobieski (1629-1696). Certains d'entre eux sont mentionnés dans l'inventaire du palais royal de Wilanów de 1696, comme « Une paire de tableaux, dans l'un un Suisse avec une hallebarde, dans l'autre une Hollandaise » (n° 29), « Une image d'une vieille Espagnole » (n° 76), « Une image d'une femme lisant un livre » (n° 97), « Une image d'une couturière hollandaise [peut-être une copie de La Dentellière de Johannes Vermeer] » (n° 98), « Un tableau de vieillards peint sur une planche, l'un d'eux tient un poisson et de l'argent » (n° 169), « Une paire de tableaux, dans l'un un vieillard, dans l'autre une femme » (n° 172), « Une paire de tableaux, dans l'un d'eux le Hollandais lutte contre les poux, dans l'autre l'autre homme se gratte » (n° 202), « Un tableau du peintre Rynbrant [Rembrandt], sur lequel est peint un vieil homme, grand, avec des cadres dorés, rond en haut » (n° 210), « Un tableau hollandais de David triomphant du géant [David et Goliath], jaunâtre » (n° 216), « Une image sur étain, une Espagnole avec un chapeau » (n° 240) (comparer « Inwentarz Generalny 1696 z opracowaniem » par Anna Kwiatkowska). Cet inventaire répertorie également des peintures qui peuvent être des copies ou des originaux de La Lettre d'amour (n° 156) et de La Laitière (n° 180) de Vermeer. Dans l'inventaire des peintures de la collection de la princesse Louise Charlotte Radziwill (1667-1695), dressé en 1671, des tronies représentant des Néerlandais (Olender/Olenderka) sont répertoriées séparément après les portraits standards et les effigies des empereurs romains (numéros 337-347, 696-697, 730, 797, comparer « Inwentarz galerii obrazów Radziwiłłów z XVII w. » par Teresa Sulerzyska). Aussi le portrait octogonal du roi Jean II Casimir, attribué à son peintre de cour Daniel Schultz, ressemble à une tronie (Musée national de Varsovie, déposé au château royal de Varsovie, huile sur panneau, 62 x 50 cm, NB 474 MNW, inscription : Joan. Ca ...). Ce tableau a très probablement été réalisé après l'accession du roi au trône en 1649 ou après le déluge dans les années 1660 pour compléter la série dite de la famille Jagellon dans la salle de marbre du château royal de Varsovie. Outre le costume du monarque avec un chapeau de fourrure ruthène, ce tableau s'inspire clairement du style de Rembrandt.
Portrait d'un vieil homme chauve par Jacob Adriaensz. Backer, vers 1633-1635, Gemäldegalerie Alte Meister à Dresde.
Portrait d'une jeune femme mariée par Jacob Adriaensz. Backer, vers 1633-1635, Gemäldegalerie Alte Meister à Dresde.
Portrait d'un homme barbu par un suiveur de Rembrandt, vers 1654, Gemäldegalerie Alte Meister à Dresde.
Portrait d'un homme au chapeau orné de perles par un suiveur de Rembrandt, avant 1667, Gemäldegalerie Alte Meister à Dresde.
Portrait d'un homme dans un kolpak rouge par Willem Drost, vers 1654, Gemäldegalerie Alte Meister à Dresde.
Portrait d'une jeune femme mettant un bracelet de perles par Willem Drost, vers 1654, Gemäldegalerie Alte Meister à Dresde.
Portrait d'un Tatar polono-lituanien au chapeau de fourrure par Daniel Schultz, après 1649, Musée des Beaux-Arts de Bordeaux.
Portrait du roi Jean II Casimir Vasa par Daniel Schultz, après 1649, Musée national de Varsovie.
Portrait d'un nain avec un chien par Daniel Schultz (?), après 1649, Palais de Wilanów, perdu.
Tarquin et Lucrèce avec portrait de Lucrezia Maria Strozzi, princesse Radziwill par Pietro della Vecchia
« Ayant rendu au Prince mon époux, digne de mémoire, le dernier service après de si graves ennuis, j'ai suivi le conseil de mes amis venus à ces funérailles de m'entendre avec le Prince grand maître d'hôtel de Lituanie afin que au moins, dans mon orphelinat, j'aurais la tête plus calme et je ne ruinerais pas ma santé par des soucis constants », écrit dans une lettre datée du 22 octobre 1654 de Turets (Biélorussie) Lucrezia Maria Strozzi (vers 1621-1694), princesse Radziwill à la reine Marie-Louise de Gonzague (Archives centrales des documents historiques de Varsovie, 1/354/0/4/703). La reine a soutenu l'ancienne dame d'honneur de la reine Cécile-Renée d'Autriche dans le conflit avec son beau-fils Michel Casimir Radziwill (1635-1680).
Michel Casimir a soulevé des objections aux dispositions du testament de son père en faveur de Lucrezia Maria, l'a accusée d'avoir contrefait le testament de son mari et avait l'intention de la priver de ses droits sur Tchernavchitsy et Turets. Le mari de Lucrezia Maria, Alexandre Louis Radziwill, mourut à Bologne en mars 1654, où il se rendit avec sa femme pour se faire soigner. De retour de l'étranger en juillet 1654, Michel Casimir s'empara de force de la résidence principale de son père décédé, le palais de Biała Podlaska. Il a également saisi les biens de Lucrezia Maria à Tchernavchitsy. Il est allé encore plus loin en déposant une plainte officielle contre sa belle-mère, dans laquelle il lui reprochait le conflit et son escalade. Jusqu'en novembre 1663, la veuve avec deux jeunes enfants était constamment impliquée dans des procédures judiciaires avec lui, généralement interrompues par des accords de compromis. Lors de l'invasion de la République par les pays voisins (déluge), Lucrezia Maria accompagna la reine en Silésie. Toute la cour fut évacuée de Varsovie via Cracovie vers Głogówek (17 octobre 1655), qui faisait partie des domaines Vasa et du douaire de la reine. La ville devint la capitale de l'émigration du couple royal et de ses partisans. On estime que jusqu'à 2 000 personnes vivaient à Głogówek et dans ses environs. De là, Lucrezia Maria et ses enfants se rendirent en Italie, à Mantoue (février 1656) et à Naples (août 1657). Elle a probablement laissé ses enfants avec sa famille à Mantoue jusqu'en 1661 ou 1663. Dans son dernier testament, elle a demandé que son corps soit déposé au Sanctuaire « delle Grazie » à Curtatone près de Mantoue, où les corps de ses ancêtres ont été enterrés dans la chapelle familiale de saint Louis (décoré de fresques de Il Pordenone). Ils ont eu beaucoup de chance. Leur richesse, leur position et leurs relations leur ont permis d'épargner leur vie et une partie de leurs biens. Ce qui est arrivé à ceux qui n'ont pas pu s'échapper était vraiment terrible. Les atrocités des envahisseurs sont décrites dans les lettres du secrétaire de la reine Pierre des Noyers, comme lors de l'incendie de Praga (un quartier de Varsovie sur la rive est de la Vistule), lorsque le brigand de l'Europe - Charles X Gustave de Suède y arrivèrent « tous ces misérables paysans, avec leurs femmes et leurs enfants, se jetèrent à genoux en le priant d'avoir pitié de leur misère; il leur dit qu'ils étaient tous des traîtres, et commanda à ses gens de tout tuer, ce qu'ils firent en sa présence sans pardonner à pas un enfant » (lettre datée du 11 août 1656 de Łańcut) (d'après « Lettres de Pierre Des Noyers ... », publié en 1859, p. 217-218). L'histoire tragique d'un garçon-ours, décrite dans « Nouvelles Ordinaires du 5me Ianvier 1664. De Warsovie, Ier Décembre 1663 » (p. 13-14, Bibliothèque nationale de France, FRBNF32780022), est très probablement aussi directement liée à l'invasion. « L'Evesque de Vilna [Vilnius] a ici envoyé à la Reyne un enfant agé de 8 a 9 ans qui a esté trouvé parmi les Ours proche de Kowno [Kaunas], dans la Lithüanie: où les Soldats qui ont leurs Quartiers d'hyver de ce costé-là, ayans esté sollicitez par les Païsans de donner la chasse à ces Bestes, qui leur causoyent de grands dommages, l'aperçeurent tout nud, fuïant avec les petits d'vne Ourse qu'ils poursuivoyent. Il a esté mis dans nostre Hospital : où par l'ordre de cette Princesse, on lui apprend la langue Françoise ». Le garçon « n'avait ni langage ni manières humaines [...], la reine lui donna un zeste de poire saupoudré de sucre ; [...] après l'avoir goûté, il le recracha dans sa main et avec sa salive, il le jeta entre les yeux de la reine ; le roi se mit à rire beaucoup » (Jan Chryzostom Pasek raconte l'histoire du garçon élevé par des ours et retrouvé en 1662 - Pamiętniki). L'ourse allaitant un enfant et l'histoire d'un garçon ont également été publiés dans « The history of Poland in many letter to person of quality ... » de Bernard O'Connor, publié à Londres en 1698 (Volume I, p. 342-343, Bibliothèque nationale de Pologne, SD XVII.3.4040 I). Lors de l'invasion, Kaunas fut incendiée et pillée par les Russes, qui occupèrent cette partie du pays du 18 août 1655 au 2 décembre 1661 (d'après « Social and Cultural Relations in the Grand Duchy of Lithuania: Microhistories », p. 9). La dévastation de la ville fut si grande que le Sejm de Varsovie en 1662 exempta Kaunas des impôts et des droits de douane pendant 10 ans. Selon les Nouvelles Ordinaires, le garçon avait 8 ou 9 ans lorsqu'il fut amené chez la reine à Varsovie en 1663, il perdit donc ses parents vers 1655-1660, c'est-à-dire lors de l'horrible déluge. L'invasion a trouvé son reflet dans la poésie, comme le poème de Zbigniew Morsztyn (vers 1628-1689), poète protestant à la cour des Radziwill, datant d'environ 1657 - « La deuxième muse de l'auteur pendant le siège de Cracovie, lorsqu'il était prisonnier des Suédois » : « Je chante, même si ma patrie souffre, Elle était autrefois si fertile, Si invincible, Et avec elle ses actes sont ruinés [...] Je chante, et les ruisseaux recueillent le sang polonais, et la fumée monte jusqu'aux nuages depuis les villes et les villages. Cette terre heureuse se transforme en cendres [...] Je chante pétrifié, Et où est mon abondance ? Où sont passés les beaux jours ? Les restes ont été brûlés par le feu et rasés jusqu'au sol ». L'un des rares artistes européens à avoir éventuellement réagi à ces événements tragiques fut Rembrandt en créant sa gravure du Christ présenté au peuple, également connue sous le nom d'Ostentatio Christi ou Ecce Homo. Cette œuvre est mystérieuse pour de nombreuses raisons. Nous ne savons pas qui l'a commandé ni pourquoi l'artiste l'a créé. Il a réalisé plusieurs versions de cette gravure, la dernière étant la plus dramatique (Rijksmuseum Amsterdam, RP-P-OB-612). La place devant le bâtiment, remplie de habitants de Jérusalem exigeant la crucifixion du Christ dans les versions initiales, a été remplacée par deux ouvertures cintrées. Entre eux, Rembrandt a placé la figure qui est parfois interprétée comme un dieu du fleuve ou de la mer, mais il pourrait aussi s'agir de Saturne, dieu romain du temps, de la dissolution, de l'abondance, du renouvellement périodique et de la libération. Les niches du bâtiment abritent des sculptures allégoriques de Justice et de Force (courage dans la douleur ou l'adversité). Au XIXe siècle, les représentants des impérialistes qui ont détruit la République et son multiculturalisme ont souvent souligné le penchant particulier de Rembrandt pour le théâtralité, sans accorder suffisamment d'attention au fait que ce théâtralisme au XVIIe siècle devait avoir un contexte et une signification importants, pas nécessairement religieux ou moraliste. Les plus intrigants sont les personnages entourant le Christ et l'homme à la porte de droite. Ce ne sont certainement pas des habitants typiques d'Amsterdam et ressemblent beaucoup aux nobles de la République, comme dans l'estampe représentant quatre Polonais (Polachi), créée par Johann Wilhelm Baur à Rome en 1636, page de titre de Polonia, nunc denuo recognita et aucta de Szymon Starowolski, publié à Wolfenbüttel en 1656 ou dans la carte de la République (Poloniae Nova et Acvrata Descriptio) de Jan Janssonius, publiée à Amsterdam en 1675. Plusieurs magantes et dignitaires de la République étaient également représentés avec une coiffure similaire - par exemple Jan Żółkiewski de son monument funéraire en marbre de Wojciech Kapinos (II) dans l'église Saint-Laurent de Jovkva (années 1630) ou Mikołaj Spytek Ligęza de son monument funéraire en albâtre de Sebastiano Sala dans l'église des Bernardins de Rzeszów (1630-1638). Dans cette composition, on peut identifier des personnages portant des costumes typiques des Juifs, des Polonais, des Lituaniens, des Ruthènes, des Cosaques, des Tatars musulmans, des Arméniens, des Allemands, des Hollandais et même des Italiens du XVIIe siècle. Un tel mélange était plutôt inédit à la mairie d'Amsterdam ou à la cour de La Haye, alors qu'il était typique à la cour grand-ducale-royale de Vilnius, Grodno, Lviv, Gdańsk, Cracovie et Varsovie et dans la plupart des villes et villages de la République (à comparer : « Lamentation de diverses personnes sur le crédit mort » - Lament różnego stanu ludzi nad umarłym kredytem, datant d'environ 1655). Seuls les deux derniers états de l'estampe de Rembrandt sont signés et datés au-dessus de l'arcade à droite de la plate-forme centrale - Rembrandt f. 1655. La même année, plusieurs armées étrangères envahissent la République. Une autre œuvre d'art fascinante liée à Rembrandt se trouve au palais de Wilanów à Varsovie (huile sur toile, 76 x 65 cm, numéro d'inventaire Wil.1346). Ce tableau représente un soldat et une jeune fille et est attribué à Pietro della Vecchia (mort en 1678), peintre actif à Venise à partir de 1633, qui étudia probablement avec Alessandro Varotari, d'où son intérêt pour la peinture vénitienne du siècle précédent, notamment celui de Titien et Giorgione. L'image d'un chevalier en costume Renaissance avec un large chapeau à plumes tirant une épée, peut-être une copie d'un original perdu de Palma Vecchio (Theatrum Pictorium, 223), est typique de della Vecchia. Il a réalisé de nombreuses versions et variantes de ce guerrier. L’image de la jeune fille, en revanche, est assez inhabituelle. Le style est différent et l'influence de Rembrandt est clairement visible « principalement dans la disposition picturale et libre des empâtements épais sur la chemise de la jeune fille » (d'après « Malarstwo weneckie ...» d'Agnès Czobor, p. 165). Il semble que le peintre ait combiné les deux effigies distinctes, son guerrier et le portrait d'une jeune fille par Rembrandt ou son entourage. Le tableau provient de la collection du comte Stanisław Kostka Potocki (1755-1821). Au dos de la toile se trouve un autocollant avec le sceau du comte de 1818-1821 et l'inscription en français : « Portrait d'un homme et d'une Femme de Della Vecchia ». À partir de 1818, Potocki fut président du Sénat du Royaume de Pologne. Il a donc très probablement acquis ce tableau en Pologne. La femme ressemble beaucoup à Lucrezia Maria Strozzi, princesse Radziwill de ses effigies par Rembrandt (National Gallery of Art, 1937.1.76 et Minneapolis Institute of Art, 34.19) et de l'atelier d'Andreas Stech (Musée de la Warmie et de la Mazurie à Olsztyn), toutes identifié par moi. Dans les peintures mentionnées de Rembrandt, la princesse était représentée sous les traits de l'héroïne romaine et de son homonyme Lucrèce. Lucrèce était la fille de Spurius Lucretius Tricipitinus et l'épouse de Collatinus de la famille royale Tarquin. Elle était célèbre pour sa beauté et encore plus pour sa vertu. Selon les historiens antiques, Sextus Tarquinius (Tarquin), l'un des fils du dernier roi de Rome, fut captivé par sa beauté et, la menaçant avec une arme, la viola. Cet événement marqua le début d'une révolte et conduisit au renversement du pouvoir royal à Rome et à l'instauration de la République. Tout au long des siècles de l'histoire romaine, Lucrèce était très vénérée, représentant l'exemple archétypal de la pureté et de la valeur féminine et un symbole de bravoure invaincue par la tyrannie. Tarquin est devenu l'image d'un tyran ou d'un ennemi et un symbole d'arrogance. Dans le tableau de Wilanów, le guerrier regarde la femme avec désir, tandis qu'elle regarde le spectateur. Le soldat-Tarquin peut donc être considéré comme un symbole de la « tyrannie » du beau-fils de Lucrezia Maria. Le tableau est généralement daté de la seconde moitié du XVIIe siècle, c'est pourquoi la princesse a commandé cette représentation déguisée d'elle-même probablement lors de son séjour à Venise ou à Mantoue ou peu après son retour en Pologne-Lituanie (vers 1657 ou 1661). Della Vecchia a probablement reçu son portrait, peint par Rembrandt, pour préparer cette composition et s'est inspirée du style du peintre hollandais. L'une des meilleures œuvres de Pietro, Saint Marc l'évangéliste du Musée national d'art de Kaunas (ČDM Mt 1396), a également été créée à cette époque.
Tarquin et Lucrèce avec portrait de Lucrezia Maria Strozzi (ca. 1621-1694), princesse Radziwill par Pietro della Vecchia, vers 1654-1661, Palais de Wilanów à Varsovie.
Ecce Homo - Allégorie de la chute de la république polono-lituanienne pendant le déluge (1655-1660) par Rembrandt, 1655, Rijksmuseum Amsterdam.
Portrait de Marcjan Aleksander Ogiński à cheval par Rembrandt
« Ils ont généralement tout tué à Vilna [Vilnius], tant hommes que femmes », rapporte Pierre des Noyers, secrétaire de la reine Marie-Louise de Gonzague, dans une lettre du 8 novembre. 1655, sur la destruction de l'illustre capitale de la Lituanie (d'après « Lettres de Pierre Des Noyers secrétaire de la reine de Pologne ... », publiées en 1859, p. 10).
Cette invasion fut certainement l’une des pires barbaries de l’histoire de l’humanité et ce n’était que le début de l’horreur provoquée par l’impérialisme étranger. La mort entourait les gens partout dans un pays détruit. Les armées étrangères et les cadavres en décomposition non enterrés dans les rues ont provoqué des épidémies. Il est très significatif que les images de la Danse de la mort (Danse macabre), une allégorie sur l'universalité de la mort, populaire en Europe occidentale au Moyen Âge après la peste noire (1346-1353), aient gagné en popularité dans la République polono-lituanienne après le déluge - allégories de la mort en stuc dans la chapelle de la Bonne Mort à Tarłów, très probablement créées par Giovanni Pietro Perti et Giovanni Maria Galli après 1662 ou Danse de la mort de Franciszek Lekszycki au monastère des Bernardins de Cracovie, peintes dans les années 1660, et une copie en Basilique de Węgrów. Après le déluge destructeur, le pays s’est lentement rétabli. Cela l’a également considérablement appauvri. De nombreuses personnes ont perdu la vie et, selon certaines estimations, la population a diminué de 40 %, voire de 90 % dans certaines villes, comme Varsovie. Les résidents ne pouvaient plus se permettre de dépenser en objets de luxe et en tableaux à l'étranger (principalement en Italie, en Flandre et en Allemagne), sauf exceptions, ce qui, paradoxalement, avait un impact positif sur la production locale. Les ateliers de peinture de deux grands centres économiques non détruits lors de l'invasion - Lviv en Ruthénie (Ukraine) et Gdańsk en Prusse polonaise (Pologne), deviennent les plus importants. L'éminent peintre de Gdańsk Daniel Schultz, peintre de la cour du roi Jean II Casimir, formé aux Pays-Bas, devient le peintre majeur de cette période. Les souvenirs apocalyptiques de l'invasion ont eu une grande influence sur l'art qui est devenu très sombre et centré sur la vanité de la vie - « la vanité des vanités, et toutes choses sont vanité » (vanitas vanitatum, et omnia vanitas) et « rappelez-vous que vous devez mourir » (memento mori). C'est après le déluge que la tradition sarmate du portrait funéraire (portrait de cercueil) se développe de manière significative, tandis que le squelette pourrissant remplace progressivement les effigies de la joyeuse Vénus et que l'Hodiguitria orientale remplace la lascive Madone occidentale. Comme de nombreux bâtiments étaient en bois, les structures incendiées ont complètement disparu en quelques jours ou quelques mois seulement. Pendant plus de cinq années d’occupation, les envahisseurs ont transformé de grandes parties du pays en désert. Ces événements horribles au cours desquels une armée de bandits unis se sont livrés à l'un des plus grands pillages organisés de l'histoire, répétés au cours des siècles suivants, ont été oubliés et n'ont jamais été fermement condamnés en Europe occidentale. Les dirigeants de cette campagne douteuse sont encore glorifiés par certains historiens comme des « tacticiens extraordinaires » ou des « grands conquérants ». Après une telle apocalypse, il a fallu tout reconstruire à partir de zéro. Il convient également de noter qu'en ces temps cruels, les Polonais n'étaient pas seulement des victimes. Ils étaient également engagés dans des campagnes militaires controversées. L'une de ces formations militaires notoires était lisowczycy également connue sous le nom de straceńcy (« hommes perdus » ou « espoir désespéré »), une unité irrégulière de la cavalerie légère polono-lituanienne, formée à la suite d'une mutinerie semi-légale des forces royales. À la suite de viols et de vols, les lisowczycy n'étaient généralement pas faits prisonniers, mais exécutés sur place. Déjà en 1623, leurs actions en Moravie et en Silésie devinrent un sujet de dispute entre Sigismond III Vasa et son beau-frère, l'empereur Ferdinand II. Amenés à combattre Gabriel Bethlen (1580-1629), prince de Transylvanie et duc d'Opole, les lisowczycy commencèrent à voler et à assassiner les habitants des villes et villages locaux. Lors d'une audience privée avec Ferdinand II, le prince Albert Stanislas Radziwill (1593-1656) répondit aux plaintes et accusations formulées dans les lettres impériales envoyées par ses diplomates à Varsovie. Dans ses instructions, Sigismond III a décrit les actions des lisowczycy comme le « libertinage des méchants ». Des lois parlementaires sévères furent émises concernant leur poursuite et leur emprisonnement pour crimes et vols en 1623, 1624, 1625, 1629 et 1631. Le prince Radziwill et le prince héritier Ladislas Sigismond Vasa devaient présenter un avis identique à l'archiduc Charles d'Autriche, évêque de Wrocław, qui les a accueillis à Nysa. Lors du voyage commun des suites du prince polono-lituanien et de l'archiduc Charles à Vienne, il y avait un risque que Ladislas Sigismond, Albert Stanislas Radziwill et l'évêque Charles d'Autriche soient kidnappés par les lisowczycy. Le 16 juin 1624, Radziwill écrivait : « La nouvelle s'est répandue, je ne sais de qui elle vient, des menaces des lisowczycy d'enlever les Très Sereins » (d'après « Świat polskich Wazów : eseje », p. 281). Les lisowczycy furent formellement privés du titre de chevalier et dissous en 1635 par un acte du Sejm, après leur retour à la République (d'après « Lisowczycy – jeźdźcy apokalipsy ze wschodu » de Piotr Korczyński). « Le Cavalier polonais » de Rembrandt, peint vers 1655 (ou dans les années 1650), traditionnellement connu dans la littérature polonaise sous le nom de Lisowczyk (comme répertorié dans la collection Tarnowski à Dzików), ne pouvait pas faire partie de cette formation notoire car la peinture a été créée il y a 20 ans après sa dissolution formelle. Le tableau, aujourd'hui conservé à la Frick Collection à New York (huile sur toile, 116,8 × 134,9 cm, numéro d'inventaire 1910.1.98), provient de la collection royale du monarque élu de la République, Stanislas Auguste Poniatowski. Il fut inscrit à l'inventaire du palais du roi sur l'Île à Varsovie en 1793 comme « Rembrandt Cosaque à cheval haut 44, larg. 54 pouces », car au XVIIIe siècle, les cosaques portaient de tels costumes démodés, au prix de 180 ducats. Le cavalier polono-lituanien par l'entourage d'Antoine van Dyck, peint dans les années 1620 (Palais de Schleissheim, numéro d'inventaire 4816), est également connu sous le nom de « Cosaque polonais » (Der polnische Kosak). Ce tableau provient de la galerie de Düsseldorf, comme les portraits du roi Sigismond III et de sa seconde épouse Constance d'Autriche (Château de Neubourg, 984 et 985), il se trouvait donc peut-être dans la collection de leur fille Anna Catherine Constance Vasa. Le tableau de Rembrandt fut offert au roi à la mi-août 1791 (mediis Augusti 1791) par Michał Kazimierz Ogiński (Mykolas Kazimieras Oginskis), grand hetman de Lituanie en échange de quelques orangers : « Sire, j'envoie à Votre Majesté un Cosaque, que Rembrandt avait mis sur son cheval. Ce cheval a mangé pendant son séjour chez moi pour 420 florins allemands" (Sire, Odsyłam Waszey Królewskiey Mości Kozaka, którego Reinbrand osadził na koniu, zjadł ten koń przez bytność swoją u mnie 420 guldynów niemieckich). Ogiński, en tant qu'envoyé du roi, résida à La Haye et à Londres d'août 1790 à mars 1791. Sur cette base, certains chercheurs pensent qu'il a acheté le tableau à l'étranger, mais il n'y a aucune preuve solide de cela. Il semble parfois qu'ils veulent maintenir l'image d'une république polono-lituanienne pauvre et primitive (avant 1655), habitée par des gens incapables d'apprécier la qualité d'une œuvre d'art et de commander un tableau exquis, plutôt que d'admettre que certains de leurs compatriotes ou alliés se sont livrés à des activités véritablement barbares en tant qu'envahisseurs, notamment le pillage et la destruction de peintures. Michał Kazimierz, membre d'une famille princière d'origine ruthène, était également un mécène des arts. Vers 1755, il commande une série de ses effigies à Anna Rosina de Gasc née Lisiewska, portraitiste allemande d'origine polonaise, mais seuls deux tableaux sont conservés, l'un à Minsk en Biélorussie et l'autre à Sanok en Pologne. Alors que les historiens de l'art en Angleterre ou en Italie ont parfois le confort de déterminer l'identité du modèle du portrait de van Dyck (ou d'un autre maître ancien célèbre), simplement sur la base de la propriété antérieure du tableau, dans les œuvres d'art liées à la Pologne, de telles tentatives donnent lieu à des discussions parfois dures et controverses. Bien que pour certains érudits, le grand Rembrandt ne pouvait pas peindre quelqu'un de la Pologne-Lituanie détruite et que le tableau soit imaginatif ou représente quelqu'un en costume oriental, la propriété déterminée la plus ancienne (Michał Kazimierz Ogiński avant 1791) et le costume indiquent que l'homme vient de la République. En 1981, Juliusz Chrościcki proposa Marcjan Aleksander Ogiński (1632-1690) comme modèle (« Rembrandt's „Polish Rider”. Allegory or Portrait? », p. 444) en se basant sur une grande ressemblance du modèle et de son costume avec le portrait anciennement à la collection Wenner-Gren en France. Cette effigie portant l'inscription MO / STR (en bas à droite), identifiée comme « Marcjan Ogiński / Staroste de Trakai », est attribuée à Ferdinand Bol, élève de Rembrandt, qui a peint le portrait de la reine Marie-Louise de Gonzague de la collection de Jacques Goudstikker à Amsterdam (vendu chez Christie's New York, 3 juin 2015, lot 15). Marcjan Aleksander, fils du châtelain de Trakai Alexandre, le dernier sénateur orthodoxe, a étudié à Vilnius et Cracovie. Il fut inscrit à l'Université de Leyde aux Pays-Bas en 1650 et rejoignit l'armée lituanienne un an plus tard. A cette époque également ses cousins : les frères Jan Jacek (1619-1684) et Szymon Karol (vers 1625-1694) étudiaient aux Pays-Bas. Le plus jeune, Szymon Karol, qui fut également proposé comme modèle possible pour le tableau de Rembrandt, étudia à l'Université de Franeker entre 1641 et 1655 et épousa en 1643 une Néerlandaise Titia Staakman, la fille du maire de Franeker, mais divorça bientôt (ils eurent une fille Sophie) et vécurent à Groningue entre 1648 et 1653. Marcjan Aleksander revient dans la République lors du déluge et à partir de 1656, sous le commandement de Paul Jean Sapieha, il participe aux combats avec l'armée de Transylvanie, puis en 1657 avec les Suédois en Courlande. Il abandonna l'orthodoxie pour le catholicisme en 1669 (les invasions étrangères accélérèrent la création de l'idée selon laquelle un bon Polonais, c'est-à-dire un résident de la République, devait être catholique). En 1663, il épousa une riche héritière de la famille ruthène Hlebowicz - Marcybella Anna (1641-1681), et après sa mort, le 4 mars 1685, il épousa Konstancja Krystyna Wielopolska (1669-1693), fille du chancelier Jan Wielopolski (1630-1688). Marcjan Aleksander est décédé sans héritier, de sorte que toutes ses propriétés ont été héritées par d'autres membres de la famille, y compris les parents de Michał Kazimierz. A Alovės en Lituanie, où il mourut en 1690, il y avait un château médiéval et un manoir princier dont aucune trace n'est visible aujourd'hui. En tant que notable important de la République, intendant lituanien (1659), grand panetier lituanien (1661), maître d'hôtel lituanien (1665), voïvode de Trakai (1670), grand chancelier de Lituanie (1684), il possédait sans doute également une importante collection de peintures, comme, très probablement, un portrait d'un homme en armure de style romain, identifié plus tard comme son portrait (Musée national d'art de Kaunas, ČDM Mt 1929). En 1688, Ogiński restaura l'église protestante de Rykantai en Lituanie, gravement endommagée lors du déluge, et la remit aux dominicains de Trakai. L'intérieur de l'église est décoré de fresques. Sur le mur des deux côtés de l'autel, sont conservés les portraits en pied de Marcjan Aleksander et de sa première épouse Marcybella Anna, aujourd'hui à peine visibles. Lors de la rénovation en 1931, la signature et la date ont été révélées : IAN CIANO 1688, identifié comme étant l'autographe du peintre Jonas Jonavičius (Jan Janowicz). Ogiński, 56 ans, était représenté en costume traditionnel - un long żupan et tenant sa main sur sa hanche comme dans le tableau de Rembrandt. Son visage ressemble beaucoup aux effigies par Rembrandt et par Bol.
Portrait de Marcjan Aleksander Ogiński (1632-1690) à cheval par Rembrandt, vers 1655, La Collection Frick.
Portrait de Marcjan Aleksander Ogiński (1632-1690) dans un chapeau de fourrure par Ferdinand Bol, années 1650, collection privée.
Portrait de la reine Marie-Louise de Gonzague par Ferdinand Bol
Le 3 mai 1660, la paix d'Oliva fut conclue entre la République polono-lituanienne et l'empire suédois, mettant ainsi fin à l'une des guerres les plus sanglantes et les plus destructrices de l'histoire polonaise. Ce traité est fréquemment attribué à l'ambitieuse reine Marie-Louise de Gonzague (1611-1667), qui supervisa personnellement la bonne préparation des négociations et tint des réunions avec les envoyés (comparer « Odrodzenie i reformacja w Polsce », Volume 45, p. 200). Le pays entouré de nombreuses monarchies absolutistes était un îlot de « liberté dorée » (Aurea Libertas) pour la noblesse et de « veto libre » (liberum veto) qui contribuaient à l'inefficacité de son système parlementaire. Comme la reine Bona en 1530, Marie-Louise souhaite introduire l'élection du roi du vivant de son prédécesseur (vivente rege) et elle obtient le soutien de la cour de France pour ces projets.
Le pays a été ravagé par une longue guerre. De nombreuses personnes qui ont réussi à sauver leur vie ont perdu leurs biens. Mais paradoxalement, quand certains perdent tout, d’autres deviennent très riches. Cette guerre a dû également affecter de nombreuses personnes à l'étranger. Par exemple, le commerce des céréales et du bois importés de Gdańsk était si vital pour l'économie néerlandaise qu'il était appelé le « commerce mère » (moedernegotie) (d'après « Kopstukken… », éd. Norbert Middelkoop, p. 104), tandis que Hendrick van Uylenburgh (décédé en 1661), un parent de Saskia, son fils Gerrit (décédé en 1679) et d'autres marchands exportaient de nombreux produits de luxe et d'art vers la République. Le 14 juillet 1656, le peintre Rembrandt, basé à Amsterdam, fut contraint de déclarer faillite (il demanda la cessio bonorum à la Haute Cour de La Haye), sa maison et ses collections furent vendues et, à l'âge de cinquante et un ans, il se retrouva sans abri et sans ressources. Il a été dépouillé, lit-on, même de son linge de maison (d'après « A Popular Handbook to the National Gallery », tome I, John Ruskin, p. 45). La même année, Otto van der Waeyen, le fils d'un marchand d'armes basé à Amsterdam, Dirck van der Waeyen, qui avait des contacts avec la Pologne-Lituanie, a été peint par l'élève de Rembrandt, Ferdinand Bol. Ce tableau, aujourd'hui conservé au Musée Boijmans Van Beuningen de Rotterdam, était signé et daté par le peintre (FBol - 1656) et l'inventaire des biens de Dirck du 14 juillet 1670 répertorie « un portrait d'Otto van der Waeyen par Ferdinand Bol » (een conterfeytsel van Otto van der Waeyen door Ferdinand Bol). Plus tard, les armoiries de la famille ont également été ajoutées en haut à droite. Le commerce avec la République en 1656, alors que le pays avait désespérément besoin de se défendre contre l'invasion barbare, était très lucratif pour le père d'Otto, car le jeune garçon, debout parmi les armes et les canons, est vêtu d'un costume de noble polono-lituanien - żupan en satin doré, un chapeau kolpak en velours doublé de fourrure coûteuse, des chaussures en cuir safian typiques et tenant un marteau de guerre nadziak. Le garçon était également le neveu de l'épouse de Bol, Elisabeth Dell. Bol, comme Rembrandt, a dû participer au commerce avant et après l'invasion, car nombre de ses tableaux ont trouvé leur chemin vers la Pologne, très probablement peu de temps après leur création, mais l'absence de noms de peintres dans les inventaires conservés et l'énorme destruction de l'héritage de la République rend cela difficile à prouver. Pendant plusieurs siècles après le déluge, le Royaume de Vénus est devenu l’un des plus grands champs de bataille d’Europe. Parmi les peintures de Ferdinand, issues très probablement des collections des Vasa polono-lituaniens, on peut citer Le Songe de Jacob de la Gemäldegalerie Alte Meister à Dresde (huile sur toile, 128,5 x 97 cm, Gal.-Nr. 1604, signée en bas à droite : f. Bol. fecit.), daté d'environ 1642, qui fut transféré de Varsovie par Auguste II avant 1722. Le roi transféra de nombreux objets des collections royales de Pologne-Lituanie en Saxe. La provenance de ce tableau est indiquée comme « De Pologne et plus tard de la Chapelle Royale » (Aus Polen und später aus der Königl. Capelle.) dans le registre de Julius Hübner de 1862 (« Verzeichniss der Königlichen Gemälde-Gallerie zu Dresden », n° 1267). Un tableau du Musée national de Gdańsk représentant l'Ange apparaissant à Agar dans le désert est très similaire en composition et en dimensions, il peut donc également provenir de la collection royale (huile sur toile, 115,6 x 97,8 cm, Ml 421 MPS). De la collection du roi Stanislas Auguste Poniatowski proviennent deux portraits signés par Bol - portrait d'une vieille femme des années 1640 (Musée national de Varsovie, M.Ob.555, antérieur 129022, signé : F. Bol) et portrait de Johanna de Geer-Trip avec sa fille (M.Ob.556, signé et daté : F.Bol 1661), ainsi que Saint Pierre repentant, attribué à Bol (Château royal de Varsovie, ZKW 3908). Au château du Wawel à Cracovie (2947), il existe un portrait d'un jeune homme coiffé d'un bonnet à plumes, peint par l'atelier de Ferdinand Bol (également considéré comme l'autoportrait de l'artiste), qui provient de la collection Zamoyski. Un autre très bon tableau de Bol qui pourrait provenir de la collection royale polonaise est un Homme en armure et casque (également comme Mars) conservé au Musée national de Varsovie (huile sur toile, 72,5 x 62,5 cm, M.Ob.2544, antérieur 34675), acheté en 1935 dans la collection de Jan Popławski. Il appartient à la catégorie des tronies, une forme de peinture de genre au format portrait, d'autant plus que le même homme a posé pour plusieurs de tableaux de Rembrandt, comme l'Homme au turban, dit « Le Noble slave », peint en 1632 (Metropolitan Museum of Art, 20.155.2) et Karel van der Pluym. On a longtemps pensé que le modèle était le frère aîné de Rembrandt, Adriaen. Une copie ou un original de cette composition se trouvait en 1909 dans la collection de la baronne Wilhelmina Czecz à Kozy (huile sur toile, 109,5 x 83,5 cm, d'après « Album wystawy mistrzów dawnych » de Mieczysław Treter, 1911, article 110, p. 33). En raison des armoiries de la famille ruthène Chodkiewicz, le tableau était considéré comme représentant le membre le plus célèbre de la famille Jan Karol Chodkiewicz (mort en 1621), grand hetman de Lituanie. Ce tableau portait en bas une inscription, découpée lors de la restauration de la toile au milieu du XIXème siècle et placée au dos : JAN CHODKIEWICZ WOIEWOD KIIOSKI HETMAN [...]. Le tableau appartient à la famille Czecz depuis 55 ans et a été acquis par Stanisław Reychan, qui l'a hérité de son père, le peintre Alojzy Reichan (1807-1860). Ce dernier aurait affirmé que le tableau provenait de l'atelier de peinture du château de Varsovie sous le règne de Stanislas Auguste et qu'il s'agissait d'une étude pour une série de portraits des hetmans. Ce portrait, déposé au Musée national de Cracovie avant la Seconde Guerre mondiale, était considéré comme une copie plutôt qu'un original (d'après le « Katalog wystawy obrazów ze zbiorów dr. Jana Popławskiego » de Jan Żarnowski, p. 43) et fut perdu au cours de la Seconde Guerre mondiale. Il convient également de noter que dans un tableau de Karel van der Pluym conservé au Metropolitan Museum of Art (71.84), également identifié comme une image du dieu romain de la guerre, Mars, le casque ressemble à ceux des images des guerriers sarmates et de Jan Karol Chodkiewicz agenouillé devant l'autel de la Vierge Marie tiré de Sacra Lithothesis (« Consécration de la pierre ») de Maciej Kazimierz Sarbiewski, publié à Vilnius en 1621 (Bibliothèque nationale de Pologne, SD XVII.3.9161). Son plastron est médiéval et son épée d'Extrême-Orient. La plus ancienne provenance confirmée de ce tableau est la collection de Théophile Thoré-Bürger à Paris en 1869, il est possible que ce portrait aux allures de tronie ait également été réalisé pour les clients de la République et transféré en France par des aristocrates fuyant de nombreuses invasions et guerres, comme l'insurrection de Janvier (1863-1864) ou l'insurrection de Novembre (1830-1831), contre l'empire russe. Il en va de même pour le célèbre Homme au casque d'or de l'entourage de Rembrandt à Berlin (Gemäldegalerie, 811A). La provenance confirmée la plus ancienne de ce tableau est la collection de Clément-Auguste de Bavière (1700-1761), archevêque-électeur de Cologne, fils de la princesse Teresa Kunegunda Sobieska (1676-1730), fille du « roi victorieux » Jean III Sobieski, qui, comme Anna Catherine Constance Vasa, a transféré une riche dot en Bavière. Les collections des tronies hollandais occupaient déjà au XVIIe siècle une place importante dans les collections royales et magnatiques de la République polono-lituanienne. Les Sarmates de l'époque moderne - les nobles de Pologne-Lituanie étaient souvent représentés dans des costumes exotiques, fantastiques ou anciens, par exemple dans le soi-disant « rouleau de Stockholm » (Château royal de Varsovie, ZKW/1528/1-39) d'environ 1605, portraits de Wincenty Aleksander Korwin Gosiewski d'environ 1650 (Palais sur l'Île à Varsovie, ŁKr 136, Palais de Wilanów, Wil.1135) ou portrait d'Aleksander Jan Jabłonowski à cheval, peint après 1697 (Château royal du Wawel, 8425). En 2015, un très beau portrait de Ferdinand Bol est vendu à New York (huile sur toile, 126,5 x 102 cm, Christie's, 3 juin 2015, lot 15). Avant 1902, il se trouvait dans la collection Westenberg à Amsterdam et plus tard dans la collection de Jacques Goudstikker à Amsterdam. En 1940, pendant la Seconde Guerre mondiale, le tableau fut confisqué par les nazis allemands pour le soi-disant Führermuseum à Linz. Ce portrait a été identifié comme représentant Marie-Louise de Gonzague, seconde épouse de Ladislas IV, qui épousa plus tard son frère Jean Casimir, répertoriée dans le dossier de restitution de 1945 comme « Portrait de Marie de Gonzague » (Portrait of Maria of Gonzaga). Lors de son voyage de Paris à Varsovie entre 1645 et 1646, la reine séjourna à Amsterdam et à Utrecht. Le 30 décembre 1645, une pièce de Jan Vos « Aran et Titus » fut jouée à Amsterdam pour la reine qui visitait la ville avec Frédéric-Henri d'Orange. Ses traits et son apparence noble semblent confirmer qu'il s'agit bien du portrait de la reine de Pologne. Cependant le style de ce tableau semble postérieur à 1645-1646, plus proche du Mars à Varsovie qui est généralement daté de la fin des années 1650 ou du portrait de Johanna de Geer-Trip daté « 1661 », lorsque les influences de l'école de peinture française ou flamande devient plus visible dans l'œuvre de Bol, et beaucoup moins celles de Rembrandt. Ainsi, dans les catalogues récents, cette identification a été remise en question car le peintre et la reine n'ont pas pu se rencontrer selon des sources connues et le tableau a été vendu comme « Portrait d'une dame, traditionnellement identifiée comme Maria Louise Gonzaga ». Dans Albertina à Vienne (9938), on trouve un dessin représentant un portrait de la reine, qui ressemble à la plupart de ses effigies. Il ressemble beaucoup au portrait de Marie-Louise réalisé par Claude Mellan en 1645 à Paris (Metropolitan Museum of Art, 53.601.285). Son visage est presque identique à celui du tableau de Bol. Le dessin viennois est signé : P van Schuppen. faciebat. / .1656., indiquant qu'il a été réalisé par le peintre et graveur flamand Pieter van Schuppen (1627-1702), qui quitta Anvers et s'installa à Paris en 1655. Ainsi, l'effigie pourrait être copiée à partir de l'estampe de Mellan ou d'une autre effigie. De nombreuses effigies de la reine attribuées à Justus van Egmont ont été réalisées bien après son départ pour la Pologne, comme le portrait du Château Royal de Varsovie (ZKW 2283), généralement daté d'environ 1650. En 1650, Marie-Louise commande à van Egmont à Paris un grand portrait d'elle et de ses deux maris. Les études pour le portrait de Bol auraient donc pu être envoyées de Varsovie. Le visage de la reine est également très similaire à celui vu dans un dessin attribué à Claude Mellan, aujourd'hui au Musée de l'Ermitage (ОР-1814) et est comparable au portrait de la reine en robe verte au Musée Suermondt-Ludwig à Aix-la-Chapelle, qui a probablement été créé dans les années 1650. Le riche costume et la pose indiquent qu'elle est une reine. Elle tient une épée comme si elle tenait un sceptre. Le style de son costume et de sa coiffure, semblable à celui des statues antiques de déesses romaines, confirme que le portrait est une allégorie. L'épée était un attribut traditionnel de l'ancienne déesse de la justice et de la loi divine Thémis (ou Justitia), tandis que le sceptre ou caducée était un symbole de Pax, déesse de la paix. Les deux déesses sont fréquemment représentées enlacées, comme dans le tableau très lesbien d'Artemisia Gentileschi (Palais royal de Naples). Ainsi, en réunissant les symboles des deux déesses, la reine représente Pax-Justitia (Paix et Justice). Dans le deuxième quart du XVIe siècle, Diane de Poitiers (1499-1566), favorite du roi de France Henri II, est représentée comme Pax à moitié nue (Allégorie de la paix) dans deux tableaux de l'école de Fontainebleau, très probablement Giovanni Capassini (Museo Nazionale del Bargello à Florence, Collezione Carrand 2064 et Musée Granet à Aix-en-Provence, inv. 201) et plus d'un siècle plus tard, en 1664, Anne d'Autriche (1601-1666), reine douairière de France, fut représentée sous les traits de Minerve et de sa belle-fille Marie-Thérèse d'Autriche (1638-1683) en Pax dans un tableau de Simon Renard de Saint-André (Château de Versailles, MV 6925). Sa robe en velours cramoisi est probablement aussi symbolique et fait référence aux symboles de la Pologne. Le portrait devrait donc être daté d'environ 1660 ou plus tard. La reconstruction des palais détruits de Varsovie commença déjà en 1659, puisque c'est de cette époque que date la conception de la décoration en trompe-l'œil de la galerie du palais de la Villa Regia à Varsovie par Giovanni Battista Gisleni. Gisleni a conçu la galerie pour la reine et elle a été réalisée entre 1665 et 1667. La décoration en trompe-l'œil imitait une loggia ouverte avec le paysage et des niches décorées de figures allégoriques et de statues dont Cesi Roma et Hercule Farnèse. Le portrait de Bol avait probablement aussi un pendant représentant le mari de la reine et a très probablement été créé dans le cadre de la série, mais nous ne le saurons probablement jamais, car après le déluge, de nombreux tableaux ont également été détruits lors d'invasions ou d'incendies. Le tableau a peut-être été un cadeau pour quelqu'un aux Pays-Bas ou il est peut-être revenu plus tard de Paris, où Jean Casimir a déplacé plusieurs peintures de sa collection. Il est également possible que le tableau ou ses copies ne soient jamais parvenus en Pologne. L'économie du pays, ravagée par cinq années de pillage et de destruction par divers envahisseurs, était dans un état déplorable. Le roi Jean Casimir ordonna que la riche couronne de Moscovie, probablement fabriquée pour le couronnement de son frère en tant que tsar de Moscovie, soit fondue en pièces de monnaie et vendit les pierres précieuses, ce qui provoqua un différend avec le parlement car la couronne était propriété de l'État. Il est donc possible que le tableau n'ait pas été payé et soit resté dans l'atelier du peintre. Il est intéressant de noter que le pendant aurait pu être conservé aux Pays-Bas. Il s'agit d'un autoportrait d'artiste de composition et de dimensions similaires, aujourd'hui conservé au Rijksmuseum (huile sur toile, 127 x 102 cm, SK-A-42). Bol ne se représente pas comme un peintre mais comme un riche aristocrate ou marchand, reposant sur la statue de Cupidon, qui symbolise l'amour romantique. Ce tableau est considéré comme ayant été réalisé à l'occasion de son mariage avec la riche veuve Anna van Erckel en 1669, mais la pièce qui l'accompagne est inconnue, ce qui suggère que Ferdinand aurait repeint le portrait du roi de Pologne. Jean Casimir abdiqua en septembre 1668 et s'installa à Paris peu après la mort de sa femme, qui apporta la paix au royaume de Vénus.
Le Songe de Jacob par Ferdinand Bol, vers 1642, Gemäldegalerie Alte Meister à Dresde.
Portrait d'Otto van der Waeyen en costume de noble polono-lituanien par Ferdinand Bol, 1656, Musée Boijmans Van Beuningen.
Portrait de la reine Marie-Louise de Gonzague (1611-1667) en Pax-Justitia (Paix et Justice) par Ferdinand Bol, vers 1660, Collection particulière.
Portrait d'un homme en armure et casque par Ferdinand Bol, vers 1660, Musée National de Varsovie.
Portrait d'un homme en armure et casque avec les armoiries de Chodkiewicz par Ferdinand Bol, Karel van der Pluym ou suiveur, après 1660, Musée national de Cracovie, perdu.
Portraits de Katarzyna Sobieska et Louise Charlotte de Brandebourg par Justus van Egmont ou atelier
Fin février 1650 à Lviv, Katarzyna Sobieska (1634-1694), sœur de Jan Sobieski (1629-1696), futur roi et fille de Jakub Sobieski (1591-1646), voïvode de Ruthénie, épousa un prince ruthène fabuleusement riche Vladislav Dominik Zaslavsky-Ostrogsky (décédé en 1656), également connu sous le nom de Władysław Dominik Zasławski-Ostrogski en polonais, qui avait presque 20 ans de plus que la mariée et était veuf. Les parents préparèrent Katarzyna à la vie monastique, ce qui fut empêché par la mort de son père en 1646. Sa mère, Zofia Teofila Sobieska née Daniłowiczówna (1607-1661), décida d'épouser Katarzyna, malgré les protestations de sa fille qui était amoureuse de Prince Dmytro Youri Vychnevetsky (1631-1682). Dmytro Youri épousa plus tard la fille de Katarzyna, Teofila Ludwika (1654-1709). Le mariage a eu lieu dans une atmosphère de scandale public, puisque Sobieska a donné naissance à un fils le 6 mars de la même année - Aleksander Janusz Zasławski-Ostrogski (1650-1673), considéré comme le fils de Dmytro Youri.
Le mari de Katarzyna était célèbre pour son style de vie somptueux, mais seuls quelques vestiges de son splendide patronage ont survécu, notamment le célèbre portrait peint par Bartholomeus Strobel en 1635, représentant le prince dans un riche costume français, aujourd'hui au palais de Wilanów (Wil.1654) et version en pied au Musée national d'art de Biélorussie à Minsk (ЗЖ-106). De magnifiques portraits similaires des épouses du prince Zofia Prudencjana Ligęzianka (décédée en 1649) et Katarzyna Sobieska devaient exister. Les portraits de Zofia Prudencjana ne sont pas connus et toutes les effigies connues de Katarzyna ont été créées après le déluge, comme l'indique son costume. Après la mort de son mari en 1656, Katarzyna se maria pour la deuxième fois en juillet 1658 à Lviv avec Michel Casimir Radziwill (1635-1680). Ils se sont probablement rencontrés en mars 1658 à Varsovie, lors du mariage de Jan « Sobiepan » Zamoyski (1627-1665) et Marie Casimire de La Grange d'Arquien (1641-1716) ou à Bardejov en Slovaquie, où elle s'est réfugiée avec ses enfants mineurs lors du déluge. A cette époque, son deuxième mari était engagé dans les batailles pour la libération des territoires conquis par les troupes russes, la reconstruction de ses domaines et sa carrière à la cour. En raison de la dévastation militaire, il obtint du roi une exonération d'impôts et de douanes pendant quatre ans. En 1661, il reçut 3 000 livres du trésor français. Michel Casimir devint bientôt châtelain de Vilnius (1661), voïvode de Vilnius (1667), vice-chancelier de Lituanie et hetman de champ de Lituanie (1668). Depuis lors, le sort de Katarzyna est étroitement lié aux activités publiques de son mari et de son frère. Le déluge marque également un tournant dans la carrière du jeune Jan Sobieski, futur roi, éduqué avec son frère aîné Marek (1628-1652) en France et aux Pays-Bas. Dans la première phase de l'invasion, il trahit Jean Casimir et se rangea du côté du brigand de l'Europe, ce qui est l'une des parties les plus controversées de la biographie du Roi Victorieux ou du Lion du Léchistan, comme on l'appela plus tard, attribuée à « erreurs de jeunesse ». Le 24 mars 1656, il quitte les rangs suédois et entre dans l'armée de Stefan Czarniecki. En réponse, Charles X Gustave ordonna d'accrocher à la potence des portraits et des plaques portant les noms de Sobieski et d'autres commandants. Ainsi, vers 1656, les portraits du jeune Sobieski et d'autres nobles devaient être nombreux, puisqu'ils étaient pendus en effigie (in effigie, une telle exécution de traîtres à la République en 1794 a été représentée dans un tableau aujourd'hui conservé au Musée national de Varsovie, MP 4881 MNW). Le 26 mai, le roi Jean II Casimir le promut au poste de grand porte-étendard de la couronne et il reçut le commandement d'un corps auxiliaire tartare dirigé par subkhan Gasi aga. La mère de Sobieski, Zofia Teofila, après la mort tragique de Marek lors du massacre de Batoh en juin 1652, partit en pèlerinage en Italie (mars 1653), visitant les sanctuaires du nord de la péninsule. Elle y resta plus de cinq ans, jusqu'en 1658, peut-être avec des pauses et visita probablement Naples. Elle devait également visiter Rome, point de visite presque obligatoire pour tout pèlerinage en Italie. Zofia Teofila était connue pour son caractère fort, voire masculin. Pleine d'énergie et d'esprit d'entreprise, elle aide son mari à gérer l'immense domaine. Pendant l'absence de son mari, puis après sa mort, Zofia Teofila dirigeait la ville de Jovkva et tous les domaines d'une main de fer (d'après « Teofila Sobieska ... » de Hanna Widacka). Elle décède le 27 novembre 1661 à Jovkva. Son magnifique portrait, conservé avant la Seconde Guerre mondiale dans l'église Saint-Laurent de Jovkva, a probablement été peint en Italie. Il la représentait en deuil après la mort de son fils et tenant un chapelet. Le style de ce tableau est comparable aux tableaux attribués à Carlo Francesco Nuvolone (1608/1609-1661/1662), peintre italien né à Milan et actif principalement en Lombardie, notamment le portrait de Giulia Bonfanti et le portrait en pendant de son mari Carlo Beccaria (Galerie nationale de Parme, GN 1112, GN 1113). Cependant, la paternité ne peut être affirmée avec plus de certitude, car le portrait n'est connu que grâce à une photographie prise par Edward Trzemeski (1843-1905) à Lviv en 1880. Il n'est pas non plus clair si Trzemeski a photographié le tableau original ou une copie réalisée par Jan Maszkowski (1794 -1865) ou son fils Marceli (1837-1862) pour le Musée Lubomirski de Lviv (comparer « Katalog muzeum imienia Lubomirskich ...» d'Edward Pawlowicz, article 372, p. 141 et « Jan Sobieski ...» par Józef Łoski, p. 3r). Après avoir terminé ses études en Pologne, le fils de Katarzyna, Aleksander Janusz, héritier des énormes domaines de Władysław Dominik (bien que n'étant pas son fils biologique), entreprit en 1667 un voyage éducatif habituel à l'étranger, en Allemagne, aux Pays-Bas, en France et en Italie. Depuis les Pays-Bas espagnols, où il s'est rendu à Anvers et à Bruxelles, le prince et sa suite ont poursuivi leur voyage vers Paris le 20 septembre. En 1669, le prince, âgé de 19 ans, retourna dans son pays natal, où il participa aux élections royales et fut considéré comme l'un des candidats à la couronne (liés à la dynastie des Jagellon). Son beau portrait en costume français, attribué à Andreas Stech, aujourd'hui conservé au Musée national d'art de Biélorussie (ЗЖ-129), est daté d'environ 1670. Bien que le séjour de sa mère en France ne soit pas confirmé dans les sources, on lui attribue fréquemment le dicton « Bonne France, glorieuse Espagne, heureuse Italie, riche Allemagne, mais la Pologne est ma préférée » (Dobra Francja, chwalebna Hiszpania, wesołe Włochy, bogate Niemcy, ale mi najmilsza Polska). Au début des années 1670, elle rénova la résidence principale des Radziwill à Biała Podlaska et l'église paroissiale locale, qui furent pillées et gravement endommagées par les forces de Transilvanie en 1657 et surtout par les troupes russes en 1660. En 1675, la princesse paya à Stefan Florian Paszkowski 400 zlotys pour les fresques du palais (d'après « Katarzyna z Sobieskich ... », partie III, de Jerzy Flisiński). Dans la seconde moitié du XVIIe siècle, la mode des portraits de dames de qualité françaises se répand en Europe. De tels portraits, comparables aux effigies des soi-disant Bellezze di Artimino du palais Pitti du début du XVIIe siècle, étaient fréquemment acquis comme modèles pour la nouvelle mode parisienne. Ils représentaient des dames aristocratiques du royaume de France, généralement des femmes instruites, mais aussi des célébrités du XVIIe siècle, connues pour leur position à la cour de France ou pour leurs scandales. L'inventaire de 1661 de la collection Lubomirski à Wiśnicz répertorie plusieurs portraits de dames françaises et italiennes qui ont survécu au déluge (section « Portraits » - Konterfety). De même l'inventaire de 1671 de la princesse Louise Charlotte Radziwill (1667-1695) - pièces 308-312, dont la reine d'Espagne et l'impératrice très probablement en costumes français (« Reine d'Espagnie », « L'Emipératrice »), précédés de deux portraits d'Alexandra, fille du prince de Valachie (296, 305), « Dame à moitié nue en manteau de zibeline » (Dama wpół naga w sobolach, 297), peut-être par Titien, portrait de la duchesse de Courlande (300), deux portraits de dames en robes à la française ornées de perles (301-302), électrice de Brandebourg (304), très probablement Louise Henriette de Nassau (1627-1667) et reine Marie-Louise de Gonzague (307) (comparer « Inwentarz galerii obrazów Radziwiłłów z XVII w. » par Teresa Sulerzyska). L'inventaire de 1667 des possessions du roi Jean II Casimir comprend 13 portraits de la famille royale française, dont le roi (Louis XIV), la reine mère (Anne d'Autriche) et l'épouse du roi (Marie-Thérèse d'Espagne) ainsi que 10 portraits non précisés de « dames de France » (d'après « Ludwika Maria ... » de Bożena Fabiani, p. 224). Plusieurs de ces portraits de dames françaises, attribués à l'école de Pierre Mignard, qui décoraient probablement le cabinet des glaces de la reine et le cabinet du roi à côté des chambres chinoises, et autrefois les chambres hautes de la reine Marysieńka (Marie Casimire), conservés au palais de Wilanów (Wil.1284, Wil.1285, Wil.1289, Wil.1290, Wil.1291, Wil.1292, Wil.1293, Wil.1297, Wil.1298, Wil.1300). Après son mariage avec Radziwill, Katarzyna Sobieska était l'une des femmes les plus riches du pays, mère et épouse de propriétaires de grands domaines en Lituanie et en Ruthénie, son portrait doit donc être considéré comme une position obligatoire dans le cycle représentant les dames de qualité de la République. Il est intéressant de noter qu'il n'y a pas de portrait de la sœur de Jean III dans l'inventaire du palais de Wilanów, réalisé après la mort du roi en 1696. Il répertorie cependant les portraits de la reine Éléonore Marie Josèphe d'Autriche « en robe blanche » (w białłej Szacie, n° 287), la reine de France « derrière la vitre » (za Szkłem, n° 37), la reine d'Angleterre « déshabillée » (bez Stroju, n° 289), la reine de Suède en « costume à l'ancienne avec des collerettes » (wstaroswieckim Stroju z kryzami, n° 288) ou encore la reine d'Écosse (Reginae Scottorum, n° 296), très probablement Marie Stuart (comparer « Inwentarz Generalny 1696 z opracowaniem » d'Anna Kwiatkowska). Les peintures mentionnées de l'école de Pierre Les Mignard n'étaient pas également mentionnés, ils pourraient donc être transférés d'autres résidences royales au XVIIIe siècle. Wilanów ou Villa Nova était une résidence d'été de banlieue, elle était donc remplie d'effigies moins formelles contrairement à d'autres résidences d'État, comme le Château royal, qui est également le siège du parlement. Il est donc possible que l'effigie de Katarzyna ait été « cachée » sous un déguisement, comme le tableau de sa patronne sainte Catherine « dans des cadres dorés » dans le cabinet de la reine (Obraz Swiętey Katarzyny w ramach złocistych, n° 40). Dans la seconde moitié du XVIIe siècle, les portraits déguisés en saints chrétiens étaient encore très populaires, comme en témoignent les portraits avec attributs de sainte Catherine représentant Anne Marie Martinozzi (1637-1672), nièce du cardinal Mazarin, par un suiveur de Constantijn Netscher (Versailles Enchères, 30 mars 2003, lot 20), Barbara Palmer née Villiers (1640-1709), maîtresses du roi Charles II d'Angleterre, par suiveur de Peter Lely (National Portrait Gallery, NPG 387), Catherine de Bragance (1638-1705), reine d'Angleterre, d'Écosse et d'Irlande, par Jacob Huysmans (Château de Hillsborough, RCIN 405880), Catherine de Questenberg (Kateřina z Questenberka) par Jan de Herdt (Château de Jaroměřice nad Rokytnou) et portrait de Marie Mancini (1639-1715), nièce du cardinal Mazarin, comme sainte Catherine par l'atelier de Jacob Ferdinand Voet (Musée de Vendôme). Le palais abrite actuellement deux intéressants portraits représentant des dames habillées à la mode dans les années 1660. Non seulement leurs poses et leurs costumes sont similaires, mais aussi le style du tableau, sans doute peint par le même peintre ou son atelier. Ils portent également un numéro d'inventaire similaire, indiquant qu'ils ont été répertoriés ensemble et proviennent probablement de la même série d'effigies. L'un est censé représenter Anne d'Autriche (1601-1666), reine de France, cousine du roi Jean II Casimir et amie de son épouse Marie-Louise de Gonzague (huile sur toile, 85 x 67 cm, Wil.1281). Il porte également une inscription pertinente en français dans le coin supérieur gauche : « Anne de Autriche Reine de France / femme de Louis XIII ». On pense qu'il provient de la collection d'August et Aleksandra Potocka, acquis avant 1877, ce qui n'exclut pas la provenance d'une précédente collection magante ou royale. Une inscription similaire (incorrecte) est visible sur le portrait du cardinal Jean Albert Vasa (1612-1634) de la collection de Wilanów, identifiant le modèle comme étant le cardinal André Bathory (1562-1599) et correctement identifié par moi en 2013 (Wil.1240). Ressemblance du modèle avec des effigies de la reine de France provenant de collections polonaises, comme la gravure de Jeremias Falck Polonus d'après Justus van Egmont (Musée national de Cracovie, MNK III-ryc.-13405), portrait en pied du monastère des Visitandines, offert par Jean II Casimir en septembre 1668, et deux portraits du Musée national de Varsovie (129779 MNW et MP 5274 MNW), identifiés par mes soins, est très général. La couronne placée sur une table à gauche est ducale ou princière (non royale) et similaire a été représentée couronnant les armoiries de la famille Radziwill dans deux œuvres dédiées au mari de Katarzyna, Michel Casimir Radziwill - Kolęnda, ktorą podczas morowego powietrza w powiecie radomskim w roku 1653 panuiącego ... de Jacek Przetocki, publiée à Cracovie en 1655 (Institut de recherches littéraires de Varsovie, 11811127) et Aqvila Radiviliana in ardvis investiganda ... de Hyacinthus Rynt, publié à Cracovie en 1664 (Bibliothèque nationale de Pologne, SD XVII.4.3545 adl.), ainsi que dans le portrait de Katarzyna Sobieska en veuve, peint vers 1680 (collection privée de Maciej Radziwiłł, inscription en latin : CATHARINA DE SOBIESZYN GERMANA İQANNİ / III REG: POL: SOROR ...). La femme du tableau de Wilanów ressemble beaucoup à Katarzyna d'après le portrait mentionné en tant que veuve et un autre portrait de la même collection, identifié comme représentant la princesse Radziwill assise sur une chaise. Le costume et la coiffure sont presque identiques à ceux de la gravure avec un portrait de Sobieska par Hirsz Leybowicz, réalisée entre 1747 et 1758 d'après un portrait original des années 1660. L'autre portrait représente une dame un peu plus âgée (huile sur toile, 73 x 57 cm, Wil.1282). Il s'agirait de l'impératrice Marie-Thérèse (1717-1780), ce qui n'est pas possible car le portrait aurait été peint plus d'un demi-siècle avant sa naissance. Cette effigie présente une ressemblance frappante avec la gravure représentant le portrait de Louise Charlotte de Brandebourg (1617-1676), duchesse de Courlande et Sémigalie, État vassal de la République polono-lituanienne, qui fut une amie proche de la reine Marie-Louise de Gonzague. Cette estampe a été réalisée par André Vaillant (1655-1693), graveur et peintre actif à Amsterdam, Paris et Berlin, en 1684, d'après un original des années 1660 (Bibliothèque nationale de Pologne, G.3253). Il s'agit d'une paire (portrait en pendant) à l'effigie du duc Jacob Kettler (1610-1682), époux de Louise Charlotte (G.3131/I). Elle ressemble également à l'effigie de la duchesse au château de Gripsholm (NMGrh 189), en robe noire, peut-être en deuil après la mort de la reine de Pologne en 1667. Ses contacts avec la reine Marie-Louise furent très cordiaux comme en témoignent ses lettres écrites en français (conservées à la bibliothèque et archives Condé, Château de Chantilly, Papiers de Gonzague). Elle exprima fréquemment son inquiétude pour la République détruite, ravagé par les envahisseurs et les conflits internes, pour son duché et pour le couple royal. « Mon coeur leur est lellement ataché [à vous] que si mon pere [Georges-Guillaume (1595-1640), électeur de Brandebourg et duc de Prusse] fut encor et comit quelque chose contre Vos Maiestez je ne l’aprouveroy jamais car j’ay trop de passion et respeck pour Vos Maiestez. Et je desire quant je seray morte de porter le tittre en mon cercoeili avec moy que j’ay esté jusques à mon dernier soupir la tres humble et toute dedié, fidele servante », a-t-elle écrit à la reine dans une lettre du 27 avril 1665 (comparer « Zwiastunki pokoju w świecie męskich wojen? » d'Igor Kraszewski, p. 171). Comme la reine, la duchesse de Courlande a également commandé ses effigies au même peintre - Justus van Egmont, comme en témoignent deux portraits, au château de Schönbrunn à Vienne et dans une collection privée, identifiés par moi. Justus est l'auteur de plusieurs beaux portraits de la reine, dont plusieurs furent réalisés après le couronnement à la cathédrale du Wawel à Cracovie le 15 juillet 1646, dont probablement l'effigie en robe du sacre au château de Versailles (huile sur toile, 82 x 65 cm, MV 3461) ou le portrait en costume de Junon, reine des dieux et déesse du mariage et de l'accouchement, accompagnée de ses deux époux Ladislas IV et Jean Casimir, commandé à Paris en 1650, vraisemblablement détruit lors du déluge. Il est intéressant de noter que les deux portraits décrits à Wilanów ressemblent également au style de Justus van Egmont, particulièrement comparable est le portrait d'une dame, connue sous le nom de marquise de Montchevreuil, à côté d'une fontaine (Sotheby's Londres, 29 octobre 2014, lot 447). Le portrait du brigand de l'Europe, Charles X Gustave, peint vers 1654 en couple avec un portrait de sa cousine la reine Christine, représentée comme Minerve (Château de Gripsholm, NMGrh 1853), est également attribué à van Egmont, bien que selon des sources connues le peintre et le roi ne pouvaient pas se rencontrer en personne, le portrait était donc basé sur des dessins d'étude ou d'autres effigies. En 1653, le peintre revient à Anvers avec sa famille, d'où il peut facilement expédier ses œuvres vers la République et la Courlande.
Portrait de la reine Marie-Louise de Gonzague (1611-1667) en robe de couronnement par Justus van Egmont ou atelier, après 1645, château de Versailles.
Portrait de Zofia Teofila Sobieska née Daniłowiczówna (1607-1661) par Carlo Francesco Nuvolone (?), 1653-1661 ou copie du XIXe siècle, perdue.
Portrait de Katarzyna Sobieska (1634-1694), princesse Radziwill par Justus van Egmont ou atelier, vers 1660-1667, Palais de Wilanów à Varsovie.
Portrait de Louise Charlotte de Brandebourg (1617-1676), duchesse de Courlande par Justus van Egmont ou atelier, vers 1660-1667, Palais de Wilanów à Varsovie.
Portrait d'un homme coiffé d'un grand chapeau, probablement le théologien Andrzej Wiszowaty par Rembrandt
Lors du déluge (1655-1660), le pays fédéral multiculturel et multireligieux réuni par l'Union de Lublin de 1569, une puissance européenne et un acteur important sur la scène politique, l'« Etat des libertés religieuses » (Confédération de Varsovie de 1573), le « Grenier de l'Europe », « Paradis des Juifs » (Paradisus Judaeorum), qui dépendait en grande partie du commerce avec d'autres pays, a été profondément humilié par les envahisseurs étrangers non catholiques, qui ont envahi le pays du nord, du sud, de l'est et l'ouest et en a pillé et détruit de grandes parties.
Le prêtre catholique Szymon Starowolski (1588-1656) dans sa « Lamentation de la mère en détresse de la couronne polonaise » (Lament vtrapioney matki Korony Polskiey ...) déclare que le déluge et les succès des envahisseurs « sont une conséquence de la guerre que la noblesse a déclaré contre Dieu, l'Église et les prêtres. [...] La principale faute était l'observance de la Confédération de Varsovie, établie pour que toutes les sectes puissent trouver refuge en Pologne et que chacun puisse blasphémer le nom du Seigneur comme il veut et forcer leurs sujets à le faire. Starowolski a été repris par un poète anonyme, écrivant : Tous ces gens blasphèment la Très Sainte Trinité, comment ne pas nous punir, ô Dieu juste » (d'après « Przyczyny wygnania arian ... » de Leszek Bober). De plus, des membres éminents des communautés protestantes du pays se sont rangés du côté des envahisseurs. Dans ces circonstances, en 1658, le Sejm avait adopté une constitution expulsant les frères polonais (également connus sous le nom d'ariens ou sociniens) de la République polono-lituanienne. La loi du parlement leur a donné le choix : conversion ou confiscation des biens et exil du pays (dans un délai de 3 ans). Le théologien socinien et noble des armoiries de Pierzchała Andrzej Wiszowaty (1608-1678), connu en latin sous le nom d'Andreas Wissowatius, fit une dernière tentative pour sauver les ariens. Du 11 au 16 mars 1660, une célèbre dispute théologique publique (Colloquium Charitativum) entre les représentants des frères polonais et le clergé de l'Église catholique eut lieu au château du châtelain Jan Wielopolski (mort en 1668) à Rożnów. La rencontre n'aboutit à rien, mais le châtelain, impressionné par l'intelligence de Wiszowaty, lui suggéra de rester dans un pays qui a besoin de personnes instruites. En échange de sa conversion à la religion catholique, il offrit au théologien le village de Gródek. Il refusa, affirmant qu'il valait mieux perdre « toute propriété et tout honneur civique que la conscience tranquille » (d'après « Reformacja w Polsce » de Henryk Barycz, tome 1, p. 202). Le 10 juillet 1660, il quitte la Pologne. Wiszowaty et sa famille se rendirent d'abord en Silésie des Habsbourg, puis chez des amis unitariens en Transylvanie. À partir de 1663, il séjourne à Mannheim et Heidelberg. Lorsqu'il fut interdit d'enseigner dans le Palatinat, il choisit Amsterdam comme lieu de résidence permanent (1666). Andrzej était le petit-fils du fondateur du socinianisme en Pologne, l'humaniste italien Fausto Paolo Sozzini (1539-1604). À l'âge de onze ans, il fut envoyé à l'Académie de la ville socinienne de Raków. Il quitte l'Académie en 1629, puis voyage beaucoup en Allemagne, aux Pays-Bas, en Belgique, en France et en Angleterre. À partir de juin 1632, il étudia la théologie et la philosophie pendant plusieurs années à Leyde, aux Pays-Bas. Il s'installe bientôt à Amsterdam. Il y rencontre et se lie d'amitié avec Krzysztof Arciszewski (1592-1656), un arien, voyageur et soldat célèbre en Europe. A Paris, Wiszowaty rencontre les penseurs Marin Mersenne, Pierre Gassendi et Hugo Grotius et peut-être René Descartes. En 1637, il retourna en Pologne. En 1638, sous prétexte d'insulter le catholicisme, l'école de Raków fut démolie, l'église fermée et les professeurs et les élèves expulsés. Indigné par cet événement, Wiszowaty se rend à Varsovie en 1639, où il prononce un discours en faveur de la doctrine de Raków devant la Chambre des députés. En 1640, il entreprit un autre voyage à travers l'Europe en tant que professeur d'Andrzej Suchodolski. Il a visité l'Allemagne, les Pays-Bas et la France. Après son retour, en 1642, le synode arien lui confia le poste de ministre de la congrégation arienne de Piaski, qui appartenait à la famille Suchodolski. Il mourut à Amsterdam le 29 juillet 1678. À la National Gallery of Art de Washington se trouve un portrait d'homme coiffé d'un grand chapeau, attribué à Rembrandt et daté variablement vers 1663 ou entre 1660-1665 (huile sur toile, 121,3 x 94 cm, 1942.9.69). Selon « Un catalogue de peintures du Canford Manor en possession de Lord Wimborne » (A Catalogue of pictures at Canford Manor in the possession of Lord Wimborne), publié en 1888 (p. 62, article 153), le tableau provenait de la collection du dernier monarque élu de la République Stanislas Auguste Poniatowski (1732-1798) et après « la dispersion de sa célèbre collection, il passa entre les mains de M. Noé, marchand de peintures bien connu à Munich ». En tant que descendant d'Izabela Elżbieta Morsztyn (1671-1758), Poniatowski était un parent éloigné de Wiszowaty, dont la grand-mère était Elżbieta Morsztyn (décédée en 1587). Bien que le roi soit réputé pour avoir tenté de constituer une collection nationale de peintures, il convient de rappeler qu'avant son élection, il possédait probablement aussi des peintures, qui étaient plutôt ses possessions privées. Des hommes vêtus de hauts chapeaux similaires ont été représentés dans une série de peintures qui décoraient le plafond d'une des pièces du palais Wielopolski à Cracovie. Stanisław Tomkowicz, dans sa publication de 1918 sur le palais (« Pałac Wielopolskich w Krakowie ... », p. 4, 18, 20, 23), a comparé le bâtiment, qui abrite aujourd'hui le conseil municipal, au Palazzo Venezia, un grand palais du début de la Renaissance au centre de Rome (siège de l'ambassade vénitienne de 1564). Ce somptueux palais a été construit en 1535-1560 pour l'hetman Jan Amor Tarnowski (1488-1561), qui l'a sans doute également décoré dans le style vénitien ou italien, mais le bâtiment fut partiellement détruit lors du déluge - en 1655, le palais servit aux Suédois de position pour les canons bombardant le Wawel. De 1667 jusqu'au milieu du XIXe siècle, le palais resta aux mains de la famille Wielopolski. Jan Wielopolski, mentionné, qui a probablement acquis le palais lorsqu'il est devenu viovode de Cracovie en 1667, et son fils, également Jan (1630-1688), ont rénové le palais, qui contenait des « antiquités respectables » et des « peintures historiques » et une pièce au premier étage, où se trouvaient des portraits de famille et des peintures du XVIIe siècle. Le plafond de la salle du premier étage était le seul parmi plusieurs qui ont survécu jusqu'en 1813 environ, date à laquelle il a été copié pour Stanisław Zamoyski par Jan Nepomucen Żyliński (décédé en 1838). Le dessin, conservé à la bibliothèque Zamoyski de Varsovie, a probablement été détruit pendant la Seconde Guerre mondiale. Le plafond d'origine a été détruit lorsque le palais a brûlé lors du grand incendie de Cracovie en 1850. Selon la description du dessin de Stanisław Zamoyski, le plafond a été peint à l'huile sur bois et représentait une ambassade polono-lituanienne à Vienne en 1669 pour négocier le mariage de l'archiduchesse Éléonore Marie Josèphe d'Autriche (1653-1697) au roi Michel Ier. Tomkowicz affirmait que le peintre aurait pu appartenir à l'école hollandaise du XVIIe siècle. En 1663, certaines peintures du plafond doré de style vénitien du château de Koniecpolski à Pidhirtsi près de Lviv dans l'ouest de l'Ukraine furent remplacées par des œuvres signées par Jan de Baan, très probablement commandées dans l'atelier du peintre hollandais Jan de Baen (1633-1702), élève de Jacob Adriaensz Backer à Amsterdam. Il est possible que les plafonds du palais Wielopolski aient également été peints à Amsterdam. Puisque les membres de la légation officielle polono-lituanienne portaient de tels costumes dans les années 1660, il en était sans doute de même pour un philosophe formé à l'étranger, principalement aux Pays-Bas. Après 1650, Lambert Visscher, peut-être élève de Pieter Soutman, actif à Amsterdam entre 1666 et 1673, créa une série de gravures représentant de notables sociniens polonais, tels que Fausto Paolo Sozzini, Jonasz Szlichtyng (1592-1661) ou Stanisław Lubieniecki (1623- 1675). Le costume de l'homme dans le tableau de Rembrandt est comparable à celui de l'effigie de Lubieniecki, tandis que ses traits du visage ressemblent à ceux du grand-père de Wiszowaty, Sozzini. L'inventaire de 1671 de la collection de la branche calviniste de la famille Radziwill fournit un aperçu précieux de l'état des collections de peintures quelques années seulement après le déluge. Il confirme que les collections des magnats comprenaient des peintures de notables locaux et étrangers ou de diplomates importants, mais dans de nombreux cas, l'identité exacte du modèle a été oubliée et parfois même les peintures ont été involontairement endommagées en raison de mauvaises conditions de stockage, principalement dues à la nécessité de évacuer les collections : « L'actuel roi de France [Louis XIV] lorsqu'il était jeune » (30/10), « Une image de prêtre portant des lynx » (49/9), « Un évêque métropolitain » (50/10), « Cécile-Renée, reine de Pologne, ses jambes sont pourries » (61/1), « Un tableau du défunt provenant de la maison des princes leurs seigneuries » (95/14), « Roi d'Angleterre » (126/2), « Un évêque » (154/5), « Un évêque assis sur une chaise » (155/6), « Un Ruthène en costume allemand tenant une masse » (165/16), « Un homme aux cheveux gris, hetman et maréchal » (193/19), « Un vieux tableau d'un roi » (194/20), « Un vieux tableau d'un roi avec un aigle » (195/21), « Un hetman cosaque » (259/10), « Un cardinal » (260/11), « Hospodar de Valachie » (261/12), « Personne à longue barbe, en noir, inscription An° 1553 etatis 47 » (753/14) (comparer « Inwentarz galerii obrazów Radziwiłłów z XVII w. » de Teresa Sulerzyska). Les magnats catholiques possédaient donc sans doute aussi de nombreux tableaux représentant des sociniens célèbres.
Portrait d'un homme coiffé d'un grand chapeau, probablement le théologien Andrzej Wiszowaty (1608-1678), par Rembrandt, vers 1660-1666, National Gallery of Art de Washington.
Une audience du plafond du palais Wielopolski à Cracovie par Jan Nepomucen Żyliński d'après le peintre hollandais (?), vers 1813 d'après l'original d'environ 1670, Bibliothèque Zamoyski à Varsovie, perdu.
Portrait de la famille de Jean Charles Kopec par Rembrandt
Jean Charles Kopec (mort en 1681), connu sous le nom de Jan Karol Kopeć en polonais ou Joannes Carolus Kopec en latin, fils de Vasil Vasilevich Kopec (1575-1636) et de Barbara Chodkiewicz, fut probablement l'un des représentants les plus notables de la famille ruthène Kopec, provenant très probablement des boyards de Smolensk. Il est probablement né à Varsovie et a fait ses études au Collège Nowodworski de Cracovie. En 1636, il s'inscrit à l'académie de Cracovie et en 1641, comme son père en 1593, il étudie à l'université de Padoue. Plus tard, il fut député de la voïvodie de Brest-Litovsk au Sejm électoral de 1648 et en 1650, il fut courtisan de la maison royale (dworzanin pokojowy królewski). Pendant le déluge, en tant que fidèle partisan du roi, il fut récompensé par le poste d'intendant lituanien et voïvode de Polotsk (Palatinus Polocensis) en 1658.
La même année, ou au début de 1659, il épousa Lucrezia Maria Strozzi (vers 1621-1694), veuve du voïvode de Polotsk Alexandre Louis Radziwill (1594-1654). Le couple eut deux filles : Françoise, connue en polonais sous le nom de Franciszka Kopciówna, née en 1659 à Varsovie et décédée en 1690 à Kodeń (mentionnée comme Francisca, Caroli Kopec Castellani Trocensis Filia, cuius Mater ex Ducali Prosapia Marchionissa de Strozzi dans « Historia Przezacnego Obrazu Kodenskiego », publié en 1720), qui épousa Casimir Vladislav Sapieha (1650-1703), voïvode de Trakai, et Anna, probablement née en 1661, qui épousa d'abord Stanisław Karol Łużecki (décédé en 1686), voïvode de Podolie, puis Konstantin Yan Chouïski (décédé en 1695), grand scribe de Lituanie. Tous deux sont mentionnés dans des documents concernant l'héritage de leurs parents en 1694, qu'ils se sont partagés (comparer « Kniaziowie litewsko-ruscy ... » de Józef Wolff, p. 527). En 1662, Jean Charles fonda à Haradzichtcha près de Pinsk en Biélorussie une église catholique en bois dédiée à sainte Anne (probablement pour commémorer la naissance de sa deuxième fille) et le monastère des moines bénédictins qu'il fit venir du Mont Cassin et qu'il richement doté. La famille, associée à la région de Pinsk, s'est convertie de l'orthodoxie au catholicisme au XVIIe siècle et Jean Charles fut l'un des premiers représentants catholiques. En 1629, son père et sa grand-mère Apolonia Wołłowicz fondèrent le monastère orthodoxe de Kupyatichi près de Pinsk (comparer « Czar Polesia » de Grzegorz Rąkowski, p. 242). En 1659, Kopec se rendit personnellement au Mont Cassin pour demander une fondation dans ses domaines. Il a également construit un palais en bois pour sa femme à Haradzichtcha. Samuel Straszkiewicz a dédié à Kopec son Decas qvaestionvm ex vniversa theologia, publié en 1672 à Vilnius. Au musée Herzog Anton Ulrich de Brunswick se trouve un « Portrait de famille » de Rembrandt, signé par l'artiste sur le panier tenu par une jeune servante (huile sur toile, 126 x 167 cm, GG 238, signé : Rembrandt. f.). Le tableau est daté par les experts vers 1665, provenant ainsi de la période de maturité et des dernières années de l'artiste avec des tendances néo-vénitiennes (plus précisément titianesques) clairement visibles. En supposant que les œuvres de Titien remplissaient de nombreuses résidences dans la République polono-lituanienne avant le déluge, un tel style serait particulièrement favorable aux mécènes de Pologne-Lituanie lors de la reconstruction d'après-guerre. Le tableau provient des collections des ducs de Brunswick-Lunebourg et des princes de Wolfenbüttel. Il a été documenté pour la première fois dans l'inventaire de la galerie Salzdahlum catalogué par Anton Friedrich Harms entre 1737 et 1744 (d'après « Welfen und Porträt ... », éd. Klaus Niehr, Silvia Schmitt-Maass, p. 133). Les costumes de l'homme et de la femme sont inhabituels pour les Pays-Bas des années 1660, ce qui indique qu'ils étaient étrangers (à comparer - portrait de Meyndert Sonck avec sa femme et ses enfants par Jan Albertsz Rotius, peint en 1662, Musée Mayer van den Bergh, MMB. 0138). L'homme porte une tenue noire sans col, très probablement un caftan oriental ou un czekman, comme la tenue noire de Kristupas Zaviša (1578-1670), grand maréchal de Lituanie dans son portrait de 1667 (Musée national d'art de Kaunas, ČDM Mt 1900). En dessous, l'homme porte un żupan cramoisi comme l'indique la manche de sa robe. La coiffe de la femme, ou toque, rappelle le balzo italien du deuxième quart du XVIe siècle, popularisé en Pologne-Lituanie par la reine Bona Sforza, tandis que son costume s'apparente à celui de Teodora Krystyna Sapieżyna née Tarnowska (1625-1652) d'après son portrait de Franciszek Wincenty Charliński, peint en 1775 d'après l'original des années 1640 (Château royal du Wawel, 8690) et les robes des dames de la découverte de la croix de Tomasz Muszyński, peinte entre 1654 et 1658 (église dominicaine de Lublin). La même femme, dans une pose similaire, était également représentée dans un autre tableau de Rembandt, identifié comme un portrait d'Hendrickje Stoffels, la compagne de longue date de Rembrandt, ou de Magdalena van Loo, une veuve étrangement heureuse du fils de Rembrandt, Titus (décédé en 1668 quelques mois seulement après le mariage). La femme porte un « costume fantastique », qui ressemble aux robes espagnoles du milieu du XVIe siècle. Ce tableau, aujourd'hui conservé au Musée des beaux-arts de Montréal (huile sur toile, 56,3 x 48 cm, inv. 1949.1006), provient de la collection du duc de Hamilton au palais de Hamilton, en Écosse, documentée pour la première fois en 1836. La femme ressemble beaucoup à l'épouse de Kopec - Lucrezia Maria Strozzi, qui après le mariage était connue en polonais sous le nom de Lukrecja Kopciowa, d'après une gravure à son effigie de Icones familiæ ducalis Radivilianæ, réalisée avant 1758, ainsi que de ses portraits peints identifiés par moi, comme celui de Pietro della Vecchia (Palais de Wilanów, Wil.1346) et de Rembrandt (Minneapolis Institute of Art, 34.19). L'apparition de deux enfants correspond aux âges des filles de Kopec vers 1663 (respectivement quatre et deux ans), donc proche de la date proposée pour l'exécution du tableau. Il a également été suggéré que le plus jeune enfant soit un garçon, mais un enfant portant un costume similaire dans un tableau du cercle de Daniel Mytens ou Antoine van Dyck (Sotheby's Londres, 27 octobre 2010, lot 16) est identifié comme étant Henriette-Marie (1626 -1651), fille d'Élisabeth Stuart (1596-1662), reine de Bohême. Le portrait de Johanna de Geer (1629-1691) avec sa fille Cecilia Trip (1660-1728) par Ferdinand Bol, élève de Rembrandt, peint en 1661 (Musée national de Varsovie, M.Ob.556 MNW), provenant de la collection du Stanislas Augustus Poniatowski, dernier monarque élu de la République à Varsovie, montre un autre costume de fille similaire. Il est intéressant de noter qu'environ trois ans plus tard, vers 1664, Johanna était représentée avec ses enfants dans un autre tableau de Bol, en Caritas et ressemblant à des images de la Vierge à l'Enfant (Rijksmuseum Amsterdam, SK-A-45). De plus, dans les portraits de famille, comme celui mentionné de Rotius ou celui de Cornelis de Vos de 1631 (Musée royal des Beaux-Arts d'Anvers, 815), les filles mettaient généralement l'accent sur l'attachement à la mère et les garçons au père, en particulier dans le cas d'un seul héritier mâle, comme ce serait le cas ici si l'enfant était un garçon. L'homme du tableau de Rembrandt tient une fleur rouge, probablement un œillet, symbole d'amour pour sa femme et ses filles. Selon Bożena Fabiani, les deux petits enfants sont les filles du couple et la troisième fille, qui tient un panier de fleurs, est une naine - très populaire comme courtisans à la cour des magnats polono-lituaniens depuis l'époque de la reine Bona (comparez « Niziołki, łokietki, karlikowie ... », Niezła Sztuka). Son riche costume, semblable à celui des autres filles, suggère qu'elle était traitée comme un membre de la famille. Tous les facteurs énumérés permettent d'identifier la famille comme celle du voïvode de Polotsk qui, bien que n'ayant probablement jamais visité les Pays-Bas, aurait pu commander un tel tableau par l'intermédiaire d'agents néerlandais à Gdańsk, qui ont également préparé les premiers dessins.
Portrait de la famille de Jean Charles Kopec (mort en 1681), voïvode de Polotsk avec une naine par Rembrandt, vers 1663, Musée Herzog Anton Ulrich à Brunswick.
Portrait de Lucrezia Maria Strozzi (vers 1621-1694) en robe noire par Rembrandt, vers 1663, Musée des beaux-arts de Montréal.
Pilate se lavant les mains par Mattia Preti
À l'été 1663, le nouveau grand vizir de l'Empire ottoman Köprülü Fazıl Ahmet (1635-1676), commandant une armée d'environ 100 000 hommes, conquiert la forteresse de Nové Zámky en Slovaquie, alors partie du royaume de Hongrie sous le règne de l'empereur Léopold Ier, parent du roi Jean II Casimir Vasa.
Le commandant en chef de l'armée de l'empereur, le comte Raimondo Montecuccoli (1609-1680), qui participa en 1657 à l'expédition des Habsbourg pour soutenir la Pologne-Lituanie pendant le déluge, n'avait sous ses ordres que 12 000 soldats réguliers autrichiens, auxquels s'ajoutaient les 15 000 Croates et Hongrois sous les ordres de Nikola Zrinski (1620-1664). Face à cette infériorité numérique de ses troupes, l'empereur Léopold Ier, durant l'hiver 1663, sollicite l'aide des princes allemands et de toute l'Europe. Les électeurs protestants de Brandebourg et de Saxe et même Louis XIV de France, opposés au régime des Habsbourg, envoyèrent une armée en soutien. L'empereur a également appelé la Pologne-Lituanie à aider l'Autriche en échange de son aide à repousser l'invasion lors du déluge. « En 1660, la République polono-lituanienne était engagée dans une guerre croissante contre les Cosaques et la Russie en Ukraine. C'était aussi une période où les dirigeants du parti pro-français exigeaient haut et fort des réformes et n'hésitaient pas à recourir à des intrigues pour atteindre leurs objectifs politiques, y compris les demandes d'intervention étrangère. Ce n'est pas un hasard si Jean Casimir, partisan du parti réformateur, a appelé en 1663 les Tatars - vassaux de leur allié la Turquie - à l'aider à briser l'opposition interne, renforcé par le passage du maréchal de la couronne et de l'hetman Lubomirski aux côtés du parti pro-autrichien. La Turquie a exigé en retour une aide dans la guerre contre l'Autriche. Alors Jean Casimir a non seulement refusé d'aider l'Autriche, mais a également accepté d'envoyer en 1663 20 000 cosaques, fidèles à Pavlo Teteria, l'ataman pro-polonais de l'Ukraine de la rive droite, pour participer à l'expédition à Nové Zámky aux côtés des Turcs et des Tatars. Ces cosaques participèrent à la prise de Nové Zámky et, avec les Tatars, dévastèrent terriblement la moitié de la Moravie. Ils ont également contribué à l'opinion publique des pays vaincus en considérant les Polonais comme des agents turcs » (d'après « Nieznany list Jana Sobieskiego z 1672 r. » de Vaclav Štěpan et Barbara Leszczyńska, p. 362). Bien que l'énorme destruction du pays par les envahisseurs chrétiens lors du déluge semble être passée inaperçue en Italie, cette trahison de la cause chrétienne, comme certains pourraient le penser, se reflète dans un tableau. Il s'agit d'une scène du Nouveau Testament - Pilate se lavant les mains, peinte par le peintre italien Mattia Preti (1613-1699), appelé Il cavaliere calabrese (le chevalier calabrais) après sa nomination comme chevalier de l'ordre de Saint-Jean (chevaliers de Malte) en 1660. À partir de 1661, l'artiste était en permanence à Malte et le tableau fut probablement proposé à la vente par l'artiste dans deux lettres datées du 23 septembre et du 11 décembre 1663 à Don Antonio Ruffo (1610/11-1678), prince de Scaletta, collectionneur sicilien, vivant à Messine sous le règne des Habsbourg espagnols. « J'ai fait un tableau de 9 x 7 palmi, où il y a un Pilate qui se lave les mains de la mort du Christ avec de nombreuses figures » (mi ritrovo fatto un quadro di palmi nove e 7, donde ci è un Pilato che si lava le mani della morte di nostro sig.re con molte figure), a écrit le peintre (comparer Catolgue Entry de Melissa Yuen). Le tableau provient de la collection Ferrara à Naples, aujourd'hui conservée au Metropolitan Museum of Art à New York (huile sur toile, 206,1 x 184,8 cm, 1978.402). La scène, considéré comme inspirée des œuvres du peintre vénitien Paolo Veronese, est inhabituelle, car le personnage principal est Ponce Pilate se lavant les mains, regardant le spectateur d'un air significatif, et le Christ apporté pour sa mort n'est que légèrement visible dans le arrière-plan. Un autre élément intrigant et significatif de la composition est le jeune serviteur africain, généralement associé à la turquerie et à l'orientalisme dans l'art européen, représentant ainsi la culture musulmane. Cependant, l’élément le plus important et le plus significatif de la scène est le costume. Pilate, se lavant les mains de sa culpabilité pour la mort de Jésus, porte un costume typique d'un noble polono-lituanien - un chapeau kolpak en fourrure et un manteau doublé de fourrure, semblables à ceux vus sur une gravure représentant un couple noble de la République dans la « Description de l'univers » d'Alain Manesson Mallet (1683), portrait gravé du roi Jean III Sobieski (1629-1696) par Nicolas de Larmessin (1684) et portrait gravé de l'ambassadeur de la République à Bruxelles Józef Bogusław Sluszka par Henri Bonnart d'après Robert Bonnart (1695). Preti devait connaître ces costumes, car les Sarmates voyageaient fréquemment en Italie dans leur tenue traditionnelle et son Diogène d'un tableau de 1649 conservé aux musées du Capitole à Rome (huile sur toile, 151 x 101 cm, PC 225), le porte également. Même s'il l'a peut-être un peu oublié à Malte, car la couleur bleue de la fourrure du chapeau est plutôt inhabituelle (les habitants de Pologne-Lituanie appauvrie, après les ravages causés par le déluge, ont apparemment beaucoup moins voyagé qu'avant 1655). De plus, dans le climat chaud du sud de l’Italie et de Malte, les Sarmates portaient, sans doute, rarement leurs chapeaux chauds, de sorte que cette anomalie est probablement même passée inaperçue auprès de la personne qui a commandé le tableau. Au XVIIe siècle, les scènes religieuses étaient encore utilisées pour véhiculer d'autres significations et en politique.
Diogène et Platon avec un homme vêtu de costume d'un noble polono-lituanien, par Mattia Preti, 1649, Musées du Capitole à Rome.
Pilate se lavant les mains, vêtu d'un costume de noble polono-lituanien, par Mattia Preti, vers 1663, Metropolitan Museum of Art.
Portraits de Lucrezia Maria Strozzi, princesse Radziwill par Rembrandt et atelier d'Andreas Stech
« REMBRANDT VAN RYN. 319. Une personne tenant un poignard dans sa main droite et une corde avec un bouton dans sa main gauche, comme si elle voulait sonner. Peint sur toile. Hauteur : coude : 1, pouce 19, largeur : coude : 1, pouce 12. » (REMBRANDT VAN RYN. 319. Osoba trzymająca w prawej ręce sztylet, a w lewej sznur z kutasem, jakoby dzwonic chciała. Mal. na płótnie. Wys: łok: 1, cali 19, szer. łok: 1, cali 12.), est la description la plus précise et la plus ancienne connue d'un tableau de Rembrandt intitulé « Lucrèce » et créé en 1666 (signé et daté : Rembrandt / f. 1666), aujourd'hui au Minneapolis Institute of Art (huile sur toile, 110,2 x 92,3 cm, 34.19). La description a été publiée en 1835 dans le « Catalogue de la galerie de peintures de maîtres célèbres de diverses écoles rassemblés par feu Michał Hieronim, prince Radziwill, voïvode de Vilnius maintenant exposé à Królikarnia près de Varsovie », créé par le peintre Antoni Blank. Radziwill a rassemblé sa collection de peintures dans son palais de Nieborów près de Łódź. La collection comprenait des œuvres d'art telles que l'Annonciation de Hans Memling, aujourd'hui au Metropolitan Museum of Art, des peintures de maîtres vénitiens, comme Titien et Tintoret, et plusieurs autres œuvres de Rembrandt, comme « La mise au tombeau du Christ » (poste 26), « Portrait d'un vieil homme, en bonnet violet et en robe noire, tenant à la main un papier roulé » (poste 193), « l'Annonciation (aux bergers) » (poste 242) et « Une femme, déshabillée, assise dans une chambre, trempant ses pieds dans une baignoire » (poste 291).
Fait intéressant, l'ancêtre direct de Michał Hieronim, qui vivait en 1666, s'appelait aussi Lucrèce, et ce n'était pas un nom couramment utilisé en Pologne à l'époque : Lucrezia Maria Strozzi (vers 1621-1694) ou Lukrecja Radziwiłłowa en polonais. Lucrezia Maria est venue en Pologne en tant que dame de la cour de la reine Cécile-Renée d'Autriche en 1637, alors qu'elle avait environ 16 ans. Son père était Pompeo Strozzi, qui a lié sa carrière à la puissante famille Gonzaga de Mantoue, et sa mère Eleonora Guerrieri. Elle est probablement née à Florence. Le 23 novembre 1642 à Varsovie dans l'église Saint-Jean-Baptiste, Lucrezia Maria épousa le prince Alexandre Louis Radziwill (1594-1654), qu'elle rencontra déjà en 1637, car il faisait partie des dignitaires polonais qui accueillaient la reine en Pologne. Ils se sont mariés seulement cinq mois après l'annulation du mariage d'Alexandre Louis avec Katarzyna Eugenia Tyszkiewiczówna (4 juillet 1642). Radziwill était plus âgé que sa troisième épouse d'environ 27 ans, il avait 48 ans, ce qui à l'époque était déjà considéré comme un âge très avancé. Leur premier enfant Cecilia Maria, nommé d'après la reine, est né peu après le mariage. Début décembre 1652, ils partent pour un voyage en Italie, où le fils d'Alexandre Louis issu du premier mariage, Michel Casimir, commence ses études à l'Université de Bologne en mai 1653. Dans les premiers jours de septembre 1653, après une difficile grossesse, Lucrezia Maria donna naissance à un fils, Dominique Nicolas, mais son mari mourut peu après à Bologne le 23 mars 1654. La mort d'Alexandre Louis a causé de grands troubles à Lucrezia Maria car son fils aîné lui était très hostile et il a soulevé des objections aux legs dans le testament de son père en sa faveur. Dans les années 1655-57, pendant le Déluge (1655-1660), elle séjourne avec son fils Dominique Nicolas en Italie. Fin 1658 ou début 1659, elle épouse Jan Karol Kopeć, voïvode de Polotsk. Le mariage a été un véritable salut pour Lucrezia Maria, car depuis lors, Kopeć est devenu partie au différend avec Michel Casimir, défendant les intérêts de sa femme et de ses enfants mineurs. En 1662, elle épousa sa fille aînée Cecilia Maria avec Mikołaj Hieronim Sieniawski (1645-1683), futur hetman de la couronne. En signe de gratitude pour l'amélioration de la santé de son fils, Lucrezia Maria fonda un monastère dominicain à Pińsk en 1666 (d'après « Lukrecja Maria de Strozzi (ok. 1621-1694), księżna Radziwiłłowa » de Jerzy Flisiński). Pendant de nombreuses années, Lucrezia a dirigé les actions de son fils dans la vie privée et publique. En tant que dame de la cour de la reine Marie-Louise de Gonzague, elle n'a probablement pas soutenu une rébellion contre le roi Jean II Casimir Vasa, initiée par Jerzy Sebastian Lubomirski, qui en 1664 a été accusé de trahison, le soi-disant rokosz de Lubomirski (1665-1666), et elle pouvait l'exprimer à travers des peintures. Lucrèce, l'incarnation de la vertu et de la beauté féminines, dont le suicide a déclenché la révolution politique, peut être considérée comme une allégorie parfaite. Le pays a été dévasté par plusieurs guerres, telles que le soulèvement de Khmelnytsky (1648-1657) et le déluge. Gdańsk, le principal port maritime du pays, dominé par les germanophones, qui, avec Lviv, était l'une des deux seules grandes villes de la République à n'être saisie par aucun des ennemis de la Pologne, renforce sa position de centre artistique du pays. Peintres de Gdańsk, Daniel Schultz, peintre de la cour du roi Jean II Casimir, et Andreas Stech ont travaillé pour de nombreux magnats polono-lituaniens. Vers 1654, Schultz a créé un magnifique portrait du prince Janusz Radziwill (1612-1655) en żupan de soie et vers 1670, Stech ou son atelier a créé une effigie du prince Aleksander Janusz Zasławski-Ostrogski (1650-1682) vêtu d'un costume français à la mode (les deux au Musée national d'art de Biélorussie à Minsk). Les portraits de deux femmes du palais Kwitajny, aujourd'hui au musée de la Warmie et de la Mazurie à Olsztyn, identifiées comme membres de la famille Radziwill sont peints dans un style très similaire. Les deux femmes étaient représentées en robe de cour guardainfante espagnole (la crinoline arrondie en cloche) des années 1660. Les Radziwill, en tant que princes du Saint Empire romain germanique, a eu des contacts avec la cour impériale de l'impératrice Éléonore de Gonzague (1630-1686) et l'impératrice Marguerite Thérèse d'Espagne à Vienne, qui y ont réintroduit la mode espagnole après son mariage avec l'empereur Léopold I en avril 1666. Chacun des voyages de Lucrezia Maria en Italie s'arrêtait également à Vienne. La mode espagnole était également très populaire en Italie à cette époque. Le roi Jean II Casimir Vasa, en tant que cousin de Philippe IV d'Espagne et de sa seconde épouse la reine Marianne d'Autriche (1634-1696), possédait sans doute plusieurs œuvres du peintre de cour espagnol Diego Velázquez et de son atelier, envoyées à Varsovie par ses proches, dont très probablement une copie du célèbre portrait de la reine Marianne, aujourd'hui au musée du Prado à Madrid (P001191). La femme la plus âgée, dont le portrait est très dans le style d'Andreas Stech, est parfois identifiée comme Katarzyna Potocka (décédée en 1642), première épouse de Janusz Radziwill (1612-1655), mais date de sa mort et absence de ressemblance avec son effigie à Minsk, exclure cette possibilité. Sa robe est très similaire au portrait de Maria Virginia Borghese (1642-1718), princesse Chigi au Palazzo Chigi d'Ariccia, près de Rome, peint par Giovanni Maria Morandi en 1659. Cette femme ressemble de façon frappante à l'effigie de Lucrezia Maria Strozzi par Hirsz Leybowicz, créé entre 1747-1758, d'après une peinture datant d'environ 1642. Le portrait d'une jeune femme, en raison de la composition, peut être considéré comme un pendant, mais son style est différent et plus proche de Daniel Schultz, qui à partir de 1660 environ était actif principalement à Gdańsk, mais travaillait toujours pour la cour royale de Varsovie. Sa robe est semblable au portrait d'une dame en robe espagnole, représentant peut-être Krystyna Lubomirska (1647-1669), fille de Jerzy Sebastian Lubomirski, créé vers 1667, en deuil après la mort de son père (de la collection Potocki, aujourd'hui dans la Musée national de Varsovie, huile sur toile, 121,5 x 97 cm, M.Ob.758). Le visage d'une jeune femme ressemble beaucoup à l'effigie d'Aleksander Hilary Połubiński (1627-1679) de la Bibliothèque de l'Université de Varsovie (numéro d'inventaire Inw.zb.d. 15609), devenu Grand Maréchal de Lituanie en 1669, donc créé autour de ce an. L'effigie mentionnée de Połubiński est un dessin (encre et aquarelle sur papier) et il s'agit probablement d'un dessin préparatoire pour une gravure ou un portrait, peut-être commandé à Gdańsk ou même à l'étranger. La femme est donc la fille de Połubiński Anna Marianna (1658-1690), qui le 9 octobre 1672 à l'âge de 14 ans épousa Dominique Nicolas Radziwill, fils de Lucrezia Maria (d'après « Archiwalia związane z kniaziami Trubeckimi ... » d'Andrzej Buczyło). Son portrait pourrait donc être commandé à Gdańsk avec l'effigie de son père et offert aux Radziwill. La femme de la peinture mentionnée de Lucrèce par Rembrandt au Minneapolis Institute of Art ressemble beaucoup à l'effigie d'une femme plus âgée de Kwitajny. Son guardainfante est également très similaire et l'ensemble du costume est presque identique au portrait d'un membre de la famille Tyszkiewicz créé vers 1793, d'après un original des années 1660 (Musée national de Varsovie, numéro d'inventaire MP 4308) ou au portrait de l'impératrice Marguerite Thérèse d'Espagne par l'atelier de Frans Luycx, créé vers 1666 (collection privée en Suède). La même femme a également été représentée comme une autre « Lucrèce » par Rembrandt, aujourd'hui à la National Gallery of Art de Washington (huile sur toile, 120 x 101 cm, 1937.1.76), qui avant 1825 était à Paris. Ce tableau est signé et daté au centre gauche : Rembrandt / 1664. Sa robe et son collier sont très similaires à ceux visibles dans un portrait d'Anna Tworkowska née Radziwill des années 1660 (Château Royal de Varsovie, numéro d'inventaire ZKW 544) ou dans le portrait de l'impératrice Éléonore de Gonzague par Frans Luycx des années 1650 dans le château de Gripsholm en Suède, prise de Pologne pendant le déluge.
Portrait de Lucrezia Maria Strozzi (vers 1621-1694), princesse Radziwill en Lucrèce par Rembrandt, 1664, National Gallery of Art de Washington.
Portrait de Lucrezia Maria Strozzi (vers 1621-1694), la princesse Radziwill en Lucrèce par Rembrandt, 1666, Minneapolis Institute of Art.
Portrait d'une dame en robe espagnole tenant un éventail, peut-être Krystyna Lubomirska (1647-1669) par le peintre flamand (?), vers 1667, Musée national de Varsovie.
Portrait d'Anna Marianna Połubińska (1658-1690) dans une robe espagnole par Daniel Schultz, vers 1670, Musée de la Warmie et de la Mazurie à Olsztyn.
Portrait de Lucrezia Maria Strozzi (vers 1621-1694), princesse Radziwill dans une robe espagnole par l'atelier d'Andreas Stech, vers 1670, Musée de la Warmie et de la Mazurie à Olsztyn.
Portrait de Michel Casimir Pac par Pier Francesco Cittadini ou atelier
En 1668, pour commémorer la libération de Vilnius après une longue occupation et destruction lors du déluge (1655-1660/1), Michel Casimir Pac (vers 1624-1682), Grand Hetman de Lituanie (à partir de 1667) fonda la construction du nouvelle église Saint-Pierre et Saint-Paul, à la place de l'ancienne détruite lors de l'invasion. Cette belle église est située sur une colline pittoresque appelée Antakalnis (littéralement « l'endroit sur les collines » en lituanien), l'une des banlieues historiques les plus anciennes et les plus grandes de Vilnius.
L'église a été construite entre 1668 et 1675 selon les plans de l'architecte de Cracovie Jan Zaor (Zaur, Zaorowicz), qui dirigea les travaux de construction jusqu'en 1671. La construction fut ensuite supervisée par l'architecte italien Giambattista Frediani. Vers 1677, Pac fait appel aux sculpteurs italiens Giovanni Pietro Perti (ou Peretti) de Florence et Giovanni Galli de Rome pour la décoration intérieure. Leurs stucs sont considérés comme le chef-d'œuvre du baroque lituanien. Les fresques ont probablement été réalisées par Michelangelo Palloni ou Martino Altomonte. Outre la statue représentant le Triomphe de la Mort, devenue un sujet courant dans l'art de la République après le déluge, fréquemment citée comme l'une des plus importantes, les panoplies sont un autre élément important de cette abondante décoration. Ils furent probablement demandés par Pac, désireux d'afficher ses victoires militaires et que les panégyristes décrivaient comme un conquérant intrépide des Moscovites et des Turcs (d'après « Wizerunki Michała Kazimierza Paca ... » d'Anna Sylwia Czyż, p. 87, 90-91, 97, 104-105). Il a servi dans l'armée dès sa plus tendre jeunesse. En 1652, il blessa grièvement Jan Sobieski, le futur roi, lors d'un duel pour Mme Orchowska. Lors du déluge, il s'illustre dans les batailles en Livonie, en Courlande et en Samogitie. Il soutient la politique de la reine Marie-Louise de Gonzague, qui lui promet le bâton d'hetman du champ (de bataille) lituanien, qu'il reçoit en décembre 1663 avec le poste de voïvode de Smolensk. Bientôt, en 1665, Pac acheta deux immeubles dans un quartier prestigieux de Vilnius, sur la via regia, qu'il fusionna ensuite en résidence, et agrandit également son domaine à Antakalnis. Michel Casimir commandait fréquemment des articles de luxe à l'étranger. La plus célèbre est une série de tapisseries au format portière avec ses armoiries, créées par l'atelier de Jan Leyniers à Bruxelles entre 1667-1669. Trois portières aux bordures décorées de panoplies ont été conservés à ce jour, deux dans les collections du Château Royal de Varsovie (ZKW-dep.FC/255, ZKW-dep.FC/256), un au Musée national de Lituanie (IM 2555), et deux à bordure florale dans les collections des musées nationaux de Cracovie et de Poznań. Dans son portrait dans l'église Saint-Pierre et Saint-Paul, attribué à Michelangelo Palloni, la table est recouverte d'un riche tissu de brocart avec ses armoiries - Gozdawa, très probablement commandé à Venise. Des panoplies sont visibles sur la page de titre de Practica prudentiæ politicæ ... de Mateusz Dłuski, publié à Vilnius en 1670 et dédié à Pac, ainsi que sur son effigie gravée publiée à Vilnius en 1686 dans Kwitnąca po smierci ... par Adam Wojciech Małachowski. Dans plusieurs de ses portraits, l'hetman tient une riche masse de style oriental - bulava, signe de son pouvoir. Il possédait une riche collection de telles masses et les offrait fréquemment, comme la masse donnée avant 1675 au sanctuaire marial de Trakai (volée avec les applications de l'image miraculeuse de la Vierge en juillet 1676). Une masse, qu'il a reçue en héritage de Wincenty Aleksander Gosiewski, il l'a offerte au maréchal lituanien Aleksander Hilary Połubiński et une autre à l'échanson lituanien Jan Karol Dolski. Dans son testament, Michel Casimir mentionne « des sabres en or, en argent et en poli ». Il a laissé l'un d'eux « turc de l'or, serti de diamants, de rubis et de turquoises » à Christophe Sigismond Pac, et l'autre « serti d'or » à Piotr Rudomina-Dusiacki, le staroste de Starodub. Il reçut également de riches cadeaux de l'étranger, comme « un cabinet incrusté de pierres et rempli de médicaments » (uno stipo incrostato di pietre e ripieno di medicamenti), envoyé par Cosme III de Médicis, grand-duc de Toscane en février 1676. Trois ans plus tard, le grand-duc exprimait le souhait que Michelangelo Palloni réalise un portrait de Pac pour sa galerie de dirigeants et commandants célèbres. L'effigie de l'hetman a été publiée en 1674 dans L'Historia di Leopoldo Cesare ... de Galeazzo Gualdo Priorato avec des images de monarques et notables européens et l'inscription MICHELE CASIMIRO PAZZI / PALATINO DI VILNA ..., soulignant la parenté de la famille Pac avec la famille aristocratique florentine Pazzi (par l'intermédiaire de leur prétendu ancêtre commun Cosmus Paccius). Michel Casimir entretenait une correspondance constante avec les Pazzi et son « parent » Lorenzo Domenico de Pazzi était son courtisan depuis au moins 1665. Lorsqu'en 1669 le pape Clément IX canonisa Marie-Madeleine de Pazzi, une religieuse carmélite déchaussée, les liens avec la famille Pazzi devinrent encore plus importants. Marie-Madeleine de Pazzi devint la protectrice de la famille Pac et fut mentionnée dans le dernier testament de l'hetman. Au Musée national d'art de Kaunas se trouve le portrait d'un homme portant une riche armure de style romain (huile sur toile, 101 x 76 cm, ČDM Mt 1929). Le tableau provient du palais Ogiński (Oginskiai) de Plungė. Il a été suggéré que le modèle soit Marcjan Aleksander Ogiński (1632-1690), mais cet homme ne ressemble en rien à son effigie de l'église de Rykantai, ni aux portraits de Rembrandt et Ferdinand Bol. Il détient également le bâton de cérémonie, ce qui indique qu'il est un officier militaire de haut rang et exclut Marcjan Aleksander, qui, après le déluge, s'est davantage impliqué dans une carrière politique que militaire. Au Rijksmuseum d'Amsterdam (numéro d'inventaire SK-A-284), se trouve un portrait similaire de Cornelis Tromp (1629-1691), un officier de la marine néerlandaise qui servit comme lieutenant-amiral général dans la marine néerlandaise, et brièvement comme amiral général dans la flotte danoise. L'armure, la cravate et la pose des deux hommes sont très similaires ainsi que la composition des deux tableaux avec un paysage à droite. Le portrait de Tromp était signé et daté (en bas à gauche) : Aº: 1668. / jANMijtens F:, indiquant que le tableau a été réalisé par Johannes Mytens en 1668. Le modèle du tableau de Kaunas n'est certainement pas Tromp et son style est plus italien que le néerlandais. Le plus proche est un portrait de dame tenant une rose, réalisé comme l'indique sa robe dans les années 1670 (vendu chez Bonhams Londres, 8 décembre 2016, lot 50). Le tableau est attribué à Pier Francesco Cittadini (1616-1681), dit il Milanese ou il Franceschino, élève de Daniele Crespi, actif principalement à Bologne. Egalement le portrait d'une jeune fille en robe brodée par cercle de Cittadini, peint dans les années 1650 (vendu chez Christie's Londres, 27 avril 2016, lot 335) et le portrait d'un garçon en uniforme rouge, probablement un aristocrate hongrois ou croate, peint à la manière de Cittadini dans les années 1660 (vendu chez Tennants, Autumn Fine Art Sale - Part II, 16 novembre 2019, lot 541) sont comparables. Ce dernier portrait indique que le peintre a accepté des commandes de l'aristocratie d'Europe centrale. L'homme du portrait de Kaunas ressemble beaucoup à Michel Casimir Pac, notamment à son effigie publiée dans L'Historia di Leopoldo Cesare ..., ainsi qu'à son portrait réalisé par Daniel Schultz ou cercle au Musée national d'art de Biélorussie (ЗЖ-108) et le portrait mentionné de Palloni dans l'église Saint-Pierre et Saint-Paul. Ainsi, le portrait a été réalisé vers 1668, lorsque le grand hetman de Lituanie fonda l'église de Vilnius et la montagne derrière lui, qui ressemble plus au Vésuve qu'aux environs de la capitale de la Lituanie, c'est ainsi que l'artiste italien a imaginé la colline appelée Antakalnis.
Portrait de Michel Casimir Pac (vers 1624-1682), grand hetman de Lituanie en armure de style romain par Pier Francesco Cittadini ou atelier, vers 1668, Musée national d'art de Kaunas.
Portrait du roi Jean II Casimir Vasa par l'atelier de Carlo Ceresa
Initium Calamitatis Regni (début de calamité pour le royaume) est la façon dont les opposants au roi élu Jean II Casimir Vasa interprétaient son monogramme royal I(J).C.R. (Ioannes Casimirus Rex). Ils accusaient le roi des événements tragiques de son règne et pensaient que les prétentions de Jean Casimir à la couronne de Suède, les revendications dynastiques légitimes, avaient amené dans le pays l'armée du « brigand d'Europe » Charles X Gustave, ainsi que celui de l'électeur de Brandebourg s'unit à lui (traité de Marienburg, conclu le 25 juin 1656), tandis que la République était aux prises avec d'autres envahisseurs à l'est.
Le pays s’est considérablement dépeuplé, l’économie était en ruine, les sources fiscales se sont taries et l’argent s’est considérablement déprécié. Cela a amené le roi à participer à la manipulation de la valeur nominale des pièces de monnaie, comme la boratynka frappée par Tito Livio Burattini (1617-1681) à Ujazdów, ce qui a également contribué à l'impopularité de Jean Casimir. Le pays qui importait auparavant des marbres lourds d'Italie et de Belgique, des produits de luxe de toute l'Europe, de Perse et de Turquie, n'était même plus en mesure de payer sa propre armée. « La véritable cause de cette misère résidait dans l'extrême appauvrissement du pays, dévasté par les vols et les destructions », comme le résumait Zygmunt Gloger dans son « Livre des choses polonaises » (Księga rzeczy polskich, p. 317), publié en 1896. En outre, la République a été ravagée par de graves conflits internes. La politique du roi et de la reine visant à renforcer le pouvoir royal a conduit à une guerre civile - la rébellion Lubomirski (1665-1666), initiée par Jerzy Sebastian Lubomirski (1616-1667) et ses partisans. Ils ont également paralysé les travaux du Sejm. Fin 1666, les principales forces des Tatars de Crimée, soutenues par les Cosaques, franchissent les frontières sud de la République et commencent la guerre en Podolie. En janvier 1667, Antonio Pignatelli (1615-1700), alors nonce apostolique dans la République polono-lituanienne, archevêque titulaire de Larissa et plus tard pape Innocent XII, rapporta que tout le pays était en effervescence avec des rumeurs sur l'abdication imminente du roi, car « en raison de son âge et de ses indispositions [de santé], il est incapable de mener des opérations militaires » (d'après « Stolica Apostolska wobec abdykacji ...» de Dorota Gregorowicz, p. 124). De plus, le 10 mai 1667, le roi fut frappé par une tragédie personnelle : son épouse, la reine Marie-Louise de Gonzague, considérée comme l'une des reines consorts les plus influentes et les plus puissantes de Pologne-Lituanie depuis l'époque de Bona Sforza (1494-1557), décédée. Le pays le plus tolérant d’Europe à la Renaissance entrait de plus en plus dans l’âge des ténèbres. Les temps de guerre, le chaos et les troubles ont été utilisés par certains pour opprimer les autres, en particulier les femmes. « Les femmes nous ont assez fait de mal avec leur politique » (dosyć i białegłowy swą polityką nam zaskórzyły), écrivait Andrzej Olszowski (1621-1677), vice-chancelier de la couronne et évêque de Chełmno, dans une lettre datée du 6 octobre 1668 à Marcin Oborski, staroste de Liw. La réticence à l'égard de l'influence politique des femmes s'est pleinement exprimée après l'abdication de Jean Casimir, lorsque le Sejm électoral a adopté une résolution (mai 1669), selon laquelle « la reine Sa Seigneurie ne devrait pas s'immiscer in negotia Status [dans les affaires de l'État], et aussi que aucun poste à la cour ne devrait être accordé par l'ingérence de dames étrangères de la cour » (Królowa Ieymć aby się in negotia Status nie mięszała, promocye także aby nigdy przez białegłowy dworskie cudzoziemskie nie chodziły, comparer « Dynastia Wazów ...» de Stefania Ochmann-Staniszewska, p. 276-277). En 1670, des « feuilles de figuier » furent probablement ajoutées aux effigies nues du roi Sigismond Auguste (1520-1572) et de sa troisième épouse Catherine d'Autriche (1533-1572), représentés comme Adam et Ève dans la tapisserie Le Bonheur édénique, pour couvrir leur nudité, lorsque la tapisserie a été transportée au monastère de Jasna Góra pour le mariage du roi Michel Ier, successeur de Jean Casimir (comparer « Arasy Zygmunta Agusta » de Mieczysław Gębarowicz, Tadeusz Mańkowski, p. 23). Le dernier portrait officiel de Jean Casimir est probablement le magnifique portrait en pied, aujourd'hui conservé au palais de Wilanów à Varsovie (huile sur toile, 202 x 153 cm, Wil.1159). Il le représente dans un costume français, à la mode à l'époque, noir en signe de deuil pour son épouse. Il tient la couronne, probablement la couronne dite de Moscovie, qui a été recréée sous une forme plus simple en 1668 par l'orfèvre de Varsovie Tobiasz Rychter. L'original, plus splendide, datant du début du XVIIe siècle, fut frappé pour la monnaie sur ordre du roi et il a été obligé par le Parlement de le restituer avant son abdication. L'ordre de la Toison d'Or décerné à Jean Casimir en 1638 par son cousin le roi Philippe IV d'Espagne pend à son cou. Le peintre est inconnu et aucun peintre actif dans la République ne semble en être l'auteur. Le style général indique des influences italiennes, des coups de pinceau audacieux, un contraste d'ombre et de lumière et un aspect « fresque », qui excluent les peintres de Gdańsk tels que Daniel Schultz, Adolf Boy ou Andreas Stech. L'auteur n'était pas Jan Tricius ou Tretko (mort en 1692), peintre polonais formé à Paris et à Anvers, car ses œuvres signées comme le portrait de Wojciech Dąbrowski, recteur de l'Académie de Cracovie, de 1664, ne présentent aucune similitude. Les tableaux attribués à Claude Callot, peintre formé à Rome, qui travailla pour Marie-Louise de Gonzague dès le début de 1667, dans la bibliothèque royale du palais de Wilanów ou dans la chapelle Vasa de la cathédrale du Wawel, sont également peints d'une manière différente. Parmi les peintres les plus éminents inspirés par la peinture italienne se trouve sans doute Tomasz Muszyński, actif à Lublin entre 1647 et 1680. Beaucoup de ses peintures sont conservées au monastère dominicain de Lublin. Son style est également différent. Il est intéressant de noter que Muszyński est sans doute l'auteur du portrait de Teresa Tyszkiewiczowa née Sapieha conservé au Musée de Varsovie (huile sur toile, 108 x 75 cm, MHW 2665), peint au début des années 1660, comme l'indique le style de sa robe. Le tableau porte ses armoiries - Lis entourées des lettres TST/XSP, abréviation de Teresa Sapieżanka Tyszkiewiczowa / Xiężna Sokolnicka Pułkownikowa. Le style de la toile rappelle le portrait du père Franciszek Grabiecki (peint en 1677), du bienheureux Ceslaus (1665) et des compositions plus grandes, comme celle de l'évêque André portant les reliques de la Sainte Croix en Pologne (1651-1653). Muszyński place ses scènes religieuses dans un entourage qu'il connaît de sa vie quotidienne. Ainsi la majorité de ses scènes représentent les habitants de Lublin « sous les traits » de personnages bibliques ou légendaires. A droite de sa grande composition représentant la Découverte de la Croix par sainte Hélène, il place une statue de Vénus désarmant Cupidon. Le tableau le plus proche par son style du portrait du roi du palais de Wilanów a été vendu en 2022 à Gênes - portrait d'un homme tenant une lettre (Wannenes Art Auctions à Gênes, 29 novembre 2022, lot 230). Il a été vendu aux enchères avec attribution à l'école bergamasque du XVIIe siècle et Ferdinando Arisi a attribué le tableau à Carlo Ceresa (1609-1679), peintre actif principalement autour de Bergame dans la République de Venise, formé dans l'atelier du peintre milanais Daniele Crespi. Une autre œuvre peinte de la même manière est un portrait ovale d'un noble (Galleria Marletta à Florence, 1erDibs : LU124028459822) et un portrait d'une noble (Lucas Aste à Milan, 24 mai 2022, lot 24), tous deux attribués à Ceresa. Le style du portrait d'une dame, peut-être l'épouse de l'artiste Caterina Zignoni, en Judith avec la tête d'Holoferne (Porro à Milan, vente 81, 30 novembre 2016, lot 5), peut également être comparé à l'effigie du roi. Les œuvres de Ceresa et d'autres peintres bergamasques du XVIIe siècle sont souvent comparées à celles du peintre le plus célèbre de Bergame, Giovanni Battista Moroni. Il ne peut être exclu qu'à travers cette peut-être dernière commande en tant que monarque élu de la République, Jean Casimir fasse référence à l'âge d'or de la Pologne-Lituanie, aux portraits des Jagellon de Moroni, que j'ai identifiés, ainsi que de nombreuses peintures magnifiques qu'il a probablement également réalisées pour des sarmates, détruits lors du déluge.
Portrait du roi Jean II Casimir Vasa (1609-1672) par l'atelier de Carlo Ceresa, vers 1668, Palais de Wilanów à Varsovie.
Portrait de Teresa Tyszkiewiczowa née Sapieha par Tomasz Muszyński, années 1660, Musée de Varsovie.
Avant l'invasion par les pays voisins, connus sous le nom de Déluge (1655-1660), la République polono-lituanienne se classait parmi les pays les plus riches d'Europe et ses monarques rivalisaient avec succès avec les dirigeants d'autres nations en tant que mécènes.
Couronne « orientale » et « moscovite » de Sigismond III Vasa
Le roi Sigismund III Vasa, le monarque élu de la République polono-lituanienne multiculturelle, était connu pour son goût artistique raffiné hérité des Jagellons et de sa grand-mère la reine Bona Sforza. Il a commandé les œuvres d'art les plus exquises non seulement en Europe, mais aussi en Perse. En 1601, le roi envoya Sefer Muratowicz un marchand arménien de Varsovie en Perse, où il commanda des tapis tissés de soie et d'or, une tente et des épées en acier de Damas et d'autres articles de luxe. Les kilims séfévides aux armoiries de Sigismond III Vasa (Aigle polonais à gerbe Vasa) ont conservés dans de nombreuses collections.
Le roi était si satisfait des résultats de l'expédition de Muratowicz qu'après son retour le 26 octobre 1602, il lui donna le titre de servitoris ac negotiatoris et l'obligea à l'avenir à présenter tous les biens apportés en Pologne depuis la Turquie et la Perse, avant qu'ils ne soient étaient mis en vente, à la cour royale, afin qu'il puisse choisir ceux qu'il aimait le plus (d'après « Sztuka islamu w Polsce w XVII i XVIII wieku » de Tadeusz Mańkowski, p. 25). Sigismond III possédait une collection particulièrement riche d'armes orientales et le bouclier kalkan persan ou turc de la collection Lubomirski à Kruszyna était, selon la tradition, la propriété du roi (Château royal de Wawel). Mechti Couli Beg, ambassadeur du chah Abbas de Perse, participa au mariage du roi à Cracovie en 1605 et Robert Shirley (décédé en 1628), envoyé par le chah en mission diplomatique auprès des princes européens, fut reçu solennellement par Sigismund au Sejm à Varsovie le 25 février 1609. Très probablement en Italie, le roi a commandé un chichak partiellement doré, un casque en acier de style oriental avec Hercule tuant l'hydre de Lerne d'un côté et Hercule combattant Antée de l'autre ainsi que des armoiries de la Moscovie, en cadeau au Fédor Ier, tsar de Russie, remise par l'ambassadeur Paweł Sapieha en 1591 (Musée du Kremlin). A Milan en Italie ou à Prague il commande le lavabo en cristal avec ses armoiries et son monogramme (Trésor de la Résidence de Munich) et à Augsbourg en Allemagne un service en argent à 20 000 florins pour la cérémonie de réception de l'Ordre de la Toison d'or (utilisé pour la première fois lors d'un banquet au château de Varsovie le 25 février 1601) et bien d'autres objets précieux. En Flandre et aux Pays-Bas il acheta des tapisseries, comme 6 pièces avec l'Histoire de Diane par l'atelier de François Spierincx à Delft, vers 1611-1615, des peintures à Venise, comme la Vierge à l'Enfant avec saint Jean-Baptiste et saint Stanislas par Palma il Giovane pour la cathédrale Saint-Jean de Varsovie, avant 1618, des objets en ambre à Gdańsk et Königsberg, comme un échiquier en ambre de la reine Anne de Danemark et d'autres cadeaux en ambre, envoyés en Angleterre en 1607 par l'envoyé anglais en Pologne William Bruce. Les commandes d'œuvres d'art étaient liées à des dates importantes de la vie du roi. En 1605, il dépensa de grosses sommes pour son mariage, y compris des robes coûteuses brodées de perles. La mariée était une sœur cadette de sa première épouse Anna, Constance d'Autriche (1588-1631), du côté paternel et maternel une descendante d'Anna Jagellon (1503-1547). En juillet 1604, Sigismond envoya des lettres aux sénateurs, dans lesquelles il les informait que l'empereur Rodolphe II n'avait pas donné son consentement pour son mariage avec Anne de Tyrol (1585-1618), et informait en même temps les seigneurs de la République de son intention d'épouser Constance (d'après « Najsłynniejsze miłości królów polskich » de Jerzy Besala, p. 169). Cette même année, Joseph Heintz (ou Heinz) l'Ancien, peintre de la cour de l'empereur, qui vécut et travailla à Rome, Venise, Prague et Augsbourg (à partir de 1604), réalise deux portraits de la mariée avec son singe préféré. L'une, moins favorable, se trouvait probablement à l'origine dans le château de sa famille à Graz (Kunsthistorisches Museum Vienna, numéro d'inventaire 9452), l'autre en robe verte, couleur symbolique de la fertilité, a été vendue à Londres en 1969 puis acquise par The Sterling and Francine Clark Art Institute à Williamstown (numéro d'inventaire 1982.127). De nombreux objets de la collection du roi Jean II Casimir Vasa, fils de Constance, vendus à Paris, ont trouvé leur place en Angleterre, dont très probablement ce portrait de sa mère. À cette époque, Heintz a également créé une copie du portrait de la reine Bona Sforza (1494-1557), la grand-mère de Sigismond III, en Salomé par Lucas Cranach l'Ancien (Kunsthistorisches Museum de Vienne, 862), identifié par moi, et un portrait de Sigismond III lui-même (Alte Pinakothek à Munich, 11885), signé : J. Heintzen F. / SIGISMVNDVS .../REX POLONIAE/ & SVECIAE ... sur une lettre sur la table. Le portrait du roi se trouvait avant 1929 au château de Schleissheim près de Munich, il s'agissait donc très probablement d'un cadeau de Sigismond à Guillaume V (1548-1626), duc de Bavière, comme le reliquaire en argent des saints Jean-Baptiste et Denys l'Aréopagite, créé en 1602 pour le tsar Boris Godounov et son fils et donnée à Guillaume V en 1614 par le roi de Pologne (Trésor de la Résidence de Munich, 63). Le portrait montre le roi avec une couronne, qui a très probablement été créée à cette époque, peut-être pour le couronnement de la nouvelle reine. Comme le portrait, elle a été réalisé soit à Prague, soit à Augsbourg, la présence de Heintz en Pologne-Lituanie n'étant pas confirmée dans les sources. Cependant, il ne peut être exclu que le peintre ou l'un de ses élèves se soit rendu à Cracovie, Varsovie ou Vilnius à cette époque pour apporter en Pologne le portrait de la mariée et de la couronne. À peine deux ans plus tôt, en 1602, la couronne de l'empereur Rodolphe II, une œuvre majeure de l'orfèvrerie européenne, a été réalisée à Prague par Jan Vermeyen de Bruxelles (décédé en 1606), en tant que couronne privée de l'empereur. La couronne de Sigismond ressemble légèrement à la couronne de Rodolphe II (vue de côté), elle a donc très probablement été créée par le même auteur, néanmoins, elle est à bien des égards atypique des monarques polono-lituaniens et européens en général. Contrairement à la couronne vue dans les portraits de la reine Anna d'Autriche (1573-1598) par Martin Kober (1595), un seul arc est visible au lieu de deux et le globe et une croix à leur intersection sont remplacés par une perle ou un diamant pointu de forme évoquant une pyramide, dit diamatus punctatus. Rodolphe II a été représenté avec sa nouvelle couronne dans certaines effigies (portrait de Hans von Aachen à Apsley House, WM.1509-1948 et gravure dans la Collection graphique d'état à Munich, 241589D), ainsi que son successeur Matthias (gravure d'Aegidius Sadeler au Rijksmuseum Amsterdam, RP-P-OB-5021) dans lesquelles quelques différences avec l'original sont visibles, cependant, malgré le fait qu'aucune autre image de la couronne de Sigismond n'est connue, nous ne pouvons pas l'attribuer à la fantaisie d'un peintre. De plus, la forme générale de la couronne décrite est inhabituelle et ressemble davantage aux couronnes visibles dans les miniatures persanes et indiennes. Des diadèmes similaires avec des pétales courbés peuvent être trouvés dans la scène d'investiture de Malik Chah Ier, sultan du grand empire seldjoukide, du livre du XIVe siècle « Jami 'al-tawarikh » (Bibliothèque de l'Université d'Édimbourg), une feuille illustrée d'un manuscrit de « Khamsé » de Nizami : Bahram Gour diverti dans le pavillon rouge, créé à Ispahan, Perse au milieu du XVIIe siècle (collection privée) ou une miniature peinte entre 1610-1618 par Bichitr, un peintre indien de la période moghole, et montrant Moinuddin Chishti, un prédicateur persan tenant un globe (Bibliothèque Chester Beatty à Dublin). La couronne de style oriental visible sur le portrait du roi, en tant que possession privée de la maison de Vasa, a très probablement été fondue sous le règne turbulent de son fils Jean II Casimir Vasa, fondue et réutilisée par Sigismond lui-même qui était un orfèvre de talent ou offert comme cadeau à quelqu'un avant 1623, car il n'était pas mentionné dans le le testament du roi du 5 mai. Le 11 mai 1606, les cadeaux du roi ont été présentés à la tsarine Marina Mniszech à Moscou - 30 vaisselles très précieux, tandis que l'envoyé du roi Mikołaj Oleśnicki (1558-1629), châtelain de Małogoszcz a offert de nombreux bijoux « de lui-même et de sa Femme », dont « une couronne avec perles, diamants et rubis » (d'après « Dzieje panowania Zygmunta III, króla polskiego » de Julian Ursyn Niemcewicz, tome 2, 1819, p. 569). La couronne visible sur le portrait de Heintz était également sertie de perles, de diamants et de rubis. Il est donc fort possible qu'Oleśnicki et sa femme aient acheté la couronne orientale de Sigismund comme cadeau pour Marina. Un autre insigne « oriental » qui est entré dans la collection de Sigismond III Vasa à cette époque était la soi-disant couronne de Moscovie. Cette couronne aurait été envoyée au roi par Faux Dmitri après son couronnement comme tsar de Russie en 1605 ou elle aurait été faite en Pologne vers 1610, après l'élection du prince Ladislas Sigismond (plus tard Ladislas IV), fils de Sigismond III, comme tsar (d'après « Klejnoty w Polsce: czasy ostatnich Jagiellonów i Wazów » de Ewa Letkiewicz, p. 139). Ladislas a légué la couronne au Trésor de l'État de la République polono-lituanienne, mais après la mort du roi en 1648, son frère et successeur Jean II Casimir a ordonné que l'insigne soit fondu en pièces de monnaie. L'un des joyaux de la couronne d'origine est devenu la propriété de Jan Kazimierz Krasiński (1607-1669), grand trésorier de la Couronne. Au XIXe siècle, il a été donné au tsar Nicolas Ier de Russie avec un morceau de parchemin portant l'inscription en latin EX CORONA MOSCOVIAE et a trouvé sa place dans les collections de l'armurerie du Kremlin à Moscou (numéro d'inventaire ДК-752). Le bijou est une icône-camée en saphir double face avec le Christ intronisé et la croix du Golgotha, attribuée à un artiste byzantin du XVe siècle. Sigismond III a été représenté avec la « couronne prise à Moscou » sur la tête (d'après « Dzieje panowania Zygmunta III, króla polskiego » de Julian Ursyn Niemcewicz, tome 2, 1819, p. 557) dans un tableau attribué à Christian Melich (Château royal de Wawel). Le tableau représente le roi sur son lit de mort exposé dans la salle des gardes du château royal de Varsovie en 1632. Elle a également été représentée dans un portrait du successeur de Sigismond Ladislas IV Vasa, attribué à Pieter Soutman et peint vers 1634, donc créé à Haarlem où le peintre revint en 1628. Le roi était représenté dans un pourpoint richement orné de dentelles et d'une haute couronne surmontée d'une croix sur une table à côté de lui (Musée national de Varsovie, 186555). Bien que Ladislas n'ait pas été couronné, il a été officiellement élu et reconnu comme le tsar de Moscovie en 1610 et a utilisé le titre de grand-duc de Moscovie jusqu'en 1634. La couronne a été mentionnée dans le testament de Sigismond III fait le 5 mai 1623 à Varsovie dans le cadre de l'héritage de son successeur. Le testament comprenait également « un bassin en or avec une aiguière aux armes de la Moscovie, acheté aux soldats » laissé à l'épouse du roi Constance d'Autriche. Le nombre d'œuvres d'art et de portraits de style ouest-européen liés au tsar Faux Dimitri I suggère qu'il a également acheté et commandé directement de tels articles. Sa belle armure créée entre 1605 et 1606 à Milan par Pompeo della Cesa se trouve au Musée d'histoire militaire de Saint-Pétersbourg et une montre de poche en argent avec un aigle, appartenant peut-être à Dimitri, fabriquée par un atelier allemand ou polonais se trouve au Kremlin de Moscou. Début janvier 1606 arriva à Cracovie Jan Buczynski, secrétaire du tsar, avec la mission d'acquérir des bijoux pour son mécène. Plusieurs marchands de Cracovie et de Lviv, ainsi que les bijoutiers Mikołaj Siedmiradzki et Giovanni Ambrogio Cellari de Milan, encouragés par la perspective d'un gain important, se sont lancés dans un voyage à Moscou. C'est probablement l'un d'eux qui a créé le sceptre (Kremlin de Moscou, R-18) et l'orbe (R-15), plus tard propriété du tsar Michel Ier (1596-1645). Le style de l'orbe ressemble à la couronne mentionnée de Sigismond III représentée dans un portrait de sa première épouse Anna par Martin Kober. En 1606, Philip II Holbein « un serviteur de la cour et agent à Augsbourg » de Sigismond III, qui, en tant que S.R.M. jubilerus était présent à Cracovie en 1605, a livré un nombre considérable d'objets de valeur à la cour de Faux Dimitri I (d'après « Philip II Holbein - złotnik i agent artystyczny Zygmunta III ... » de Jacek Żukowski, p. 23). Holbein a également travaillé pour l'empereur Rodolphe II, puis - l'empereur Matthias. Il est possible que les émissaires de Dimitri soient également arrivés à Augsbourg et à Hambourg en Allemagne. Un dessin de l'Album Amicorum d'un marchand et banquier d'Augsbourg Philipp Hainhofer (1578-1647), qui a créé le célèbre cabinet de curiosité ou d'art de Poméranie (Pommerscher Kunstschrank) pour le duc Philippe II de Poméranie, est une copie d'un tableau de Szymon Boguszowicz représentant la réception des envoyés polonais par le tsar Faux Dimitri I en 1606 (Bibliothèque Herzog August et Musée national hongrois). Parmi les dessins pour les couronnes de l'orfèvre hambourgeois Jakob Mores (Mörs) l'Ancien, né vers 1540 et vivant jusqu'en 1612 environ (d'après « Archiv Fur Geschichte Des Buchwesens », Volume 65, p. 158) dans son « Livre de bijoux » (Kleinodienbuch, Bibliothèque d'État et universitaire de Hambourg) il y a deux couronnes qui ressemblent à la couronne représentée dans le portrait mentionné de Ladislas IV par Pieter Soutman, ainsi que les couronnes visibles dans Le couronnement de Marina Mniszech à Moscou le 8 mai 1606 par Szymon Boguszowicz ou suiveur, créé vers 1613 (Musée historique d'État de Moscou). On pense généralement qu'il s'agit de dessins pour la couronne de Rodolphe II, mais la forme générale ressemble davantage aux couronnes généralement associées à la Russie (par exemple, la grande couronne impériale de 1762) - la « mitre » est plus ouverte que dans la couronne de Rodolphe et il y a un globe et une croix (globus cruciger) à l'intersection des arcs et non une grosse pierre comme dans la couronne créée par Vermeyen. Quelques années plus tôt, entre 1593 et 1595, Mores a créé deux dessins pour la couronne ouverte du roi Christian IV de Danemark-Norvège, qui ont également été inclus dans son « Livre de bijoux ». Ce sont cependant Dirich Fyring et Corvinianus Saur qui, entre 1595 et 1596, ont réalisé la couronne pour le couronnement de Christian IV (Château de Rosenborg), néanmoins les dessins de Mores ressemblent à la forme de la couronne finale. Certains bijoux en Pologne sont également attribués à Mores ou à son entourage, comme les décorations de chapeaux de François de Poméranie (1577-1620), créées vers 1600 (Musée national de Szczecin) ou une chaîne de Constance d'Autriche des années 1600 (Château royal de Wawel, ZKnW-PZS 1323), tandis que l'aigle impérial à deux têtes de la robe de diamant de la Vierge noire de Częstochowa, également créé à cette époque, peut avoir été créé par l'un des orfèvres de la cour nommés pour Constance d'Autriche ou Marina Mniszech. La forme de l'insigne impérial mentionné avec une couronne plus petite au sommet est également similaire au bonnet du grand ensemble du tsar Michel Ier, créé par les ateliers du Kremlin de Moscou en 1627. Il est également possible que la plus petite couronne du « Livre de bijoux » ne soit pas une variante, mais l'insigne destiné au couronnement de Marina Mniszech.
Portrait de Sigismond III Vasa avec la couronne « orientale » par Joseph Heintz l'Ancien, vers 1604, Alte Pinakothek à Munich.
Visualisation de la couronne « orientale » de Sigismond III Vasa par Jan Vermeyen (attribué), vers 1604, © Marcin Latka.
Portrait de Ladislas IV Vasa avec la soi-disant couronne « moscovite » par Pieter Soutman, vers 1634, Musée national de Varsovie.
Dessin de conception pour la soi-disant couronne « moscovite » par Jakob Mores l'Ancien, vers 1605-1610, Bibliothèque d'État et universitaire de Hambourg.
Dessin de conception pour la soi-disant couronne « moscovite » ou la couronne de Marina Mniszech par Jakob Mores l'Ancien, vers 1605-1610, Bibliothèque d'État et universitaire de Hambourg.
Bustes en bronze de Sigismond Vasa et Constance d'Autriche
Bien que l'existence des bustes royaux soit purement hypothétique et non confirmée par les sources, la mode de ces sculptures antiques, issues de l'Italie et de la cour impériale de Prague et de Vienne, a sans doute trouvé son reflet dans la cour cosmopolite des Vasa à Cracovie et à Varsovie. Cartouche en bronze avec armoiries de la République polono-lituanienne du château de Wawel, une fonte en bronze qui a été préservée jusqu'à nos jours et commandée par Sigismond III vers 1604 pour orner la porte dans l'aile nord du château menant à l'Escalier des sénateurs, confirme que les résidences des Vasa polonais étaient remplies de tels objets.
En 1624, l'évêque de Cracovie, Marcin Szyszkowski, qui s'est intitulé « le plus fidèle serviteur de la maison d'Autriche » et qui, avec Zygmunt Myszkowski, a amené la reine Constance de Graz en Pologne, a parrainé une nouveau dôme architectural au-dessus du reliquaire de saint Stanislas dans la cathédrale du Wawel dans le style du baroque romain. C'est l'œuvre de l'architecte royal Giovanni Battista Trevano, le même qui a reconstruit le château royal de Varsovie, en marbre noir et rose, en bronze doré et en bois, créé dans les années 1626-1629. Les figures en bronze doré des évangélistes et des saints patrons de Pologne, flanquant la coupole au-dessus du baldaquin, ont été fondues par Antonio Lagostini, actif à Cracovie vers 1624. L'année même de l'achèvement de ces travaux, l'évêque a également commandé un monument funéraire pour lui-même dans la cathédrale près du baldaquin. Selon la lettre de Marcin Szyszkowski à Andrzej Łukomski, chanoine du chapitre de la cathédrale de Cracovie, du 20 janvier 1629, cela a également été commandé à Trevano et Lagostini. Le modèle du buste en bronze fondu doit être attribué aux sculpteurs liés à Trevano, Andrea et Antonio Castelli, sculpteurs de Lugano, actifs à Cracovie à partir de 1623 environ. S'ils existaient, les bustes royaux étaient sans aucun doute en bronze doré, tout comme la majorité des œuvres similaires conservées dans de nombreux pays européens et le buste de l'évêque Szyszkowski. Le matériau et sa réutilisation militaire fréquente expliqueraient également pourquoi les œuvres ne se sont pas conservées, tout comme les statues en bronze du jardin de Ladislas IV au palais Villa Regia à Varsovie, qui sont confirmées dans des sources. La statue en bronze préservée du roi Sigismond III à la colonne, dite colonne de Sigismond à Varsovie, était au début également dorée. La reconstruction est basée sur des portraits royaux avec une composition espagnole des années 1610 créés par l'atelier du peintre de la cour Jakob Troschel, qui étaient dans la collection du Germanisches Nationalmuseum à Nuremberg avant la Seconde Guerre mondiale. Les deux effigies, probablement de la dot de la princesse polono-lituanienne Anne Catherine Constance Vasa, sont très schématiques et idéalisées, les traits du visage sont donc basés sur des effigies plus réalistes de la paire royale créée par d'autres peintres de la cour.
Buste en bronze doré du roi Sigismond III Vasa, années 1610 à 1631. Reconstruction hypothétique par Marcin Latka ©. Tous droits réservés.
Buste en bronze doré de la reine Constance d'Autriche, années 1610 à 1631. Reconstruction hypothétique par Marcin Latka ©. Tous droits réservés.
Voir plus de photos de Bustes en bronze de Sigismond Vasa et Constance d'Autriche sur Pinterest - Artinpl et Artinplhub
Pendentif héraldique d'Anne Catherine Constance Vasa
La princesse Anne Catherine Constance Vasa est née à Varsovie le 7 août 1619. Elle était la fille unique de Sigismond III Vasa et de sa seconde épouse Constance d'Autriche qui a survécu à l'enfance, et la plus jeune des enfants du couple royal.
Les grands pendentifs de style espagnol, comme celui décrit ici, deviennent moins à la mode avec l'introduction du style français au milieu des années 1630, qui a incité les broches frontales. La création du pendentif pourrait être ensuite clôturée entre le milieu des années 1620 et 1638, lorsque Anne Catherine Constance est devenue majeure et est entrée en possession des comtés qui lui ont été conférés par le Parlement. C'est aussi probablement en 1638 que le portrait de la princesse en robe rouge espagnole avec deux pendentifs en or a été créé (aujourd'hui au château impérial de Nuremberg). Le roi Sigismond III, lui-même un orfèvre talentueux, peut-être directement inspiré le programme emblématique compex de ce bijou, bien qu'il soit également possible qu'il ait été créé longtemps après sa mort en 1632. Depuis 1637, un mariage a été suggéré entre Anne Catherine Constance et Ferdinand Charles, Archiduc d'Autriche, héritier du Tyrol et neveu de Ferdinand II, empereur romain germanique. Frédéric-Guillaume, électeur de Brandebourg, et Gaston, duc d'Orléans (frère du roi Louis XIII de France), étaient également parmi les candidats potentiels. Un bijou mettant l'accent sur de splendides connexions dynastiques et soulignant l'immensité des territoires gouvernés par la famille s'intégrerait parfaitement dans la situation de la princesse à cette époque. Plusieurs bijoux héraldiques figuraient dans les portraits officiels de la mère d'Anne Catherine Constance, Constance d'Autriche. Le père de la princesse, Sigismond III Vasa, a été élu monarque de la République polono-lituanien, bi-fédération de Pologne et de Lituanie dirigée par un monarque commun en union réelle, qui était à la fois roi de Pologne et grand-duc de Lituanie. Depuis le couronnement de Sigismond en 1592, les Vasa polonais se sont proclamés dirigeants héréditaires légitimes de la Suède, ignorant par conséquent la déposition de Sigismond en 1598 par le parlement suédois. Anne Catherine Constance a finalement épousé Philippe-Guillaume de Neubourg (1615-1690), à Varsovie le 8 juin 1642. Elle a apporté une dot considérable en bijoux et en espèces, calculée à un total de 2 millions de thalers. L'inventaire des bijoux de princesse conservés à la bibliothèque Czartoryski de Cracovie résume leur valeur à 443 289 1/3 de thalers durs. Le pendentif héraldique est classé 18e dans la section Pendentifs: « Un pendentif en diamant avec des figures du défunt roi Sigmunt et Constantia avec des couronnes sur la tête, au milieu le grain de rubis, et sous l'Aigle blanc, au bas des armoiries du Duché de Lituanie, à droite suédoise et à gauche autrichienne; au-dessus de ce grain de rubis, un lion jaune avec la mâchoire ouverte, tiennent ensemble Zygmunt et Constantia dans ses deux crocs, sur les côtés et en bas cinq diamants ronds suspendus », évalué à 2 000 thalers. Il est difficile de déterminer le degré d'exactitude de l'inventaire à la fois en termes de description des bijoux et d'évaluation. Un «gros diamant» dans une bague était évalué à 30 000 thalers et une bague avec des «armoiries de l'Autriche» ne valait que 40 thalers. Traditionnellement, la reine était placée à droite et le roi à gauche, et pas comme dans la description du pendentif, qui trouve une confirmation dans les portraits de Sigismond et Constance, ainsi que l'emplacement des stalles royales dans la cathédrale Saint-Jean de Varsovie. L'inventaire comprend également : « Un collier de 22 pièces, dont 11 avec un diamant au milieu, 3 taillé carrée, 3 taillé triangle et serti de deux perles. 11 autres parties dont une tête de lion au centre ayant une perle dans sa gueule, quatre diamants et quatre perles sertis autour de lui. Le tout avec un pendentif serti de soixante-deux diamants, dessus une tête de lion et six perles pendantes », un cadeau de la reine à la princesse, évalué à 80 000 thalers; « Un pendentif dans lequel un Lion avec trois couronnes en forme de blason suédois avec vingt-six diamants différents et trois perles pendantes », évalué à 150 thalers et « Un pendentif dans lequel un aigle blanc avec un gros rubis sur la poitrine, trois petites pièces rubis et trois grosses perles », évalué à 700 thalers. Ainsi qu'un « Aigle blanc, portant sur sa poitrine un blason sur lequel deux rubis, tous sertis de diamants, avec trois perles pendantes », d'une valeur de 1 200 thalers, ce qui est très probablement identique à « l'aigle en diamant avec rubis » de la maison d'Autriche reçue en 1543 par Elizabeth d'Autriche (1526-1545) de l'empereur Charles Quint à l'occasion de son mariage avec Sigismond II Auguste de Pologne, et conservée dans le trésor de la résidence de Munich. Parmi les joailliers renommés à la cour des Vasa de la première moitié du XVIIe siècle, qui pouvaient créer l'œuvre, se trouvaient Mikołaj Siedmiradzki (vers 1550-1630) de Lviv dans l'Ukraine d'aujourd'hui, qui était au service de Sigismond III depuis 1604, et qui en tour à tour employé dans son atelier Mikołaj Pasternakowicz et Zygmunt Frączkiewicz. Il y avait aussi Jean Barbier de Lorraine, actif à Cracovie à partir de 1605, qui a déménagé à Gdańsk en 1625 et Beniamin Lanier (mort en 1630) de Vitry-le-François dans le nord-est de la France, qui était actif à Cracovie à partir de 1606, tous deux bijoutiers de la cour de Sigismond III. Jakub Burnett d'Edimbourg qui s'est installé à Lviv dans la première moitié du XVIIème siècle a été employé par Ladislas IV. Des membres de la famille ont également commandé des bijoux à l'étranger, comme le prince Jean Casimir Vasa qui, en 1643, a payé 9 000 florins pour des bijoux à Samuel von Sorgen de Vienne et 189 florins « Pour le cœur de diamant à M. Jakub bijoutier ». Anne Catherine Constance est morte sans enfant à Cologne le 8 octobre 1651 et a été enterrée dans l'église des Jésuites de Düsseldorf. C'est en raison du caractère purement héraldique du bijou, de la valeur élevée du matériau et de la nouvelle mode pour des bijoux plus simples que le pendentif a très probablement été fondu, peut-être encore au XVIIème siècle.
Extrait de l'inventaire des bijoux de Son Altesse la duchesse de Neubourg, princesse de Pologne (Spisanie Kleynotów Xiężney Iey Mości Neyburskiey, Królewney Polskiey) par la chancellerie royale de Varsovie, 1645, Bibliothèque Czartoryski de Cracovie. Fragment décrivant le pendentif héraldique d'Anne Catherine Constance Vasa.
Pendentif héraldique d'Anne Catherine Constance Vasa, milieu des années 1620 à 1638. Reconstruction hypothétique par Marcin Latka ©. Tous droits réservés.
Voir plus de photos de Joyaux des Vasa polonais sur Pinterest - Artinpl et Artinplhub
Tapisseries avec l'histoire d'Ulysse
Lors de son séjour à Anvers en 1624, le prince héritier de la République polono-lituanienne, Ladislas Sigismond Vasa, a visité l'atelier de Pierre Paul Rubens, admiré les peintures de Jean Brueghel l'Ancien dit de Velours et visité la célèbre collection d'art de Cornelis van der Geest. Il est également allé voir le tapissierspand (magazin des tapissiers), sur le site de l'actuel théâtre Bourla, le 24 septembre 1624. Nous avons visité une maison, écrit Stefan Pac, dans son journal où on vend de belles et précieuses tapisseries qu'on envoie dans le monde entier. Quelques jours plus tard, le 5 octobre 1624, Gaspard Nagodt, trésorier du prince de Pologne, signa un contrat avec un tisserand bruxellois Jacques Geubels le Jeune pour la livraison de dix tapisseries représentant l'histoire d'Ulysse de six aunes de hauteur chacune (l'aune flamande équivalant à environ 70 cm), entrelacé de fil d'or et d'argent. L'ensemble complet comprenait 594 aunes et coûtait 19008 florins. Le 12 octobre 1624, un autre contrat est signé pour une série intitulée « aux verdures » c'est-à-dire tapisseries du type de verdure ou « Paysages et Bocages en fresque », pour 9207 florins.
Un marchand anversois, Jean Bierens, « agent et domesticque de son Alteze le Sérénissime Prince Wladislaus Sigismundus, Prince de Poloigne et de Suède », supervisa le tissage des tapisseries de l'Histoire d'Ulysse et des verdures que Geubels le Jeune fit à Bruxelles. Un procès intenté par Geubels contre Jean Bierens, en décembre 1626 pour paiement, confirme qu'au moins une partie des tapisseries commandées était prête à cette date. Des notations dans les archives révèlent l'existence d'agents du prince, tels que mentionné Jean Bierens, Georges Deschamps ou le Français Mathieu Rouault. Ils devaient satisfaire les créanciers de Ladislas Sigismond et s'assurer que tout était exécuté et envoyé en Pologne. Probablement en raison des difficultés financières du prince, l'ensemble n'a pas été exécuté avant la mort de Geubels en 1629 et la commande a été accomplie par un atelier inconnu. On ne sait pas quand l'Histoire d'Ulysse et les verdures ont été expédiées d'Anvers et quand elles sont arrivées en Pologne. Ladislas Sigismond, le monarque nouvellement élu de la République sous le nom de Ladislas IV, voulait les avoir avant son couronnement le 6 février 1633 à Cracovie. Par acte notarié du 12 janvier 1632, nous apprenons que Jean Bierens avait reçu trois coffres contenant environ deux cent cinquante-trois marcs d'argenterie des mains de Francesco Gissa et Joannes Curius, un majordome et l'autre secrétaire de l'abbé Mikołaj Wojciech Gniewosz (décédé en 1654), ambassadeur de la République. Le marchand anversois leur avait donné deux mille trois cent dix rixdales en gage et avait promis d'envoyer la précieuse livraison à Gdańsk à l'adresse d'Abraham Pels. Dans la lettre du 15 septembre 1632, Ladislas IV demanda à Christian IV du Danemark de libérer ses tapisseries de la douane (Rkps Riqsarkivet, Polen A. I, 3). Selon François Mols, un certain nombre de cartons de tapisseries par Jacques Jordaens avec la date 1620 ont été vendues à Anvers en 1774. On pense que ces tapisseries ont été inspirées par des fresques perdues du Primatice sur le même sujet à Fontainebleau. Un document du 15 mai 1656 dans les archives d'Anvers dans lequel Jacques Geubels, fils de Jacques Geubels le Jeune, s'était engagé à tisser des tapisseries représentant l'Histoire d'Ulysse d'après des cartons de Jordaens, confirme que la série était faites sur des dessins de ce peintre. Des tapisseries somptueuses « accrochées à un style étranger » parmi les « arts dorés des Pays-Bas » sont mentionnées dans la « Brève description de Varsovie » d'Adam Jarzębski (La route principale, ou une brève description de Varsovie) de 1643 comme ornant du palais Villa Regia de Ladislas IV à Varsovie (1950-1956). La série a été héritée par le frère de Ladislas, Jean II Casimir, qui les a emmenés en France après son abdication en 1668 et a été vendue aux enchères à Paris en 1673 à l'agent de Charles I Louis, électeur palatin pour 12000 livres (position 728 de l'inventaire).
Tapisserie avec Ulysse menaçant Circé par l'atelier de Jacques Geubels II après carton de Jacques Jordaens, 1624-1632, avec les armoiries du prince héritier de la République polono-lituanienne, Ladislas Sigismond Vasa, la marque de la ville de Bruxelles B B, monogramme de tisserand et signature IACO GEVBELS. Reconstruction hypothétique par Marcin Latka ©. Tous droits réservés.
Voir plus de photos du Palais Villa Regia à Varsovie sur Pinterest - Artinpl et Artinplhub
Au début du mois de janvier 1606, Jan Buczynski, secrétaire de Faux Dimitri, tsar de Russie, arriva à Cracovie avec pour mission d'acquérir des bijoux pour son patron. Plusieurs marchands de Cracovie et de Lviv, ainsi que les bijoutiers Mikołaj Siedmiradzki et Giovanni Ambrogio Cellari de Milan, encouragés par la perspective d'un gain important, ont entrepris un voyage lointain à Moscou.
La princesse Anne Vasa (1568-1625), qui possédait une collection de bijoux d'une valeur estimée à 200 000 thalers, a également décidé d'en vendre une partie secrètement au tsar. Stanisław Niemojewski (vers 1560-1620) des armoiries de Rola, intendant (Podstoli) de la Couronne, a été chargé de livrer des bijoux d'une valeur de 70 000 zlotys « enveloppés dans la soie colorée » dans un coffret en fer « peint en vert ». Faux Dimitri a été tué le 17 mai 1606 et ce n'était pas avant 1609 lorsque la collection a été restituée par le nouveau tsar Vassili Ivanovitch Chouiski. Parmi les joyaux rendus figurait « un aigle à deux têtes de diamant avec des rubis », provenant probablement de la collection de la princesse ou mis en gage avec Niemojewski du Trésor de la République avant 1599. Tels joyaux héraldiques, qu’ils soient impériaux ou autrichiens ou polonais, étaient sans aucun doute en possession de différentes reines et princesses de Pologne depuis au moins 1543, année où Elizabeth d’Autriche (1526-1545) reçut de l'empereur Charles Quint un « aigle en diamant avec des rubis » à l'occasion de son mariage avec Sigismond II Auguste, roi de Pologne. Inventaire des bijoux de la princesse polonaise Anne Catherine Constance Vasa, fille de Sigismond III et de Constance d'Autriche, mentionne quatre pendentifs et deux paires de boucles d'oreilles avec des aigles, sûrement trois impérial-autrichiens et deux polonais, comme « un pendentif avec un aigle émaillé blanc, à laquelle sept diamants, trois perles rondes et une grande pendaison », d'une valeur de 120 thalers et « un aigle en diamant avec un diamant taillé net au centre, plus de diamants autour et trois perles pendantes ». Anne Vasa, en demi-princesse de Pologne, fille de Catherine Jagiellon et soeur du roi Sigismond III, avait le droit d'utiliser cet emblème. Après la défaite de Sigismond à la bataille de Stångebro en 1598, elle quitta la Suède pour vivre avec lui en Pologne où elle passa le reste de sa vie. Le portrait en miniature d'une femme avec un pendentif à l'aigle de la collection Harrach à Vienne (palais Harrach dans la rue Freyung), précédemment identifié comme une effigie d'Anne d'Autriche (1573-1598), première épouse du roi Sigismond III, s'appuyant sur une forte ressemblance avec le portrait de Catherine Jagiellon, s'il est liée à la Pologne, devrait plutôt être identifiée comme un portrait de la soeur du roi Anne Vasa, et non comme son épouse. L’absence de lèvre inférieure saillante dite « lippe habsbourgeoise », connue des portraits préservés d’Anne d’Autriche et du costume du modèle, selon la mode du Nord et non espagnole de la cour impériale, confirme cette hypothèse. L'aigle était un symbole du pouvoir impérial suprême, de la magnanimité, de l'Ascension au ciel et de la régénération par le baptême et était utilisé dans les bijoux partout en Europe à cette époque. Si le pendentif est un symbole héraldique, le portrait devrait être daté d’environ 1592, alors que Sigismond était sur le point d’abandonner le trône polonais au profit d’Ernest d’Autriche, qui allait épouser la princesse Anne Vasa (cela expliquerait également comment la miniature a trouvé son chemin en Autriche) ou à 1598, alors que la princesse devait se légitimer dans son nouveau pays.
Aigle à deux têtes en diamants de la Maison d'Autriche par anonyme de Milan ou Vienne, milieu du XVIe siècle, Trésor de la Résidence de Munich. Très probablement de la dot de la princesse Anne Catherine Constance Vasa.
Détail du portrait d'Anne d'Autriche (1573-1598) par Martin Kober, 1595, Collections de peintures de I'Êtat de Bavière.
Miniature de la princesse Catherine Jagellon (1526-1583) par l'atelier de Lucas Cranach le Jeune, vers 1553, Musée Czartoryski.
Miniature d'une femme avec un pendentif à l'aigle, probablement la princesse Anna Vasa (1568-1625) par anonyme, années 1590, collection Harrach au château de Rohrau (?). Identification par Marcin Latka.
Voir l'œuvre dans les Trésors polono-lituaniens.
Quand en 1598 mourut la reine Anne d’Autriche, la première épouse de Sigismond III Vasa, une jeune chambellan de la cour de la reine et gouvernante des enfants du roi, Urszula Meyerin, occupa son poste non seulement dans le lit du roi, mais aussi à la cour et dans la politique du pays. Cette période de sept ans entre le premier et le deuxième mariage du roi, marquée par le rôle croissant de sa maîtresse et « la ministre en jupe » comme on l'appelait, se reflète très probablement dans le reliquaire de sainte Ursule de musée diocésain de Płock.
Avant 1601, le roi Sigismond III ordonna à un orfèvre de Płock, Stanisław Zemelka, de décorer un buste reliquaire de son saint patron, saint Sigismond, dans la cathédrale de Płock, avec une couronne en or provenant de son trésor. Vers la même année, l'allié et protégé du roi, Wojciech Baranowski, évêque de Płock, commanda à l'atelier de l'orfèvre royal un buste en argent pour des reliques de sainte Ursule de la cathédrale de Płock, qui devait être transféré au nouveau collège jésuite établi à Pułtusk. Urszula Meyerin, une partisane des jésuites qui correspondait avec le pape et utilisait son influence sur le roi pour nommer ses favoris aux postes d’État, méritait l’honneur de donner son effigie à la vierge martyre Ursule, ce qui serait une autre raison de la gratitude du roi envers Baranowski. Il est également possible que le roi, lui-même un orfèvre talentueux, ait participé à l'exécution de cette commande, d'où l'absence de signature sur l'œuvre.
Reliquaire en argent de saint Sigismond avec diadème de Płock en or par anonyme de Cracovie (reliquaire) et anonyme de Hongrie ou d'Allemagne (diadème), deuxième quart du XIIIe siècle et 1370, musée diocésain de Płock.
Reliquaire en argent de sainte Ursule en forme de buste par Stanisław Ditrich, vers 1600, musée diocésain de Płock.
En 1637, lorsque le roi Ladislas IV Vasa, âgé de 42 ans, décida de se marier finalement, la situation à la cour de sa maîtresse, Jadwiga Łuszkowska, devint difficile. C’est probablement grâce aux efforts de la fille impériale, Cécile-Renée d'Autriche, épouse du roi que Jadwiga a épousé Jan Wypyski, le starost de Merkinė en Lituanie, et a quitté le cour de Varsovie.
Portrait du prince Sigismond Casimir Vasa avec un page (probablement le fils illégitime de Łuszkowska et Ladislas IV - Ladislas Constantine Vasa, futur comte de Wasenau) par cercle de Peter Danckerts de Rij, vers 1647, Galerie nationale de Prague.
Vers 1659, lorsque la grande guerre, connue en Pologne sous le nom de Déluge, se terminait, il devint évident pour tout le monde à la cour de Varsovie que la reine Marie Louise de Gonzague, âgée de 48 ans, ne donnerait pas naissance à un enfant, et tout pensaient à un héritier possible du trône. Une reine puissante donna naissance à un fils en 1652, mais l'enfant mourut au bout d'un mois. Le vieux roi Jean Casimir Vasa, ancien cardinal, qui s'est trouvant inadapté à la vie ecclésiastique, s'est présenté aux élections pour le trône polonais après le décès de son frère et a épousé sa belle-soeur, a toutefois eu au moins un enfant illégitime, une fille Marie Catherine et peut-être un fils.
La peinture offerte par la reine Marie Louise à l'église de la Sainte-Croix de Varsovie en 1667 et créée par l'artiste de la cour vers 1659 représente le fils aîné de la maîtresse du roi Katarzyna Franciszka (Catherine Françoise) Denhoffowa. Jean Casimir Denhoff, âgée de 10 ans, comme le jeune Jésus, tenu par la reine Marie Louise, représentée en la Vierge Marie, offre une bague à sa mère en costume de sainte Catherine. Katarzyna Franciszka Denhoffowa, née von Bessen (ou von Bees) d’Olesno en Silésie et sa soeur cadette Anna Zuzanna, filles d’honneur de la reine Cécile-Renée, sont restées à la cour après sa mort. Denhoffowa est devenue la servante de confiance d'une nouvelle reine et de son second mari, Jean Casimir. En 1648, elle épouse un courtisan de Jean Casimir, Teodor Denhoff, et un an plus tard, le 6 juin 1649, elle donne naissance à Jean Casimir Denhoff, futur cardinal. Les parrains du jeune Denhoff n'étaient autre que le roi et la reine elle-même. En 1666, à l'âge de 17 ans, il fut fait abbé de l'abbaye de Mogiła et étudia le droit canonique à Paris entre 1670 et 1674 sous la protection de Jean Casimir Vasa.
Mariage mystique de sainte Catherine, peut-être par Jan Tricius, vers 1659, Musée national de Varsovie.
Portrait du roi Jean II Casimir Vasa par Daniel Schultz, 1659, Musée de Bains Royaux à Varsovie.
Portrait du cardinal Jean Casimir Denhoff par cercle de Giovanni Maria Morandi, après 1687, collection particulière.
Voir plus de photos de Vasa polonais sur Pinterest - Artinpl et Artinplhub
Deux lions en marbre à l'entrée principale du château de Drottningholm en Suède, cité par certains auteurs comme trophée de guerre de forces suédoises du château de Frederiksborg au Danemark, pourraient sans doute être identifiés avec quatre lions en marbre décrits par Adam Jarzębski dans sa « Brève description de Varsovie » de 1643, comme ornant l'entrée du château d'Ujazdów à Varsovie - I lwy cztery generalne, Między nimi, naturalne, Właśnie żywe wyrobione, A z marmuru są zrobione; Nie odlewane to rzeczy, Mistrzowską robotą grzeczy (2273-2278).
Dans les années 1630, avant son mariage avec Cécile Renée d'Autriche, Ladislas IV Vasa, fit plusieurs commandes de sculptures à Florence, dont peut-être des lions pour son palais d'Ujazdów. Le matériau, le marbre italien, et une forme similaire aux lions des Médicis, rendent cette hypothèse plus probable. Les écus écartelés de lions aux armoiries effacées, suggèrent également un aigle et un chevalier de Pologne-Lituanie, plutôt que des emblèmes plus complexes de Christian IV de Danemark.
Lion en marbre du château d'Ujazdów par anonyme d'Italie, années 1630, château de Drottningholm. Photo: Nationalmuseum (CC BY-SA).
Lion en marbre du château d'Ujazdów par anonyme d'Italie, années 1630, château de Drottningholm. Photo: Nationalmuseum (CC BY-SA).
|
Artinpl est un projet éducatif individuel pour partager des connaissances sur les œuvres d'art aujourd'hui et dans le passé en Pologne.
Si vous aimez ce projet, veuillez le soutenir avec n'importe quel montant afin qu'il puisse se développer. © Marcin Latka Catégories
All
Archives
April 2023
|